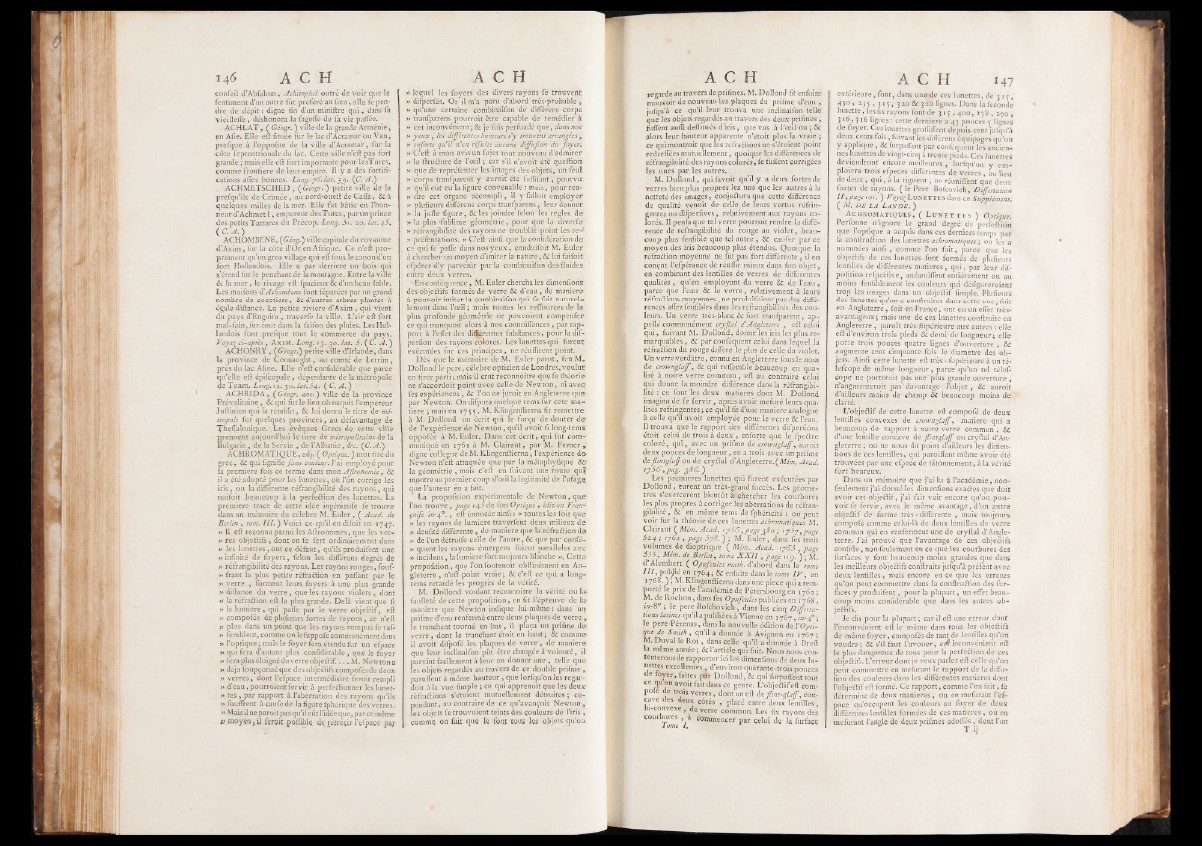
4
w.
14« A C H
c o n f e i l d’Abfalom, Achitüphel' outré de voir que ïe
fentiment d’un autre fut préféré au lien, alla fe pendre
de dépit : digne fin d’un miniftre q u i, dans fa
vieillefle , déshonora la fa g e ffe de fa vie paffée.
ACHLAT , ( Géogr. ) ville de la grande Arménie >
en A l ie . Elle eft lituée fu r le lac d’Acramarou V an,
prefque à l’oppolite de la ville d’Acramar, fur la
côte feptentrionaie du lac. Cette ville n’eft pas fort
grande ; hiais elle éft fort importante pour lësTùrcs,
c om m e frontière de leur empire^ Il y a dés fortifications
a l le z bonnes. Long.yG. lat. 39. ( Ç .A .)
: A C H M E T S C H E B , (Géogr. ) petite ville de la
prefqu’île de Crimée, au nord-oued: de Caffa, 8c à
quelques milles de la mer. E l le fu t bâtie' en l’honneur
d’Achmet I , empereur desTurfcs, p a r u n prince
des petits Tartares du Précop. Long. St. z0.lat.4S,
G - A - ) ; M W
ACHOMBENE, (Géog.) ville capitale du royaume
d’Axim, fur la côte d’Or en Afrique. Ce n’eft pro*
prement qu’un gros village qui eft fous le,canon d’un
fort Hollandois. Elle a par derrière un bois qui
s’étend fur le penchant de la montagne. Entre la ville
& la mer, le rivage eft fpacieux & d’un beau fable.
Les maifons d’Ackombene font féparées par un grand
nombre de cocotiers, & d’autres arbres plantés à
égale diftance. La petite riviere d’Axim , qui vient
du pays d’Enguira , traverfe la ville. L’air eft fort
mal-fain, fur-tout dans la faifon des pluies. LesHol-
landois font prefqiie tout le commerce du pays,
Voyt{ ci-après, AxiM. Long. *3.30. lat. S. (C . A . )
ACH ONRY , (Géogr.) petite ville d’Irlande, dans
la province de Connaught, au comté de Letrim,
p,rès du lac Aline. Elle n’eft confidérable que parce
qu’elle eft épîfcopale, dépendante de la m é t r o p o le
de Tuam. Long. tz. 30. lat. 04. (C . A . )
. ACHRÏDA -, (Géogr. ont.) ville de la province
Prévalitaine, & q u i ftit le lieuoù.naquit l’empereur
Juftinien qui la rétablit, & lui donna le titre de métropole
fur quelques provinces, au défavantage de
Theflalonique.. Les évêques Grecs de cette ville
prennent aujourd’hui le titre de métropolitains de la
Bulgarie, de la Servie , de l’Albanie, -&c. (C.A .)
ACHROMATIQUE, adj. ( Optique. ) mot tiré du
grec , 8c qui lignifie fans couleur. J’ai employé pour
I3 première fois ce terme dans mon Afbronomie, 8C
il a été adopté pour les lunettes, où l’on corrige les
ir is , ou la différente réfrangibilité des rayons, qui
nuifoit .beaucoup à la perfection des limettes. La
première trace de cette idée ingénieufe fe trouve
dans un mémoire du célébré M. Euler, ( Acad, de
Berlin , tom. III. ) Voici ce qu’il en difoit en 1747.
« I l eft reconnu parmi les Aftronomes, que les ver-
» res objectifs, dont on fe fert ordinairement dans
» les lunettes, ont ce défaut, qu’ils produifent une
» infinité de foy ers, félon les différens degrés de
» réfrangibilité des rayons. Les rayons rouges, fouf-
» frant la plus petite refraétion en paffant par le
». verre , forment leurs foyers à une plus grande
» diftance du verre, que les rayons violets , dont
« la réfraction eft la plus grande. Delà vient que fi
» la lumière, qui p a ffe par le verre o b j e c t i f , eft
» compofée de plufieurs fortes de rayons, ce n’eft
» plus dans un point que les rayons rompus fe raf-
>> iemblent, comme on lefuppofe communément dans
» l’optique; mais le foyer fera étendu fur un efpace
» qui fera d’autant plus confidérable, que le foyer
» fera plus éloigné du verre o b j e c t i f . . . . M. N e w t o n a
» déjà foupçonnéque des objectifs compofésde deux
» verres, dont l’efpace intermédiaire feroit rempli
». d’eau, pourroient fervir à perfectionner les lunet-
» te s , par rapport à l’aberration des rayons qu’ils
» fo u ffr e n t à caufe de la figure fphérique des verres.
» Mais il ne paroît pas qu’il eût l’idée que, parce même
t> m o y e n , i l f e r o i t p o | f ib lç dé. r é t r é c ir l ’ç fp a c e p a r
A C H
» lequel les foyers des divers' rayons fe trouvent
» difperfés. Or il m’a paru d’abord très-probable,
» qu ’une certaine combinaifon de différens corps
» tranfparens pourroit être capable de remédier à
» cet inconvénient ; 8c je fuis perfuadé que, dans nos-
>» y eu x,; les différentes humeurs s’y trouvent arrangées ,
» enforte qu il n en réfulte aucune dffujion du foyer.
» C’eft à mon avis un fujet tout nouveau, d’àdmirer
» la ftruéture de l’oeil ; car s’il n’àvoit été queftion
» que de-repréfenter les images des objets, un feui
».corps tranfparerit y aufoit été fuffifant, pourvu
» qu’il eût eu la figure convenable : mais; y pour ren-
» dre cet organe accompli, il y falloit employer
» plufieurs différens corps tranfparens, leur donner
» la jufte figure, 8c les joindre félon les réglés de
» la plus ffublime géométrie, pour que la diverfe
» réfrangibilité des rayons ne troublât point les re-?
» préfèntations. » C’eft ainfi que la confidération de
ce qui fé paffe dans rios-yeux, conduifoit M. Euler
à chercher un moyen d’imiter la nature, & lui faifoit-
efpérer d’y parvenir par la combinaifon des fluides,
entre deux verres-.
- En'conféquence, M. Euler chercha les dimenfions
dès objectifs formés de verre 8c d?eau , de maniéré
à pouvoir imiter la combinaifon qui fe fait naturellement
dans l’oeil ; mais toutes les reffources de la
plus profonde géométrie ne pouvoient compenfer
ce qui manquoit alors à nos connoiffancespar rapport
à l’effet, des di^rentes fubftànces, pourladif*
perfion des ray ons colorés. Les lunettes qui furent
exécutées fur ces principes , ne réufîirent point.
Dès que le mémoire de M. Euler parut, feu M*
Dollond le pere, célébré opticien de Londres, voulut'
en tirer parti ; mais il crut rëconnôître que fa théorie-
ne s’accordoit point avec celle de Newton, ni avec?
fes expériences, 8c l’on hë'jüroit en Angleterre que-
par Newton. On difputa quelque tems fur ce te ma-*'
tiere ; mais en 175 5 , M. Klingenftierna fit remettre
à M. Dollond un écrit qui le força de douter de'
de l’expérience de Newton, qu’il avoit fi long-tems»
oppofée à M. Euler. Dans cet écrit, qui fut communiqué
en 1761 à M. Clairaut, par M. Ferner
digne dolleguè de M. Klingenftierna, l’expérience d e
Newton n’eft attaquée que par la métaphyfique 8c:
la géométrie , mais c’eft en fuivant une route quf
m.Ontre au premier coup d’oeil la légitimité de l’ufagg.
que l ’auteur en a fait.
La propofition expérimentale de Newton, que-
l’on trouve, page 14S de fon Optique, édition Frein-“
çoife in-4 ° . , eft énoncée ainfi 5 « toutes les fois que
» les rayons de lumière traverfent deux milieux de
» denfité différente, de maniéré que la réfraCHon de
» de l’un détruife celle de l’autre, 8c que par cenfé-
» qiient les rayons -émergens foient parallèles aux
» incidens, la lumière fort toujours blanche », Cette
propofition, que l’on foutenoit obftinémënt en Angleterre
, n’eft point vraie ; 8c c’eft ce qui a long-
• tems retardé les progrès de la vérité.
M. Dollond voulant reconnoître la vérité ou la-
faufleté de cette propofition, en fit l’épreuve de la;
maniéré que Newton indique lui-même î dans uq
prifme d’eau renfermé entre deux plaques de verre;*
■ le tranchant tourné en bas, il plaça un prifme de
verre , dont le tranchant étoit en haut ; 8c comme
il avoit difpofé les plaques de verre , de maniéré
que leur inclinaifon pût être changée à volonté, il
parvint facilement à leur en donner une , telle que
les objets regardés au travers de ce double prifme ,
paruffent à même hauteur, que lorfqu’on les regar-
doit;à la vue fimple ; ce qui apprenoit que les deux-
réfra&ions s’étoient mutuellement détruites ; cè-»
pendant, au contraire de ce qu’avançoit Newton,
les objets fe trouvoient teints des çouleurs de l’iris ,
, commq on fait que le fortf tous les abjetsqu’oa
regarde au travers de prifmes. M. Dollond fit enfuite
mouvoir de nouveau les plaques du prifme d’eau ,
jufqu’à ce qu’il leur trouva une inclinaifon telle
que les objets regardés au travers des deux prifmes,
fuffent aufli deftitués d’iris, que vus à l’oeil nu ; 8c
alors leur hauteur apparente n’étoit plus là vraie ;
ce qui montroit que les réfractions ne s’étoient point
redreffées mutuellement, quoique les différences de
réfrangibilité des rayons colorés, fe fuflènt corrigées
les unes par les autres. ,
M. Dollond, qui favpit qu’il y a deux fortes de
verres bien plus propres les uns que les autres à la
netteté des images, conjectura que cette différence
de qualité venoit de celle de leurs vertus réfringentes
ou difperfives, relativement aux rayons colorés.
Il penfaque tel verre pourroit rendre la différence
de réfrangibilité du rouge au v iole t, beaucoup
plus fenfible que tel a u t r e , & eau fer par ce
moyen des iris beaucoup plus étendus. Quoique la
r é f r a c t io n moyenne ne rut pas fort différente, il en
conçut l’efpérance de réuflir mieux dans fon objet,
en combinant des lentilles de verres de différentes
qualités , . qu’en employant du verre & de l’ea u ,
parce que l’eau & le verre, relativement à leurs
réfraâions moyennes, ne produifoient pas des, différences
affez fenfibles dans les réfrangibilités. des couleurs.
Un verre très-blanc & fort tranfparent, appelle
communément pryjlal f Angleterre , eft celui
qui, fuivant M. Dollond, donne les ir is le s plus remarquables
, & par conféquent celui dans lequel la
réfraCHon du rouge différé le plus de celle du violet.
Un verre verdâtre, connu en Angleterre fous le nom
de crownglaff., 8c qui reffemble beaucoup en qualité
à notre verre commun, eft au contraire celui
qui donne la moindre différence dans la réfrangibilité
: ce font les deux matières dont M. Dollond
imagina dë fe fervir , après avoir mefuré leurs qualités
réfringentes ; ce qu’il fit d’une maniéré analogue
à celle qu’il -avo it employée pour le verre & feau.
Il trouva que le rapport des différentes difperfions
étoit celui de trois à deux , enforte- que le fpe&re
coloré, qui, avec un prifme de crownglaff, auroit
deux pouces de longueur, en a trois avec un prifme
deJLintglafJou de cryftal d’Angleterre. (Mém. Acad.
* 7 é s > P aë ' Ü H
trës s’exercèrent bientôt à> chercher les co u rb u r e ;
les plus propres à corriger les-aberrations de réfran
gibilité, 8c en .même tems de fphériçité : on peu;
voir fur la théorie de ces lunettes achromatiques M
Clairaut ( Mém. Acad. iySG, page 3 80 ; /ÿSy, pa«t
Sz4 ; 17S2 , page Sy8. ) ; M. Euler, dans fes troi;
volumes de dioptrique ( Mém. Acad. iÿGS , pag,
SSS, Mém. de Berlin, tome X X I I , page 11 y . ) ; M
d’ Alembert ( Opufcules math, d’abord dans le torru
I I I , publié en 1764; & enfuite dans le I V , er
1768. ) ; M. Klingenftierna dans une piece quia rem
porté le prix de l’académie de Pétersbourg en 1762
M. de Rochon, dans fes Opufcules publiées en 1768.
in-S° ; le pere Bofchovich, dans les cinq Diferta-
tions latines qu’il a publiées à Vienne en 1767, 'in-40
le pere Pezenas, dans la nouvelle édition de YOpti-
que de Smith, qu’il a donnée à Avignon en 1767 :
M. Duval le R o i , dans celle qu’il a donnée à Bref
la même année ; 8c l’article qui fuit. Nous nous con
tenterons de rapporter ici les dimenfions de deux lunettes
excellentes . d’environ quarante-trois pouce;
de foyer, faites p'âr Dollond, 8c qui furpaffent toui
ce q u ’o n avoit fait dans ce genre. L’obje&ifeft corn-
poié de trois verres, dont un eft de flint-glaff, con-
cave des deux côtés , placé entre deux lentilles
bi-convexe , de verre commun. Les fix rayons de;
courbures , à commencer par celui de la furfact
extérieure, font, dans une de ces lunettes, de 3 15 ,
45° » 235 > 3 1 5 ,3 2.0 &: 3 f e lignes. Dans la fécondé
lunette, les fix rayons font de 315;, 400, 238,290 ,
3 16, 316 lignes : cette derniere a 43 pouces 5 lignes
de foyer. Ces lunettes grolfiffent depuis cent jufqu’à
deux cents fois, fuivant les différens équipages qu’on
y applique, 8c furpaffent par conféquent les anciennes
lunettes de vingt-cinq à trente pieds. Ces lunettes
deviendront encore meilleures , lorfqu’on y em-
ploiera'trois efpeces différentes de verres , au lieu
de d eux, q ui, a la rigueur, ne réunifient que deux
fortes de rayons. ( le Pere Bofcovich, Differtation
11, page 101. ) Voyei Lunet tes dans ce Supplément.'
( M. d e l a L a n d e . )
A chromatiques, ( L u n e t t e s ) Optique.
Perfonne n’ignore le grand degré de perfeéHôn
que l’optique a acquis dans ces derniers temps par
là conftruftion des lunettes achromatiques ,• on les a
nommées ainfi , comme l’on fait, parce que les
objectifs de ces lunettes font formés dé plufieurs
lentilles de différentes matières, qui, par leur dif-
pofition refpeéHve , anéantiffent entièrement ou au
moins fenfiblement les couleurs qui défigureroient
trop lés images dans un obje&if fimple. Plufieurs
des limettes qu’on a conftruites dans cette vu e , foit
en Angleterre, foit en Fran.ce, ont eu un effet très-
avantageux; mais une de ces lunettes conftruite en
Angleterre , paroît très-fiipérieure aux autres ; elle
eft d’enViron trois pieds & demi de longueur ; elle
porte ttrois pouces quatre lignés d’ouverture , &:
augmente cent cinquante fois le diamètre des objets.
Ainfi cette lunette eft très - fupériëUre à un té-
lefeopê de même longueur, parce qu’un tel télef-
cope ne porteroit pas une ' plus grande ouverture ,
n’augmenteroit pas ' davantage-l’ob je t , 8c auroic
d’ailleurs moins de champ & beaucoup moins de
clarté.
L’objeéHf de cette lunette eft compofé de deux
lentilles convexes de crownglaff, matière qui a
beaucoup de rapport à notre verre commun , 8c
d’une lentille con'cave de jüntglaff ou cryftal d’Angleterre
; on ne nous dit point d’ailleurs les dimen-
fiôris de ces lentilles, qui paroiffent même avoir été
trouvées par une elpece de tâtonnement, à la vérité
fort heureux;
Dans un mémoire que j’ai lu à l’académie, non-
feulement j’ai donné les dimenfions exactes que doit
avoir cet objeftif, j’ai fait voir encore qu’on, pou-
vo itfe fervir, avec le même avantage, d’un autre
objèâi-f de forme très - différente , mais toujours
compofé comme celui-là de deux lentilles de verre
commun qui en renferment une de cryftal d’Angleterre.
J’ai prouvé que l’avantage de ces objeftifs
eonfifte, non-feulement en ce que les courbures des
furfaces y font beaucoup moins grandes que dans
les meilleurs objeôifs conftruits jufqu’à préfent avec
deux lentilles, mais encore en ce que les. erreurs
qu’on peut commettre dans la conftruftion des fur-
faces y produifent, pour la plupart, un effet beaucoup
moins confidérable que dans les autres ob-
jeéfifs.
Je dis pour la plupart ; car il eft une erreur dont
l’inconvénient eft le même dans tous les objeftifs
de même foy e r , compofés de tant de lentilles qu’on
voudra; 8c s’il faut l’avouer, cexinconvénient eft
le plus dangereux de tous pour la perfection de ces
objectifs. L’erreur dont je veux parler eft celle qu’on
peut commettre en mefurant le rapport de la diffu-
fion des couleurs dans les différentes matières dont
l’objeétif eft formé. Ce rapport, comme l’on fait, fe
détermine de deux maniérés, ou en mefurant l’efpace
qu’occupent les couleurs au foyer de deux
différentes lentilles formées de ces matières , ou en
mefurant l’angle de deux prifmes adoffés, dont l’un