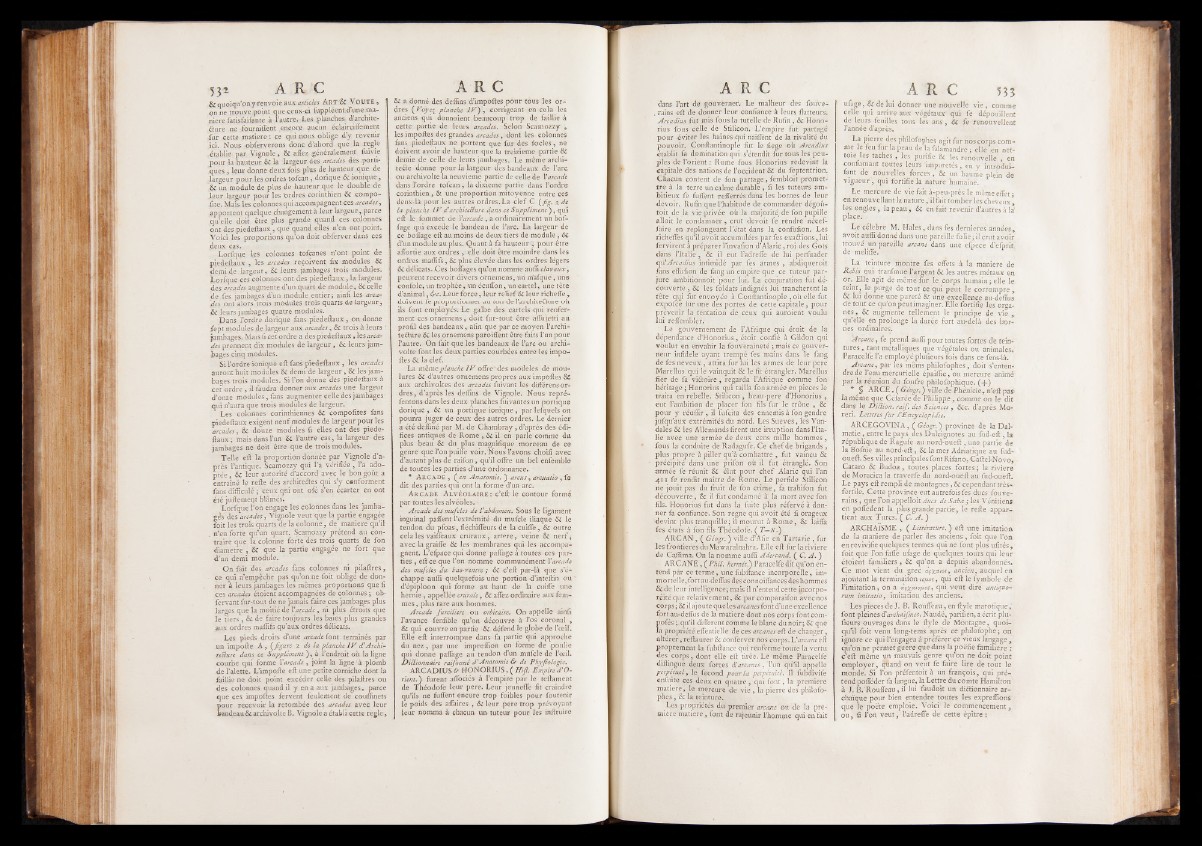
& quoiqu’onyfenvoieauxanicles &R5T& V O U T E ,
on ne trouve .point que ceux-ci fuppléent.d une rna- ;
niere fatisfaifante à l’autre. Les .planches d’archite-
âure ne fourniffent encore aucun éclairciffement
fur cette matière : ce qui nous oblige ,dy revenir
ici. Nous obferyerons donc d’abord que la réglé ,
■ établie par Vignole, & ajflez .généralement fuivie
pour la hauteur & la largeur; des arcades des porti- ;
ques , leur donne deux fois plus de hauteur que de j
largeur pour les ordres tofcan , dorique & ionique,
& u n m o d u le de plus de hauteur que le double de
le u r largeur pour les Ordres corinthien & .compo- !
dite. Mais les colonnes qui a c com pa gn en t ce s arcades,
apportent quelque changement à le u r largeur, parce
qu’elle doit être, plus grande quand ces colonnes
ont des piedeftaux , que quand elles n’en ont point.
Voici les proportions qu’on doit obferver dans ces :
deux ca s. . . . .
L p r fq u e les colonnes tofcanes n’ont point de
piedeftaux , les arcades reçoivent fix modules &
demi 4e largeur, .& leurs jambages trois modules.
Lorfque ces colonnes ont des piedeftaux., la largeur
des arcades augmente d’un quart de module, & celle
de fe s jambages .d’un module entier; ainfi les arcades
ont alors trois modules trois quarts de largeur,
& leurs jambages quatre modules.
Dans l’ordre dorique fans piedeftaux, on donne
fept modules de largeur aux arcades, & trois à leurs '
jambages. M a is fi cet ordre a des piedeftaux, les arcades
prennent dix modules de largeur, &. leurs jambages
c in q modules.
Si l’ordre ionique eft fans piedeftaux , les arcades
auront huit modules & demi dé largeur, & les jambages
trois modules. Si l’on donne des piedeftaux à
cet ordre , il faudra donner aux arcades une largeur
d’onze modules, fans augmenter celle des jambages-
qui n’aura que trois modules de largeur.
Les colonnes corinthiennes & compofites fans
piedeftaux exigent neuf modules de largeur pour les
arcades, & douze modules fi elles ont des piedë-
ftaux; mais dans l’un & l’autre cas, la largeur des
jambages ne doit être que de trois modulés.
Telle eft la proportion donnée par Vignole d’après
l’antique. Scamozzy qui l’a vérifiée , l’a adoptée
, & leur autorité d’accord avec le bon goût a
entraîné le refte des a r ch ite c te s qui s’y conforment
fans difficulé ; ceux qui ont ofé s’en écarter en ont
été juftement blâmés.
Lorfque l’on engage les colonnes dans les jambages
des arcades, Vignole veut que la partie engagée
fqit les trois quarts de la colonne, de maniéré qu’il
_ n’en forte qu’un quart. Scamozzy prétend au contraire
que la colonne forte des trois quarts de fon
diamètre , & que la partie engagée ne fort que
d’un demi module.
On fait des arcades fans colonnes ni pilaftres,
ce qui n’empêche pas qu’on ne foit obligé de donner
à leurs jambages les mêmes proportions que fi
ces arcades étoient accompagnées de colonnes ; o.b-
fervant fur-tout de ne jamais faire ces jambages plus
larges que la moitié de Y arcade, ni plus étroits que
le tiers., & de faire toujours les baies plus grandes
aux ordres maflifs qu’aux ordres délicats.
Les pieds droits d’une arcade font terminés par
un impofte A , (figure 2 de la planche I V d'Architecture
dans ce. Supplément ) , à l’endroit o.ù la ligne
courbe qui forme Y arcade , joint la ligne'à plomb
de l’alette. L’impofte eft une petite corniche dont la
faillie ne doit point excéder celle des pilaftres ou
des colonnes quand il y en a aux jambages, parce
que ces impolies fervent feulement de couflinets
pour recevoir la retombée des, arcades avec leur
bandeau & archivolte B. Vignole a établi cette réglé,
& a donné des deflins d’impoftes pour tous les ordres
( Voye^ planche l'V ) c o r r ig e a n t en cela les
anciens qui donnoient beaucoup trop de faillie à
cette partie de leurs arcades. Selon Scamozzy ,
le s impolies des grandes arcades, dont les colonnes
fans piedeftaux ne portent que fur des focles, ne
doivent ayoir de hauteur que la treizième partie &
d emie .de celle de leurs jambages. Le même architecte
donne pour la largeur des bandeaux de l’arc
ou a r c h iv o lte la neuvième partie de celle de Y arcade
dans l’ordre tofcan, la dixième partie dans l’ordre
corinthien, & une proportion mitoyenne entre ces
deux-là-pour les autres ordres. La clef C (fig. 2 de
la planche IV d'architecture dans ce Supplément ) , qui
eft le fom m e t de Y arcade, a ordinairement un bof-
fage qui excede le bandeau de l’arc. La largeur de
ce boflage eft au moins de deux tiers de module, &
d’un module au plus. Quant à fa hauteur ', pour être
affortie aux ordres , elle doit être moindre dans les
ordres maflifs, & plus élevée dans les ordres légers
& délicats. C es boflages qu’on nomme au K\ clavaux,
peuvent recevoir divers ornemens, un rnafquè, une
confole, un trophée, un écuûbn, un cartel, une tête
d’animal, &c. Leur force, leur relief & leur richeffe,
doivent fe proportionner au ton de Parehite&ure oîi
ils font employés. Le galbe des cartels qui renferment
ces ornemens, doit fur-tout être affujetri au
profil des bandeaux, afin que par ce moyen l’archi-
tefture & les ornemens paroiffent être faits l’un pour
l’autre. On fait que les bandeaux de l’arc ou archivolte
font les deux parties courbées entre les impo-
; lies & la clef.
La même planche I V offre * des modèles de moulures
& d’autres ornemens propres aux impolies 8c
aux archivoltes des arcades fuivant les différens ordres,
d’après les deflins de Vignole. Nous repré-
fentons dans les deux planches fuivantes un portique
, dorique, & un portique ionique, par lefquels on
j pourra juger de ceux des autres ordres. Le dernier
a été defliné par M. de Chambray. d’après des édifices
antiques de Rome ,& il en parlé comme du
plus beau & du plus magnifique morceau de ce
genre que l’on puifle voir.‘Nous l’avons ehoifi avec
d’autant plus de raifon, qu’il offre un bel enfemble
de toutes les parties d’une ordonnance.
* A r c a d e , ( en Anatomie. ) arcus, arcuatio , fe
dit des parties qui ont la forme d’un arc.
A r c a d e A l v é o l a i r e : c ’ e ft l e c o n to u r fo rm e
p a r to u te s le s a lv é o le s . •
Arcade des mufcles de Vabdomen. Sous le ligament
inguinal paflent l’extrémité du mufcle iliaque & le
tendon du pfoas, fléchiffeurs de la Cuiffe, & outre
cela les vaiffeaux cruraux, a r t è r e , veine & nerf *
avec la graiffe & les membranes qui les accompagnent.
L’efpace qui donne paffage à toutes - ces parties
, eft ce que l’on nomme communément Y arcade
des mufcles du bas-ventre ; & c’eft par-là que s’éch
ap p e aulfi quelquefois une portion d’inteftin ou
d’épiploon qui forme au haut de la cuiffe une
hernie, appellée crurale, & affez ordinaire aux femmes
, plus rare aux hommes.
Arcade furciliere ou orbitaire. On appelle ainfi
l’avance fenfible qu’on découvre à l’os coronal ,
& qui couvre en partie & défend le globe de l’oeil.
Elle eft interrompue dans fa partie qui approche
du n ez, par une impreflîon en forme de poulie
qui donne paffage au tendon d’un mufcle de l’oeil.
Dictionnaire raifonné d'Anatomie & de Phyfiologie.
ARCADIUS & HONORIUS, ( Hifi. Empire d’O-
rient. ) furent affociés à l’empire par le teftament
de Théodofe leur pere. Leur jeuneffe fit craindre
qu’ils ne fuffent encore trop foibles pour foutenir
le poids des affaires , & leur pere trop prévoyant
leur nomma à chacun un tuteur pour les inftruire
dans l’art dé g o u v e rn e r . Le malheur des f o u v e -
. rains eft de donner leur confiance à leurs flatteurs.
Arcadius fut mis fous la tutelle de Rufin , & Hoflo-
rius fous celle de Stilicon. L’empire fut partagé
pour éviter les haines qui riaiffent de la rivalité du
pouvoir. Conftantinople fut le fiege o ù Arcadius
établit fa domination qui s’étendit fur tous les peuples
de l’qrient : Rome fous Honoriùs redevint la
capitale des nations de l’occident & du feptentrion.
Chacun content de fon partage, fembloit promettre
à la terre Un calme durable , li les tuteurs ambitieux
fe fufîerit refferrés dans les bornes de leur
devoir. Rufin que l’habitude de commander dégoû-
toit de la vie privée où la majorité’ de fon pupille
alloit le condamner, crut devoit fe rendre nécef-
laire en -replongeant l ’é ta t dans la confufion. Les
richefîeS qu’il avoit accumulées par fes e x a c t io n s , lu i
fe r v i r e n t à préparer Pinvafion d’Alaric, roi des Gots
dans l’Italie, & il eut l’adreffe de lui perfuader
q\YArcadius intimidé par fes armes , abdiqueroit
fans effufion de fangun empire que ce tuteur parjure
ambitionnoit pour lui. La conjuration fut découverte
, & les foldats indignés lui tranchèrent la
tête qui fut envoyée à Conftantinople ,où elle fut
expofée fur une des portes de cette capitale, pour
prévenir la tèntation de ceux qui àuroient voulu
lui r e ffem b le r .
Lé gouvernement de l’Afrique qui étoit de la
dépendance d’Hojnorius, étoit confie à Gildon qui
Voulut en en v a h ir la fouveraineté ; mais ce gouvern
e u r infidèle ayant trempé fes mains dans le fang
de fes neveux , attira fur lui les armes de leur pere
Marellus qui le vainquit & le fit étrangler. Marellus
fier de fa v i f t o i r e , regarda l’Afrique com m e fon
héritage ; Honoriùs qui tailla fon armée en pièces le
traita en rebelle. Stilicon, beau pere d’Honorius ,
eut l’ambition de placer fon fils fur le trône , &
pour y réufîir , il fufeita des ennemis à fon gendre
jufqu’aux extrémités du nord. Les Sueves, les Vandales
& les Allemands firent une. ifruption dans l’Italie
avec une armée de d e u x cens mille hommes,
fous la conduite dé Radagufe. Ce chef de. brigands ,
plus propre à piller qu’à combattre , fut vaincu &
précipité dans une prifon où il fut étranglé. Son
armée fe réunit & élut pour chef Alaric qui l’an
411 fe rendit maître de Rome. Le perfide Stilicon
ne jouit pas du fruit de fon crime, fa trahifon fut
découverte, & il fut condamné à la mort avec fon
fils. Honoriùs fut dans la fuite plus réfervé à donner
fa confiance. Son régné qui avoit été fi orageux
devint plus tranquille; il mourut à Rome, & laiffa
fes états à fon fils Théodofe. ( T— iv.) ,
ARC AN, ( Géogr. ) ville d’Afie en Tartarie , fur
les frontières du Mavaralnahra. Elle eft fur la riviere
de Cafiima. On la nomme aufli Adercand. (C . A .')
ARC ANE, ( Phil. hermét.) Paracelfe dit qu’on entend
par ce terme, une fubftance incorporelle, immorte
lie, fort au-deffus des connoiffances des hommes
& de leur intelligence; mais il n’entend cette incorpo-
réité que relativement, & par comparaifon avec nos
corps ; & il ajoute que les arcanes font d’une excellence
fort au-deffus de la matière dont nos corps font com-
pofés qu’il d ifferent comme le blanc du noir; & que
la propriété effentielle de ces arcanes eft de changer,
altérer, reftaurer & conferver nos corps. L'arcane eft
proprement la fubftance qui renferme toute la vertu
des corps, dont elle eft tirée. Le même Paracelfe
diftingue deux fortes d'arcanes, l’un qu’il appelle
perpétuel t le fécond pour la perpétuité. Il fubdivife
enfuite ces deux en quatre , qui f o n t , la première
matière, le mercure de vie , la pierre des philofo-
phes, & la teinture.
Les. propriétés du premier arnzne ou de la première
matière, font de rajeunir l’hompie qui en fait
ufagé, & de lui donner une nouvelle v ie , comme
celle qui arrive aux végétaux’ qui fe dépouillent
de leurs feuilles tous les ans, & fe renouvellent
l’annéé d’après.
La pierre des phÙofophes agit fur nos corps comme
le feu fur la peau de la falamandre ; elle én nettoie
les taches , les purifie & les renouvelle , en
confumant toutes leurs impuretés j en y introdui-
fant de nouvelles forces, & un baume plein de
vigueur , qui fortifie la nature humaine.
Le mercure de vie fait à-peu-près ie même effet*
en fenouvellant la nature, il fait tomber lès Cheveux ,
les ongles , la peau, ôc en fait revenir d’autres à la’
place;
Le célébré M. Haies, dans fes dernieres années,
avoit aufli donné dans une pareille folie; il crut avoir
trouvé un pareille arcane dans une efpece d’efprit
de meliffe. ’
La teinture montre fes effets à la maniéré de
Rèbis qui tranfmue l’argent & les autres métaux en
or; Elle agit de même' fur le corps humain ; elle le
teint, le purge de tout ce qui peut le corrompre ,
& lui donne une pureté & une excellence au-deffus
de tout ce qu’on peut imaginer. Elle fortifie les organes,
& augmente tellement le principe de vie ,
qu’elle en prolonge la durée fort au-delà des bornes
ordinaires.
Arcane, fe prend aufli pour toutes fortes de teintures
, tant métalliques que végétales ou animales.
Paracelfe l’a employé plufieurs fois dans ce fens-là.
Arcane y par les mêms philofophes, doit s’entendre
de l’eau mercurielle épaifiie, ou mercure animé
par la réunion du foufre philofophique. (+ )
* § ARCE, ( Géogr. ) ville de Phénicie, n’eft pas-
la même que Céfarée de Philippe, comme on le dit
dans le Diction, raifi. des Sciences, &c. d’après Mo»
reri. Letttres fur VEncyclopédie.
ARCEGOVINA, (Géogr.') province de la Dal-
marie, entre le pays des Dulcignotes au fud-eft , la
république de Ragufe au nord-ouefl, une partie de
la Bofnie au nord-eft, & la mer Adriatique au fud-
oueft. Ses villes principales font Rifano, Caftel-Novo,
Cataro & Budoa, toutes places fortes ; la riviere
de Moracica la traverfe du nord-oueft au ftid-oueft.
Le pays eft rempli de montagnes, & cependant très-
fertile. Cette province eut autrefois fes ducs fouve-
rains, que l’on appelloit ducs de Saba ; les Vénitiens
en poffedent la plus grande partie, le refte appartient
aux Turcs. ( C. A . )
ARCHAÏSME , ( Littérature. ) eft une imitation
de la maniéré de parler des anciens, foit que l’on
en revivifie quelques termes qui ne font plus ufités,
foit que l’on fafîe ufage de quelques tours qui leur
étoient familiers , & qu’on a depuis abandonnés»
Ce mot vient du grec ancien y auquel en
ajoutant la terminaifon qui eft le fymbole de
l’imitation, on a «pxaurposy qui veut dire antiquorum
imitatioy imitation des anciens.
Les pièces de J. B. Rouffeau, en ftyle marotique
font pleines d’archaïfmes. Naudé, parifiën, a écrit plu-
fieurs ouvrages dans le ftyle de Montagne, quoiqu’il
foit venu long-tems après ce philofophe ; on
ignore ce qui l’engagea à préférer ce vieux langage ,
qu’on ne permet guere que dans la poëfie familière :
c?eft même un mauvais genre qu’on ne doit point
employer, qiiand on veut fe faire lire de tout le
monde. Si l’on pféfentoit à un françois , qui prétend
pofleder fa langue, la Lettre du comte Hamilton
à J. B. Rouffeau, il lui faudoit un diâionnaire archaïque
pour bien entendre toutes les expreffions
que le poète emploie. Voici le commencement;,
ou, fi l’on veut, l’adreffe de cette épître :