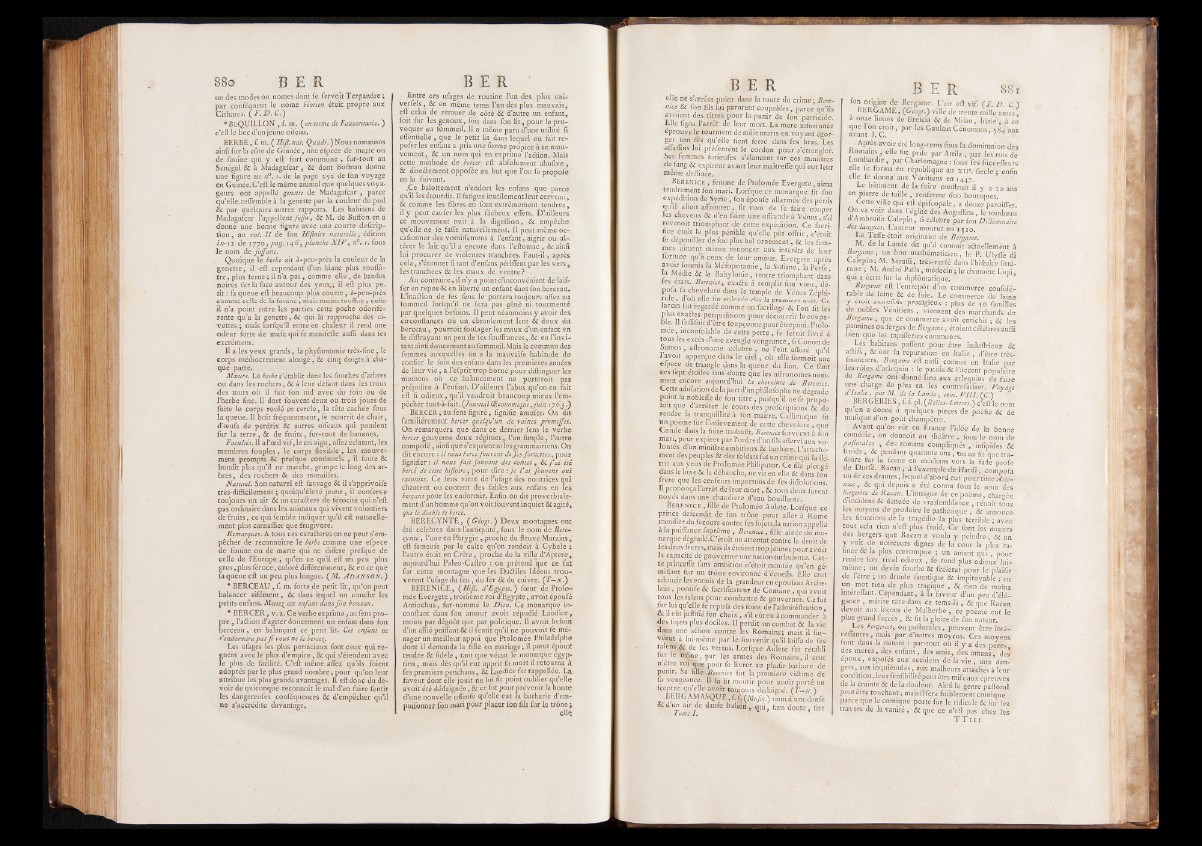
un des modes ou nomes dont fe fervoxt Terpandre ;
par cohféquent le nome béotien étoit propre aux
Cithares. ( F .D .C .)
* BEQUILLON , fi. m. ( en terme de Fauconnerie. )
c’eft le bec d’un jeune oifeau.
BERBE, f. m. ( Hijl.nat. Quadr. ) Nous nommons
ainfi fur-la côte de Guinée, une efpece de m a r te ou
de fouine qui y eft fort commune , fur-tout au
Sénégal & à Madagafcar, & dont Bofman donne
une fig u r e au n°. i. de la page 252 de fon voyage
en G u in é e . C ’ e ft le même animal que quelques voyageurs
ont appellé genette de Madagafcar , parce
q u ’ e lle .re ffe rn b le à la genette par la couleur du poil
8c par quelques autres rapports. Les habitans de
Madagafcar l’appellent fojjà, & M. de BufFon en a
donné une bonne figure avec une courte defcrip-
tion, au vol. I I de fon Hifloire naturelle, édition
in-12 de 1770, pag.j^iï, planche X IV , n°. 1. fous
le nom de foffane.
Quoique le herbe ait à-peu-près la couleur de la
genette, il eft cependant d’un blanc plus rouffâ-
t re , plus terne ; il n’a. pas, comme elle , de bandes
noires fur la face autour des yeu^; i l eft plus petit
: fa queue eft beaucoup plus courte, à-peu-près
comme celle de la fouine, mais moins touffue, enfin
il n’a point entre les parties cette poche odorifé-
rente qu’a la genette, & qui la rapproche des civettes
; mais lorfqu’il entre en chaleur il rend une
odeur forte de mufc qui fe manifefte auffi dans fes
excrémens. .
Il a les yeux grands, la phyfionomie très-fine, le
corps médiocrement alongé, 6c cinq doigts à chaque
patte.
Moeurs. Le herbe s’établit dans les fouehes d’arbres
ou dans les rochers, 8c à leur défaut-dans les trous
des murs oh il fait fon nid avec du foin ou de
l’herbe -fine. Il dort fouvent deux ou trois jours de
fuite le corps roulé en cercle, la tête cachée fous
la queue. Il boit fréquemment, fe nourrit de chair,
d’oeufs de perdrix 8c autres oifeaux qui pondent
fur la terre, 8c de fruits, fur-tout de bananes.
Facultés. Il a l’oeil v if, le cri aigu, affez éclatant, les
membres fouples, le .corps flexible , les mouve-
mens prompts 8c prefque continuels , il faute 8c
bondit plus qu’il ne marche, grimpe le long des arbres,
des rochers & des murailles.
Xaturel. Son naturel eft fauvage 8c il s’apprivoife
très-difficilement ; quoiqu’élevé jeune, il conferve
toujours un air 8c un caraftere de férocité qui n’eft
pas ordinaire dans les animaux qui vivent volontiers
de fruits, ce qui femble indiquer qu’il eft naturellement
plus carnaffier que frugivore.
Remarques. A tous ces cara&eres on ne peut s’empêcher
de reconnoître le btrbe comme une efpece
de fouine ou de marte qui ne différé, prefque de
celle de l’Europe , qu’en ce qu’il eft un peu plus
gros, plus féroce, coloré différemment, 8c en ce que
la queue eft un peu plus longue. ( M. A d a n s o n . )
* BERCEAU, f. m. forte de petit lit, qu’on peut
balancer aifément, 8c dans lequel on couche les
petits enfans. Mette£ cet enfant dans fon berceau.
* BERCER, v . a. Ce verbe exprime, au fens propre
, l’aâion d’agiter doucement un enfant dans fon
berceau, en balançant ce petit lit. Cet erifant ne
s*endormira pas Jî vous ne le berceç.
Les ufages les plus pernicieux font ceux qui régnent
avec le plus d’empire, 8c qui s’étendent avec
le plus de facilité. C’eft même affez qu’ils foient
adoptés par le plus grand nombre, pour qu’on leur
attribue les plus grands avantages. Il eft donc du devoir
de quiconque reconnoît le mal d’en faire fentir
les dangereufes conféquences 8c d’empêcher qu’il
ne s’accrédite davantage.
Entre ces ufages de routine l’un des plus itnî-
verfels, 6c en même tems l’un des plus mauvais,
eft celui de remuer de côté 8c d’autre un enfant,
foit fur les genoux, foit dans fon lit , pour le provoquer
au fommeil. Il a même paru d’une utilité fi
effentielle , que le petit lit dans lequel on fait re-
pofer les enfans a pris une forme propice à ce mouvement,
8c un nom qui en exprime l’aétion. Mais
cette méthode de bercer eft abfolument abufive,
& dire&ement oppofée au but que l’on fe propofe
en la fuivant.
.Ce balottement n’endort les enfans que parce
qu’il les étourdit. Il fatigue inutilement leur cerveau,
&c comme les fibres en font extrêmement tendres,
il y peut caufer les plus fâcheux effets. D ’ailleurs
ce mouvement nuit à la digeftion , 8c empêche
qu’elle ne fe faffe naturellement. Il peut même oc-
cafionner des vomiffemens à l’enfant, aigrir ou altérer
le lait qu’il a encore dans l’eftomac , & ainfi
lui procurer de violentes tranchées. Faut-ilaprès
cela, s’étonner fi tant d’enfans périffent par les vers ,
les tranchées 6c les maux de ventre ?
Au contraire, il n’y a point d’inconvénient de laif-
fer en repos 6c en liberté un enfant dans fon berceau,
L’inaâion de fes fens le portera toujours affez au
fommeil lorfqu’il ne fera pas gêné ni tourmenté
par quelques befoins. Il peut néanmoins y avoir des
circonftances oh un ébranlement lent 6c doux du
berceau, pourroit foulager les maux d’un enfant en
’le diftrayant un peu de fes fouffrances, 6c en l’invitant
ainfi doucement au fommeil.Mais le commun des
femmes auxquelles on a la mauvaife habitude de
confier le foin des enfans d^ns les premières années
de leur vie t a l’efprit trop borné pour diftinguer les
momens oit ce balancement ne porteroit pas
préjudice à l’enfant. D’ailleurs l’abus qu’on en fait
eft fi odieux, qu’il vaudroit beaucoup mieux l’empêcher
tout-à-fait. ( Journal (économique, juin /7Ô3.)
B e r c e r j au fens figuré, lignifie amufer. On dit
familièrement bercer quelqu'un de vaines pronieffes.
On remarquera que dans ce dernier fens le verbe
bercer gouverne deux régimes, l’un fimple, l’autre
compofé, ainfi que s’expriment les grammairiens. On
dit encore : il nous berce fouvent defes Jomettes, pour
lignifier : il nous fait fouvent des contes , 8c f ai été
bercé de cette hijloire, pour dire : je l'ai fouvent oui
raconter. Ce fens vient de l’ufage des nourrices qui
chantent ou content des fables aux enfans en les
berçant pour les endormir. Enfin on d it proverbialement
d’un homme qu’on voit fouvent inquiet 6c agité,
que le diable le berce.
BÉRECYNTE, ( Géogr. ) Deux montagnes ont
été célébrés dans l’antiquité, fous le nom de Bere-
cynte, l’une en Phrygie , proche du fleuve Marzias ,
eft fameufe par le culte qu’on rendoit à Cybele :
l’autre étoit en Crête , proche de la ville d’Aptere,
aujourd’hui Paleo-Caftro : on prétend que ce fut
fur cette montagne 'que les Da&iles Ideens trouvèrent
l’ufage du feu , du fer 8c du cuivre. (T— n .)
BERENICE, {Hifi. d'Egypte.') foeur de Ptolo-
mée Evergete, troifieme roi d’Egypte, avoit époufé
Antiochus, fur-nommé le Dieu. Ce monarque in-
conftant dans fon amour avoit répudié Laodice,
moins par dégoût que par. politique. Il avoit befoin
d’un allié puiffant 6c il fentit qu’il ne pouvoit fie ménager
un meilleur appui que Ptolomée Philadelphe
dont il demanda la fille en mariage; il parut époutf
tendre 6c fidele, tant que vécut le monarque égyptien
, mais dès qu’il eut apprit fa mort il retourna à
fes premiers penchans, 6c Laodice fut rappellée. La
faveur dont elle jouit ne lui fit point oublier qu’elle
avoitété dédaignée, 6c ce fut pour prévenir la honte
d’une nouvelle offenfe qu’elle eut la barbarie d’em-
poifonner fon mari pour placer fon fils fur le trône ;
elle ne s’arrêta point dans la route du crime ; Bérénice
f c fon fils lui parurent coupables, parce qu’ils
avoient des titres pouf la punir de fon parricide.
Elle figna l’arrêt de leur mort. La mère infortunée
éprouve le tourment de millemorts en voyant égorger
fon fils qu’elle tient ferré dans fes bras. Les
affaffins lui préfentent le cordon pour s’étrangler.
Ses femmes furieufes s’élancent fur ces ‘ miniltres
de/ang & expirent avant leur maîtreffe qui eut leur
même deftinée.
B é r é n ic e , femme de Ptolomée Evergete, aima
tendrement fon mari. Lorfque ce monarque fit fon
expédition de Syrie , fon époufe allarmée des périls
qu’il alloit affronter , fit voeu de fe faire couper
les cheveux 6C d’en faire une offrande à Vénus, s’il
revenoit triomphant de cette expédition. Ce facri-
fice étoit le plus pénible qu’elle put offrir, c’étoit
fe dépouiller de fon plus bel ornement, 6c les femmes
aiment mieux renoncer aux intérêts de leur
fortune qu’à ceux de leur amour. Evergete après
avoir fournis la Méfopotamie, la Sufiane, la Perfe
la Médie 6c la Babylonie, rentre triomphant dans
fes états. Bérénice, exacte à remplir fon voeu, dé-
pofa fauchevelure dans le temple de Vénus Zéphi-
ride., d’où elle fut pnlevée «dès la première nuit. Ce
larcin fut regardé comme un facrilege 8c l’on fit les
plus exactes perquifitions pour découvrir le coupable
Il fuffifoit d’être foupçonné pourêtrepuni. Ptolo-
mee, inconsolable de cette perte, fe feroit livré à
tous les exees d’une aveugle vengeance, fi Conon de
Samos, aftronome célébré , ne l’eût alluré qu’il
lavoit apperçuedans le ciel , où elle formait une
efpece de triangle dans la queue du lion. Ce font
ces fépt étoiles fans-doute que les aftronomes nomment
encore aujourd’hui la chevelure de Bérénice.
Çette adulation de la part d’un philofophe ne dégrade
point1 la nobleffe de fon titre , puifqu’il ne fe propos
foit que d’arreter le cours des proferiptions 6c de
rendre la tranquillité à fori maître. Callimaque fit
un poëme fur l’enlevement de cette chevelure, que
'Catiide dans la fuite traduifit. Bérénice furvécut à fon
mari, pour expirer par l’ordre d’un fils affervi aux volontés.
d’un miniftre ambitieux 6c barbare. L’attachement
des peuples 6c des foldats fut un crime qui la flétrit
aux yeux de Ptolomée Philipator. Ce fils plongé
dans le luxe 6c la débauche, ne vit en elle 6c dans Ion
frere que les.,cenfeurs importuns de fes diflolutions.
Il prononça l’arrêt deleur mort, 6c tous deux furent
noyés dans une chaudière d’eau bouillante.
B é r é n ic e , fille de Ptolomée Aulete. Lorfque ce
prince defeendit de fon trône pour aller à Rome
mendier du fecôurs contre fes fujets,la nation àppella
à la puiffance fupreme , Bérénice, fille aînée du monarque
dégradé.C’étoit un attentat contre le droit de
fes deux frétés, mais ils etoiént trop jeunes pour a voir
la capacité de gouverner une nation turbulente. Cet- '
te princeffe fans ambition n’étoit montée qu’en gé-
miflant fur un trône environné d’écueils. Elle crut
adoucir les ennuis de la grandeur en époufant Arche-
laiis, pontife 8c facrificateur de Comane , qui avoit
tous les talens pour combattre 8c gouverner. Ce fut
fur lui qu’elle fe repofa des foins de l’adminiftration,
■ J e il eut juftifiefon choix, s’il eût eu à commander à 1
des fujets plus dociles. Il perdit un combat 6c la vie
dans, une afrion contre les Romains; mais il fur-
vecqt à lui-même par le fou venir qu’il laiflà de fes
c* iS ^CS vertus> Lorfque Aulete fut rétabli
e § 8 | i :j Par les armes des Romains, il crut
n’etre roi' que pour fe livrer au plaifir barbare de
punir. Sa fille Bérénice fut la première vi&irne de
fa vengeance. Il la fit mourir pour avoir porté un
feeptre quelle aVoit toujours dédaigné. (T—n .')
BERGA M ASQUE, f. fi (Mujîq '.) nom d’une danfe
8cdun air de danfe Italien, qui, fans’doute, tire
■ ’ ' Tome I.
fon origine de Bergame. L ’air eft vif. (F. D. C. Y
BERGAME, (Géogr.) ville de trente mille âmes,
à onze lieues de Brefcia 6c de Milan, bâtie , . à ce
que l’on croit, par les Gaulois Cénomans,'584 ans
. avant J. C. ’ ; * .
Après avoir été long-tems fous la domination des
Romains , elle fut prife par Attila, par les rois de
Lombardie, par Çharlemagné : fous fes fiicceffeurs
e e fe forma en république au xu v fie c le : enfin
elle le donna1 aux Vénitiens en 1447.
Le bâtiment de la foire conftruit il y a 20 ans
en pierre de taille , renferme 600 boutiques.
Cette ville qui eft épifcopale, a douze paroiffes.
Un va voir dans l’églife des Auguftins, le tombeau
d Ambroife Calepin, fi célébré par fon Dictionnaire
des langues. L’auteur mourût en x ciq. '
Le Taffe étoit originaire de Bergame.
M. de la Lande dit qu’il connoît aauellement à
Bergame. , un bon mathématicien, le P. Ulyffe di
Calepio ; M. Seraffi, très-verfé dans l’hiftoire Iitté- '
raire ; M. André Pafla, médecin ; le chanoine Lupi
qui a écrit fur la diplomatique. '
'Bergame eft l’entrepôt d’un commerce confidé-
rable de laine 8c de foie. Le commerce de laine
y etoit autrefois prodigieux : plus de jo familles
de nobles Vénitiens, viennent des marchands de
Bergame , que ce commerce avoit enrichis ; 6c les
pannines ou ferges de Bergame, étoient célébrés auffi
bien que les îapifferies communes.
Les habitans paffent pour être induftrieux 6c
aflifs, 8c ont la réputation en Italie , d’être très-
• ■ ,^nanAc’ers‘ Bergame eft auffi connue en Italie par
les rôles d arlequin : le patois 6c l’accent populaire
de Bergame ont donné lieu aux arlequins de faire
une charge de plus en les contrefàifant. Voyage
d'Italie , par M. de la Lande , tom. V il I J C.)
BERGERIES, f. f. pl. (Belles-Lettres?) c’eft le nom
qu’on a donné quelques pièces de poéfie 6c de
mufique d’un goût champêtre.
Avant qu’on eût _en France l’idée de la bonne
comedie-, on donnoit au théâtre , fous le nom de
pafor al es , des romans compliqués’ , infipides 6c
froids , 6c pendant quarante ans, t>n ne fit que traduire
fur la feene en médians vers la fade profe
de Durfé. Racan , à l’exemple de Hardi, compofa
un de ces drames , lequel d’abord,eut pour titre Ane-
nice, 8c qui depuis a été connu fous le nom des
bergeries de Racan. L’intrigue de ce poëme, chargée
d’mcidéns 6c dénuée de vraifemblance , réunit tous
les moyens de produire le pathétique , 6c annonce
les fituations de la tragédie la plus terrible ; avec
tout cela rien n’eft plus froid. Ce font les moeurs
des bergers que Racan a voulu y peindre, 6c on
y voit de noirceurs- dignes de la cour la plus ra-
finée 6c la plus corrompue ; un amant qui , pour
rendre fon rival odieux , fe rend plus odieux lui-
mêipe; un devin fourbe 6c fcélérat pour lé plaifir
de 1 etre ; un druide fanatique 6c impitoyable t en
un mot rien de plus tragique , 6c rien de moins
mtereffant. Cependant, à la faveur d’un peu d’élégance
, mérite rare dans ce tems-là , 8c que Racan
devoit aux leçons'de Malherbe,, ce poëme eut le
plus grand fucces , 6c fit la gloire de fon auteur.
Les bergeries, ou paftorales, peuvent être inté-
reffantes, mais par d’autres moyens. Ces moyens
font dans la nature : par-tout' où il y a des perës
des meres, des enfans, des amis, des amanS des
époux, expofés aux accidens, de la vie , aux dangers,
aux inquiétudes, aux malheurs attachés à leur
condition, leur fenfibilité peut être mife aux épreuves
de la crainte 6c de la douleur. Ainfi le genre paftoral
peut etre touchant ; maisil fera foiblement comique
parce que le comique porte fur le ridicule 6c fur les
travers de là vanité, 6c que ce n’eft pas chez les
T T t t t
H