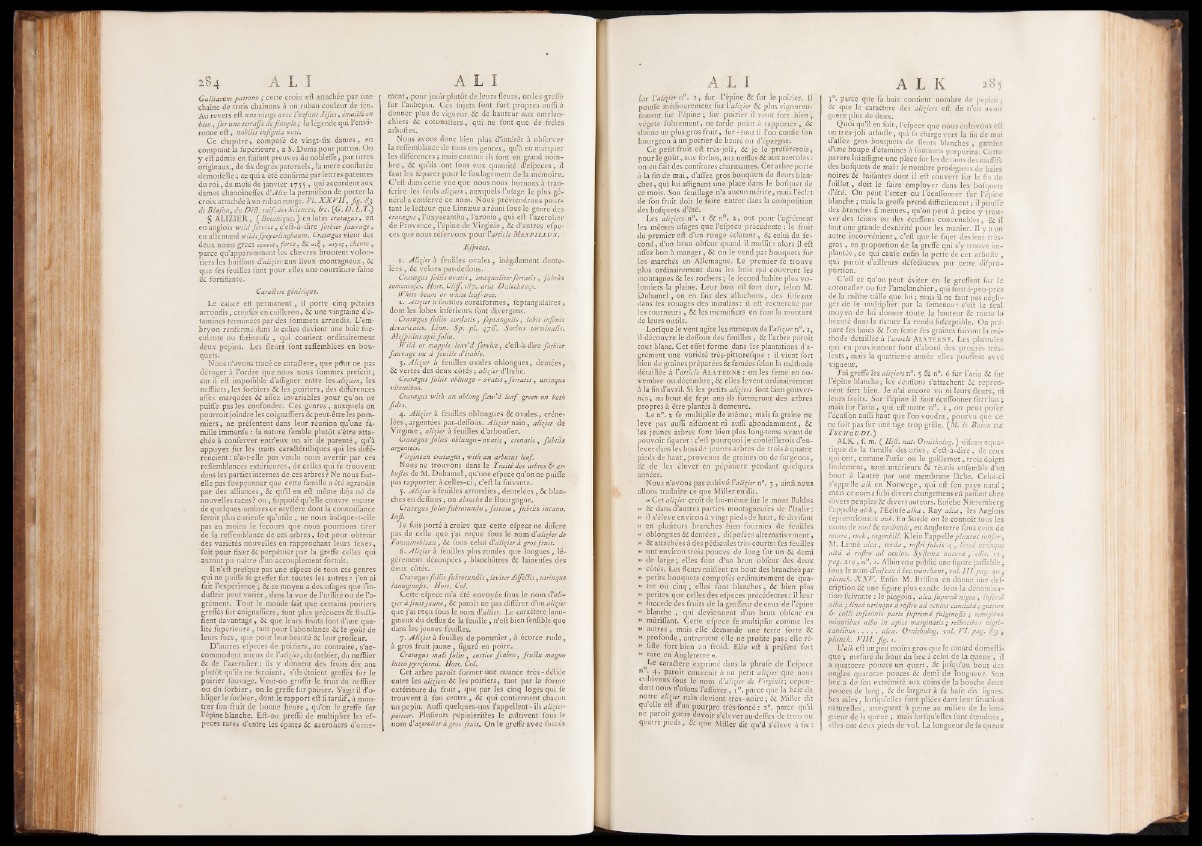
Galliarum patrons ; cette croix eft attachée par une
chaîne de trois chaînons à un ruban couleur de feu.
Au revers eft une vierge avec L'enfant Jéfus, émaillé en
bleu, fur une terraffe de Jinople ; la légende qui l’environne
e f t , nobilis infignia voti.
Ce chapitre-, compofé de vingt-fix dames, en
comptant la fupérieure, a S. Denis pour patron. On
y eft admis en faifant preuves de nobleffe, par titres
originaux, de lix degrés paternels, la mere conftatee
demoifelle ; ce qui a été confirmé par lettres-patentes
du ro i, du mois de janvier 1755, qui accordent aux
dames chanoineffes d'A lix la permiflîon de porter la
croix attachée à un ruban rouge. PI. X X V I I , fig. 83
de Blafon, du Dicl. raif des Sciences, &c. (G. D . L.T.')
§ ALIZIER, ( Botanique. ) en latin cratcegus, en
en anglois wild fervice, c’eft-à-dire forbier fauvage,
en allemand wildefpeyerlingbaum. Cratcegus vient des
deux noms grecs zpctToç, force, 6c , aiyoç, ckevre ,
parce qu’apparemment les chevres broutent volon-
tiers les buiffons d'alisier aux lieux montagneux, &
que fes feuilles font pour elles une nourriture faine
6c fortifiante.
Caractère générique.
Le calice eft permanent, il porte cinq pétales
arrondis, creufés en cuilleron, 6c une vingtaine d’étamines
terminées par des fommets arrondis. L’embryon
renfermé dans le calice devient une baie fuc-
■ culente ou farineufe , qui contient ordinairement
deux pépins. Les fleurs font raffemblées en bouquets.
Nous n’avons tracé ce cafa&ere, que p£ur ne pas
déroger à l’ordre que nous nous fommes preferit ;
car il eft impolîible d’afligner entre les alisiers, les
neffliers, les forbiers & les poiriers, des différences
affez marquées & affez invariables pour qu’on ne
puiffe pas les confondre. Ces genres, auxquels on
pourroit joindre les coignaffiers & peut-être les pommiers
, ne préfentent dans leur réunion qu’une famille
immenfe : la nature femble plutôt s’être attachée
à conferVer entr’eux un air de parenté, qu’à
appuyer fur les traits cara&ériftiques qui les différencient
: n’a-t-elle pas voulu nous avertir par ces
reffemblances extérieures, de celles qui fe trouvent
dans les parties internes de ces arbres? Ne nous fait-
elle pas foupçonner que cette famille a été agrandie
par des alliances, 6c qu’il en eft même déjà né de
nouvelles races? o u , fuppofé qu’elle couvre encore
de quelques ombres ce myftere dont la connoiffance
feroit plus curieufe qu’utile , ne nous indique-t-elle
pas au moins le fecours que nous pourrions tirer
de la reflemblance de ces arbres, foit pour obtenir
des variétés nouvelles en rapprochant leurs fexes,
' foit pour fixer & perpétuer par la greffe celles qui
auront pu naître d’un accouplement fortuit.
Il n’eft prefque pas une efpece de tous ces genres
qui ne puiffe fe greffer fur toutes les autres : j’en ai
fait l’expérience ; 6c ce moyen a des ufages que l’in-
duftrie peut varier, dans la vue de l’utilité ou de l’agrément.
Tout le monde fait que certains poiriers
greffés fur coignaffiers, font plus précoces & frufti-
fient davantage, & que leurs fruits font d’une qualité
fupérieure , tant pour l’abondance 6c le goût de
leurs fucs, que pour leur beauté 6c leur groffeur.
D ’autres efpeces de poiriers, au contraire, s’accommodent
mieux de l'alisier, du forbier, du nefflier
& de l’azerolier : ils y donnent des fruits dix ans
plutôt qu’ils ne feraient, s’ils étoient greffés fur le
poirier fauvage. Veut-on groffir le fruit du nefflier
ou du forbier, on le greffe fur poirier. S’agit-il d’obliger
le forbier, dont le rapport eft fi tardif, à montrer
fon fruit de bonne heure, qu’on le greffe fur
l’épine blanche. Eft-on preffé de multiplier les ef--
peces rares d’entre les épines 6c azeroliers d’ornement,
pour jouir plutôt de leurs fleurs, on les greffé
fur l’aubepin. Ces fujets font fort propres auffi à
donner plus de vigueur 6c de hauteur aux amelan-
chiers 6c cotonafters, qui ne font que de frêles
arb uftes.
Nous avons donc bien plus d’intérêt à obferver
la reflemblance de tous ces genres, qu’à en marquer
les différences ; mais comme ils font en grand nombre
, 6c qu’ils .ont fous eux quantité d’efpeces, il
faut les féparer pour le foulagement de la mémoire*
C ’eft dans cette vue que nous nous bornons à tran-
ferire les feuls a lis ie r s , auxquels l’ufage le plus général
a confervé ce nom. Nous préviendrons pourtant
le lefteur que Linnæus a réuni fous le genre des
cratcegus, l’oxyacantha, Paronia, qui eft l’azerolier
de Provence, l’épine de Virginie, 6c d’autres efpeces
que nous réfervons pour l'article M e s p i l l u s .
Efpeces.
1. Ali fur à feuilles ovales, inégalement dentelées
, 6c velues par-deffôus.
Cratcegus foliis ovatis, incequaliter ferratis , fubtui
tomentojis. Hort. Cliff. 187. aria Dalechamp.
White beam or white le'af-tree.
2. A li fe r à feuilles cordiformes, feptangulaires,
dont les lobes inférieurs font divergens.
• Cratcegus foliis cordatis , feptangulis, lobis infimis
devaricatis. Linn. Sp. pl. 476. Sorbus torminalis.
Mefpillus apii folio.
Wild or mapple leav'd fervice, c’eft-à-dire forbier
fauvage ou d feuille dérable.
3. A li fe r à feuilles ovales oblongues, dentées,
6c vertes des deux côtés ; alifer d’Italie.
Cratcegus foliis oblungo - ovatis, ferratis , utrinque
virentibus. .
Cratcegus with an oblong faw'd leaf green on both
Jîdes.
4. A life r à feuilles oblongues & ovales, crénelées
»argentées par-deffous. A life r nain, alifer de
Virginié, alifer à feuillesd’arboufier.
Cratcegus foliis oblungo - ovatis, crenatis , fubtus
argenteis.
Virginean cratcegus , with an drbutus leaf.
Nous ne trouvons dans le Traité des arbres & ar-
bufies de M. Duhamel, qu’une efpece qu’on ne puiffe
pas rapporter à celles-ci, c’eft la fuivante.
5. A life r à feuilles arrondies, dentelées , 6c blanches
en deffous , ou alouche de Bourgogne.
Cratcegus folio fubrotundo, ferrato, fubtus incano.
Injl.
Je fuis porté à croire que cette efpece ne différé
pas de celle que j’ai reçue fous le nom d’alifer de
Fontainebleau , & fous celui d’alifer à gros fruit.
6. A life r à feuilles plus rondes que longues, légèrement
découpées, blanchâtres 6c laineufes des
deux côtés.
Cratcegus foliis fubrotundis , leviter diffeclis , utrinque
lanuginojîs. Hort. Col.
Cette efpece m’a été envoyée fous le nom d’«//-
f e r à fruitjaune, 6c paroît ne pas différer d’un alifer
que j’ai reçu fous le nom d’allier. Le caraétere lanugineux
du deffus de la feuille, n’eft bien fenfible que
dans les jeunes feuilles.
7. A life r à feuilles de pommier, à écorce rude,
à gros fruit jaune, figure en poire.
Cratcegus mali folio , cortice feabro, fructu magno
luteà pyriformi. Hort. Col.
Cet arbre paroît former une nuance très - déliée
entre les ali fers 6c les poiriers, tant par la forme
extérieure du fru it, que par les cinq loges qui fe
trouvent à fon centre, 6c qui contiennent chacun
un pépin. Auffi quelques-uns l’appellent - ils alifer-
poirier. Plufieurs pépinieriftes le cultivent fous le
nom d'açerolier à gros fruit. On le greffe avec fuccès
fur Y alifer n°. i , fur l ’épine & fur le poirier. IÎ
pouffe médiocrement fur Y alifer 6c plus vigoureu-
fement fur l’épine ; fur poirier il vient fort bien ,
végété fobrement, ne tardé point à rapporter, 6c
donne un plus gros fruit, fur - tout fi l’on confie fon
bourgeon à un poirier de beuré ou d’épargne.
Ce petit fruit eft très-joli, 6c je le préférerais*
pour le goût, aux forbes, aux neffles 6c aux azeroles :
on en fait des confitures charmantes. Cet arbre porte
à la fin de mai, d’affez gros bouquets de fleurs blam
ches, qui lui affignent une place dans le bofquet de
ce mois. Son feuillage n’a aucun mérite* mais i’éeîr.t
de fon fruit doit le faire entrer dans la compofition
des bofquets d’été.
Les alifers n°. 1 6c n°. 2, ont pour l’agrément
les mêmes ufages que l’efpece précédente : le fruit
du premiér eft d’un rouge éclatant, 6c celui du fe7
cond, d’un brun dbfcur quand il mollit : alors il eft
affez bon à manger, & on le vend par bouquets fur
les marchés en Allemagne. Le premier fé trouve
plus ordinairement dans les bois qui couvrent les
montagnes 6c les rochers ; le fécond habite plus vo lontiers
la plaine. Leur bois eft fort dur, félon M .
Duhamel, on en fait des alluchons, des fufeaux
dans les rouages des moulins : il eft recherché par
les tourneurs, 6c. les menuifiers en font la monturë
de leurs outils.
Lorfque le vent agite les rameaux de Y alifer n°. 1,
il découvre le deffous des feuilles , 6c l’arbré paroît
tout blanc. Cet effet forme dans les plantations d’agrément
une variété très-pittorefque : il vient fort
.bien de graines préparées & femées félon la méthode
détaillée à Y article Alaterne : On les feme en novembre
ou décembre, & elles lèvent ordinairement
à la fin d’avril. Si les petits alifers font bien gouvernés,
au bout de fept ans ils formeront des arbres
propres à être plantés à demeure.
Le n°i 2 fe multiplié de même ; mais fa graine ne
îeve pas auffi aifément ni auffi abondamment, &
les jeunes arbres font bien plus long-tems avant de
pouvoir figurer: c’eft pourquoi je confeillerois d’enlever
dans lés bois de jeunes arbres de trois à quatre
pieds de haut* provenus de graines ou de furgeons,
6c de les élever en pépinière pendant quelques
années.
Nous n’avôns pas cultivé Y alifer n°. 3 , àinfi nous
allons traduite ce que Miller en dit.
«Ce t alifer croît de lui-même fur le mont Baldus
» & dans d’autres parties montagneufes de l’Italie :
» il s’élève environ à vingt pieds de haut, fe divifant
» en plufieurs branches bien fournies de feuilles
» oblongues & dentées, difpOfées alternativement,
» 6c attachées à des pédicules très-courts : fes feuilles
» ont environ trois pouces de long fur un & demi
>* de large; elles font d’un brun obfeur dés deux
» côtés. Les fleurs naiflènt au bout des branchés par
» petits bouquets compofés ordinairement de qua-
» tre ou cinq ; elles font blanches, & bien plus
» petites que celles des efpeces précédentes : il leur
» fuccede des fruits de la groffeur de ceux de l’épine
» blanche , qui deviennent d’un brun obfeur en
» mûriffant. Cette efpece fe multiplie comme les
» autres, mais elle demande une terre forte &
» profonde, autrement elle rte profite pas: elle ré-
» fifte fort bien au froid. Elle eft à préfent fort
» rare en Angleterre ».
QLe caraôere exprimé dans la phrafe de l’efpece
n • 4 » paroît convenir à un petit alifer que nous
cultivons fous le nom d'alifer de Virginie; cependant
nous n’ofons l’affurer, i° . parce que la baie de
no5tre a^ifer nain devient très-noire; 6c Miller dit
qu elle eft d’un pourpre très-foncé : 2®. parce qu’il
ne paroît guere devoir s’élever au-deffus de trois ou
quatre pieds, 6c que Miller dit qu’il s’élève à fix :
30. parce que fa baie contient nombre de pépins ;
&c que le caraétere des alifers eft de n’en avoir
guère plus de deux.
Quoi qu’il en foit, l’efpecé que nous cultivons êft
un très-joli arbufte, qui fe charge vers la fin de mai
«gaffez gros bouquets de fleurs blanches , garnies
d une houpe d etamines à fommets purpurins. Cette
parure luiaffigne une place fur les devants des riiaffifs
des bofquets de mai : le nombre prodigieux de baies
noires 6c luifantes dont il eft couvert fur la fin de
Juillet, doit le faire employer dans les bofquets
d’été. On peut l’enter ou l’écuffonner fur l’épine
blanche ; mais la greffe prend difficilement ; il pouffé
des branches fi menues, qu’on peut à peine y trouver
dés feions ou des écuffons convenables, & ii
faut une grande dextérité pour les manier. Il y a un
autre inconvénient, c’eft que le fujet devient très*-'
gros , en proportion de la greffe qui s’y trouve im-^
plantée, ce qui caufe enfin la perte de cet arbufte ,
qui paroît d’ailleurs défeâueux par bette difpro-
pôrtion.
C ’eft ce qu’on peut éviter en lè. greffant fur le
cotonafter ou fur l’amélanchier, qui font à-peu-près
de la même taille que lui ; mais il ne faut pas négliger
de le multiplier par là femence : c’eft le feu!
moyen de lui donner toute la hauteur & toute la
beauté dont la rîàture l’a rendu fufceptible. On prépare
fes baies 6c l’on feme fes graines fuivant la méthode
détaillée à Y article Alaternè. Les. plantules
qui en proviennent font d’abord des progrès très-
lents, mais la quatrième année elles pouffent avec
vigueur.
J’ai greffé les alifers n°. 5 & n°. 6 fur l’aria & fut
l’épine blanche ; les écuffons s’attachent & reprennent
f o r t bien. Je n’ai encore vu ni leurs fleurs, ni
leurs fruits. Sur l’épine il faut écuffônner fort bas ;
mais fiir l’aria , qui eft notre n°. 1 , on peut pofer
l’écuffon auffi haut que l’on voudra, pourvu que ce
ne foit pas fiir unë tige trop grêle. (M. le Baron D E
T s c h o u d i .')
ALK., f. m. ( Hijl. fiai. Orniihàlog. ) oifeau aquatique
de la famille des unes j c’eft-à-dire, de ceux
qui ont, comme furie où le guillemot, trois doigts
feulement, tous antérieurs 6c réunis enfemble d’un
bout à l’autre par une membrane lâche. Celui-ci
s’appelle alk en N o rvè g e , qui eft fon pays natal ;
mais ce nom a fubi divers changemens en paffant chez
divers peuples 6c divers auteurs. Eufebe Niereriiberg
l’appelle alck, l’Eclufe alka, Ray alca, les Anglois
leptentrionaux auki En Suède on le con'noît fous les
noms de tord 6c tordmiile, en Angleterre fous ceux dé
murre * ruck, ragônbill. Klein l’appelle plautus tohfor ,
M. Linné alca, torda , rojlti fulcis 4 , lineâ utrinque
àltâ a rojlro ad oculosi Syjlema naturce , edit. 12 ÿ
pag. 210, n°. 1. Albin en a publié une figure paffable,
fous le nom à. oifeau à bec tranchant, vol. III.pag. 40 4
planch. X X V . Enfin M. Briffon en donne Une def-
cription & une figure plus exaéte fous la dénomination
fuivante : le pingoin, alca fuperht nigra, infernè
alba j lineâ utrinque à rojlro ad oculos candidâ; gutture
& cùlli inférions parte fupremâ fulginojîs ; remigibus
minôribus albo in apice marginatis; reBric'tbus nigrH
cantibus . . . . . alca. Ornitholog. vol. VI. pag. 8g ,
planch. VIII. fig. 1.
Ualk eft un peu moins gros que le canard domefti-
que ; mefuré du bout du bec à celui de la queue , il
a quatorze pouces un quart, & jufqu’au bout des
ongles quatorze pouces & demi de Ionguèur. Son
bec a de fon extrémité aux coins de la bouche deux
pouces de long , & de largeur à fâ bafe dix lignes.
Ses ailes, lorfqu’elles font pliées dans leur fituation
naturelles, atteignent à peine au milieu de la longueur
de la queue ; mais lorfqu’elles font étendues ,
elles ont deux pieds de vol. La longueur de fa queue