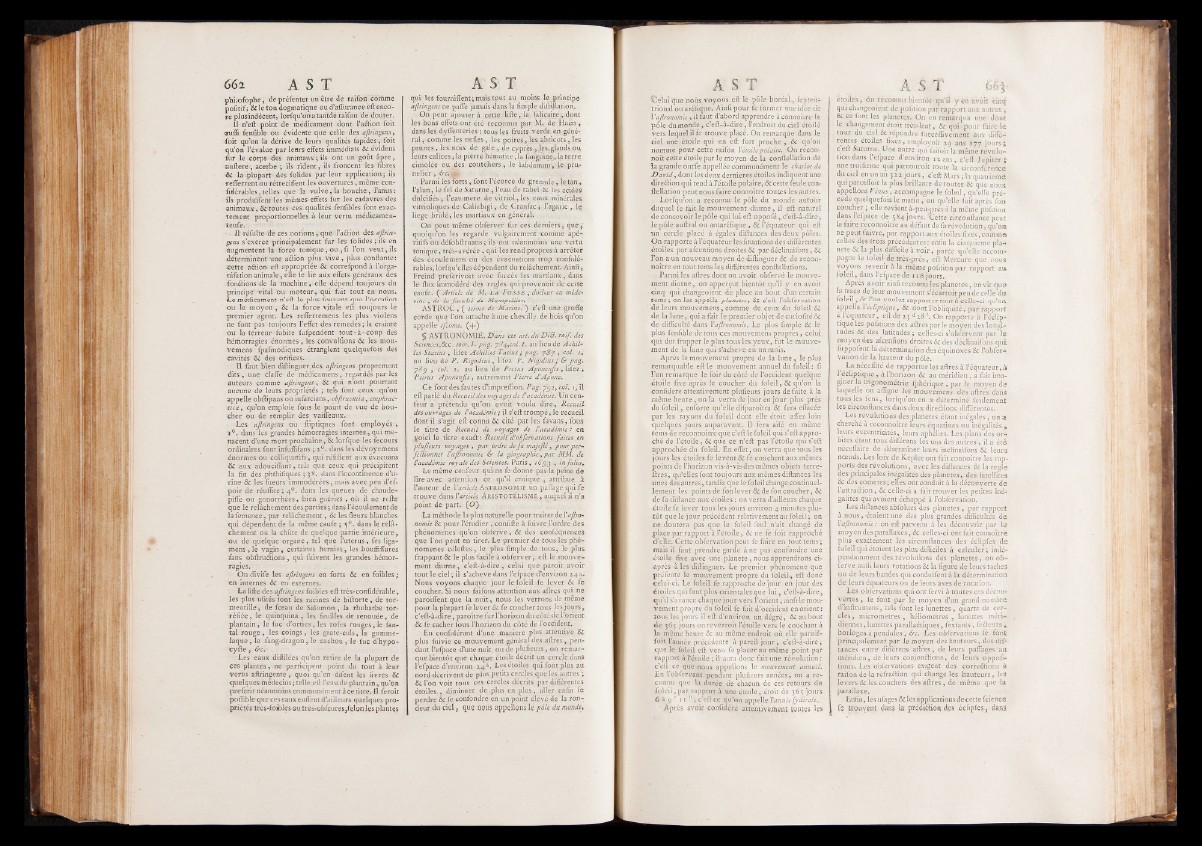
m
66î A S T
phiiofophe, de préfenter un être dç raifon comme
pofitif; & le ton dogmatique ou d’affurance eft encore
plus indécent, lorfqu’on a taritdé raifon de douter.
Il n’eft point de médicament dont l’a&ion foit
aufli fenfible ou évidente que celle des ajlringens,
foit qu’on la dérive de leurs qualités fapides;'foit
qu’on l’évalue par leurs effets immédiats & évidens
lur le corps des1 animaux; ils ont un goût âpre,
auftere -, acerbe ; ils rident, ' ils froncent les fibres
& la-plupart des folidës par leur application; ils
refferrent ou rétreciffent les ouvertures, même con-
lidérables, telles que la vulve,'la bouche,"l’anus:
ils produifent lès mêmes effets fur les cadavres des
animaux, & ftôutes >ces-qualités fenfibles font exactement
proportionnelles à leur vertu médicamèn-
teufe.1 ;
- Il réfulte de ces notions ; que l’aftion des ajlringens
s’exerce principalement fur les folides;ils en
augmentent la force tonique, o u , fi l’on veut,ils
déterminent'ïine aûion plus v iv e , plus confiante:
reette aétion« eft appropriée & correfpond à l’orga-
■ nifation animale , elle fe lie aux effets généraux des
fonctions-de la machine, elle dépend toujours du
principe'vital-'Ou7 moteur, qui fait tout en nous.
Le médicament n’eft le plus fouvent que l’occafion
ou le moyen:, & la force vitale efi toujours le
premier agent. Les refferremens les plus viôlens
ne font pas toujours l’effet des remedes ; la crainte
ou la terreur fubite fufpendént tout-à- coup des
hémorragies énormes , les convuliions & les mou-
vemens fpafmodiques étranglent quelquefois des
cavités & des orifices. ■
Il faut bien diftinguer,des ajlringens proprement
dits , une claffe de médicamens, regardés par les
auteurs comme ajlringens, & qui n’ont pourtant
-aucune de leurs propriétés ; tels font ceux .qu’on
appelle obftipans ou infarcians, obflruentia, emphrac-
:tica, qu’on emploie fous, le point de vue de boucher
ou de remplir des- vaiffeaux.
Les ajlringens ou ftiptiques font, employés:,
i ç . dans les grandes hémorragies internesqui menacent
d’une mort prochaine, & lorfque les lecours
ordinaires font infuffifans ; z°. dans les dévoyemens
énormes ou ;colliquatifs, qui réfifterit aux évacuans
•& aux adoucifians, tels que ceux qui précipitent
la fin des phthifiques ; 3?. dans l’incontinence d’urine
& lés fueurs immodérées, mais avec peu cL’ef-
poir de réuffite ; 40. dans les queues de chaude-
piffe ou gonorrhées, bien guéries , ou il ne refie
que le relâchement des,parties; dans l’écoulement de
lafemence, par relâchement, & les fleurs blanches
•qui dépendent de la même caufe ; 50. dans le relâchement
ou la chute de quelque partie intérieure,
ou de quelque organe, tel que ï’uterus, fes liga-
-mens, le vagin , certaines hernies., les bouffiffures
fans obftruétions , qui fuivent les grandes hémorragies.
On divife les ajlringens. en forts & en foibles ;
en internes & en externes.
La lifte des 'ajlringens foibles efi très-corifidérable,
-les plus ufités font les racines de biftorte, de tor-
mentille, de fceau de Salomon , la rhubarbe torréfiée
, lé quinquina , lés feuilles de renouée, de
plantain, le fuc d’orties , les rofes rouges, le fautai
rouge , les. coings, les grate-culs, la gomme-
laque , le fang-dragon, le cachou , le fuc d’hypo-
c y fte , &ci' .
Les'eaux diftilées qu’on retire de la plupart de
ces plantes,tne participent point du tout à leur
•Vertu aftringente, quoi qu’en difent les livres &
quelques-médecins;telle efi Peau de plantain, qu’on
prefcrit néanmoins communément à ce titre. 11 feroit
poffibleque ces eaux euffeni d’ailleurs quelques propriétés
très-fo&les ou très-obfçiires?fçlon les plantes
A S T
qui les foûrniffeht; mais tput au moins le, ,principe
ajlringent ne paffe jamais dans la fimpje difti|lation.
On peut ajouter à cette lifte , .la, falieaireï;-dont
les bons effets ont été reconnus par -Mv de- Haën ,
dans les dyffenteries : tous les fruits verds; en généralcomme
les nefles, les poires.,-les .^briçets., les
-primes,.les. noix de. gale , de cyprès^ les.,glands ou
leurs calices, la pierre hématite, la fanguine,, la terre
cimolée ou des couteliers, ,1e labdanumy;,le- pru-
nelier, &c.
Parmi les forts, font l’écorce de grenade-a le tan,
l’alun, le fel de Saturne , l’eau derabel-ôç îesacjdes
dulcifiés, l’eau-mere de vitriol, les .eaux minérales
vitrioliques de Calfabigi, de Cranfac ; l’agaric , le
liege brûlé, les martiaux .en général ,
On peut même obferver fur eescdemiers, que,'
quoiqu’on les regarde vulgairement, -comme apéritif!
ou défobftruàns ; ils ônt néanmoins une vertu
tonique, très-avérée, qui les rend praprescà arrêter
des écoulemens ou des évacuations trop 'canfidé»
rables, lorfqu’ellès dépendent du relâchement.Ainfi,
Freind prëlcrivoit -avec fuccès les martiaux, dans
le flux immodéré des -réglés- qui provenoit- ;de cette
caufe. [Article dé M, LA Fosse , docteur• en' médecine
, de la faculté de Montpellier, rafl
ASTROÇ , ( terme de Marine.'J c’eft-line grofîe
cordé que l’on attache à une cheville de bois qu’on
appelle efcome. (+ )
§ ASTRONOMI £. Dans cet- art. du -Dicl. ràif. des
ScienceSy&Lc. toin.l. pag. jS^Jcol.l. au» lieude Athil-
lès Statïüs ; life-z Aohilles Tàtius ; pag:-ySf Jûcol: /.
au lieu dé-P. Rigodius J liiez P. Nlgidius:;'& pag.
j8cj , col. 2. au liëii 'dé - Prétus Aponenjis, -lifez,
Petrus Apohenjis, autrement Pierre diApone. .
Cè font desfautës d’imprefiion. Pagi fc)2, col. 1, il
eft parlé du Recueil des voyages de l ’académie. XJn cen-
lèur a prétendu qu’on avoit voulu dire, Recueil
des ouvrages de Cacademie; il s’eft trompé, le recueil
dont il s ’agit eft connu & cité par les fàvans, fous
le titre de Recueil de voyages de l'académie : en
yoici le titre exaét : Recueil d’obfervations faites en
plufieurs voy ages , par ordre de fa majeflé, pour perfectionner
Vaflronomie & la géographie'., par MM. de
£ académie royale des'-Sciences. Paris ,- ' / ÇcfQ.., in folio,
Le même cenfeur qui'ne fe donne pas la peine de
lire avec attention, ce qu’il critique , attribue à
l’auteur de 'Particle.Astronomie un p.aflage qui fe
trouve dans l’article Aristotélisme , auquel il n’a
point de part. (O) ,
La méthode la plus naturelle pour traiter de Y agronomie
& pour l’étudier ^confifte à fuivre l’ordre des
phénomènes qu’on obferve, & des conl'équences
que l ’on peut en tirer. Le premier de-tous lés phénomènes
céleftes, le plus-fimple de tous, le plus
frappant & le plus facile à obferver, eft le mouvement
diurne, c’eft-à-dire , celui que pàroît avoir
tout le ciel ; il s’acheve dans l’efpace d’environ 24 fa.1
Nous voyons chaque jour le foleil fe. -lever & fe
coucher. Si nous faifons attention aux aftres qui ne
paroilfent que la nuit, nous les verrons de même
pour la plupart fe lever & fe coucher tous les jours,
c’eft-à-dire, paroître fur l’horizon du côté d.e ,l’orient
& fe cacher fous l’horizon du côté de l’occident.
En confidérant d’une maniéré plus, attentive &
plus fui vie ce mouvement général des aftres, pendant
l’efpace d’une nuit ou de plufieurs, on remarque
bientôt que chaque étoilé décrit un cercle.dans
.l’efpace d’environ 24 h. Les étoiles qui font plus au
nord décrivent de plus petits cercles que les autres ;
& l’on voit tous ces cercles décrits par différentes
étoiles., diminuer de .plus en plus.,, aller .enfin fe
perdre & fe confondre en un point élevé de la rondeur
du ciel, que nous appelions le pôle du, monde*
A S T
fjëkii ^jne nous voyons.eft lè pôle boréal, fepten-
trional ou arétique. Ainfipour le former une idée dè
Vajlronomie > il faut d’abord apprendre à cônnoître le
pôle du monde , c’eft-à-dire, l’endroit du ciel étoilé
vers -lequel il fe trouve placé. On remarque dans le
ciel-une-étoile-qui en eft fort proche., & qu’on
nomme pour cette raifon 1 'étoile polaire. On recon-
noîtcette étoile, par le moyen delà conftellàtion dè
la grande durfe appellée communément le chariot de
David, dont les deux dernieres étoiles indiquent une
dire&ion qui tend à l’étoile polaire, & cette feule con-
fteliation peut no.us faire cônnoître toutes les autres.
. Lorfqu’on a reconnu le pôle du monde-, autour
duquel fe fait le mouvement diurne, il eft naturel
de concevoir le pôle qui lui eft oppofé, c’eft-à-dire-,
le pôle auftral ou antarétique , & l’équateur qui eft
■ un cercle placé à égales diftances des deux pôles-.
On rapporte àlféquateur les fituations des différentes
étoiles par afeenfions droites & par déclinaifons, &
l’on a un nouveau moyen de diftinguer & de reeon-
noître en tout tems les différentes conftellations.
-Parmi les aftres dont on avoit obfervé le mouvement
diurne, on apperçut bientôt qu’il y en âyoit
cinq qui changeoierit de place au bout d’un certain
tems ; on -les appella planètes, & c’eft rôbfervation'
de leurs mouvemens, comme de. ceux du foleil &
de la lune, qui a fait le premier objet de curiofité &
de difficulté dans Vagronomie. Le plus fimple & le
plus fenfible de tous ces mouvemens propres, celui
qui dut frapper le plus tous les yeux, fut le mouvement
de la lune qui s’acheve en un mois.
.. Après le mouvement propre de la lune, le plus
remarquable eft le mouvement annuel du foleil: fi
l ’on remarque le foi-r du côté de l’occident quelque
•étoile fixe après le coucher du foleil, & qu’on la
confidere attentivement plufieurs jours de fuite à la
même heure, on la verra de jour en jour plus près
du foleil, enforte qu’elle difparoîtra & fera effacée
par les rayons dit foleil dont elle étoit affez loin
quelques' jours auparavant. Il fera aifé en même
tems de reconrioître que c’eft le foleil qui s’ eft approché
de l’étoile, & que ce n’eft pas l’étoile qui s’eft
approchée du foleil. En effet, on verra que tous les
jours les étoiles fe lèvent & fe couchent aux mêmes
points dè l’horizon vis-à-vis des mêmes objets terrestres,
qu’elles font toujours aux mêmes diftances les
unes des autres , tandis que le foleil change continuellement
les points de fonlever & de fon coucher, &
de fa diftance aux étoiles-: on verra d’ailleurs chaque
étoile fe lever tous les jours environ 4 minutes plutôt
que le jour précédent relativement au foleil ; on
ne doutera pas que le foleil feul n’ait changé de
place par rapport à l’étoile, & ne fe foit rapproché
d ’elle. Get'te obfervation peut fe faire en tout tems;
mais il faut prendre garde à ne pas confondre une
étoile fixe avec -une plànete , nous apprendrons ci-
après à les diftinguer. Le premier phénomène que
préfente le mouvement propre du foleil«, eft donc
celui-ci. Le foleil fe rapproche de jour en jour des
étoiles qui font plus orientales que lui, c’elkà-dire,
qu'il s’avance chaque jour vers l’orient ; ainfile mouvement
propre du foleil fe fait d’occident en orient:
tous les jours il eft d’environ un degré, & au bout
de.3.6-5 jours onreverroit l’étoile vers le couchant à
la même heure & au même endroit où elle paroif-
foit l’année précédente à pareil jour, c’eft-à-diré,
que le foleil eft venu fe placer au même point par
rapport à l’étoile ; il aura donc fait une révolution:
c ’eft ce que nous appelions le mouvement annuel.
En l’obfe rvant pendant plufieurs années, on a reconnu
que la durée de ehacun. de ces rètôurs du
foleil,par rapport à une étoile,. étoit de 365 jours
6 h Cf ' 1 1 11 ; c’eft ce qu’on appelle \année fydérale.J
■ Après avoir conûdéré attentiveixienî Louées les
À S T 66^
étoiles, ôn rëconnut bientôt ‘qu’il y en avoit cinq
qui changeaient de pofition par rapport aux autres ;
& ce font les planetès. Gn en remarqua uhe dont
le. changement étoit très^lent, & qüi pour faire lé
tour du ciel & répondre fucceffivement aux différentes
étoiles fixes, employoit 20 ans 177 jours j
e eft Saturne. Une autre qui faifoit la même révolution
dans l’efpace d’environ 12 ans, c’eft Jupiter j
une troifieme qui parcouroit toute la ch-'cônféfexicé
du ciel en un an 3 22 jours, c’eft Mars ; là quatriemê
qui paroiffoit la plus brillante de toutes & que nôuâ
appelions Vénits -, açcompagne le foleil, qu’elle précédé
quelquefois le matin, ou qu’elle fuit après fon
coucher ; elle revient à-peu-près à la même pofition
dans lefpâce de 584 jours. ‘Cette circonftanee peut
la faire reconnoitre au défaut de fa révolution, qu’oit
ne peut fùivrej par rapportaux étoiles fixes, coriimo
celles des trois précédentes: enfin la cinquième planète
& la plus difficile à voir, parce qu’elle accompagne
le foleil de très-près, eft Mercure que nous
voyons revenir à la même pofition par rapport au
foleil, dans l’efpaeé de 116 jours. •
Après avoir ainfi rècônnu les pianètés, bii vit que
h trace de leur mouvement s’écartoitpeu de celle dit
foleil, & l’on voulut rapporter tout à celle-ci qu’ort
appella ¥ écliptique, & dont l’obliquité; par rapport
à l’équateur, eft de 23 d28/. On rapporte à l’éclip-
tique les pofitions des aftres parle moyen des longitudes
&c des latitudes ; celles-ci s’obfervent par lë
moyen des afeenfions droites & des déclinaifons qui
fuppofent là determinaifon des équinoxes & l’obfer-,
vation de la hauteur du pôle.
, néeeffité de rapporter les aftres à l’équateur, à:
I écliptique, à l’horizon & au méridien, a fait imaginer
la trigonométrie iphérique, par le moyen dé
laquelle on affigne les mouvemens des aftres danS
tous les fens, lorfqu’on en a déterminé feulement
les circonftanees dans deux direftions différentes.
. Les révolutions des planètes étant inégaiès, ôn à
cherche à reconnoxtre leurs équations ou inégalités ^
leurs excentricités, leurs aphélies. Les plans des orbites
étant tous diffère ns les uns des autres , il à été
néceffaire dé déterminer leurs inclinaifons & leurs
noeuds. Les loix de Kepler ont fait .connoître les rap^
ports des révolutions, avec les diftances & la réglé
des principales inégalités des planètes, des fatellites
& des cometes ; elles ont conduit à la découverte de
l’attraftion, & celle-ci a fait trouver les petites inégalités
qui avôient échappé à l’obfervation.
Les diftances abfoliies des planètes , par rapport
à nous, -étoient une des plus grandes difficultés de
Yajlronomie : on eft parvenu à les découvrir par le
moyen des parallaxes, & celles-ci ont fait connoître
plus exactement les circonftanees des éclipfes de
loleil qui étoient les plus difficiles à calculer; indépendamment
des révolutions des planètes, on. ob-
lerve aulfi leurs rotations & là figure de leurs tâches
ou de leurs bandes qui eonduifent à la détermination
de' leurs équateurs ou de leurs axes de rotation;
Les observations qui ont fervi à toutes ces décou-».
vertes, fe font par le moyen d’un grand nombre
d’inftrumenSj tels font les lunettes, quarts de cercles
, micromètres , héliometres , lunettes méridiennes,
lun'èttes parallaétiqués, fextants, feéieurs ^
horloges à pendules,- &c. Les obfer varions, fe font
principalement par le moyen des hauteurs, des difc
tances entre différens aftres, de leurs paffages aii
méridien, de leurs conjonftions* de leurs appointions.
Les oblervations exigent des correétions à
raifon de la réfraftiôn qui change les hauteurs, les
levers & les couchers des aftres, de même que la
parallaxe.
Enfin, les ufages & les applications de cette fcience
fe trouvent daa§ la prçdiétioa d.es éclipfes ? dan$