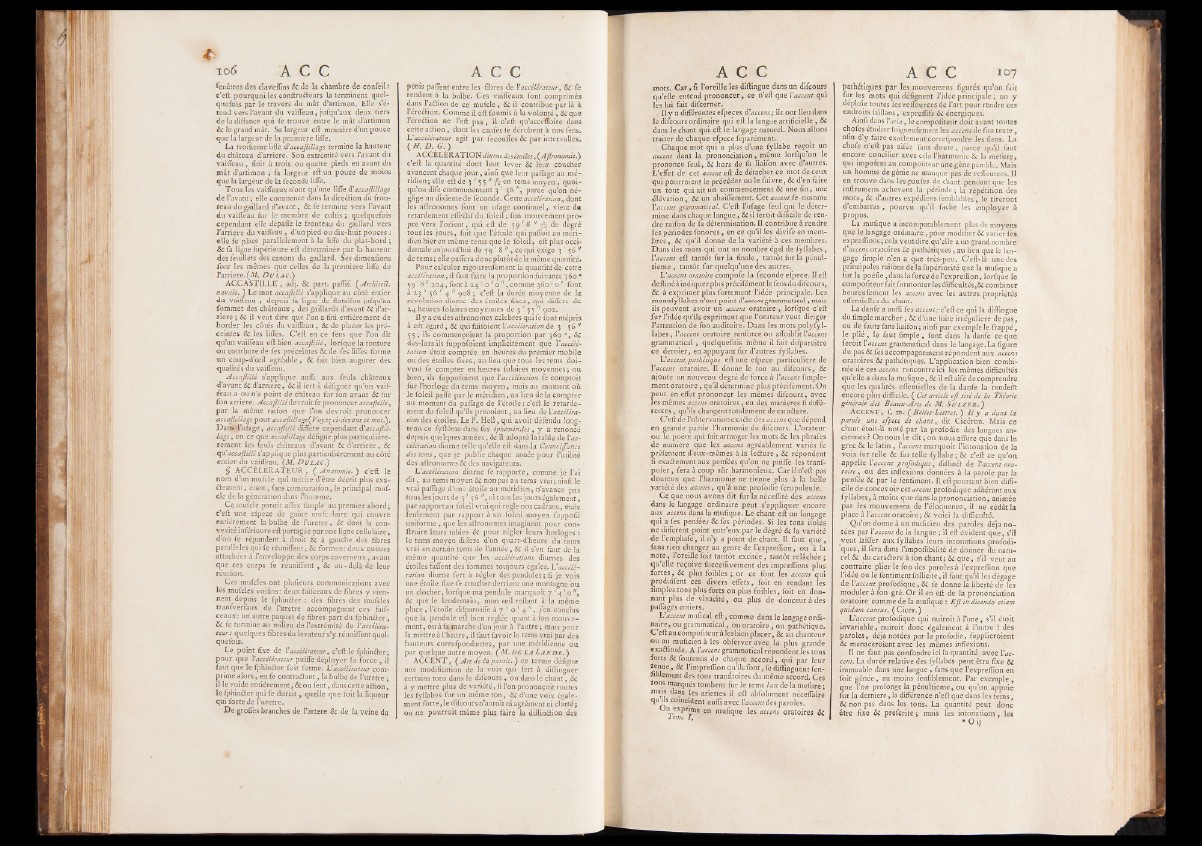
fenêtres des cîaveflins & de la chambre de confeîl :
c’eft pourquoi les conftruâeurs la terminent quelquefois
par le travers du mât d’artimon. Elle s’étend
vers l’avant du vaiffeau, jufqu’aux deux tiers
de la diftance qui fe trouve entre le mât d’artimon
& le-grand mât. Sa largeur eft moindre d’un pouce
que la largeur de la première liffe.
La troilieme liffe à! accajlillage termine la hauteur
du château d’arriere. Son extrémité vers l’avant du
vaiffeau, finit à trois ou quatre pieds en avant du
mât d’artimon ; fa largeur eft un pouce de moins
que la largeur de la fécondé liffe.
Tous.les vaiffeaux n’ont qu’une liffe <Y accajlillage
de l’avant ; elle commence dans la dire &i on du fronteau
du gaillard d’avant, 6c fe termine vers l’avant
du vaiffeau fur le membre de coltis ;. quelquefois
cependant elle dépaffe le fronteaii du gaillard vers
l’arriere du vaiffeau, d’un pied ou dix-huit pouces :
elle fe place parallèlement à la liffe du plat-bord;
& fa ligne fupérieure eft déterminée par la hauteur
des feuillets des canons du gaillard. Ses dimenfions
font les mêmes que celles de la première liffe de
l’arriere. (M. D u l a c .)
ACCÀSTILLÉT, adj. 6c part, paflif. ( Architecl.
navale. ) Le mot accajlillé s’applique au côté entier
du vaiffeau , depuis la ligne de flotaifon jufqu’au
fommet des châteaux, des gaillards d’avant & d’arriere
; & il veut dire que l’on a fini entièrement de
.border les côtés du vaiffeau, & de placer les préceintes
& les liffes. C ’eft en ce fens que l’on dit
qu’un vaiffeau eft bien accajlillé, lorfque la tonture
ou courbure de fes préceintes 6c de fes liffes forme
un coup-d’oeil agréable, 6c fait bien augurer des
qualités du vaiffeau.
Accajlillé s’applique aufli aux feuls châteaux
d ’avant & d’arriere, & il fert à défigner qu’un yaif-
feau a ou n’a point de château fur fon avant & fur
fon arriéré. Accajlillédevroit fe prononcer accajlellé-,
par la même raifon que l’on devroit prononcer
accajlellage pour accajlillage (Voye^ ci-devant ce mot J .
Dans4’ufage, accajlillé différé cependant àlaccajlillage
, en ce que accajlillage déligne plus particuliére-
rement les feuls châteaux d’avant & d’arriere, 6c
qu’accajlillé s’applique plus particuliérement au côté
entier du vaiffeau. (M. D u l a c J
§ A CC ÉLÉRA TEU R, ( Anatomie. ) c’eft le
nom d’un mufcle qui mérite d’être décrit plus exactement,
étant, fans comparaifon,le principal mufcle
de la génération dans l’homme.
Ce mufcle paroît affez fimple au premier abord;
c ’eft une efpece de gaine mufculaire qui couvre
entièrement la bulbe de l’uretre, 6c dont là convexité
inférieure eft partagée par une ligne cellulaire,
d ’oii fe répandent à droit 6c à gauche des fibres
parallèles qui fe réunifient& forment deux queues
attachées à l’enveloppé des corps caverneux, avant
que ces corps fe réunifient, 6c au - delà de leur
réunion.
Ces mufcles ont plufieurs communications avec
les mufcles voifins : deux faifceaux de fibres y viennent
depuis le fphinfter : des fibres des mufcles
tranfverfaux de l’uretre accompagnent ces fa ifceaux:
un autre paquet de fibres part du fphinfter -,
& fe termine au milieu de l’extrémité de Y accélérateur:
quelques fibres du levateur s’y réunifient quelquefois.
Le point fixe de l’accélérateur, c’eft le fphinéter;
pour que Y accélérateur puiffe déployer fa force , il
faut que le fphinâer foit ferme. L’accélérateur comprime
alors., en fe contra étant, la bulbe de l’uretre ;
il le vuide entièrement, & on fent, dans cette aélion
le fphinéler qui fë durcit, quelle que foit la liqueur
qui forte de l’uretre.
De groffes branches de l’artere & de la veine du
pénis paffent entre les fibres de l'accélérateur, &T fe
rendent à la bulbe. Ces vaiffeaux font comprimés
dans l’aétion de ce mufcle , 6c il contribue par là à
l’éreâion. Comme il eft fournis à la volonté , & q u e
l’ereéfion ne l’eft pa s, il n’eft qu’acceffoire. dans
cette aélion, dont les caufes fe dérobent à nos fens.
Vaccélérateur agit par fecouffes & par intervalles.
( H. D . G. )
ACCÉLÉRATION diurne des étoiles, (AJlronomie.'),
c’eft la quantité dont leur lever & leur .coucher
avancent chaque jour, ainfi que leur paffage. au méridien;
elle eft de 3 ' 5 5 " Jz en tems moyen, quoiqu’on
dife communément 3 ' 56 ", parce- qu’on néglige
un dixième de fécondé. Cette accélération,.dont
les-aftronome? font un ufage continuel, vient du
retardement effe&if du foleil ; fon mouvement propre
vers l’orient, qui eft de 59 ' % " ~ de degré
tous les jours, fait que l’étoile qui paffoit au méridien
hier en même tems que le foleil, eft plus occidentale
aujourd’hui de 5 9 '8 " , ce qui exige 3 ' 56 "
de tems; elle paffera donc plutôt de la même quantité.
Pour calculer rigoureufement la quantité de cette
accélération, il faut faire la proportion fuivante 360 *
59'8 " 204, font à 2 4 h o ' o " , comme 360 0 0/ font
à 23 1 5 6 ' 4 " 908 ; c’eft la durée moyenne de la
révolution diurne des étoiles fixes, qui différé de
24 heures folaires moyennes de 3 ' 5 5 " 902.
. Il y a eu des aftronomes célébrés qui fe font mépris
à cet égard, & quifaifoient Y accélération de 3 ' <6 "
55; ils commençoient la proportion par 360 ° , &
dès-lors ils fuppofoient implicitement que Y accélération
étoit comptée en heures du premier mobile
ou des étoiles fixes, au lieu que tous les tems doivent
fe compter en heures folaires moyennes ; ou
bien, ils fuppofoient que Y accélération le comptoit
fur l’horloge du tems moyen, mais au moment où
le foleil paffe par le méridien, au lieu de la compter
au moment du paffage de l’étoile : c’eft le retardement
du foleil qu’ils prenoient, au lieu de Y accélération
des étoiles. Le P. Hell, qui avoit défendu long-
tems ce fyftême dans fes èphémérides , y a renoncé
depuis quelques années, 6c il adopté la table de Y accélération
diurne telle qu’elle eft dans la Conrioijfance
des tems, que je publie chaque année pour l’utilité
des aftronomes 6c dés navigateurs.
U accélération diurne fe rapporte, comme je l ’ai
dit, au tems moyen 6c non pas au tems vrai ; ainfi le
vrai paffage d’une étoile au méridien, n’avance pas
tous les jours de 3 ' 56 ", ni tous les jours également,
par rapportait foleil vrai qui réglé nos cadrans, mais
feulement par rapport à un foleil moyen fuppofé
uniforme, que les aftronomes imaginent pour con-
ftruire leurs tables & pour régler leurs horloges :
le tems moyen différé d’un quart-d’heure du tems
vrai en certain tems de l’année, & il s’en faut de la
même quantité que les accélérations diurnes des
étoiles faffent des fommes toujours égales. U accélération
diurne fert à régler des pendules ; fi je vois
une étoile fixe fe coucher derrière une montagne/oii
un clocher, lorfque ma pendule marquoit 7 114 ' p " ,
6c que le lendemain, mon oeil reftant à la même
place, l’étoile difparoiffe à 7 h o ‘ 4 " , j’en conclus
que la pendule eft bien réglée quant à fon mouvement
, ou à fa.marche d’un jour à l’autre ; mais pour
la mettre à l’heure, il faut favoir le tems vrai.par des
hauteurs correfpondantes, par une méridienne ou
par quelque autre moyen. ( M. de l a La n d e .')
A C C EN T , (A r t de la parole. ) ce terme défigne
une modification de la voix qui fert à diftinguer
certains tons dans le difeours , ou dans le chant, ,&
à y mettre plus de variété, fi l’on prononçoit toutes
les fyllabes fur un même ton, 6c d’une voix également
forte, le difeours n’auroit ni agrément ni clarté;
on ne pourroit même plus faire la diftin&ion .des
mots. C a r , fi l’oreille les diftingue dans un difeours
qu’elle entend prononcer, ce n’eft que Y accent qui
les lui fait difeerner.
II y a différentes efpeces d?accens; ils ont lieu dans
le difeours ordinaire qui eft la langue artificielle , 6c
dans lé chant qui eft le langage naturel. Nous allons
traiter de chaque efpece féparément.
Chaque mot qui a plus d’une fyllabe reçoit un
accent dans la prononciation, même lorfqu’on le
prononce feul, 6c hors de fa liaifon avec d’autres.
L ’effet de c et accent eft de détacher ce mot de ceux
qui pourroient le précéder ou le fuivre, 6c d’en faire
un tout qui ait un commencement 6c une fin * une
élévation, & un abaiffement. Cet accent fe nomme
Y accent grammatical. C’eft l’ufage feul qui le détermine
clans chaque langue, & i l leroit difficile de ren^
dre raifon de fa détermination. Il contribue à rendre
les périodes fonores, en ce qu’il les divife en membres
, 6c qu’il donne de la variété à ces membres.
Dans des mots qui ont un nombre égal de fyllabes,
Y accent eft tantôt fur la finale, tantôt fur la pénultième
, tantôt fur quelqu’une des autres.
L ’accent oratoire compofe la fécondé efpece. Il eft
deftiné à indiquer plus précifément le fens du difeours,
& à exprimer plus fortement l’idée principale. Les
monofyllabes n’ont point $ accent grammatical, mais
ils peuvent avoir un accent oratoire , lorfque c’eft
fur l’idée qu’ils expriment que l’orateur veut diriger
l ’attention de fon auditoire. Dans les mots polyfyl-
labes, Y accent oratoire renforce ou affoiblit Y accent
grammatical, quelquefois même il fait difparoître
ce dernier, en appuyant fur d’autres fyllabes.
L accent pathétique eft une efpece particulière de
Vaccent oratoire. Il donne le ton au difeours, &
ajoute un nouveau degré de force à Y accent Amplement
oratoire, qu’il détermine plus précifément. On
peut en effet prononcer les mêmes difeours, avec
les mêmes accens oratoires, en des maniérés fi différentes
, qu’ils changent totalement de caraftere.
C’eft de l’obfervationexaâe des accens que dépend
en grande partie l’harmonie du difeours. L’orateur
ou le poète qui fait arranger les mots 6c les phrafes
de maniéré que les accens agréablement variés fe
préfentent d’eux-mêmes à la led u re , & répondent
fi exa&ement aux penfées qu’on ne puiffe les tranf-
pofer, fera à coup sûr harmonieux. Car il n’eft pas
douteux que l’harmonie ne tienne plus à la belle
.variété des accens, qu’à une profodie fcrupuleufe.
Ce que nous avons dit fur la néceffité des accens
dans le langage ordinaire peut s’appliquer encore
aux accens dans la mufique. Le chant eft un langage
qui a fes penfées 6c fes périodes. Si les tons ifolés
ne different point entr’eux par le dégré 6c la variété
de Pemphafe, il n’y a point de chant. Il faut que ,
fans rien changer au genre de l’expreflïon, ou à la
note, l’oreille foit tantôt excitée, tantôt relâchée ;
qu’elle reçoive fucceffivement des impreffions plus
fortes, 6c plus foibles ; or ce font les accens qui
produifent ces divers effets, foit en rendant les
fimples tons plus forts ou plus foibles, foit en donnant
plus de vivacité, ou plus de douceur à des
paffages entiers. .
L accent mufical eft, comme dans le langage ordinaire,
ou grammatical, ou oratoire, ou pathétique.
C ’eft au compofiteur à les bien placer, & au chanteur
ou au mufîcien à les obferver avec la plus grande
exa&itude. A Y accent grammatical répondent les tons
forts 6c foutenïis de chaque accord, qui par leur
Jenue, & l’impreflîôn qu’ils font, fe diftinguent fen-
fiblememt des tons tranfitoires du même accord. Ces
îons marqués tombent fur le tems bon de la mefure ;
mais dans les ariettes il eft abfoîument néceffaire
qu ils coïncident auïïi avec Y accent des paroles.
On exprime en mufique les accens oratoires &
lome I,
pathétiques par les mouvemens figurés qu*on fait
fur les mots qui défignent l’idée principale ; on y
déploie toutes les refiources de l’art pour rendre ces
endroits faillans, expreftîfs & énergiques.
Ainfi dans Y aria, le compofiteur doit avant toutes
chofes étudier foigneufement les accens de fon texte,
afin d’y faire exactement correfpondre les fiens. La
chofe n eft pas aifée fans doute, parce qu’il faut
encore concilier avec cela l’harmonie & la mefure*
qui impofent au compofiteur une gêne pénible. Mais
un homme de génie ne manque pas de reffources. Il
en trouve dans les paufes de chant pendant que les
inftrumens achèvent la période ; la répétition des
mots, 6c. d’autres expédiens femblables, le tireront
d’embarras , pourvu qu’il fâche les employer à
propos. ,
La mufique a incomparablement plus de moyens
que le langage ordinaire, pour modifier 6c varier fes
expreflions; cela veut dire qu’elle a un grand nombre
d’accens oratoires 6c pathétiques, au lieu que le langage
fimple n’en a que très-peu. C ’eft-là une des
principales raifons delà fupériorité que la mufique a
fur la poéfie, dans la force de Pexpreflïon, lorfque le
compofiteur fait furmonter les difficultés,& combiner
heureufement les accens avec les autres propriétés
effentielles du chant.
La danfe a aufli fes accens: c’eft ce qui la diftingue
du fimple marcher, 6c d’une fuite irrégulière de pas,
ou de fauts fans liaifon; ainfi par exemple le frappé,
le p lié , le faut fimple , font dans la danfe ce que
ferôit Y accent grammatical dans le langage. La figure
du pas & fes accompagnemens répondent aux accens
oratoires 6c pathétiques. L’application bien combinée
de ces accens rencontre ici les mêmes difficultés
qu’elle a dans la mufique, 6c il eftaifé de comprendre
que; les qualités eflentielles de la danfe la rendent
encore plus difficile. ( Cet article ejl tiré de la Théorie
générale des Beaux-Arts de M; SuLZER. )
Accent , f. m. ( B elles-Lettres. ) I l y a dans la
parole une ejpece de chant, dit Cicéron. Mais ce
chant étoit-il noté par la profodie des langues anciennes
? On nous le dit ; on nous affure que dans le
grec 6c le latin, Yaccent marquoit l’intonation de la
voix fur telle 6c fur telle fyllabe ; 6c c’eft ce qu’on
appelle Y accent projodique, diftinft de Y accent oratoire
, ou des inflexions données à'la parole par la
penfée & par le fentiment. Il eft pourtant bien difficile
de concevoir cet accent profodique adhérant aux
fyllabes, à moins que dans la prononciation, animée
par les mouvemens de l’éloquence, il ne cédât la
place à Y accent oratoire ; 6c voici la difficulté.
Qu’on donne à un muficien des paroles déjà notées
par Y accent de la langue ; il eft évident que, s’il
#veut laiffer aux fyllabes leurs intonations profodi-
ques, il fera dans l’impoflibilité de donner du naturel
6c du cara&ere à fon chant; & que, s’il veut au
contraire plier le fon des paroles à l’expreflion que
l’idée ou le fentiment follicite, il faut qu’il les dégagé
de Y accent profodique, 6c fe donne la liberté de les
moduler à fon gré. Or il en eft de la prononciation
oratoire comme de la mufique : E jl in dicendo etiam
quidam cantus. ( Cicer. )
L accent profodique qui nuiroit à l’une, s’il étoit
invariable, nuiroit donc également à l’autre ! des
paroles, déjà notées par la profodie, fupplieroient
6c menaceroient avec les mêmes inflexions.
Il ne faut pas confondre ici la quantité avec l’<zt-
cent. La durée relative des fyllabes peut être fixe &
immuable dans une langue , fans que l’expreflîon en
foit gênée, au moins fenfiblement. Par exemple,
que l’on prolonge la pénultième, ou qu’on appuie
fur la derniere, la différence n’eft que dans les tems,
& non pas dans les tons. La quantité peut donc
être fixe 6c preferite ; mais les intonations, les
• O i j