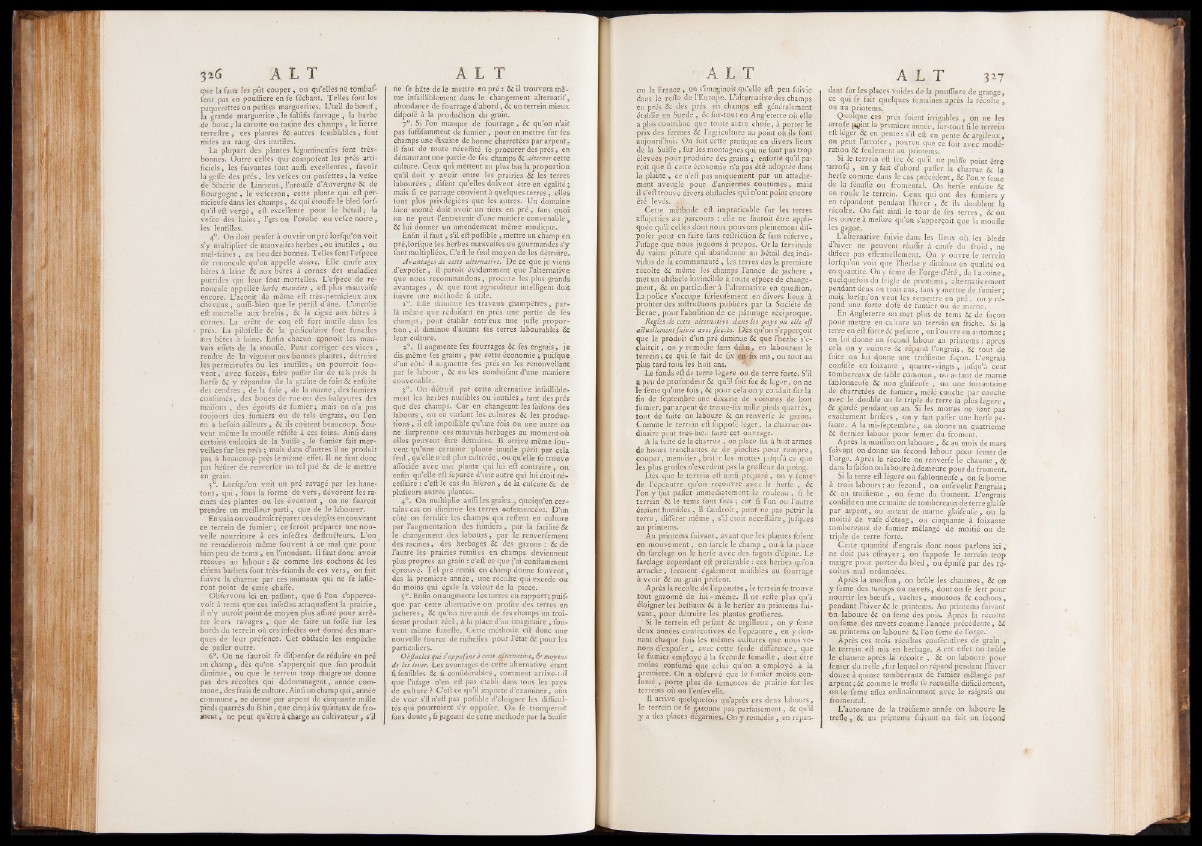
que la faux les put couper, oit qü’ellès në tônlbaf-
fent pas en pouffiere en fe féchant. Telles font les
pâquerettes ou petites marguerites. L’oeil de boeuf,
la grande marguerite , le falfifls fauvage , la barbe
de boue,- la carotte ou racine des champs, le lierre
terreftre, ees plantes ôc- autres femblables, font
mifes au rang des inutiles.
La plupart des plantes légiuiîineiifes font très-
bonnes. Outre celles qui compofent les prés artificiels,
les fuivantes font auffi excellentes, favoir
la geffe des prés, lès vefees ou poifettes, la vefee
de Sibérie de Linnæus, l’arouflë d’Auvergne ôc de
Bourgogne, le vefèerOn, cette plante qui eftpér-
nicieufe dans les champs, ôc qui étouffé le bled lorf-
qu’il eft ve rg é , eft excellente pour le bétail; la
vefee des haies, Tgrs ou l’orobe ou vefee noire,
les lèntilles.
4°. On doit penfer à ouvrir un pré lorfqu’on voit
s’y multiplier de mauvaifes herbes , ou inutiles , ou
mal-faines , au lieu des bonnes. Telles font l’efpece
de renoncule qu’on appelle douve. Elle caufe aux
bêtes à laine ôc aux bêtes à cornés des maladies
putrides qui leur font mortelles. L’efpece de renoncule
appellée herbe maudite , eft plus mauvaife
encore. L’aconit de même eft très-pernicieux aux
chevaux, auffi-bien que le përfil d’âne. L’âncolie
eft mortelle aux brebis, ôc la ciguë aux bêtes à
cornes. La crête de coq eft fort inutile dans les
prés. La pilofelle ôc la pédiculaire font funeftes
aux bêtes à laine. Enfin chacun cpnnoît les mauvais
effets de la moufle. Pour corriger ces vices ,
fendre de la vigueur aux bonnes plantes, détruire
les pernicieufes ou les | inutiles, on pourroit fou-
vent , avec fuccès, faire paffer fur de tels prés la
herfe & y répandre de la graine de foin ôc enfuite
des cendres , de la fuie , de la marrie, des fumiers
Confiimés, des boues de rue ou des balayures des
maifons , des égouts dé fumier; mais on n’a pas
toujours des fumiers ou de tels- engrais, ou l’on
en a befoin ailleurs 5 ôc ils coûtent beaucoup. Souvent
même la moufle réiifte à ces foins. Ainfi dans
certains endroits de la Suiffe , le fumier fait merveilles
fur lès prés ; mais dans d’autres il ne produit
pas à beaucoup près le même effet. Il rie faut donc
pas héfiter de renverfet un tel pré ôc dé le mettre
èn grain,
50. Lorfqu’on voit un pré ravagé par les hane-
tons, q u i, fous la forme de v er s , dévorent les racines
des plantes ou les éventent , on ne fauroit
prendre un meilleur parti, que de le labourer.
En vain on voudroit réparer ces dégâts en couvrant
ce terrein de fumier ; ce fero.it préparer une nouvelle
nourriture à ces infeûes deftrutteurs. L ’on
rie remédieroit même fouvent à ce mal que pour
bien peu de tems , en l’inoridant. Il faut donc avoir
recours au labour : ôc comme les cochons ôc les
chiens barbets font très-friands de ces vers, on fait
fuivre la charrue par ces animaux qui ne fe laffe-
ront point de cette -chaffe.
Obfervons ici en paffant, que fi l’on s’apperce-
voit à tems que ces infeftes attaquaffent la prairie,
il n’y auroit point de moyen plus affûté pour arrêter
leurs ravages , que de faire un foffé fur les
bords du terrein où ces infeftes ont donné des marques
de leur préfence. Cet obftacle les empêche
de paffer outre.
6°. On ne fauroit fe difpenfer de réduire en pré
un champ, dès qu’on s’apperçoit que Ton produit
diminue, ou que le terrein trop maigre ne donne
pas des .récoltes qui dédommagent, année commune
, des frais de culture. Ainfi un champ qui, année
commune, ne donne par arpent de cinquante mille
pieds quarrés du Rhin, que cinq à fix quintaux de froment
, ne peut qu’être à charge au cultivateur, s’il
fie fe hâte de le mettre en pré : & il trouvera mê-
riie infailliblement.dans le . changement alternatif,
abondance de fourrage d’abord, ôc un terrein mieux
difpofé à la produ&ion du grain,
70. Si l’on manque de fourrage, ôc qu’on n’ait
pas fuffifamment de fumier , pour en mettre fur fes
champs une dixaine de bonne charretées par arpent,
il faut de toute néceffité fe procurer des p rés, en
dénaturant une partie de fes champs ôc alterner cette
culture. Ceux qui. mettent au plus bas la proportion
qu’il doit y avoir entre les prairies ôc les terres
labourées , difent qu’elles doivent être en égalité ;
mais fi ce partage convient à quelques terres , elles
font plus privilégiées-que les autres. Un domaine
bien monté doit avoir un tiers en p r é , fans quoi
on ne peut l’entretenir d’une maniéré convenable ,
ôc lui donner un amendement même modique.
Enfin il faut, S’il eft poflible , mettre un champ en.
pré,lorfque les herbes mauvaifes ou gourmandes s’y
font multipliées. C ’eft le feul moyen de les détruire.
Avantages de cette alternative. De ce que je viens
.d’expofer., il paroît évidemment que l’alternative
que nous recommandons, procure les plus grands
avantages , ôc que tout agriculteur intelligent doit
fuivre une méthode fi utile.
i° . Elle diminue fes travaux champêtres, parla
même que réduifant en prés une partie de fes
champs, pour établir entr’eux une jufte proportion
, il diminue d’autant fes terres labourables &
leur culture.
20. Il augmente fes fourrages & fes engrais, je
dis même fes grains, par cette économie puifqug
d’uri côté il augmente fes prés en les renoiivellant
par le labour, ôc en les conduifant d’une maniéré
convenable.
30. On détruit par cette alternative infailliblement
les herbes rtuifibles ou inutiles , tant des prés
que des champs. Car en changeant les faifons des
labours i ou en variant lès cultures ôc les productions
, il eft impoffible qu’une fois ou une autre on
ne furprenne ces mauvais herbages au moment où
elles peuvent être détruites. Il arrivé même fou-
vent Qu’une certaine plante inutile périt par cela
' feu l, qu’elle ri’eft plus cultivée, ou qu’elle fe trouvé
affociée avec une plante qui lui eft contraire, ou
enfin qu’elle eft féparée d’une autre qui lui étoit né-
eéffaire : c’eft le cas du liferon, de la eufeute ôc de
plufieürs autres plantes.
4°. On multiplie auffi les grains , quoiqu’en certains
cas on diminue les terres «nfemencées. D ’un
côté on fertilife les champs qui reftent en culture
par l’augmentation des fumiers , par la facilité &
le changement des labours, par le renverfement
des racines $ des herbages ôc des gazons : & dé
l’autre lés prairies remiles en champs deviennent
plus propres au grain : c’eft ce que j’ai conftamment
éprouvé. T e l pré remis en champ donne fouvent ,
dés la première année, une récolte qui excede ou
du moins qui égale la valeur de la piece. .
50. Enfin on augmente les terres en rapport; puif-
que par cette alternative on profite' des terres en
jachères, ôc qu’on tire ainfi de fes champs un troi-
fieme produit' ré e l, à la place d’un imaginaire , fouvent
même funefte. Cette méthode eft donc une
nouvelle fource dericheffes pour,l’état ôc pour les
particuliers.
O bjlacles qui s1oppofent à cette alternative^ & moyens
de les lever. Les avantages de cette alternative étant
fifenfibles ôc fi confidérables, comment arrive-t-il
que l’ufage n’en eft pas établi dans tous les pays
de culture ? C’eft ce qu’il importe d’examiner, afin
de voir s’il n’eft pas poflible d’éloigner les difficultés
qui pourroient s’y oppofer. On fe tromperoit
fans doute, fi jugeant de cette méthode par la Suiffe
pu la France , on s’imaginoit qu’elle eft peu fuivie
dans le refte de l’Europe. L’alternative des champs
en prés Ôc dés, prés en champs eft généralement
établie en Siiede , ôc fur-tout en Angleterre où elle
a plus contribué que toute autre chofe, à porter le
prix des fermes & l’agriculture au point où ils font
aujourd’hui. On fuit cette pratique en divers lieux
de la Suiffe , fur les montagnes qui ne font pas trop
élevées pour produire des grains ; enforte qu’il paroît
que fi cette économie n’a pas été adoptée dans
la plaine , ce n’eft pas uniquement par un attachement
aveugle pour d’anciennes coutumes, mais
il s’eft trouvé divers obftacles qui n’ont point encore
été levés.
Cette méthode eft impraticable fur les terres
affujetties au parcours : elle ne fauroit être appliquée
qu’à celles dont nous pouvons pleinement dif-
pofer pour en faire fans reftriôion & fanS réferve,
ï’ufage que nous jugeons à propos. Or la fervitude
de vaine pâturé qui abandonne au bétail des individus
de la communauté, les terres dès la première
récolte ôc même les champs l’année de jachere ,
niet yn obftacle invincible à toute efpece de. changement,
ÔC en particulier à l’alternative en queftion.
La police s’occupe férieufement en divers lieux à
profiter des inftruéHons publiées par la Société dé
Berne, pour l’abolition de ce pâturage réciproque.
Réglés de cette alternative dans les pays où elle eft
acluellement fuivie avec fuccès. Dès qu’on s’apperçoit
que le produit- d’un pré diminue Ôc que l’herbe s’é-
çlaircit, on y remédie fans délai, en labourant le
terrein ; ce qui fe fait de fix en,fix ans, ou tout au
plus tard tous les huit ans.
Le fonds eft de terre légère ou de terre forte. S’il
a peu de profondeur ôc qu’il foit fec ôc léger , on ne
le feme qu’une fois, ôc pour cela on y conduit fur la
fin de fepteiyfire une dixaine de voitures de bon
fumier, par arpént de trente-dix mille pieds quarrés,
tout de fuite on labo.ure 6c on renverfe le gazon.
Comme le terrein eft fuppofé léger, la charrue ordinaire
peut très-bie. 1 taire cet ouvrage.
A la fuite de la charrue , on place fix à huit armes
de houes tranchantes ôc de pioches pour rompre,
çouper, menuifer , b r i l r les mottes jufqu’à ce que
les plus groffes n’excedent pas la groffeur du poing.
Dès que le terrein eft ainfi préparé, on y feme*
de Tépéautre qu’on recouvre avec la herfe , 8c
l’on y fait paffer immédiatement le rouleau , fi le
terrein ôc le tems font feçs ; car fi l’un ou l ’autre
étoient humides \ il faudroit, pour ne pas pétrir la
te r re , différer même , s’il étoit néceffaire, jufques
au printems.
Au printems fuiyant, avant que les plantes foient
en mouvement, on farcie le enamp , ou à la place
dti farclage on le herfe avec des fagots, d’épine. Le
farclage cependant eft préférable : ces herbes qu’on
arrache, feroient également nuifib.les au fourrage
à venir & au grain préfent.
Après la récolte de l’épéautre, le terrein fe trouve
tout gazonné de lui-même, il ne refte plus qu’à
éloigner les beftiaux & à le herfer au printems fui-
,vant, pour détruire les plantes groffieres.
Si le terrein eft pefant ôc argilleux, on y feme
deux années conlëcutives de Tépéautre , en y donnant
chaque fois les mêmes cultures que nous venons
d’expofer , avec cette feule différence, que
le fumier employé à la fécondé femaille , doit être
moins confirmé que celui qu’on a employé à la
première. On a obfervé que le fumier moins ,eon-
fume^, porte plus de femences de prairie fur les
terreins où onTenfeveiit.
Il arrive quelquefois qu’après ces deux labours .,
le térrein ne fe gazonne pas parfaitement, ôc qu’il
y a des places dégarnies. On y. remédie, en répandant
fur les places vuides de la pouffiere de grange,
ce qui fi; fait quelques femaines après la récolte ,
ou au printems.
Quoique ces prés foient irrigables , on ne les
atrofe pçint la première année-, fur-tout fi le terrein
eft leger ôc en pente : s’il eft en pente ôc argileux,
on peut la rro fe r, pourvu que ce fait avec modér
ration & feulement au printems.
Si le terrein eft fec ôc qu’il ne puiffe point être
•arrofé , on y fait d’abord paffer la charrue & la
herfe comme dans le cas précédent, & Ton y feme
de la fenaffe ou fromental. On herfe enfuite 8c
on roule le terrein. Ceux qui ont des fumiers y
en répandent pendant Thiver , & ils doublent la
récolté. On fait ainfi le tour de fes terres , & on
les ouvre à mefure qu’on s’apperçoit que la moufle
les gagne.
L’alternative fuivie dans les lieux où les bleds
d’hiver ne peuvent réuffir à caufe du froid , ne
différé pas effentiellemenr. On y ouvre le terrein
lorfqu’on voit que l’herbe y diminue en qualité 011
en quantité. On y feme de l’orge d’é té, de l'avoine,
quelquefois du leigle de printems, alternativement
pendant deux ou trois ans, fans y mettre de fumier;
mais lprfqu’on veut le? remettre en pré, on y répand
une forte dofe de fumier ou de marne.
En Angleterre on met plus de tems 8c de façon
pour mettre en culture un terrein en friche. Si la
terre en eft forte & pelante, on l’ouvre en automne;
on lui donne un fécond labour au printems : après
cela on y voiture 8c répand l’engrais, 8c tout de
fuite on lui donne une troifieme façon. L’engrais
confifte en foixante , quatre-vingts, jyfqu’à cent
tombereaux de labié commun, ou autant de marne
fablonneufe 8c non glaifeufe , ou une foixantaine
de charretée;? de furrûer, mêlé couche par couche
avec le double ou le triple de terre la plus légère,
& gardé pendant un an. Si les mottes ne font pas
exaftement brifées , on y fait paffer une herfe pe-
fante. A la mi-feptembre,, on donne un quatrième
& dernier labour pour femer du froment.
Après la moiffon on laboure , ôc au mois de mars
fuivapt on donne un- fécond labour .pour femer de
l ’orge. Après la récolte on renverfe le chaume , &
dans la faifon on laboure à demeure pour du froment.
Si la terre eft légère ou fablonneufe , on fe borne
à trois labours : au fécond , on enfevelit l’engrais;
ôc au troifieme , on feme du froment. L’engrais
copfifte en une certaine de tombereaux de terre glaife
par arpent, ou autant de marne glaifeufe , ou la
moitié de vafe d’étang , ou cinquante à foixante
tombereaux de fumier mélangé de moitié ou de
triple de terre forte.
Cette quantité d’engrais dont nous parlons ic i ,’
ne doit pas effrayer ; on fuppofe le terrein trop
maigre pour porter du bled, ou épuifé par des récoltes
mal ordonnées.
Après la moiffon, on brûle les chaumes, ôc on
y feme des turnips ou navets, dont on fe fert pour
nourrir les boeufs , vaches , moutons ôc cochons,
pendant Thiver ôc le printems. Au printems fuivant
On,laboure ôc on feme des pois. Après la récolte
on feme des navets comme l’année précédente, ÔC
au printems on laboure ôc Ton feme de l’orge.
Après çes trois récoltes confécutives, de grain ,
le terrein eft mis en herbage. A cet effet on brûle
le chaume après la récolte , ôc on laboure pour
femer du trefle ,fur lequel on répand pendant Thiver
douze à quinze tombereaux de fumier mélangé par
arpent ; ôc comme le trefle fe recueille difficilement,
on le feme affez ordinairement avec le raigrafs ou
fromental.
L’automne de la troifieme année on laboure le
trefle, ôc au pryitems fuivant on fait un fécond