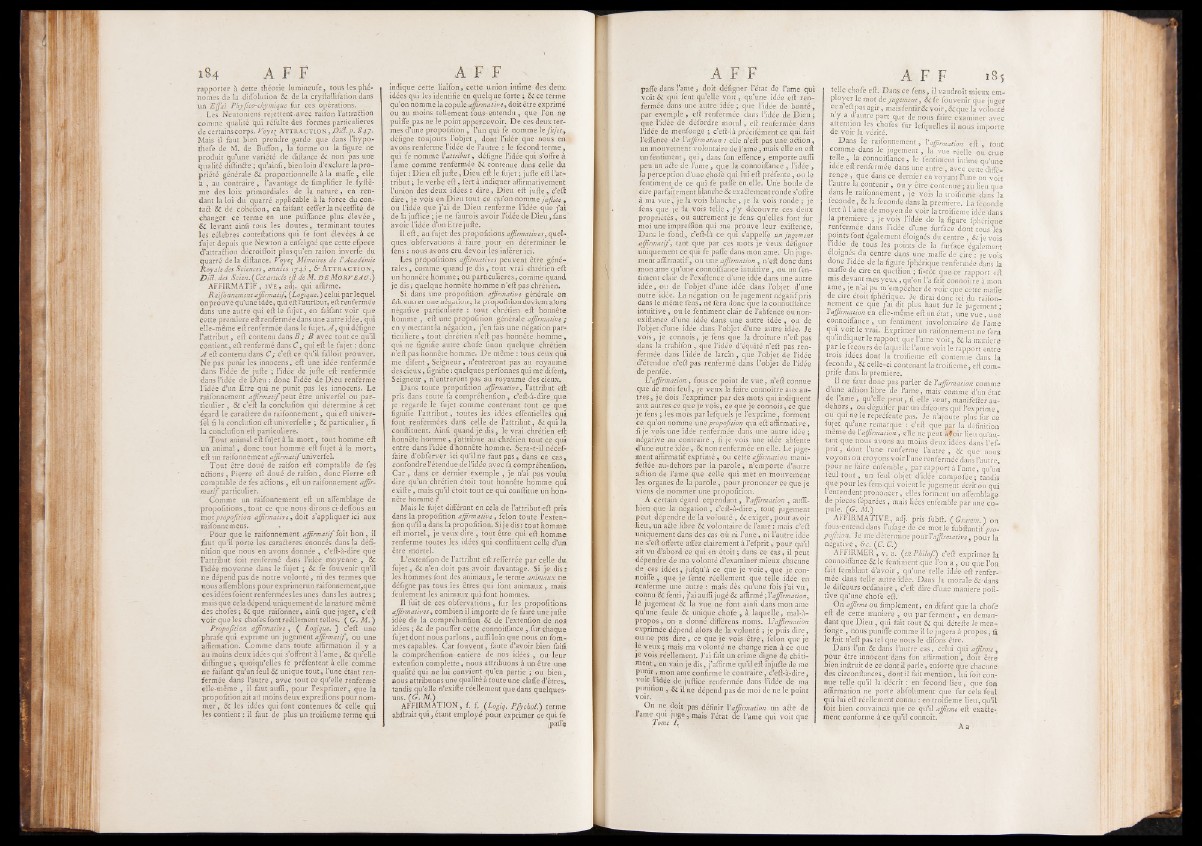
rapporte? à dette théorie lumineufe, tous les phé-
tiomes de la di ffolution- & de la cryftallifation dans
uA Ejfai Phyjico-thymique fur ces opérations.
Les Neutoniens rejettent,avec raifon l’attraCtion
comme qualité qui réfülie des formes particulières
de certains corps. Vàye^ Attraction, Dict.p. 847.
Mais il faut bien prendre garde que dans l’hypo-
thefe de M. de Buffon, la forme ou la figure ne
produit qu’une variété de diftance & non pas une
qualité diftinCte ; qu’ainfi, bien loin d’exclure la propriété
générale Si proportionnelle à la malle , elle
à , au contraire, l’avantage de Amplifier le.lÿftê-
me des loix primordiales de la nature, en rendant
la loi du quarré applicable à la force du cont
a i & de côhéfion, en faifant ceffer la néceflîté de
changer ce terme en une puiffance plus é le v é e ,
& levant àinfi tous les doutes, terminant toutes
les célébrés conteftations qui fe font élevées à ce
fui et depuis que Newton a enfeigné que cette efpeee
d’attraCtion décroiffoit plus qu’en raifon inverfe du
quarré de la diftance. Voyt£ Mémoires de L'Académie
Roy ale des Sciences, années 1746,6* ATTRACTION,
J)ici. des Scien. {Cet article ejl de M. DE MoRVEAU.)
AFFIRMATIF, iVe , adj. qui affirme.
Raifoiinenient affirmatif, (Logique.) celui par lequel
onprouvé qu’une idée, qui eft l’attribut, eft renfermée
dans une autre qui eft le fujet, en faifant voir que
cette première eft renfermée dans une autre idée, qui
elle-même eft renfermée dans le fujet. A , qui défigne
l’attribut, eft contenu dans B ; B avec tout ce qu’il
contient, eft renfermé dans C , qui eft le fujet : donc
A eft contenu dans C ; .c’eft ce qu’il falloit prouver.
Ne pas punir les innocens, eft une idée renfermée
dans l’idée de jufte ; l’idée de jufte eft renfermée
dans l’idée de Dieu : donc l’idée de Dieu renferme
l ’idée d’un Être qui ne punit pas les innocens. Le
raifonnement affirmatif peut être univerfel ou particulier
, & c’eft la cortclufion qui détermine à cet
égard le caraétere du raifonnement, qui eft univerfel
fi la conclufion eft univerfelle ; & particulier, fi
la conclufion eft particulière,.
Tout animal eft fujet à la mort, tout homme eft
un animal, donc tout homme eft fujet à la mort,
eft un raifonnement affirmatif univerfel.
Tout être doué de raifon eft . comptable de fes
aCtions , Pierre eft doué de raifon, donc Pierre eft
comptable de fes actions , eft un raifonnement affirmatif
particulier.
Comme un raifonnement eft urt àffemblâge de
propofitions, tout ce que nous dirons ci-deflous au
motpropofition affirmative, doit s’appliquer ici aux
raifônnemens. *
Pour que le raifonnement affirmatif foit bon , il
faut qu’il porte les cafaftëres énoncés dans la défi-;
nition que nous en avons donnée , c’eft-à-dire que
l ’attribut foit renfermé dans l’idée moyenne , &
l ’idée moyenne dans le fujet ; & fe fouvenir qu’il
ne dépend pas de notre volonté, ni des termes que
nous affemblons pour exprimerun raifonnement,que
ces idées foient renfermées les unes dans les autres ;
mais que cela dépend uniquement de la nature même
des chofes; & que raifonner, ainfi que juger, c’eft
voir que les chofes fontreéllement telles-. (G - M.')
Propofition affirmative , ( Logique. ) c’eft une
phrafe qui exprime un jugement affirmatif, ou une
affirmation. Comme dans toute affirmation il y a
au moins deux idées qui s’offrent à l ’ame, & qu’elle
diftingue ; quoiqu’elles fe préfentent à elle comme
ne faifant qu’un feul & unique tout, l’une étant renfermée
dans l’autre , avec tout ce qu’elle renferme
elle-même , il faut aufli, pour l’exprimer, que la
propofition ait ail moins deux expreffions pour nommer
, & les idées qui font contenues & celle qui
les contient : il faut de plus un troifieme terme qui
indique cette liaifon, cette union intime des deux
idées qui les identifie en quelque forte ; & ce terme
qu’on nomme la copule affirmative, doit être exprimé
ou au moins tellement lous-entendu , que l’on ne
puiffe pas ne le point appercevoir. De ces deux termes
d’une propofition , l’un qui fe nomme le fujet,
défigne toujours l’o b je t , dont l’idée que nous en
avons renferme l’idée de l’autre : le fécond terme ,
qui fe nomme 1'attribut, défigne l’idée qui s’offre à
l’ame comme renfermée & contenue dans celle du
fujet : Dieu eft jufte, D ieu eft le fujet ; jufte eft l’attribut
; le verbe eft , fert à indiquer affirmativement
l’union des deux idées : dire, Dieu eft jufte, c’eft
dire, je vois en Dieu tout ce qu’on nomme jullice ,
ou l’idée que j’ai de Dieu renferme l’idée que j’ai
de la juftice ; je ne faurois avoir l’idée de Dieu,fans
avoir l’idée d’un Etre jufte.
Il e ft, au fujet des propofitions affirmatives, quelques
obfervations à faire pour en déterminer le
fens : nous avons cru devoir les inférer ici.
Les pfôpofitions affirmatives peuvent être générales
, comme quand je d i s t o u t vrai chrétien eft
un honnête homme; ou particulières, comme quand
je dis; quelque honnête homme n’eft pas chrétien.
Si dans une propofition affirmative générale on
fait entrer une négation, la propofition devient alors
négative particuliere : tout chrétien eft honnête
homme , . eft une propofition générale affirmative ;
en y mettant la négation, j’en fais une négation particuliere
, tout chrétien n’eft pas honnête homme ,
qui ne lignifie autre chofe finon quelque chrétien
n’eft pas honnête homme. De même : tous ceux qui
me difent, Seigneur, n’entreront pas au royaume
des deux , lignifie : quelques perfonnes qui me difent,
Seigneur , n’entreront pas au royaume des cieux.
Dans toute propofition affirmative, l’attribut eft
pris dans toute fa compréhenfion, c’eft-à-dire que
je regarde le fujet comme contenant tout ce que,
lignifie l’attribut, toutes les idées elfentielles qui
font renfermées dans celle de l’attribut, &t qui la
conftituent. Ainfi quand je dis, le vrai chrétien eft,
horçriête homme , j’attribue au chrétien tout ce qui
entre dans l’idée d’honnête homme. Sera-t-il nécef-
faire d’obferver ici qu’il ne faut pas , dans ce cas
confondre i’éiendue de l’idée avec fa compréhenfion*
C a r , dans ce dernier exemple , je n’ai pas voulu
dire qu’un chrétien étoit tout honnête homme qui
èxifte, mais qu’il étoit tout ce qui conftitue un honnête
homme ?
Mais le fujet différant en cela de fattribut eft pris
dans la propofition affirmative, félon toute l’exten-
fion qu’il a dans la propofition. Si je dis : tout homme
eft mortel, je v eux dire , tout être qui eft homme
renferme toutes les idées qui conftituent celle d’un
être mortel.
L ’extenfion de l’attribut eft refferrée par celle du
fuje t, & n’en doit pas avoir davantage. Si je dis:
les hommes font des animaux, le terme animaux ne
défigne pas tous les êtres qui font animaux, mais
feulement les animaux qui font hommes.
Il fuit de ces obfervations, fur les propofitions
affirmatives, combien il importe de fe faire une jufte
idée de la compréhenfion & de l’extenfion de nos,
idées ; & de pouffer cette connoiffance, fur chaque
fujet dont nous parlons, aufli loin que nous en fom-
mes capables. Car fouvent, faute d’avoir bien faifi
la compréhenfion entière de nos idées , ou-leur
extenfion complette, nous attribuons à un être une
qualité qui ne lui convient qu’en partie ; ou bien ,
nous attribuons une qualité à toute une claffe d’êtres,
tandis qu’elle n’exifte réellement que dans quelques-
uns. {G- Af.)
AFFIRMATION, f. f. ( Logiq. Pfychol.) terme
abftrait q ui, étant employé pour exprimer ce qui fe
iparffe
paffe dans l’ame, doit défigner l’état de l’ame qui
voit & qui fent qu’elle v o i t , qu’une idée, eft renfermée
dans une autre idée ; que l’idée de bonté,
par exemple , eft renfermée dans l’idée de Dieu ;
que l’idée de défordre moral, eft renfermée dans
l’idée de menfonge ; c’eft-là précifément ce qui fait
l’effence de l'affirmation : elle n’eft pas une aÇtion,
un mouvement volontaire de l’ame, mais elle en eft
un fentiment, qui, dans fon effence, emporte aufli
peu un a été de l’ame, que la connoiffance , l’idée ,
la perception d’une chofé qui lui eft préfente, ou le
fentiment de ce qui fe paffe en elle. Une boule de
cire parfaitement blanche & exactement ronde s’offre
à ma vue ,* je la Vois blanche , je la vois ronde ; je
fens que je la vois telle , j ’y découvre ces deux
propriétés, ou autrement je fens qu’elles font fur
moi une impreflion qui me prouve leur exiftence.
Dans le fond., c’eft-là ce qui s’appelle un jugement
affirmatif, tant que par ces mots je veux défigner
uniquement ce qui fe paffe dans mon ame. Un jugement
affirmatif, ou une affirmation , n’eft donc dans
mon ame qu’une connoiflànee intuitive , ou un fentiment
clair de l’exiftence d’une idée dans une autre
id ée, ou de l’objet d’une idée dans l’objet d’une
autre idée. La négation ou le jugement négatif pris
dans le même fens, ne fera donc que la connoiffance
intuitive , ou le fentiment clair de l’abfence ou non-
exiftence d’une idée dans, une autre idée , ou de
l’objet d’une idée dans l’objet d’une autre idée. Je
vo is , je connois, je fens que la droiture n’eft pas
dans la trahifon, que l’idée d’équité n’eft pas renfermée
dans l’idée de larcin, que l’objet de l’idée
d’étendue n’eft pas renfermé dans l ’objet de l’idée
de penfée.
L’affirmation, fous ce point de vu e , n’eft connue
que de moi feul,. je veux la faire connoîtrè aux autres,
je dois l’exprimer par des mots qui indiquent
aux autres:ce que je'vois, ce que je connois, ce que
je fens ; les mots par lefquels je l’exprime, forment
ce qu’on nomme une propofition qui eft: affirmative,
fi je vois une idée renfermée dans une autre idée ;
négative au contraire fi je vois une idée abfentë
d’une autre idée, & non renfermée en elle. Le juge- i
ment affirmatif exprimé , ou cette affirmation mani-
feftée au-dehors par la parole, n’emporte d’autre
aétion de l’amé que celle qui met en 'mouvement
les organes de la parole, pour prononcer ce que je
viens de nommer une propofition.
A cèrtain égard cependant, l'affirmation , aufll-
bien que la' négation, c’eft-à-dire, tout jugement
peut dépendre de la volonté , & exiger, pour avoir
lieu, un afte libre & volontaire de l’ame : mais c’eft
uniquement dans des bas où ni l’une, ni l’autre idée j
ne s’eft offerte affez clairement à l’efprit, pour qu’il j
ait vu d’abord ce qui en étoit ; dans ce cas, il peut
dépendre de ma volonté d’examiner mieux chacune
de ces idées , jufqu’à ce que je vo ie , que je con-
noiffe , que je fente réellement que telle, idée en
renferme une autre: mais dès qu’une fois j?ai v u ,
connu & fënti, j’ai aufli jugé & affirmé ; l'affirmation,
lë jugement & la vue ne font ainfi dans mon ame
qu’une feule & unique chofe , à laquelle, mal-à-
propos , on a donne différens noms. U affirmation
exprimée dépend alors de la volonté ; je puis dire,
ou ne pas dire , ce que je vois être, félon que je
le veux ; mais ma volonté ne change rien à ce que :
je vois réellement. J’ai fait un crime digne de châti-
ment, en vain je dis, j’affirme qu’il eft injufte de me
punir, mon ame confirme le contraire, c’eft-à-dire,
voit l’idée de juftice renfermée dans l’idée de ma
punition , & il ne dépend pas de moi de ne le point
voir.
On ne doit pas définir l’affirmation un a£te de
lame qui juge, mais l’état de l ’ame qui voit que
Tome I. H ^
telle chofe eft. Dans ce fens, il vaudroit mieux employer
le mot de jugement, & f e fouvenir que juger
C? n Pas ag^r ■> mais fentir & voir, & que la volonté
n y a d autre part que dé nous faire examiner avec
attention les chofes fur lefquelles il nous importe
de voir la vérité. *
Dans le raifonnement, l'affirmation eft , tout
comme dans le jugement , la vue réelle ou crue
telle,, la connoiffance, le fentiment intime qu’une
idée eft renfermée dans.une autre , avec cette différence
, que dans ce dernier en voyant l’une on voit
1 autre la contenir , ou y être contenue ; au lieu que
dans le raifonnement, je vois la troifieme-dans la
fécondé, & la fécondé dans la première. La fécondé
fert à l ’ame de moyen de voir la troifieme idée dans
la première ; je vois l'idée de la figure fphérique
renfermee dans l’idée d’une furface dont tous les
points font également éloignés du centre , & je vois
l’idée ^de tous les points de la furface également
éloignés du centre dans une mafl'e de cire : je vois
donc l’idée de la figure fphérique renfermée dans la
maffe de cire en queftion ; fi-tôt que ce rapport eft
mis devant mes y e u x , qu’on l’a fait connoîtrè à mon
ame, je n’ai pu m’empêcher de voir que cette mafl'e
de cire étoit fphérique. Je dirai donc ici du raifonnement
ce que j’ai dit plus haut fur le jugement ;
Vaffirmation en elle-même eft un état, une vu e , une
connoiffance , un fentiment involontaire de l’ame
qui. voit le vrai. Exprimer Un raifonnement ne fera
qu’indiquer le rapport que l’ame v o it , & la maniéré
par le fe cours de laquelle l’ame voit le rapport entre
trois idees dont la troifieme. eft contenue dans la
fécondé, & celle-ci contenant la troifieme, eft corn-
prife dans la première.
> il faut donc pas parler de l'affirmation comme
d une action libre de l’ame, mais comme d’un état
de l’amè , qu’elle peut, fi elle veut, manifefter au-
dehors , ou déguifér par un difcours qui l’exprime,
ou qui ne le repréfente pas. Je n’ajoute plus fur ce
fujet qu’une remarque : c’eft que par la définition
même de l'affirmation, elle ne peut àfoir lieu qu autant
que nous avons au moins deux idées dans l’efp
rit, dont l’une renferme l’au tre , & 'q u e nous'
voyons ou croyons voir l’une renfermée dans l’autre,
pour ne faire enfemble, par rapport à l’ame, qu’un
feul to u t , un feul objet d'idée compofée ; tandis
que pour les fens qui voient le jugement écrit ou qui
lentendentprononcer, elles forment un affemblage
de pièces féparées , mais liées enfemble par une copule.
(<?. M.)
AFFIRMATIVE, adj. pris fubft. ( Gramm. ) on
fous-entend dans l’ufage de ce mot le fubftantif
pofuion. 'Je me’détermine pour l'affirmative, pour la
négative, &c. {C. Ci)
AFFIRMER , v. a. (enPhilof.) c’eft exprimer la
connoiffance & le fentiment que l’on a , ou que l’on
fait femblant d’a voir, qu’une telle idée eft renfermée
dans telle autre idée. Dans la morale dedans
le difcours ordinaire , c’eft dire d’une maniéré pofi-
tive qu’une chofé eft.
On affirme ou Amplement, en difant que la chofe
eft de cétte maniéré , ou par ferment, en demandant
que Dieu , qui fait tout & qui détefte le men-
fonge , nous puniffe comme il le jugera à propos, fi
le fait n’eft pas tel que nous le difons être.
Dans l’un & dans l’autre cas, celui qui affirme,
pour être innocent dans fon affirmation, doit être
bien inftruit de cé dont il parle, enforte que chacune
des circonftances, dont il fait mention, lui foit connue
tejile qu’il la-décrit : en fécond lieu, que fon
affirmation ne porte abfqlument que fur cela feul
qui lui eft réellement connu : en troifieme lieu, qu’il
foit bien convaincu que ce qii’il affirme eft exactement
conforme à ce qu’il connoît.
A a