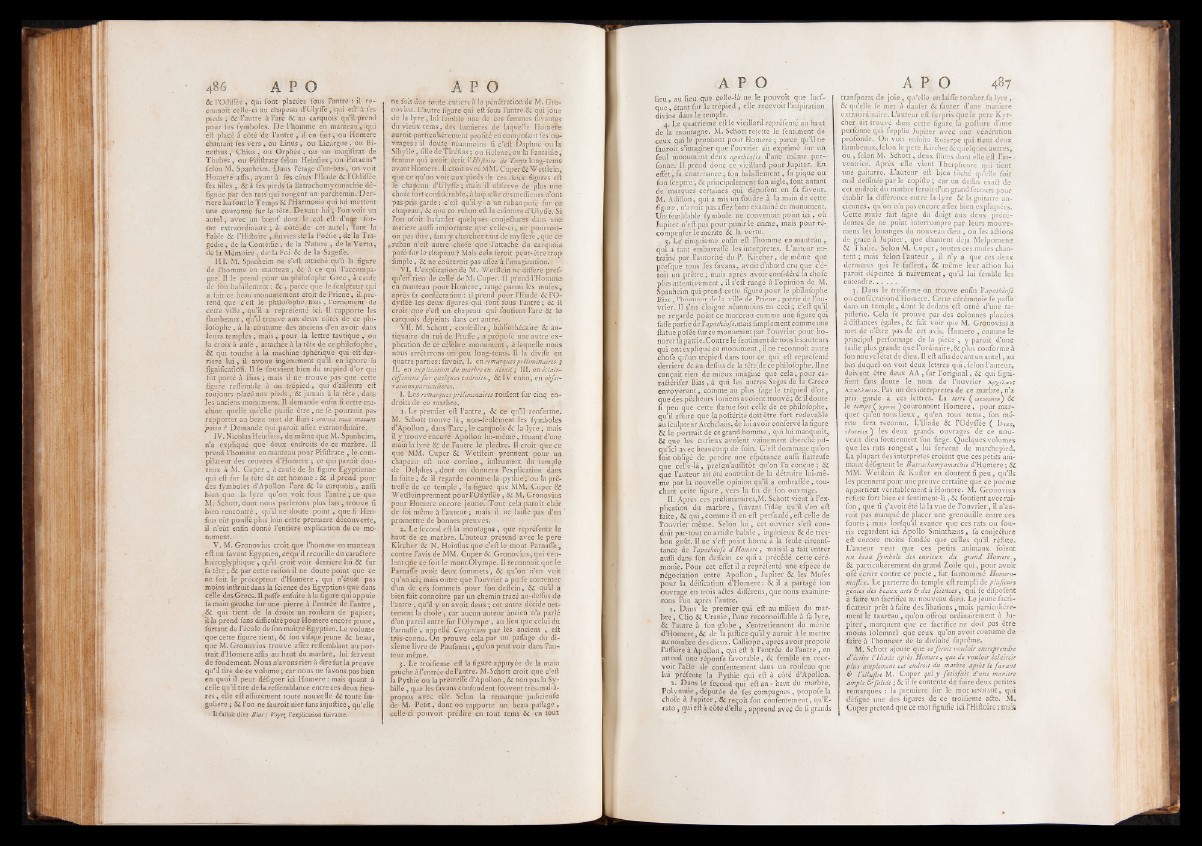
& l’Qdifféey qui font placées fous l’arttfev: Il fé-
connoît celle-ci au chapeau '-d’Ulyfle j qui eiL’à fies
pieds; & l’autre à l’arc & au carquois qu’il prend
pour les fymbdles. De l’homme en manteau, qui
eft placé à côté de l’antre , il en fait ;-ou Homere
chantant Tes vers , ou Lirnts, ou Lieürgue, ou Bi-
nethüs, Chius, ou Orphée , du' un magiftrat de
Thebes, ou Pififtrate félon Heinfius y- ou ' Pittacus*
félon M. Spânheim. Dans l’étage d’en-bàs!, on voit
Homere affis, ayant à fes côtés'l’Iliade & FOdilîée
fes filles , & ’à fes piedsTâ Batrachomyomachie dé-
fignée par des rats* qui1'longent um parchemin. Derrière
lui font le Temps & l’Har monie qui lui mettent1
une couronne fur la - fête. Devant lui ; l?on voit un
autel, avec un boeuf dont ‘le.co l eft d’une forme
extraordinaire 4 côté&de cet autel, ToritTa'
Fable & l’Hiftoire , fuivies de là Poéfie, de la Tragédie,
delà Comédie , de la Nature , delà Vertu,
de la Mémoire, de'la Foi & de la Sâgefle.
III. M. Spânheim ne-s’eft attaché qu’à la figure
de l’homme en manteau, & à ce q u i‘ l’accompagnée
Il le prend pour un philofophe G re c, à calife
de fôn habillement: parce que Je Jculpteur qui
a fait ce beau monumement étoit de Priene, il.pré-
tend que^.c’eft le philofophe Bias, l’ornement de
cette v ille , qu’il a représenté ici. Il rapporte les
flambeaux, qu’il trouve aux deux côtés de ce phi-
Jofophe, à la coutume des anciens d’en avoir dans
leurs temples ; mais ,' pour, la lettre tautique ,\ou
la croix à anfe , attachée à la tête de ce philofophe ,
& qui touche à la machine lphérique qui eft derrière
lu i, il avoue ingénument qu’il en ignore la
fignificatidfi. Il fe fouvient bien du trépied d’or qui
fut porté à Bias ; mais il ne trouve pas que cette
figure r effemble à un trépied, qui d’ailleurs eft
toujours placé aux pieds, & jamais à la tête , dans
les anciens monumens. Il demande enfin fi cette machine
quelle qu’elle puiffe être , ne fe pourroit. pas-
rapporter au beau mot de Bias : omnia. mea mtcum
porto ? Demande qui paroît allez extraordinaire.
IV. Nicolas Heinfius-, de .même que M. Spânheim,
n’a expliqué que deux endroits de ce marbre. Il
prend l’homme en manteau pour Pififtrate , le compilateur
des oeuvres d’Homere ; ce qui paroît douteux
à M. Guper , à caufe de la figure Egyptienne
qui eft fur la tête de cet homme : & il prend pour
des fymboles d’Apollon Tare & le carquois, aufii
bien.que la lyre qu’on voit fous l’antre ; ce que
M; Schott, dont nous parlerons plus bas , trouve fi
bien rencôntré, qu’il ne doute point, que fi Hen-
fius eût pouffé plus loin cette première découverte,
il n’eût enfin donné l’entiere explication de ce monument,
H
V . M. Gronovius croit que l’homme en manteau
eft un favant Egyptien, ce qu’il recueille du caraétere
hiéroglyphique , qu’il croit voir derrière lui & fur
fa tête y & par cette raifon il ne doute point que ce
ne foit le précepteur d’Homere, qui n’étoit pas
moins inftruit dans la fcience des Egyptiens que dans
celle des Grecs. Il paffe enfuite à la figure qui appuie
fa main gauche fur une pierre à l’entrée de l’antre ,
ôc qui tient de la droite un rouleau de papier;
ilia prend fans difficulté pour Homere encore jeune,
fôrtant de l’école de fon maître Egyptien. Le volume
que cette figure tient, & fon vifage jeune & beau,
que M. Gronovius trouve affez reffemblant au portrait
d’Homere affis au haut du marbre, lui fervent
de fondement. Nous n’avons rien à direfur la preuve
qu’il tire de ce volume ; car nous ne favons pas bien
en quoi il peut défigner ici Homere : mais quant à
celle qu’il tire de la reffemblance entre ces deux figures
, elle eft affurément toute nouvelle & toute fin-
.guliere ; & l’on ne fauroit nier fans injuftice, qu’elle
Ilfalloitdire Bios: Voyeç l’explication fuivarite:
ne foit due toute entière à la pénétration de M. GrcM
novius. L’autre figure qui eft fous l’antre & qui joue
- de la lyre , lui femble une de ces 'femmes lavantes
du vieux'tems, dès lumières de laquelle Homéirè
auroit particuliérement profité en compofant fes ouvrages
: il doute néanmoins fi c’eft Daphné ou la
Sibylle ÿ fille de Tirefias ; ou Hélene; ou la Fantaifie,
femme qui a voit j écrit l’Hïjloire de Troye long-tems
»vantHomere. Il croit avec MM; Cupêr&Wetftein,
que de' 'qu’on voit ;aux pieds de ces deux figures eft
le chapeau d’Ulyffe ; mais il obferve de plus une
chofe fort confidérable, à laquelle cés meffieurs n’ont
pas pris garde : -c’eft qu’il y . a un ruban pofé fur ce
chapeau , & que ce ruban eft la ceinture d'Ulyfle. Si
l’on ;ofôit hafarder quelques conjeriures dans une
matière (auffi importante què celle-ci, ne pourroit-
©n pas dire, fans y chercher .-.tant de myftëfe ; que ce
^rüban n’eft autre . chofe que J’attache du carquois
' pofé fur le" chapeau ? Mais cela feroit peut-être trop
fimple, & ne coûtéroit pas affez'à,F-iniaginatiom. •
' - VI. L’explication de M. Wetftein ne différé «pref-
qu’en rien de celle' de M. Cuper. Il prend l’Homme
en manteau pour Homere, rangé parmi les mufes,
apres fa confécration : il prend pour l’Iliade & 1’0 -
dyffée les deux figures' qui font fous l’antre ; & il
croit que c’eft un chapeau qui- foutient l’arc & le
carquois dépeints dans cet antre. ’> C
VII. M. Schott; confeiller, bibliothécaire' & antiquaire
du roi de Pruffe ; a propofé une autre explication
de ce célébré monument, à laquelle nous
nous arrêterons un peu long-tems. Il la divife en
quatre parties :favoir, I. en remarques préliminaires';
II. en explication du marbre en détail ; III . en-éclair-
ôijfemens fur quelques endroits, & IV enfin, en o.bfer-'
vationsparticulières.■
‘ I. Les remarques préliminaires roulent fur cinq en-
droits.dè ce marbre.
1. Le premier eft l’antre , & ce qu’il renferme^
M. Schott trouve là , non-feulement les fymboles
d’Apollon, dans Tare, le carquois-'& ladyre ; mais
il y trouve encore Apollon lui-même, tenant d’une
main la lyré & de l’autre le pléélre. Il croit que ce
que MM. Cuper & Wetftein prennent pour un
chapeau eft une cortine, inftrument du temple
de Delphes', dont on donnera l’explication dans,
la fuite ; & il regarde, commedà pythie^ou la prê-
treffe de ce temple , la figure que MM. Cuper &
Wetfteinprennent pourl’Odyffée, & M. Gronovius
pour Homere encore, jeune. Tout .cela paroît clair
de foi même à l’auteur ; mais il ne laiffe pas d’en
promettre dé bonnes preuvés.:
2. Le fécond eft la montagne , que repréfente le
haut de ce marbre. L’auteur prétend avec le ,pere
Kircher & N. Heinfius que c’eft le mont Parnaffe,
contre l’avis de MM. Cuper & ,Gronovius, qui veulent
qûe ce foit le mont Olympe. Il reconnoît que le
Parnaffe avoit deux fommets, & qu’on n’en voit
qu’un ici; mais outre que l’ouvrier a pu fe contenter
d’un de ce's fommets pour fon deffein, & qu’il a
bienfait connoître par un chemin tracé au-deffus de
l’antre , qu’il y en avoitdeux; cet antre décide nettement
la chofe , car aucun auteur ancien n’a parlé
d’un pareil antre fur l’Olympe , au lieu que celui dû
Parnaffe , appellé Corcyrium par les anciens , eft
très-connu. On prouve cela par un paffage du dixième'livre
de Paufanias, qu’on peut voir dans l’auteur.
même. ..
3. Le troifieme eft la figure appuyée de la main
gauche à l’entrée de l’antre. M. Schott croit que c’eft
la Pythie ou la prêtreffe d’Apollon, & non pas la Sy-
bille, que les favans confondent fouvent très-mal-à-
propos avec elle. Selon la remarque judicieiife
de- M. Petit, dont on rapporte un beau paffage,
celle-ci pouYojt prédire en tout tems & en tout
lieu, au lieu que celle-là ne,lg pouvoit que lorf-
que, étant-fur le trépied , elle recevoit l’infpiration.
divine dans le'temple.
4. Le quatrième eft le vieillard repréfenté au haut
de la montagne. M. Schott rejette le . fentiment de
ceux qui je\px,énhent pour Homere ; parce qu’il ne
fauroit, s’imaginer que l’ouvrier ait exprimé fur un
feul monument deux apotfieQfe^i d’une même p_er-'
fonne. II. pfencl donc ce vieillard pour Jupiter. En
effetjifa.'çpnti'nance ,■ fon habillement, fa piquè;ou
fon feeptre, & principaiement fon aigle, font autant
de ‘marques certaines qui dépofent en fa. Faveur.
M.. Adiffon, qui a mis un foüdre .à la main de cette
figure, n’a voit pas affez bien examine ce monument..
Un:femblable;fymbole ne convenoit point ici’ , oii
Jupiter, n’eft pas pour .punir le.crime, mais pour ré-
compenfer le mérite & la vertu.
5. Le1 cinquième, enfin.eft l'homme enmanteau,
qui à tant embar-raffé les,interprètes. L’auteur entraîné
par.l’autorité du P. Kircher, de même que
prefqlie tous ,l:es favans, avoit d’abord cru qiie c’é-
toit un.prêtre'; mais après avoirconfidérélachofe
plus attentivement, il s’eft rangé à l’opinion de M .
Spanlieim quirprend cette figuré pour le philofophe
Bias,, rhbnheur de la v ile de Priene , patrie de l’ouvrier^’
Il s^én. éloigne néanmoins en ceci,; c’eft qu’il
ne regarde point ce morceau comme une figure qui
faffe partie de Vapotfiéofe,niais fimplement comme une
ftatue pofée fur ce monument par l’ouvrier,pour honorer
la patrie.Contre le fentiment de tous les.àuteurs
qui ont expliqué ce monument,, il ne reconnoît autre
chofe. qu’un trépied dans tout .ee qui eft rep.réfenté
derrière &■ àu-aeffus de la têtefle ce philofophe. Il ne
conçoit rien de mieux imaginé que cela',.pour ,ca-
ra&érifer Bias , à qui les autres Sages de la Grèce
envoyèrentcomme au plus fage le trépied d’or ,
que des pêcheurs Ioniens avoient trouvé; & il doute
fi peu qîié cette ftatue foit celle de ce.philofophe,
qu’il affure que lapoftérité doit être fort redevable
au fcülpteur Archélaüs, de lui avoir confervé la figure
& le portrait de ce grand homme, qui lui manquoit,
& que les curieux avoient vainement cherché juf-
qu’ici avec beaucoup de foin. C ’eft dommage qu’on
foit obligé de perdre une efpérance auffi natteufe
que celle-là, prefqu’auffitôt qu’on l’a conçue ; &
que l’auteur ait été contraint de la détruire lui-même
par la nouvelle opinion qu’il a embraffée, touchant
cette figure, vers la fin de fon ouvrage.
II. Après ces préliminaires,M. Schott vient à l’explication
du marbre, fuivant l’idée qu’il s’en eft
faite, & q ui, comme il en eft perfuadé, eft celle de
l’ouvrier même. Selon lu i, cet ouvrier s’eft conduit
par-tout en artifte habile , ingénieux & de très-
B.on goût. Il ne s’eft point borné à la feule cirçonf-
tance de Yapothcofe d’Homere, mais il a fait entrer
auffi dans fon deffein ce quia précédé cette cérémonie.
Pour cet effet il a repréfenté une efpece de
négociation entre Apollon, Jupiter & les Mufes
pour la déification d’Homere: & il a partagé fon
ouvrage en trois a êtes difterens, que nous examinerons
l’un après l’autre.'
1. Dans le premier qui eft au milieu. du marbre
, Clio & Uranie, l’une reconnoiffable à fa lyre,
& l’autre à fon globe , s’entretiennent du mérité
d’Homere, & de la juftice qu’il y auroit à le mettre
au nombre des dieux. Calliope, après avoir propofé
l’affaire à Apollon, qui eft à l’entrée de l’antre , en
attend une réponfe favorable, & femble en recevoir
l’afte de corifentement dans un rouleau que
lui préfente la Pythie qui eft à côté d’Apollon.
2. Dans le fécond qui eft au-haut du marbre,
Polymnie, députée de fes compagnes , propofé la
chofe à Jupiter, & reçoit fon contentement, qu’E-
rato, qui eft à côté d’elle , apprend avec de fi grands
trantports.. de jo ie , qu’elle en laiffe tomber fa ly re ,
& qu’elle fe met à danfer & fauter d’une maniéré
extraordinaire. L’auteur eft furpris que le pere Kyr-
cher ait .trouvé dans cette1 figure, la pofture d’une
perfonne qui fupplie Jupitèr avec une vénération
profonde. On voit enfuite Euterpe qui tient deux
flambeaux, félon le pere Kircher & quelques autres,
ou , félon' M. Schott, deux flûtes dont elle eft l’in -,
ventrice. Après elle vient Therpficore qui tient
une guitarre. .L’auteur eft bien fâché qu’elle foit
mal défljnéé par le copifte ; car un deffin exatt de
cet endroit du marbre feroit d’un, grand fecours pour
établir là différence, entre la lyre & la guitarre anciennes,
qu’on n’a pas encore affez bien expliquées.
Çette mufe fait figue du doigt aux deux précédentes
de ne .point interrompre par leurs mouvement
les louanges du nouveau dieu, ou les actions
de grâce à Jupiter, que chantent déjà Melpomene
& Thalie. Selon M. Cuper, toutes ces mules chantent
; mais félon l’auteur , il n’y a que ces deux
dernieres qui le faffent, & même leur aftion lui
paroît dépeinte fi naïvement, qu’il lui femble les
entendre.. . . . .
, 3.. Dans le troifieme on trouve enfin Yapothéofe
ou confécration d’Homere. Cette cérémonie fe paffe'
dans un temple,.dont le dedans eft orné d’une ta-
piiïerie. Gela fe prouve par des colonnes placées
à diftances égales,& fait voir que M. Gronovius a
tort de n’être pas de cet avis. Homere , comme le
principal perfonnage de la pièce", y paroît d’une
taille plus grande que l’ordinaire,& plus conforme à
fon nouvel état de dieu. Il eft affis devant un autel ,.au
bas duquel on voit deux lettres qui,félon l’auteur,
doivent être deux AA , fur l’original, & qui lignifient
fans" doute le nom de l’ouvrier Ap%i\a.oç
a.7t«AXmWk. Pas un des interprètes de ce marbre , n’a
pris garde à ces lettres.' La terre ( omou/xivn') &
le temps ( xpoi'of.) couronnent Homere, pour marquer
qù’ën tous lieux, qu’en tous tems, fon mérite
fera reconnu. L’Iliade & l’Odyffée ( I
oS'iirtnitt ) les deux grands ouvrages de ce nouveau,
dieu foutiennent fon fiege. Quelques volumes
que. les rats rongent, lui fervent de marchepied.
La plupart des interprètes croient que ces petits animaux
défignent le Batrachomyomachie d’Homere ; &C
MM. Wetftein & Kufter en doutent fi peu, qu’ils
les prennent pour une preuve certaine que ce poème
appartient véritablement à Homere. M. Gronovius
réfute fort bien ce fentiment-là, & foutient avec raifon
, que fi ç’avoit été là la vue de l’ouvrier, il n’au-
roit pas manqué de placer une grenouille entre ces
fou ris ; mais lorfqu’il avance que ces rats ou fou-
ris regardent ici Apollo Sminthæus , fa conjefture
eft encore moins fondée que celles qu’il réfute.
L’auteur veut que ces petits animaux foient
un beau fymbole des envieux du grand Homere ,
& particuliérement du grand Zoïle qui, pour avoir
ofé écrire contre ce' poëte, fut furnommé H orner 0-
majiix. Le parterre du temple eft rempli de plufieurs
génies des beaux arts & des fciences, qui fe difpofent
à faire un facrifice au nouveau dieu. Le jeune facri-
ficateur prêt à faire des libations, mais particuliérement
le taureau, qu’on offroit ordinairement à Jupiter
, marquent que ce facrifice ne doit pas etre
moins folemnel que ceux qu’on avoit coutume de
faire à l’honneur de la divinité fuprême.
M. Schott ajoute que ce feroit vouloir entreprendre
d'écrire l'Iliade apres Homere, que de vouloir éclaircir
plus amplement cet endroit du marbre après le favant
& l'illujlre M. Cuper qui y fatisfait d’une maniéré
ample &folide ; & il fe contente de faire deux petites
remarques : la première fur le mot mnhmh , qui
défigne une des figures de ce troifieme afte. M.
Cuper prétend que ce mot fignifie ici l’Hiftoire : mais