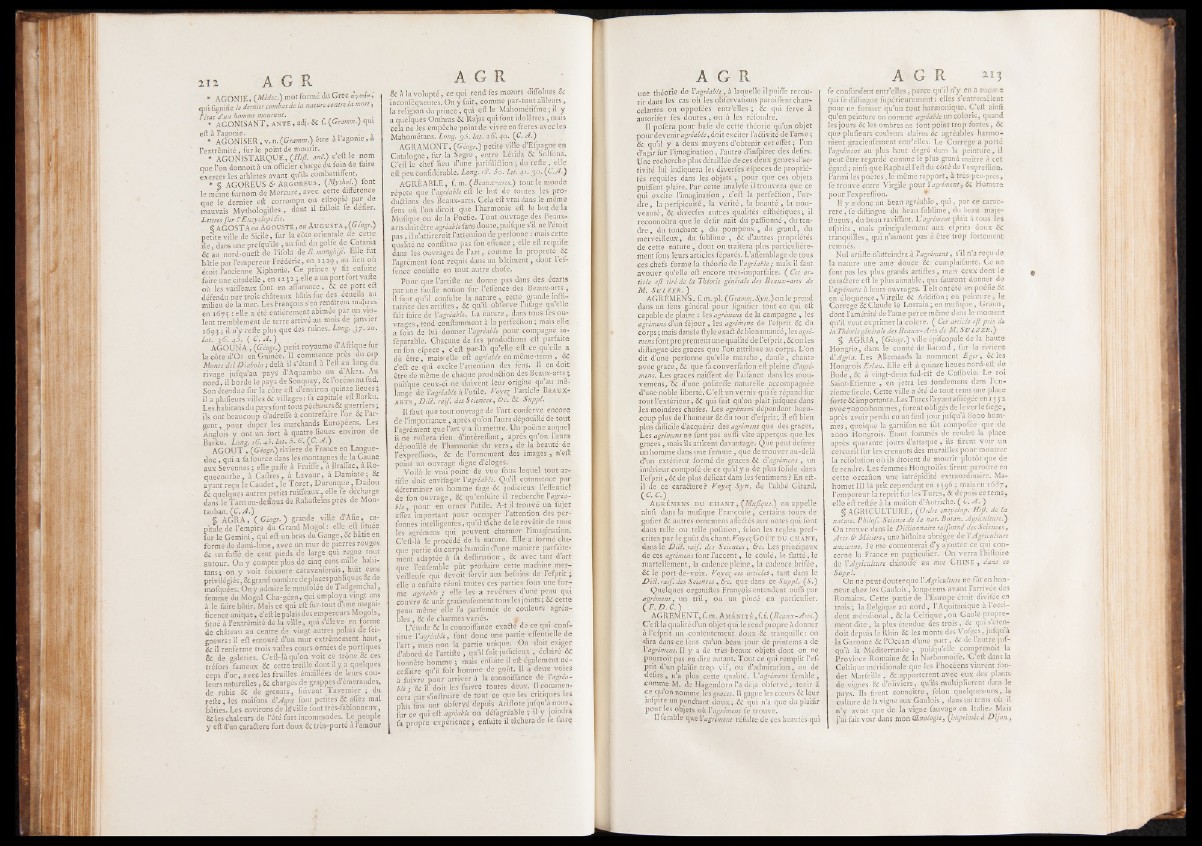
* AGONIE, (Médec.) mot formé du G rec *?m* »
qui fignifie le dernier combat de la nature contre la mort,
Y état d'un homme mourant. '
* AGONISANT, A N T E , ad j. & f. (Gramm.) q u i
eft à l ’a g o n ie . 1 A - A
* AGONISER, v .n .(Gramm.) être à 1 agonie, a
l’extrémité, fur le point de mourir.
* AGONISTARQUE, (Hift. and.) ce ft le nom
que l’on donnoit à un officier chargé du fom de faire
exercer les athlètes avant qu’ils co^attment.
* « AGOREUS 6- Argoreus , (Mythol) font
le même furnom de Mercure, avec cette différence
que le dernier eft corrompu ou eftropie par de
mauvais Mythologues , dont il falloit fe defier.
Lettres fur CEncyclopédie.
§ AGOSTA ou A g o uste, ou A u g u stA , (Geogr.)
petite ville de Sicile, fur la côte orientale de cette
île , dans une prefqu’île , au fud du golfe de Catama
& au nord-oueft de l’ifola: de li monghiji. Elle tut
bâtie par l’empereur Frédéric, en 1219 , au heu ou
étoit l’ancienne Xiphonie. Ce prince y fit enluite
faire une citadelle, en 1232 ; elle a un port fort vatte
oîi les vaiffeaux font en affurance, & ce port eft
défendu par trois châteaux bâtis fur des eçueils au
milieu de la mer. Les François s’en rendirent maîtres
en 1675 : elle a été entièrement abîmée par un v iolent
tremblement de terre arrive au mois de janvier
1693 ; il n’y refte plus.que des ruines. Long. 3 7 .20.
lat. 36'. 4S. ( C. A . ) H H > .
AGOUNA , (Géogr.) petit royaume d Afrique lur
la côte d’Or en Guinée. Il commence près du cap
Monte del Diabolo ; delà il s’étend à l’eft au long du
rivage jufqu’au pays d’Aquambo ou d Akra. Au
nord, il borde le pays de Sonquay, & l’océan au fud.
Son étendue fur la côte eft d’environ quinze lieues ;
il a plufieurs villes & villages :-la capitale eft Barku.
Les habitans du pays font tous pécheurs & guerriers ;
ils ont beaucoup d’adreffe à contrefaire l’or 6c 1 argent
, pour duper les marchands Européens, Les
Anglois y ont un fort à quatre lieues environ de
Barku. Long. iG. 4-5. bat. 5 . G. {C. A .)
AGOUT , (Géogr.) riviere de France en Languedoc
, qui a fa fource dans les montagnes de la Caune
aux Sevennes ; elle paffe à Fraiffe, à Braffac, à Ro-
quecourbe, à Caftres, à Lavaur, à Damiate ; &
ayant reçu le Caudet, le T o re t, Durenque, Dadou
& quelques autres petits ruiffeaux, elle fe décharge
dans le Tarn au-deffous de Rabafteins près de Mon-
tauban. (C .A .)
§ AG R A , (Géogr.) grande ville dA fie , capitale
de l’empire du Grand Mogol: elle ëft^lituee
lur le Gemini, qui eft un bras du Gange, & bâtie en
forme de demi-lune, avec un mur de pierres rouges
& im foffé de cent pieds de large qui régné tout
autour. On y compte plus de cinq cens mille habitans
; on y voit foixante caravanferais, huit cens
privilégiés, & grand nombre de places publiques & de
mofquées. On y admire le maufolee de Tadgemchal,
femme du Mogol Cha-géan, qui employa vingt ans
à le faire bâtir. Mais ce qui eft fur-tout d’une magnificence
unique, c’eftle palais des empereurs Mogols,
litué à l’extrémité de la v ille , qui s’eleve en forme
de château au centre de vingt autres palais de fei-
gneurs : il eft entouré d’un mur extrêmement haut,
& il renferme trois vaftes cours ornées de portiques
& de galeries. C’eft-là qu’on v o it ce trône 6c ces
tréfors fameux & cette treille dont il y a quelques
ceps d’o r , avec les feuilles émaillées de leurs couleurs
naturelles, & chargés de grappes d’émeraudes,
de rubis & de grenats, fuivant Tavernier ; du
refte, les maifons à'Agra font petites 6c affez mal
î>âties. Les environs de Avilie font très-fablonneux,
& le s chaleurs de l’été fort incommodes. Le peuple
y eft d’un caraétere fort doux & très-porte à l’amour
& à la volupté, ce qui retld fes moeurs diffqlues &
inconféquentes. On y fuit, comme par-tout ailleurs ,
la religion' du prince , qui eft le Mahometifme ; il y
a quelques Omhras & RajaS qui font idolâtres , mais
Cela ne les empêche point de vivre en freres avec les
Mahométans. Long. § 5. lat. zG. 40. (C. A .)
AGRAMONT, (Géogr.) petite ville d’Efpagne en
Catalogne, fur la Segre , entre Léridà & Solfona.
C’eft le chef lieu d’une jurifdiftion ; du refte , elle
eft peu Confidérable. Long. 18. 5o. lat. 41. 30. (C.A.)
AGRÉABLE, f. m. (Beaux-arts.) tout le monde
répété que l’agréable eft le but de toutes les produirions
des Beaux-arts. Cela eft vrai dans le meme
fens où l’on diroit que l’harmonie eft le but de la
Mufique ou de la Poëfie. Tout ouvrage des Beaux-
arts doit être agréable fans doute, puifque s’il ne l’étoit
pas , iln’attireroit l’attention de perfonne : mais cette
qualité ne conftitue pas fon effence ; elle eft requife
•dans les ouvrages de l’art, comme la propreté ^ 6c
l’agrément font requis dans un bâtiment, dont l’ef-
fence confifte en tout autre chofe.
Pour que l’artifte ne donne pas dans des écarts
par une fauffe notion fur l’effence des Beaux-arts ,
il faut qu’il confulte la nature , cette grande infti-
tutrice des artiftes, 6c qu’il obferve l’ufage qu’elle
fait faire de Y agréable. La nature, dans tous fes ouvrages
, tend conftamment à la perfeftion ; mais elle
a foin de lui donner Y agréable pour compagne in-
féparable. Chacune de fes: produaions eft parfaite
en fon efpece , c’eft par-là qu’elle eft ce qu’elle a
dû être, mais* elle eft agréable en meme-tems , &
c’eft ce qui excite l’attention des fens. 11 en doit
être de même de chaque production des Beaux-arts^;
puifque ceux-ci ne doivent leur origine quau mélangé
de Y agréable à l’utile. Voye£ 1 article B EAUX-
ARTS,, Dicl. raif. des Sciences, &c. 6c Suppl.
Il faut que tout ouvrage de l’art conferve encore
de l’importance , après.qu’on l’aura dépouillé de tout
l ’agrément que l’art y a lu mettre. Un poëme auquel
il ne reliera rien d’intéreffant, après qu’on l’aura
dépouillé de l’harmonie du vers“, de la beauté de
j l’expreffion*, 6c de l’ornement des images , n’eft
point un ouvrage digne d’éloges.
Voilà le vrai point de vue fous lequel tout ar-
tifte doit envifager Y agréable. Qu’il cotnmence par
déterminer en homme fage & judicieux l’effentiel
de fon ouvrage, 6c qu’enfuite il recherche Y agréable,
pour en orner l’utile. A-t il trouvé un fujet
affez important pour occuper l’attention des per-
fonnes intelligentes, qu’il tâche de le revêtir de tous
les agrémens qui peuvent charmer l’imagination.
C’eftdà le procédé de-la nature. Elle a formé chaque
partie du corps humain d’une maniéré parfaitement
adaptée à fa deftination , & avec tant dart
- qUe l’enfemble pût produire cette machine mer-
veilleufe qui devoit lervir aux befoins de Tefprit ;
elle a enfuite réuni toutes ces parties foiis une forme
agréable ; elle les a revêtues d’urië peau qui
couvre & unit gracieufement tous les joints ; 6c cette
peau même elle l’a parfemée de couleurs agréables
, & de charmes variés. f
L’étude 6c la connoiffance exa&e de ce qui conftitue
Y agréable, font donc une partie efféntielle de
l’a r t , mais non la partie unique.' On doit exiger
d’abord de l’artifte , qu’il foit judicieux , éclairé &
honnête homme ; mais enfuite il eft également né-
ceffaire qu’il foit homme de goût. Il a deux voies
à fuivre' pour arriver à la connoiffance de Y agréa-
ble - & il doit les fuivre toutes deux. Il commencera
par s’inftruire de tout ce que les critiques les
plus.fins ont obferyé depuis Ariftote jufqu’à nous,
fur ce qui eft agréable ou défagréable ; il y joindra
fa propre expérience ; enfuite il tâchera de fe fairç
une théorie de l’agréable , à laquelle il pmffe recourir
dans les cas où les obfervations paroiffent chancelantes
ou oppofées entr’elles ; & qui ferve à
autorifer fes doutes, ou à les réfoudre.
Il pofera pour bafe de cette théorie qu’un objet
pour devenir agréable, doit exciter l’a&ivité de l’ame ;
& qu’il y a deux moyens d’obtenir cet effet ; l’un
d’agir fur l’imagination, l’autre d’infpirer des defirs.
Une recherche plus détaillée de ces deux genres d’activité
lui indiquera les diverfes efpeces de propriétés
requifes dans les objets , pour que ces objets
puiffent plaire. Par cette analyle il trouvera que ce
qui excite l’imagination., c’ eft la perfection, l’ordre
, la perfpicuité, la vérité, la beauté , la nouveauté,
6c diverfes autres qualités efthétiques ; il
reconnoîtra que le defir naît du paffionné , du tendre
, du touchant , du pompeux , du grand, du
merveilleux, du fublime , 6c d’autres propriétés
de cette nature , dont on traitera plus particuliérement
fous leurs articles féparés. L’affemblage de tous
ces chefs forme la théorie de Y agréable; mais il faut
avouer qu’elle eft encore très-imparfaite. ( Cet article
eft tiré de la Théorie générale des Beaux-arts de
M. S u l z e r . )
AGRÉMENS, f. m. pl. (Gramm. Syn.) on le prend
dans un fens général pour lignifier tout ce qui eft
capable de plaire : les agrément de la campagne , les
agrémens d’un féjour , les agrémens de l’elprit & du
corps ; mais dans le ftyle exact & bien nuancé, les agrémens
(ont proprement une qualité de l’efprit,&on les
diftingue des grâces que l’on attribue au corps. L’on
dit d’une perfonne ..qu’elle marche, danfe, .chante
avec grâce, & que fa converfation eft pleine d’agré-
itiens. Les grâces naiffent de l’aifance dans les mou-
vemens, d’une politeffe naturelle accompagnée
d’une noble liberté. C ’eft un vernis qui fe répand fur
tout l’extérieur, & qui fait qu’on plaît jufques dans
les moindres chofes. Les agrémens dépendent beaucoup
plus de l’humeur & du tour d’efprit; il eft bien
plus difficile d’acquérir des agrémens cjue des grâces,
Les agrémens ne font pas- auffi vite apperçus que les
grâces, mais ils attirent davantage. Que peut defirer
un homme dans une femme, que de trouver au-delà
d’un extérieur formé de grâces & dû agrémens , un
intérieur compofé de ce qu’il y a de plus folide dans
l’efprit, & de plus délicat dans les fentimens? En eft-
il de ce caraftere? Voyez Syn. de l’abbé Girard.
( C .C . ) .
Agrémens du chant , (Mujiqus.) on appelle
ainfi dans la mufique Françoife, certains tours de
gofier & autres ornemens affeôés aux notes qui font
dans telle ou telle pofition, félon les réglés pref-
crites par le goût du chant. Voye^Goût du chant,
dans le Dicl. raif. des Sciences, &c. Les principaux
de cçs agrémens font l’accent, le coulé, le flatté, le
martellement, la cadence pleine, la cadence brifée,
& le port-de-voix. Voye^ ces articles, tant dans le
Dicl. raif. des Sciences, &c. que dans ce Suppl. (S.)
Quelques organiftes François entendent auffi par
agrément, un tril, ou un pincé en particulier.
( F. D . C. )
AGRÉMENT,f. m. AMÉNiTÊ,f.f. (Beaux-Arts.)
C ’eft la qualité d’un objet qui le rend propre à donner
à l’efprit un contentement doux & tranquille : on
dira dans ce fens qu’un beau jour de printems a de
Y agrément. Il y a de très-beaux objets dont on ne
pourroit pas en dire autant. Tout ce qui remplit l’ef-
prit d’un plaifir trop v if, ou d’admiration, ou de
defirs , n’a plus nette qualité. L’agrément femble,
comme M. de Hagendornl’a déjà obfervé, tenir à
ce qu’on nomme les grâces. Il gagne les coeurs & leur
infpire un penchant doux, & qui n’a que du plaifir
pour les objets oîi Y agrément fe trouve.
Il femble que Y agrément réfulte de ces beautés qui
fe confondent entr’elles, parce qu’il n’y en a aucune
qui fe diftingue fupérieurement : elles s’entremêlent
pour ne former qu’un tout harmonique. C’eft ainfi
qu’en peinture on nomme agréable un coloris, quand
les jours & les ombres ne font point trop fortes, &
que plufieurs Couleurs claires & agréables harmo-
nient gracieufement entr’elles. Le Correge a porté
Y agrément au plus haut degré dans la peinture, il
peut être regardé comme le plus grand maître à cet
égard ; ainfi que Raphaël l’eft du côté de l’expreffion.
Parmi les poètes, le même rapport, à très-peu-près *
fé trouve entre Virgile pour Y agrément) & Homere
pour l’expreffion.
Il y a donc un beau agréable, q ui, par ce earac-
rere, fe diftingue du beau fublime, du, beau maje-
ftueux, du beau raviffant. L’agrément plaît à tous les
efprits , mais principalement aux elprits doux &:
tranquilles, qui n’aiment pas à être' trop fortement
remués.
Nul artifte n’atteindrà à Y agrément, s’il n’a reçu de
la nature une âme douce 6c complaifante. Ce ne
font pas les plus grands artiftes, mais ceux dont le q
caraftere eft le’plus aimable, qui fauront donner de
Yagrément à leurs ouvrages. Tels ont été en poéfie &C
en,éloquence, Virgile 6c Addifon; èn peinture, le
C o rreg é& Claude le Lorrain; en mufique, Graun,
dont l’aménité de l’ame perce même dans le moment
qu’il veut exprimer la colere. ( Cet article ejl pris de
laThéorie générale des Beaux-Arts de M. S u L Z E R .)
§ AGRIA, (Géogr.) ville épifcopale de la haute
Hongrie, dans le comté de Barzod, fur la riviere
d’Agria. Les Allemands la nomment Eger, & les
Hongrois Erlau. Elle eft à quinze lieuesnord-eft de |
Bude, & à vingt-deux fud-eft de Caffovie. Le roi
Saint-Etienne , en jetta les fondemens dans l’cn-
zieme fiecle. Cette ville a été de.tout tems une place
forte &importante..LesTurcs l’ayant affiégée en 1552
avec70ôoohommes, furent obligés de lev er le fiege,
après avoir perdu en un feul jour jufqu’à 8000 hommes,
quoique la garnifonne fût compofée que.de
2.000 Hongrois. Étant fommés de rendre la place
après quarante jours d’attaque , ils firent voir un
cercueil fur les crenauts des murailles pour montrer
la réfolution où ils étoient de mourir plutôt que de
fe rendre. Les femmes Hongroifes firent paroître en
cette occafion une intrépidité extraordinaire. Mahomet
III la prit cependant en 1596; mais èn i6 S y ,
l’empereur la reprit fur les Turcs, & depuis ce tems,
elle eft reftée à la maifon d’Autriche. ( C .A . )
§ AGRICULTURE, (Ordre encycLop. Hijl. de la
nature. Pkilof Science de la nat. Botan. Agriculture.)
On trouve dans le Dictionnaire raifonné des Sciences ,
Arts & Métiers, une hiftoire abrégée de Y Agriculture
ancienne. Je me contenterai d’y ajouter ce qui concerne
la France en particulier. On verra l’hiftoire
de Y Agriculture chinoife au mot C h in e , dans ce
Suppl. ■. ' '"V • ’ ■ r - •
On ne peut douter que Y Agriculture ne fut en honneur
chez les Gaulois, long-tems avant l’arrivee des
Romains. Cette partie de l’Europe étoit divifee en
trois ; la Belgique au nord, l’Aquitanique a l’occident
méridional, & la Celtique, ou Gaule proprement
dite , la plus étendue des trois , 6c qui s eten-
doit depuis le Rhin & les monts des Vofges, jufqu’à
la Garonne 6c l’Océan d’une part, & de 1 autre jufqu’à
la Méditerranée , puifqu’elle comprenoit la
Province Romaine & la Narbonnoife. C eft dans la
Celtique méridionale que les Phocéens vinrent fonder
Marfeille , & apportèrent avec eux des plants
de vignes & d’oliviers, qu’ils multiplièrent dans le
pays. Ils firent connoître, félon quelques-uns, la
culture de la vigne aux Gaulois , dans un tems où il
1 n’y avoit que de la vigne fauvage en Italie.* Mais
j’ai fait voir dans mon OEnologie, (imprimée à D ijon ,