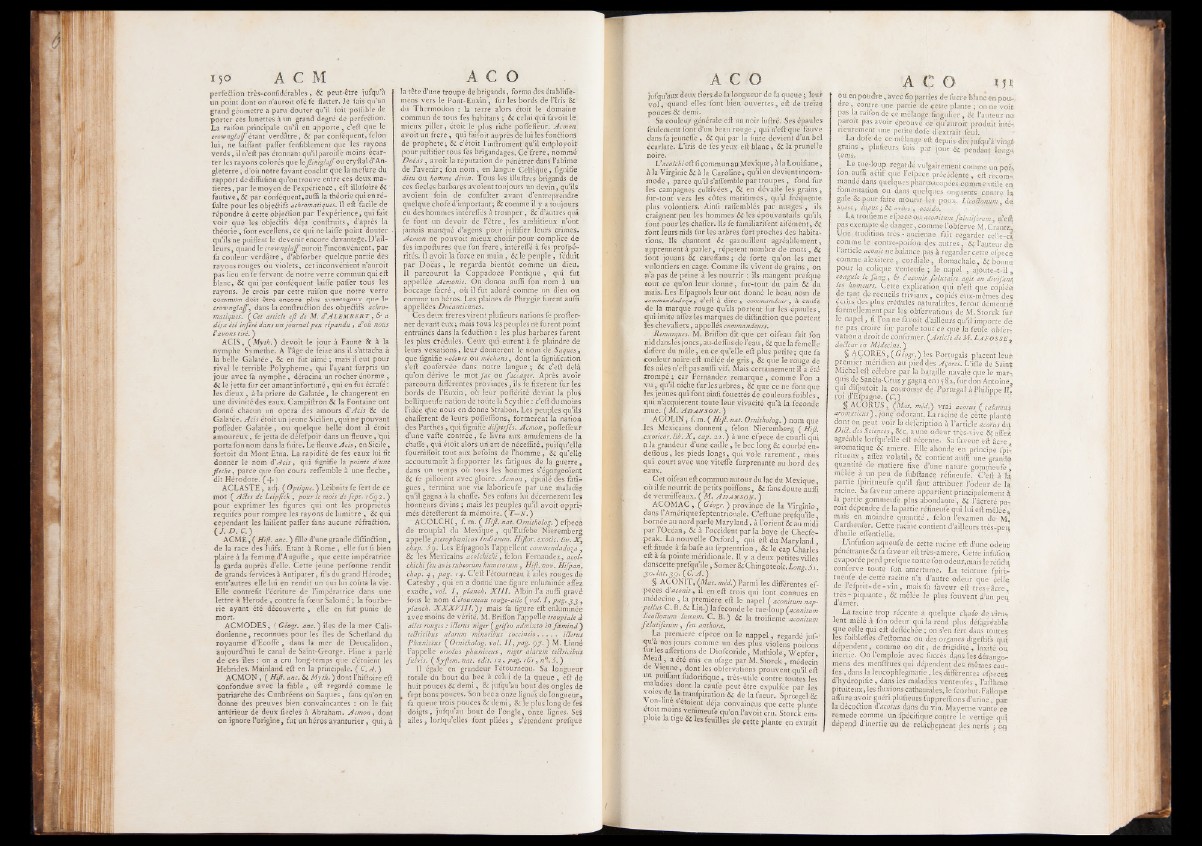
53.
M ° A C M
perfeôion très-confidérables, & peut-être jufqu’à
un point dont on n’auroit ofé fe flatter. 3e fais qu’un
grand géomètre a paru douter qu’il foit poflible de
porter ces lunettes à un grand degré de perfection.
La raifon principale qu’il en apporte, c’eft que le
crownglafétant verdâtre, & par conféquent, félon
lui, ne laiffant paffer fenliblement que les rayons
verds, il n’eft pas étonnant qu’il paroiffe moins ecar-
ter les rayons colorés que lefiintglajf ou cryftal d’Angleterre
, d’où notre favant conclut que la mefure du
rapport de diffufion qu’ontrouve entre ces deux matières
, par le moyen de l’expérience, eft illufoire &
fautive, & par conféquent, aufli la théorie qui en re-
fulte pour les objectifs achromatiques. Il eft facile de
répondre à cette objection par l’expérience, qui fait
voir que les objectifs déjà conftruits, d’après la
théorie, font excellens, ce qui ne laiffe point douter .
qu’ils ne puiffent le devenir encore davantage. D ’ailleurs
, quand le crownglajfauroit l’inconvénient, par
fa couleur verdâtre, d’abforber quelque partie des
rayons rouges ou violets, cet inconvénient n’auroit
pas lieu en fe fervant de notre verre commun qui eft
blanc, & qui'par conféquent laiffe pafler tous les
rayons. Je crois par cette raifon que notre verre
commun doit être encore plus avantageux que le
crownglajf, dans la conftru&ion des objeCtifs achromatiques.
( Cet article eß de M. <£ALEMBERT , & a
déjà été inféré dans un journal peu répandu , d'ou nous
Vavons tiré. )
A CIS, (Mytk.) devôit le jour à Faune & à la
nymphe Symethe. A l’âge de feize ans il s’attacha à
la belle Galatée, & en fut aimé ; mais il eut pour
rival le terrible Polypbeme, qui l’ayant furpris un
jour avec fa nymphe, déracina un rocher énorme ,
& le jetta fur cet amant infortuné, qui en fut écrafé :
les dieux, à la priere de Galatée , le changèrent en
une divinité dés eaux. Campiftron & la Fontaine ont
donné chacun un opéra des amours dé Acis & de
Galatée. Acis étoit un jeune Sicilien, qui ne pouvant
pofîeder Galatée , ou quelque belle dont il étoit
amoureux, fe jetta de défefpoir dans un fleuve, 'qui
portafon nom dans la fuite. Le fleuve Acis, en Sicile,
fortoit du Mont Etna. La rapidité de fes eaux lui fit
donner le nom d'A cis , qui fignifie la pointe d'une
fléché, parce que fon cours reflemble à Une fléché,
dit Hérodote, (-f- )
A C LA STE , adj. ( Optique. ) Leibnitz fe fert de ce
mot ( Actes de Leipfick , pour le mois de fept. 7 6jp2. )
pour exprimer les figures qui ont lés propriétés
requifes pour rompre les rayons de lumière , & qui
cependant les laiffent pafler fans aucune réfraction.
QJ-D.C. )
ACMÉ, ( Hiß. anc. ) fille d’une grande diftinftion,
de la race des Juifs. Etant à Rome , elle fut fi bien
plaire à la femme d’Augufte , que cette impératrice
la garda auprès d’elle. Cette jeune perfonne rendit
de grands ferviëesà Antipater, fils du grand Hérode;
entr’autres elle lui en rendit un qui lui coûta la vie.
Elle contrefit l’écriture de l’impératricë dans une
lettre à Herode , contre fa foeur Salomé ; la fourberie
ayant été découverte , elle en fut punie de
mort.
ACMODES, ( Gèogr. anc. ) îles de la mer Cali-
donienne, reconnues pour les îles de Schetland du
royaume d’Ecofle , dans la mer de Deucalidon,
aujourd’hui le canal de Saint-George. Pline a parlé
de ces îles : on a cru long-temps que c’étoient les
Hébrides. Mainland eft en la principale. (C. A.)
ACMON , ( Hiß. anc. & Myth. ) dont l’hiftoire eft
confondue avec la fable , eft regardé comme le
patriarche des Cunbréens ou Saques, fans qu’on en
donne des preuves bien convaincantes : on le fait
antérieur de deux fiecles à Abraham. Acmon, dont
on ignore l’origine, fut un héros avanturier, qui, à
A C O
la tête d’une troupe de brigands, forma des établifle-
mens vers le Pont-Euxin , fur les bords de l’Iris &
du Thermodon : la terre alors étoit le domaine
commun de tous fes habitans ; & celui qui favoit le
mieux piller, étoit le plus riche poflefleur. Acmon
avoit un frere, qui faifoit auprès de lui les fondions
de prophète ; & c’étoit l'inftrument qu’il errtployoit
pour juftifier tous fes brigandages. Ce frere, nommé
jDotas, avoit la réputation de pénétrer dans l’abîme
de l’avenir ; fon nom, en langue Celtique, fignifie
dieu ou homme divin. Tous les illuftres brigands de
ces fiecles barbares avoienttoujours un devin, qu’ils
av oient foin de confulter avant d’entreprendre
quelque chofe d’important; & comme il y a toujours
eu des hommes intérefles à tromper, & d’autres qui
fe font un devoir de l’être, les ambitieux n’ont
jamais manqué d’agens pour juftifier leurs crimes.
Acmon ne potivoit mieux, choifir pour complice de
fes impoftures que fon frere, intéreflé à fes profpé-
rités. U avoit la force en main , & lé peuple , féduit
par D o ë a s , le regarda bientôt comme un dieu.
Il parcourut la Cappadoce Pontique , qui fut
appellée Acmonie. On donna aufli fon nom à un
boccage facré, où il fut adoré comme un dieu ou
comme un héros. Les plaines de Phrygie furent aufli
appellées Do'èantiennes.
Ces deux freres virent plufieurs nations fe profter-
ner devant eux; mais tous les peuples ne furent point
entraînés dans la féduftion : les plus barbares furent
les plus crédules. Ceux qui eurent à fe plaindre de
leurs vexations, leur donnèrent le nom de Saques ,
que fignifie voleurs ou médians, dont la fignification
s’eft confervée dans notre langue ; & c’eft delà
qu’on dérive le mot Jac ou faccager. Après avoir
parcouru différentes provinces, ils fie fixèrent fur les
bords de l’Euxin, où leur poftérité devint la plus
belliqueiife nation de toute la Scythîe : c’eft du moins
l'idée que nous en donne Strabon. Les peuples qu’ils
cbafferent de leurs po'fîefiions, formèrent la nation
des Parthes, qui fignifie difperfés. Acmon, poflefleur
d’une vafte contrée, fe livra aux amufemens de la
chaffe, qui étoit alors urfiart de néceflité, puifqu’elle
fourniflbit tout aux befoins de l’homme , & qu’elle
accoutumoit à fupporrer lés fatigues de la .guerre,
dans on temps où tous les hommes s’égorgèoient
& fe pilloient avec gloire. Acmon, épuifé des fatigues
, 'termina une vie lâbbrieufe par une maladie
qu’il gagna à la chaffe. Ses énfans lui décernèrent les
honneurs divins ; mais lès peuples qu’il avoit oppri^
; més dérefterent fa mémoire. (T —jv. )
A CO LCH I, f. m. ( Hijl. nat. Ornitkolog. ) efpecè
de troüpial du Mexique , qu’Eufebe Nieremberg
appelle pterophczhicus Indiarum. Hijlor. éxotic. liv. X ,
chap. Scf . Les Efpagnols l’appellent commendado7a ,
& les Mexicains acolchichî, félon Fernandèz, acol-
chichi feu avis rubeorum humerorum , Hijl. nov. Hifpan.
chap. 4 , pag. 14. C ’eft l’étourneau à ailes rouges de
Catesby , qui en a donné une figure enluminée affez
exafie, vol. / , planch, X I I I . Albin l’a aufli gravé
fous le nom à!étourneau rouge-aile ( vol. I , pag. 3 3 ,
planch. X X X V l l l . ) ; mais fa figure eft enluminée
avec moins de vérité. M. Briffon l’appelle troupiale à
ailes rouges : iclerus niger ( grifeo adrnixto in feeminâ )
tectricibus alarum mihoribus coccineis.......... iclerus
Phoeniceus ( Ornïtholog. vol. I I , pag. 9 y. ) M. Linné
l’appelle oriolus phceniceus, niger ala,rum tectricibus
fulvis. ( Syjlem. nat. edit. 12, pag. i ’Ci , n% 5. )
Il égale en grandeur l’étourneau. Sa longueur
totale du bout du bec à celui de la queue, eft de
huit pouces & demi, & jtifqu’au bout des ongles de
, fept bons pouces. Son bec a onze lignés de longueur,
fa queue trois pouces & demi, & le plus long de fes
doigts, jufqu’au bout de l’ongle, onze lignes. Ses
ailes, lorfqu’elles font pliées, s’étendent prefquë
t
l
jufqu’aux deux tïers.de la longueur de là queue ; leufi
v o l , quand elles font bien ouvertes, eft de t r e i z e
pouces & demi.
, Sa couleur générale eft un noir luftré'. Ses épaules
feulement fönt d’un beau rouge, qui n’eft que ■ fauve
dans fa jeuneffe , & qui par la fuite devient d’un bel
écarlate. L’iris de fes yeux e ft bianç, & la prunelle
noire.
Uacolchi eft fi commun au Mexique, à la Louifiane-,
à la Virginie & à la Caroline , qu’ilen devient incommode
, parce qu’il s’aflemble par troupes , fond fur
les campagnes cultivées, & en dévafte lés grains ,
ftir-tout vers les côtes, maritimes , qu’il fréquent©
plus volontiers, Ainfi raffemblés par nuages , ils
craignent peu les hommes & les épouvantails qu’ils,
font pour les chafler. Ils fe familiarifent aifément, &
font leurs nids fur les arbres fort proches des habita-,
tions. Ils chantent & gazouillent agréablement,
apprennent à parler, répètent nombre de mots, &
font jouans & careffans ; de forte q u ’ o n les met
volontiers en cage. Comme ils vivent de grains, on
n’a pas de peine à les nourrir : ils mangent prefque
tout ce qu’on leur donne, fur-tout du pain & du
maïs. Les Efpagnols leur ont donné le beau nom de ;
commendadoça, ç’eft-à-dire , commandeur, à caufe
de la marque rouge qu’ils portent fur les épaules,
qui imite affez les marques de diftinftion que portent
les chevaliers, appelles commandeurs.
Remarques. M. Briffon dit que c e t oifëau fait fon
nid dansles joncs, au-defîùs de l’ e a u , & que fa femelle
d iffé r é du m â le ., en .e e qü’èlle e ft plus petite; que fa
couleur noire eft mêlée de gris , & que le rouge de
fes ailes n’eft pas aufli vif; Mais certainement il a été :
trompé ; car Fernandez r em a r q u e , comme l’on a ■
v u , qu’il niche fur les a r b r e s , & que ce ne font que j
lesjeunes qui font ainfi fouettés de couleurs.foibles,
qui n’acquierent toute leur vivacité qu’à la feeoqde
mue. ( M. A d a n s o n . )
A CO L1N , f. m. ( Hiß. nat. Ornitkolog. ) nom que I
l e s Mexicains donnent, félon Nieremherg ( Hiß.
-exoticor. lib. X , cap. 22.) à une e fp e c e de CQurli qui
u la grandeur d’une caille, le bec lo n g & courbé en-r -
deflbus, les pieds longs, qui vole rarement, mais
qui court aveç une vîteffe furprenante au bord des
eaux.
Cet oifeau eft commun autour du lac du Mexique,
où ilfe nourrit de petits poiflbns, & fans doute aufli
de vermifleaux. ( M, A dansoet. )
ACOMAC , ( Géogr. ) province de la Virginie,
dans l’Amérique feptentrionale. C ’ e ft u ne p r e fq u ’î l e ,
bornée au nord parle Maryland, à l’orient & au midi
par l’Océan, & à l’o c c id e n t par Ja b a y e de Cbeçfe-
peak. La nouvelle Oxford, qui eft du Maryland ,
eft fituée à fa bafe au feptentrion, & le cap Charles
eft à fa pointe méridionale. Il y a deux petites villes
dans cette prefqu’île , Somer&Chingoteok.Lo/zfr, J /.
ßo . lqt.3ß . (C .A .)
§ ACONIT, {Mat. midi) Parmi les différentes ef-
peces & aconit, i l en eft trois qui font connues en
médecine , la première eft le napel ( aconitum nap-
pellus Ç. B. & L in .) la fécondé le tue-loup (aconitum
licoctonum luteum. C. B .) & la troifieme aconitum
Calutiferum, feu anthora,
La première efpece ou le nappel, regardé juf-'
qu’à nos jours comme un des plus v io le n s poifons
w i e s affertions de Diofcoride, Mathiole, A V e p fe r ,
Mead, a été mis en ufage par M. Storck, médecin
de Vienne, dont les obfervations prouvent qu’il eft
un puiffant fudorifique, très-utile contre toutes les
maladies dont la caufe peut être expulfée par les
-voies de la tranfpiration & de lafueur. Sproegel &
on-une s etoient déjà convaincus que cette plante
«toit moins venimeufe qu’on l’avoit cru. Storck em-
ploie la tige & les feuilles de cette plante extrait
où en pondre, avec 60 parties de fucre blanc en pou-,
dre , contre une partie de cette plante ; on ne voit
pas la raifonde ce mélange fingulier, & Fauteur ne.
paroît pas avoir éprouve ce qu’auroit produit inté-*,
neuremen.t une petite dofe. d’extrait feul.
La dofe de ce mélange eft depuiS‘dix jufqu’àVingfc
grains , plufieurs fois par- jour & pendant long-\
Le tue-loup regardé vulgairement comme un ppK
Ion aufli' a â if que l’efpece précédente , eft récora-%
mandé dans quelques pharmacopées comme-utile en
fomentation ou dans quelques onguents contre.' la,
gale; &-;poùr. faire m'Ourir-ks poux. Licoctonum J d i
lupus } & HTiivo\x ocçidô.
La troifieme efpece o4u,ctconituni falutiferuni, n’eft}
pas exempte de danger , comme l’ob/erve M.Crantr,
Une tradition, très - ancienne fait regarder celle-ci
comme le çontrerpoifon des autres, 8ç l’auteur de
j'J’a r t i c l e n e balance pas à regarder cette efpece
çomme alexitere , cordiale, ftomachale, & bonne
pour la colique venteufe ; le napel , ajoute-t-il ,
coagule le fang,, 6* l'aconit falutaire agit en divif anç
les - humeurs,. Cçtte explication qui n’eft que copiée
4e tant de recueils triviaux, çopiés ëüx-mêmes des
écrits des plus çrédules naturalises, fero.it démentié
formellement par les obfervations dé M.Storck fur*
le napel, fi fon ne favoit d’ailleurs qu’il importe dé
ne pas croire fur parole tout ce que la feule obfer*
vattqn a droit de confirmer. (Article de M . L a f o s s e ,
dqcîeur en Médecine. )
§ AÇORES, (Géogr./) les Portugais 'placent leu*
premier méridien au pied des Açores. L’ifle de Saint
Michel.eft célébré pa.r la bataille navale que le mar-
quis de Sanûa-Cri\?y gagnq em 582,‘fur don Antoine-
qui difputqit la couronne de Portugal à Philippe II!
roi d’Ëfpagne. (C.)
1 ACORUS , (Mae. méd.) vrai àçorus ( calamus
aromaticus ) , jonc' odorant. La racine de cètte planté
dont on peut voir la defeription à l ’article c/cofus dit
Dict. des Sciences, &c. a une odeur très-vive & âfle£
agréable lorfqu’elle eft récente. Sa faveur, eft âcre t
aromatique & amere. Elle abonde en principe fpi-
ritueux , affez volatil, & contient aufli une grande
quantité de matière fixe d’une nature gommeufe^
mêlée à un peu de fubftance réfineufe. C ’eft à I4
partie fpiritueufe qu’il faut attribuer l’odeur de la,
racine. Sa faveur amere appartient principalement à
la partie gommeufe plus abondante , & l’âçreté pa-'
roît dépendre 4e la partie réfineufe qui lui eft mêlée*’
mais en moindre quantité, félon l’examen de M.
Gartheufer. Cette racine contient d’ailleurs très-peiî
d’huile eflentielle,
L’infufion aquèufe de cette racine eft d’une odeur
pénétrante & fa faveur eft très-amere. Cette infûfion
évaporée perd prefque toute fop odeur,mais leréfidij
conferve toute fan amertume. La teinture fpirif-
tuèufe de cette racine n’a d’autre odeur que pelle
de l’efprit-de- v in , mais fa faveur eft très7 âcre,
très - piquante , & mêlée le plus foùvent 4’un peu
d’amer.
La racine trop récente a quelque e^ofe de v în t
lent mêlé à fon odeur qui la rend plus défagréablq
que Celle qui eft defféchée ; on s’en fert dans toutes
les foibleffes d’eftomac ou des organes digeftifs qui
dépendent, comme on dit, de frigidité , iaxité.ou
inertie. On l’emploie avec fuccès dans les dérange^
mens dés menftrues qui'dépendent 4es mêmes cau-
fe s , dans la leucophlegmâtie, les differentes efpecés
d’hydropifie, dans les maladies venteufôs, l’afthme
pituiteux, les fluxions cathacrales, le fcqrbut. Fallope
affure. avoir-guéri plufieurs fuppreflîons d’urine, pac
la décoâion d’acorus dans du vin. Mayerne vante'ce
repiede comme un.fpécifique coqtre le vertige qui
dépend d’inertie au de relâchepient des. nerfs ; oq