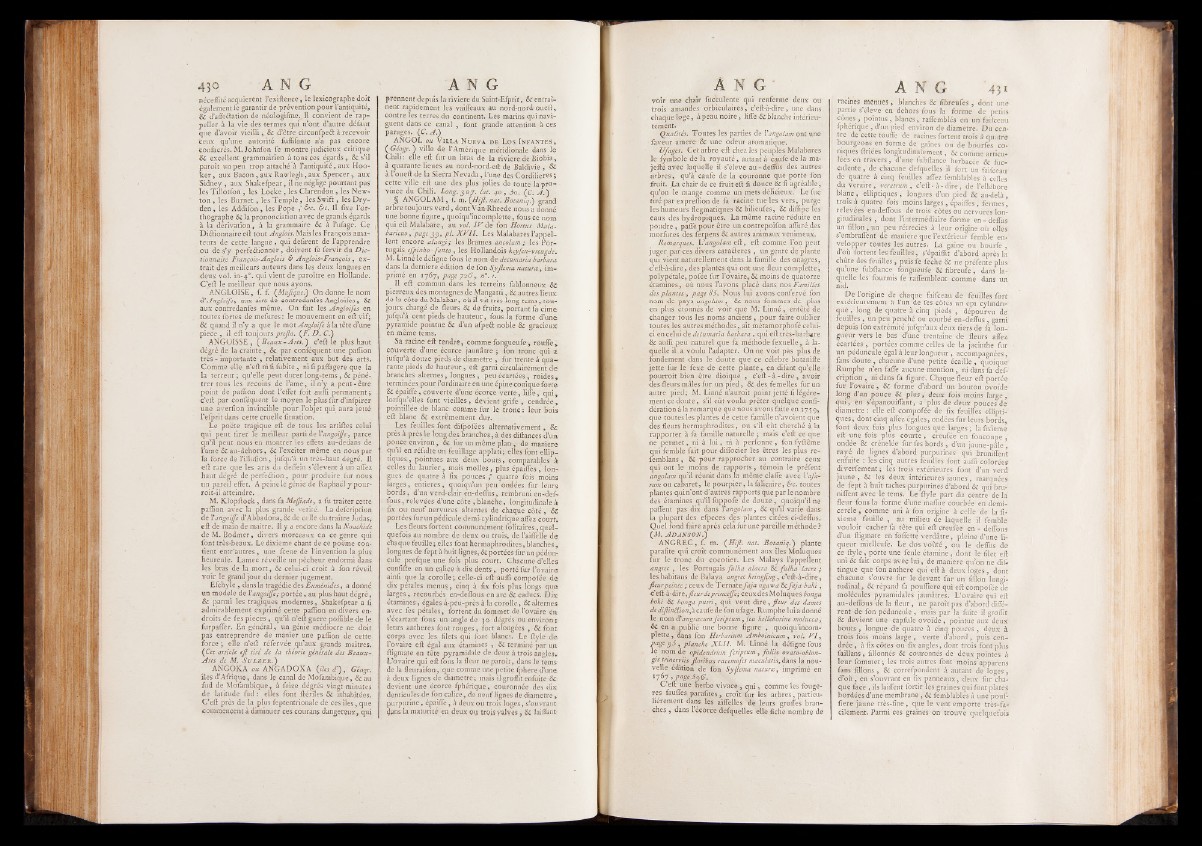
néceflité acquièrent l’exiftence, le lexicographe doit
également fe garantir de prévention pour l’antiquité,
& d’affe&ation de néologifme._ Il convient de rappelle*
à la vie des -termes qui n’ont d’autre défaut
que d’avoir vieilli & .d’être circonfpeél à recevoir
Ceux qu’une autorité fuffilànte n’ a pas encore
COnfacrés. M. Johnfon fe montre judicieux critique
& excellent grammairien à tous ces égards, & s’il
paroît un peu trop attaché à l’antiquité., aux Hoo-
k e r , aux Bacon , aux Rawlegh, aux Spencer , aux
Sidney , aux Shakefpear, il rie néglige pourtant pas
les Tillotfon , les Locke , les Clarendon, les Newton
, les Burnet, les Temple, les Swift, les D ry-
den, les Addifon, les Pope ,' 6*c, &c. Il fixe l’orthographe
8c la prononciation avec de grands égards
à la dérivation, à la grammaire & à l’ufage. Ce
Di&ionnaire eft tout Anglois. Mais les François amateurs
de cette langue , qui défirent de l’apprendre
ou de s’y perfeûionner, doivent fe fervir du Dictionnaire
François-Anglois & Anglois-François, extrait
des meilleurs auteurs dans les deux langues en
deux vol. in-40. qui vient de paroître en Hollande.
C ’eft le meilleur que nous ayons.
ANGLOISE, f. f. (Mufique.) On donne le nom
d’Angloife, aux airs de contredanfes Angloifes, 8c
aux contredanfes même. On fait les Angloifes en
toutes fortes de mefures: le mouvement en eft vif;
8c quand il n’y a que le mot Angloife à la tête d’une
piece , il eft toujours prejlo. (F. D . C.)
ANGOISSE , (Beaux-Arts.') c’eft le plus haut
dégré de la crainte, 8c par conféquent une paflion
très - importante , relativement aux but des arts.
Comme elle n’eft ni fi fubite, ni fi paffagere que la
la terreur ; qu’elle peut durer long-tems, & pénétrer
tous les recoins dë l’ame, il n’y a peut - être
point de paflion dont l’effet foit aufli permanent ;
c’eft par conféquent le moyen le plus fur d’infpirer
une averfion invincible pour l’objet qui aura jetté
l’efprit dans cette cruelle fituation.
Le poète tragique eft de tous les artiftes celui
qui peut tirer le meilleur parti de Yangoijje, parce
qu’il peut nous en montrer les effets au-dedans de
l’ame 8c au-dehors, 8c l’exciter même en nous par
la force de l’illufion, jufqu’à un très-haut degré. Il
eft rare que les arts du deffein s’élèvent à un affez
haut dégré de perfeûion, pour produire fur nous
un pareil effet. A peine le génie de Raphaël ypour-
roit-il, atteindre.
M. KIopftock, dans fa Mejjîade, a fu traiter cette
paflion avec la plus grande vérité. La defcription
de Yangoijfe d’Abbadona, 8c de celle du traître Judas,
eft de main de maître. Il y a encore dans la Aloachide
de M. Bodmer, divers morceaux en ce genre qui
font très-beaux. Le dixième chant de ce poème contient
entr’autres, une fcene de l’invention la plus
heureufe. Lamec réveille un pêcheur endormi dans
les bras de la mort, & celui-ci croit à fon réveil
voir le grand jour du dernier jugement.
Efchyle, dans la tragédie des Euménides y a donné
un modelé de l’angoijfe; portée, au plus haut dégré,
8c parmi les tragiques modernes, Shakefpear a fi
admirablement exprimé cette paflion en divers endroits
de fes pièces , qu’il n’eft guere poflîble de le
furpaffer. En général, un génie médiocre ne doit
pas entreprendre de manier une paflion de cette
force ; elle n’eft réfervée qu’aux grands maîtres.
( Cet article ejl tiré de la théorie générale des Beaux-
Arts de M, SuLZER.)
ANGOKA ou ANGADOXA (îles d’) , Gèogr.
îles d’Afrique, dans le canal de Mofambique, &au
fud de Mofambique, à feize dégrés vingt minutes
de latitude fud : elles font ftériles & inhabitées.
C ’eft près de la plus feptentrionale de ces îles, que
commencent à diminuer ces courans dangereux, qui
p r e n n e n t d e p u i s l a r i v i e r e d u S a i n t - E f p r i t , 8c e n t r a î n
e n t r a p i d e m e n t l e s v a i f f e a u x a u n o r d - n o r d » o u e f t ,
c o n t r e l e s t e r r e s d u c o n t i n e n t . L e s m a r i n s q u i n a v i g
u e n t d a n s c e c a n a l , f o n t g r a n d e a t t e n t i o n à c e s
p a r a g e s . ( C .A .)
A N G O L ou V i l l a N'u e v a d e L o s In f a n t e s ,
( Géogr. ) v i l l e d e l ’ A m é r i q u e m é r i d i o n a l e d a n s l e
C h i l i : e l l e e f t f u r u n b r a s d e l a r i v i e r e d e B i o b i a ,
à q u a r a n t e l i e u e s a u n o r d - n o r d - e f t d e B a l d i v i e , 8 c
à l ’ o u e f t d e l a S i e r r a N e v a d a , l ’ u n e d e s C o r d i l i e r e s ;
c e t t e v i l l e e f t une d e s p l u s j o l i e s d e t o u t e l a p r o v
i n c e , d u C h i l i . Long, j o j . lat. 40 , do. ( C .A . )
§ A N G O L A M , 1. m . (Lfijl. nat. Botaniq.) g r a n d
a r b r e t o u j o u r s v e r d , d o n t V a n - R h e e d e n o u s a d o n n é
u n e b o n n e f i g u r e , q u o i q u ’ i n c o m p l e t t e , f o u s c e n o m
q u i e f t M a l a b a r e , a u vol. IF ’ d e f o n Hortus Mala-
baricus, page 3 3 , pi. X V L I. L e s M a l a b a r é s l ’ a p p e l l
e n t e n c o r e alangi; l e s B r a m e s ancolam ; l e s P o r t
u g a i s efpinho - fanto , l e s H o l l a n d o i s keyfen-vreugde.
M . L i n n é l e d é f i g n e f o u s l e n o m d e decumaria barbara.
d a n s l a d e r n i e r e é d i t i o n d e f o n Syftema naturce, i m p
r i m é e n 1 7 6 7 , page y z& ^ n ? . / .
I l e f t c o m m u n d a n s l e s t e r r e i n s f a h l o n n e u x 8c
p i e r r e u x d e s m o n t a g n e s d e M a n g a t t i , & a u t r e s l i e u x
d e l a c ô t e d u M a l a b a r , o ù i l v i t t r è s - l o n g - t e m s , t o u j
o u r s c h a r g é d e f l e u r s 8c d e f r u i t s , p o r t a n t f a c i m e
j u f q u ’ à c e n t p i e d s d e h a u t e u r , f o u s l a f o r m e d ’ u n e
p y r a m i d e p o i n t u e & d ’ u n a f p e f t n o b l e 8c g r a c i e u x
e n m ê m e t e m s .
S a r a c i n e ' e f t t e n d r e , c o m m e f o n g u e u f e , r o u f f e ,
c o u v e r t e d ’ u n e é c o r c e j a u n â t r e ; f o n t r o n c q u i a
j u f q u ’ à d o u z e p i e d s d e d i a m è t r e , f u r t r e n t e à q u a r
a n t e p i e d s d e h a u t e u r , e f t g a r n i c i r c u l a i r e m e n t d e
b r a n c h e s a l t e r n e s , l o n g u e s , p e u é c a r t é e s , roides ,
t e r m i n é e s p o u r l ’ o r d i n a i r e e n u n e é p i n e c o n i q u e forte
& é p a i f f e , c o u v e r t e d ’ u n e é c o r c e v e r t e , lifte, q u i ,
l o r f q u ’ e l l e s f o n t v i e i l l e s , d e v i e n t g r i f e , c e n d r é e ,
p o i n t i l l é e d ë b l a n c c o m m e f u r l e t r o n c : l e u r b o i s
e f t b l a n c & e x t r ê m e m e n t d u r .
L e s f e u i l l e s f o n t d i f p o i e e s a l t e r n a t i v e m e n t , 8c
p r è s à p r è s l e l o n g d e s b r a n c h e s , à d e s d i f t a n c e s d ’ u n
p o u c e e n v i r o n , & f u r u n m ê m e p l a n , d e m a n i é r é
q u ’ i l e n r é f u l t e u n f e u i l l a g e a p p l a t i ; e l l e s f o n t e l l i p t
i q u e s . , p o i n t u e s a u x d e u x b o u t s , c o m p a r a b l e s à
c e l l e s d u l a u r i e r , m a i s m o l l e s , p l u s é p a i f f e s , l o n g
u e s d e q u a t r e à f i x p o u c e s / q u a t r e f o i s m o i n s
l a r g e s , e n t i è r e s , q u o i q u ’ u n p e u O n d é e s f u r l e u r s
b o r d s , d ’ u n v e r d - c l a i r e n - d e f l u s , r e m b r u n i e n - d e f -
f o u s , r e l e v é e s d ’ u n e c ô t e , b l a n c h e , l o n g i t u d i n a l e à
f i x o u n e u f n e r v u r e s a l t e r n e s d e c h a q u e c ô t é , 8c
p o r t é e s f u r u n p é d i c u l e . d e m i - c y l i n d r i q u e a f f e z c o u r t .
L e s f l e u r s f o r t e n t c o m m u n é m e n t f o l i t a i r e s , q u e l q
u e f o i s a u n o m b r e d e d e u x o u t r o i s , d e l ’ a i f f e l l e d e
c h a q u e f e u i l l e ; e l l e s f o n t h e r m a p h r o d i t e s , b l a n c h e s ,
l o n g u e s d e f e p t à h u i t l i g n e s , 8c p o r t é e s f u r u n p é d u n -
c u l e p r e f q u e u n e f o i s p l u s c o u r t . C h a c u n e d ’ e l l e s
c o n f i f t e e n u n c a l i c e à d i x d e n t s , p o r t é f u r l ’ o v a i r e
a i n f i q u e l a c o r o l l e ; c e l l e - c i e f t a u f l i c o m p o f é e d e
d i x p é t a l e s m e n u s , c i n q à f i x f o i s p l u s l o n g s q u e
l a r g e s , r e c o u r b é s e n - d e f l o u s e n a r c 8c c a d u c s . D i x
é t a m i n e s , é g a l e s à - p e u - p r è s à l a c o r o l l e , & a l t e r n e s
a v e c f e s p é t a l e s , f o r t e n t d u f o m m e t d e l ’ o v a i r e e n
s ’ é c a r t a n t f o u s u n a n g l e d e 3 0 d é g r é s o u e n v i r o n :
l e u r s a n t h è r e s f o n t r o u g e s , f o r t a l o n g é e s , & f o n t
c o r p s a v e c l e s f i l e t s q u i f o n t b l a n c s . L e f t y l e d e
l ’ o v a i r e e f t é g a l a u x é t a m i n e s , & t e r m i n é p a r u n
f t i g m a t e e n t ê t e p y r a m i d a l e d e d e u x à t r o i s a n g l e s .
L ’ o v a i r e q u i e f t f o u s l a f l e u r n e p a r o î t , d a n s l e t e m s
d e l a f l e u r a i f o n , q u e c o m m e u n e p e t i t e f p h e r e d ’ u n e
à d e u x l i g n e s d e d i a m è t r e ; m a i s i l g r o f l i t e n f u i t e 8c
d e v i e n t u n e é c o r c e f p h é r i q u e , c o u r o n n é e d e s d i x
d e n t i c u l e s d e f o n c a l i c e , d e n e u f l i g n e s d e d i a m è t r e ,
p u r p u r i n e , é p a i f f e , à d e u x o u t r o i s l o g e s , s ’ o u v r a n t
d a n s l a m a t u r i t é ' e n d e u x o y . t r o i s y a l y e s , 8c l a i f i a n t
voir une chair fueculente qui renferme deux ou
trois amandes orbiculaires, c’eft-à-dire, une dans ,
chaque loge, à peau noire, fiffe 8c blanche intérieu-
tement.
Qualités. Toutes les parties de Y angolam ont une
faveur â trier e 8c une odeur aromatique.
Ùfages. Cet arbre eft chez les peuples Malabarés
le fymbole de la royauté, autant à caufe de la ma-
jeflé avec laquelle il s’élève au - defltis des autres ■
arbres, qu’à caufe de la couronne que porte fon
fruit. La chair de ce fruit eft fi douce & fi agréable,
qu’on le mange comme un mets délicieux. Le fuc
tiré par expreflïon de fa racine tue les vers, purge
les humeurs flegmatiques 8c bilieufes, & diflipe les
eaux des hydropiques. La même racine réduite en
poudre, paflè pour être un contrepoifon affuré.des
morfur.es des ferpens 8c autres animaux venimeux.
Remarques. Vangolam eft, eft comme l’on peut
juger par ces divers caraâeres , un genre de plante
qui vient naturellement dans, la famille des onagres,
c’eft-à-dire, des plantes qui ont une fleur complette ,
polypétale, pofée fur l’ovaire, & moins de quatorze
étamines, où nous l’avons placé dans nos Familles
des plantes, page 85. Nous lui avons confervé fon
nom de pays angolam, 8c nous fommes de plus
en plus étonnés de voir que M. Linné, entêté de
changer tous les noms anciens, pour faire oublier
toutes les autres méthodes, ait métamorphofé celui-
ci en celui de delumaria barbara , qui eft très-barbare
8c aufli peu naturel que fa méthode fexuelle ,,à laquelle
il a voulu l’adapter. On ne voit pas plus de
fondement dans le doute que ce célébré botanifte
jette fur le fexe de cette plante, en difant qu’elle ■
pourroit bien être dioïque , c’e f t-à -d ire , avoir
des-fleurs mâles fur un pied, & des. femelles fur un
autre pied; M. Linné n’auroit point jetté fi légèrement
ce doute, s’il eût voulu prêter quelque confi-
dération à la remarque que nous avons faite en 1759,
que toutes les plantes de cette famille n’avoient que
des fleurs hermaphrodites, ou s’il eût cherché à la
rapporter à fa famille naturelle ; mais c’eft ce que
rie permet, ni à lui, ni à perfonne, fon.fyftême
qui femble fait pour diffocier les êtres les plus re-
femblans, 8c pour rapprocher au contraire ceux
qui ont le moins de rapports, témoin le préfent
angolam qu’il réunit dans la même claffe avec Yafa-
rum ou cabaret, le pourpier, la falicaire, &c. toutes
plantes qui n’ont d’autres rapports que par dénombré
des étamines qu’il fitppofe de douze, quoiqu’il ne
paffent pas dix dans Y angolam, 8c qu’il varie dans
la plupart des efpeces des plantes citées ci-deffus.
Quel fond faire après cela fur une pareille méthode ?
(M. A d an so n .)
ANGREC, f. m. (FUJI. nat. Botaniq.) plante
parafite qui croît communément aux îles Moluques
fur le tronc du cocotier. Les Malays l’appellent
angrec , les Portugais fulha alacra 8c fulha lacre ;
leshabitans de Balaya angrec kringflng, c’eft-à-dire,
fleur peinte ; ceux de T ernatefaja ngawa 8cfaja baki ,
c’eft-à-dir e y fleur de princejfe; ceux des Moluques bonga
boki 8c bonga puiri, qui veut dire, fleur des dames
de diflinclionçk caufe de fon ufage. Rumphe lui a donné
le nom dé angrcecum fcriptum, feu helleborine moluccay
& en a publié une bonne figure , quoiqu’incomplette,
dans fon Herbarium Amboinicum, vol. V I ,
page c)5 , planche XLII. M. Linné la défigne fous
le nom de opidendràm fcriptum, foliis ovaiô-oblon-
gis tnnerviis floribus racemàfis maculatis, dans la nouvelle
édition de fon Syflema naturce , • imprimé en
1767 » P^e 5c,6 .
C’eft une herbe vivace, qui, comme les fougères
fauffes. parafites, croît fur les arbres, particuliérement
dans les aiffelles dë leurs groffes branches
, dans lecorce defquelles elle fiche nombre de
racines menues, blanches 8c fibreufes , dont une
partie s’élève en dehors fous la forme de petits
cônes , pointus, blancs, raffemblés en un faifceau
fphérique, d’un pied environ de diamètre. Du cen*
tre de cette touffe de racines fortent trois à quatre
bourgeons en forme de gaînes ou de bourfes co*
niques ftriées longitudinalement, & comme articulées
en travers, d’urie fubftance herbacée & fuc-
culente, de chacune defquelles il fort un faifceau
de quatre à cinq feuilles affez femblables à celles
du veraire, veratrum , c’eft - à - dire, de l’ellébore
blanc, elliptiques , longues d’un pied & au-delà,
trois à quatre fois moins larges , épaiffes, fermes,
relevées en-deffous de trois côtes ou nervures longitudinales
, dont l’intermédiaire forme en - deffus
un fillon,un peu rétrécies à leur origine où elles
s’embraffent de maniéré que l’extérieur femble envelopper
toutes les autres. La gaîne ou bourfe ,
d’où fortent les feuilles , s’épaiflît d’abord après la
chûte des feuilles, puis fe feche & ne préfente plus
qu’une fubftance forigueufë & fibreufe, dans laquelle
les fourmis fe raffemblent comme dans un
nid.
De l’origine de chaque faifceau de feuilles fort
extérieurement à l’un de fes côtés un épi cylindrique,
long de quatre à cinq pieds , dépourvu de
feuilles , un peu penché ou courbé en-deffus , garni
depuis fon extrémité jufqu’aux deux tiers de fa longueur
vers le bas d’une trentaine de;‘fleurs affez
écartéès , portées comme celles de la jacinthe fur
un péduneiïle égal à leur longueur, accompagnées,
fans doute, chacune d’une petite écaille, quoique
Rumphe n’en faffe aucune mention , ni dans fa def-
dription , ni dans fa figure. Chaque fleur eft portée
fur l’ovaire, & forme d’abord un bouton ovoïde
long d’un pouce & plus, deux fois moins large,
qui, en s’épanouiffant, a plus de deux pouces de
diamètre : elle eft compofée de fix feuilles elliptiques,
dont cinq affez égales, ondées fur leurs bords,
font deux fois plus longues que larges ; lafixieme
eft une fois plus courte, creufée en foucoupe ,
ondée & crénelée fur fes bords , d’un jaune-pâle ,
rayé de lignes d’abord purpurines qui bruniffent
enfuite : les cinq autres feuilles font aufli colorées
diverfement ; les trois extérieures font d’un verd
jaune , & les deux intérieures jaunes, marquées
de fept à huit taches purpurines d’abord & qui bruniffent
avec le tems. Le ftyle part du centre de la
fleur fous la forme d’une maffue courbée en demi-
cercle , comme uni à fon origine à celle de la fi-
xieme feuille , au milieu de laquelle il femble
vouloir cacher fa tête qui eft creufée en - deffous
d’un ftigmate en foffette verdâtre, pleine d’une liqueur
mieileufe. Lé dos voûté , ou le deffus de
ce ftyle, porte une feule étamine, dont le-filet eft
uni & fait corps avec lu i, de maniéré qu’on ne dik
tingue que fon anthere qui eft à deux loges , dont
chacune s’ouvre fur le devant fur un fillon longitudinal,
& répand fa pqufliere qui eft compofée de
molécules pyramidales jaunâtres. L’ovaire qui eft
au-deffous de la fleur, ne paroît pas d’abord différent
de fon péduncule , mais par la fuite il groflit
& devient une capfule ovoïde , pointue aux deux
bouts , longue de quatre à cinq pouces , deux à
trois fois moiris large , verte d’abord , puis cendrée.,
à fix côtes ou fix angles, dont trois-font plus
faillans, fillonnés & couronnés de deux pointes à
leur fomnret ; les trois autres font moins apparens
fans filions, & correfpondent à autant de loges,
d’o ù , en s’ouvrant en fix panneaux , deux fur chaque
face , ils laiffent fortir les graines qui font plates
bordées d’une membrane , & femblables à une pouf-
fiere jaune très-fine , que le vent emporte très-facilement.
Parmi ces graines on trouvé quelquefois