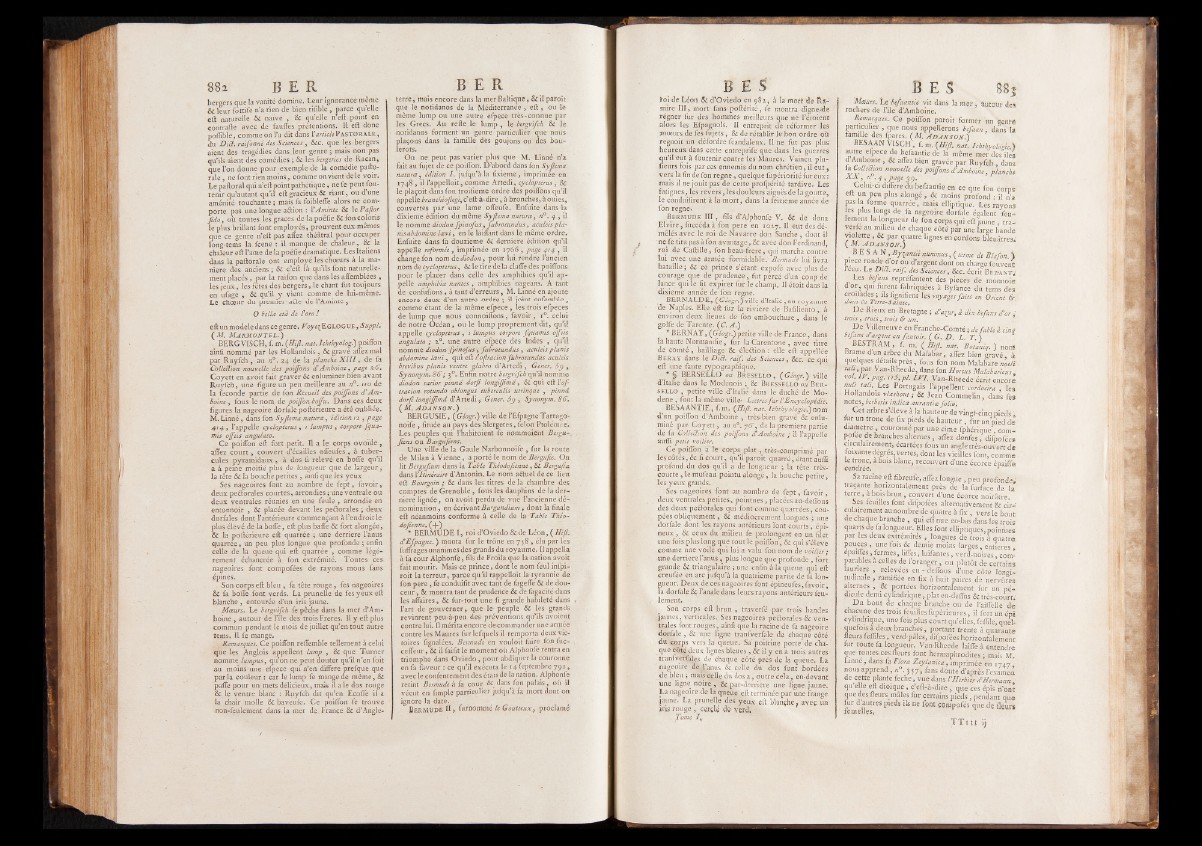
bergers que la vanité domine. Leur ignorance même
& leur fottife n’a rien de bien rifible, parce qu’elle
eft naturelle U naïve , & qu’elle n’eft point en
contrafte avec de fauffes prétentions. Il eft donc
poffible, comme on l’a dit dans Y article P a s t o r a l e , Su Dicl. raifonnè des Sciences , &c. que les bergers
aient des tragédies dans.leur genre ; mais non pas
qu’ils aient des comédies ; & les bergeries de Racan,
que l’on donne pour exemple de la comédie pafto-
raie, ne font rien moins, comme on vient de le voir.
Le paftoral qui n’eft point pathétique, ne fe peut fou-
tenir qu’autant qu’il eft gracieux & riant, ou d’une
aménité touchante ; mais fa foibleffe alors ne comporte^
pas une longue aftion : VAminte & le Pajlor
fido, oh toutes les grâces de la poefie & fon coloris
le plus brillant font employés, prouvent eux-mêmes
que ce genre n’eft pas affez théâtral pour occuper
long-tems la fcène : il manque de chaleur, & la
chaleur eft l’ame de la poéfie dramatique. Les Italiens
dans, la paftorale ont employé les choeurs à la maniéré
des anciens ; & c’eft là qu’ils font naturellement
placés , par la raifon que dans les affemblées ,
les jeux, les fêtes des bergers, le chant fut toujours
en ufage , & qu’il y vient comme de lui-même.
Le choeur du premier a&e de l’Aminte,
O bel la età de Üoro !
eft un modèle dans ce genre. Voyeff.G'LOGVE, Suppll
( M . M a r m o n t e l . )
BËRGVISCH, f. m. (Hijl..nat. lchthyologi) poiffon
ainfi nommé par les Hollandois, & grave affez mal
par Ruyfch, au n°. 2.4 de la planche X I I I , de fa
Collection nouvelle des poijfons d'Amboine , page z6.
Coyett en avoit fait graver & enluminer bien avan t.
Ruyfch, une figure un peu meilleure au n°. no de
la fécondé partie de fon Recueil des poijfons d’Am-
boine , fous le nom, de poiffon bojfu. Dans ces deux
figures la nageoire dorfale poftérieure a été oubliée.
M. Linné, dans fon Syjlema naturce, édition iz , page
4/4 , l’appelle cyclopterus, 1 lumpus, corpore fqua-
mis offeis angulato.
Ce poiffon eft fort petit. Il a le corps ovoïde,
affez cou rt, couvert d’écailles offeufes , à tubercules
pyramidaux, à dos fi relevé en boffe qu’il
a à peine moitié plus de longueur que de largeur,
la tête & la bouche petites , ainfi que les yeux
Ses nageoires font au nombre de fept, favoir,
deux pe&orales courtes, arrondies ; une ventrale ou
deux ventrales réunies en une feule, arrondie en
entonnoir , & placée devant les peôorales ; deux
dorfales dont l’antérieure commençant à l’endroit le
plus élevé de la boffe, eft plus baffe & fort alongée,
& la poftérieure eft quarrée ; une derrière l’anus
quarree, un peu plus longue que. profonde ; enfin
celle de la queue qui eft quarrée , comme légèrement
échancrée à fon extrémité. Toutes ces
nageoires font compofées de rayons mous fans
épines.
Son corps eft bleu , fa tête rouge , fes nageoires
& fa boffe font verds. La prunelle de fes yeux eft
blanche, entourée d’un iris jaune.
Moeurs. Le bergvifck fe pêche dans la mer d’Amboine,
autour de Pile des trois Freres. Il y eft plus
commun pendant le mois de juillet qu’en tout autre
tems. Il fe mange.
Remarques. Ce poiffon reffemble tellement à celui
que les Anglois appellent lump , & que Turner
nomme lumpus, qii’on ne. peut douter qu’il n’en foit
au moins une efpece q,ùi n’en différé prefque que
par la couleur : car le lump fe mange de même, &
paffe pour un mets délicieux, mais il a le dos rouge
& le ventre blanc : Ruyfch dit qu’en Ecoffe il a
la chair molle & baveufe. Ce poiffon fè trouve
non-feulement dans la mer de France & d’Angleterre,
mais encore dans la mer Baltique, & il paroît
que le notidanos de la Méditerranée , e f t , ou le
même lump ou une autre efpece très-connue par
les Grecs. Au refte le lump, le bergvifck' & le
notidanos forment un genre particulier que nous
plaçons dans la famille des goujons ou des bou-
lerots.
On ne peut pas varier plus que M. Linné n’a
fait au fujet de ce poiffon. D’abord dans fon Syjlema
naturce, édition I. jufqu’à la fixieme, imprimée- en
1748 , il l’appelloit, comme Artedi, cyclopterus, &
le plaçoit dans fon troifieme ordre des poiffons qu’il
appelle branchiojlegi, c’eft-à-dire, à bronches, à ouïes,
couvertes par une lame, offeufe. Enfuite dans la
dixième édition du même Syjlema naturce, n°. 4 , il
le nomme diodon Jpinofus, fubrotundus, aculeis planis
abdomine Icevi, en le làiffant dans le même ordre.
Enfuite dans fa douzième & derniere édition qu’il
appelle reformée, imprimée en 1766, page 4/4 , il
change fon nom de diodon, pour lufrendre l’ancien
nom de cyclopterus-, & le tire de la claffe des poiffons
pour le placer dans celle des amphibies qu’il appelle
amphibia nantes , amphibies nageàns. A tant
de confufions, à tant d’erreurs, M. Linné en ajoute
encore deux d’un autre ordre ; il joint enfemble ,
comme étant de la même efpece, les trois efpeces
de lump que nous connoiffons, favoir , i°. celui
de notre Océan, ou le lump proprement dit, qu’il
appelle cyclopterus , 1 lumpus corpore fquamis ojfeis
angulato ; z°. une autre efpece des Indes , qu’il
nomme diodon Jpinofus, fubrotundus, aculeis planis
abdomine Icevi ', qui eft t ojlracion fubrotundus aculeis
brevibus planis ventre glabro d’Artedi, Gêner. 69 ,
Synonym. 86; 30. Enfin notre bergvifck qu’il nomme
diodon rarior pinnâ dorji lôngijjîmâ, & qui eft Yof-
tracion rotundo oblongus tuberculis utrinque , ■ pinnâ
dorji longijjimâ d’Artedi, Gener. J9 , Synonym. 86.
( M . A d an s o n . }
BERGUSIE, ( Géogri) ville de l’Efpagne Tarrago-
noife , fituée au pays des Slergetes, félon Ptolémée.
Les peuples qui l’habitoient fe nommoieht Bergu-,
Jiens ou Bargujiens.
Une ville de la Gaule Narbonnoife , fur la route
de Milan à Vienne, a porté le nom de Bergufie. On
lit Bergujium dans la Table Théodojienne, & Bergufi a
dans TItinéraire d’Antonin. Le nom attuel de ce lieu
eft Bourgoin ; & dans les titres delà chambre des
comptes de Grenoble, fous les dauphins de la derniere
lignée, on avoit perdu de vue l’ancienne dénomination,
en écrivant Burgundium, dont la finale
eft néanmoins conforme à celle de la 'Table Théodojienne.
(+ )
* BERMUDE I , roi d’Oviedo & de Léon, ( ffifl.
ÆEfpagne. ) monta fur le trône en 75.8 , élu par les
fuffrages unanimes des grands du royaume. Il appella
à fa cour Alphonfe, fils de Froila que la nation avoit
fait mourir. Mais ce prince, dont le nom ferul infpi-
roit la terreur, parce qu’il rappelloit la tyrannie de
fon pere , fe conduifit avec tant de fageffe & de douceur
, & montra tant de prudence & de fagacité dans
les affaires, & fur-tout une fi grande habileté dans
l’art de gouverner, que le- peuple & les grands
revinrent peu-à-peu des préventions qu’ils avoiènt
contre lui. Il mérita encore de.commander une arrçiéè
contre les Maures fur lefquels il remporta deux victoires
fignalées. Bermude en vouloit faire fon fuc-
ceffeur, & il faifit le moment où Alphonfe rentra en
triomphe dans Oviedo, pour abdiquer la couronne
en fa faveur : ce qu’il exécuta le i4feptembre 79 1,
avec le confentement des états de la nation. Alphonfe
retint Bermude à fà cour & dans fon palais, pu il
vécut en fimple particulier jufqu’à fa mort dont on
ignore la date.
Bermude II» furnommé le Goutteux, proclamé
toi de Léon & d’Oviedô en 982, à la' mofi Üe TU-
mire III, mort fans'poftérité, fe montra digne/de
régner fur des hommes meilleurs que ne l’qtoient
alors les Efpagnols. Il entreprit de réformer les
moeurs de fes fujets, & de rétablir le bon ordre où
regnoit un défordre fcandaleux. Il ne fut pas plus
heureux dans cette entreprife que dans les guerres
qu’il eut à foutenir contre les Maures. Vaincu plu-
fieurs fois par ces ennemis du nom chrétien, il eut,
vers la fin de fon régné, quelque fupériorité fur eux :
mais il ne jouit pas de cette profpérité tardive. Les
fatigues, les revers, les douleurs aiguës de la goutte,
le conduifirent à la m ort, dans la feizieme année de
fon regnei -
B e r m u d e I II, fils d’Alphonfe V. & de dona
Elvire, fuccéda à fon pere en 1027. Il eut des démêlés
avec le roi de Navarre don Sanche, dont il
t ne fe tira pas à fon avantage, & avec don Ferdinand,
roi de Caftille, fon beau-frere, qui marcha contre
lui, avec une armée formidable.^ Bermude lui livra
bataille ; & ce prince s’étant expofé avec plus de
courage que de prudence, fut percé d’un coup de
lance qui le fit expirer fur le champ. Il étoit dans la
dixième année de fon régné.
BERNALDE, {Géogr.} ville d’Italie ,au royaume
■ de Naples. Elle eft fur la riviere de Bafiliento, à
environ deux lieues de fon embouchure, dans le
golfe de Tarente. (C. A.)
* BERNAY, (Géogri) petite ville de France, dans
la haute Normandie, fur la Carentone , avec titre
de Comté, bailliage & éle&ion : elle eft appellée
B é r a y dans le Dicl. raif. des Sciences, &c. ce qui
eft une faute typographique.
* § BERSELLO ou B r e s e l l o , ( Géogr. ) ville
d’Italie dans le Modenois ; & B r e s s e l l o o//Ber-
s e l l o , petite ville d’Italie dans le duché de Mo-
dene , font la même ville- Lettres fur V Encyclopédie.
BESAANTIE, f.m. fHifl. nat. Ichthyologie.} nom
d’un poiffon d’Amboine , très-bien gravé & enlumine
par Coye tt, au/z°. jG , de la première partie
de fa Collection des poijfons cCAmboine il l’appelle
auffi petit voilier.
Ce poiffon a le corps p lat, très-comprimé'par
les côtés, & fi court, qu’il paroît quatre, étant auffi
profond du dos qu’il a de longueur ; la tête très-
courte , lefnufeau pointu aiongé, la bouche petite,
les yeux grands.
Ses nageoires font au nombre de fept, favoir,
. deux ventrales petites, pointues, placées au-deffous
des deux pe&orales qui font comme quarrées, coupées
obliquement, & médiocrement longues ; une
dorfale dont les rayons antérieurs Vont courts, épineux
, & ceux du milieu fe prolongent en un filet
une fois plus long que tout le poiffon, & qui s’élève
comme une voile qui lui a valu fon nom de voilier;
une derrière l’anus , plus longue que profonde , fort
grande & triangulaire ; une enfin à la queue qui eft
creufée en arc jufqu’à la quatrième partie de là longueur.
Deux de ces nageoires font épineufes,favoir ,
la dorfale & l’anale dans leurs rayons antérieurs feu-
, lement.
_ Son corps eft brun , traverfé par trois bandes
jaunes, verticales. Ses nageoires pe&orales & ventrales
font rouges, ainfi que la racine de fa nageoire
dorfale, & une ligne tranfyerfale de chaque côté
du corps vers Ja queue. Sa poitrine porte de chaque
côté deux lignes bleues , & il y en a trois autres
tranfvéi-Çales de chaque côté près de la queue. La
nageoire de garnis & celle du dos font bordées
de bleu ; mais celle du dos a , outre cela, en-devant
une ligne noire , & par-derriere une ligne jaune.
La nageoire de la queue eft terminée par une frange
jaune. La prunelle des yeux eft blançhe» avec un
iris rouge , cerclé de verd,
J orne ƒ,
Mdiirs. Le befaahtie vit dans la mer, âiitotir des
rochers de l’île d’Amboine.
Remarques. Ce poiffon paroît former un genfd
particulier , que nous appellerons befaan ; dans là
famille des fpares. (M . A d a n s o n I)
BESAAN VISCH, f. m. (Jlifl. nat. IchthyoWgieS
^?Areie • eGe k^antie de la même mer des îles
7 ^ , °;ne’ & affezbien g^vée par Ruyfch , dans
la 6ollechon nouvelle des poijfons c?Amboine, planché
X X , n°. 4 , page 3 9.
Celui-ci différé du befâantie en ce que fon corps
elt un peu plus aiongé * & moins profond : il n’a
pas la forme quarrée, mais elliptique. Les rayons
les plus longs de fa nageoire dorfale égalent feulement
la longueur de fon corps qui eft jaune . tra->
verie au milieu de chaque côté par une large bande
violette, & parNquatre lignes en cordons bleuâtresi
( M . A d a n s o n .)
B E S A N , Byiantii nunimus, ( terme Je Blafon. î
piece ronde d or ou d’argent dont on charge fouvent
lécu. Le Dicl, raif. des Sciences, &e. écrit Bezwnt»1
Les befans repréfentent des pièces de monnoie
d or, am furent fabriquées à Byfance du tems des
croilades ; ils lignifient les voyages faits en Orient &
dans la Terre-Sainte.
De Rieux en Bretagne ; d \ü r , à dix befans d’or 1
trois, trois, trois & un.
, p eV illen eu v e en Franche-Comté ; de fable à cinq
bejans d argenten fautoir. { G .D . L. T .)
BESTRAM , f. m. ( Hijl. nat4 Botaniq. ) nont
Brame d un arbre du Malabar, affez bien gravé, à
quelques détails près, fous fon nom Malabare noeli
tah par Van-Rheede, dans fon Hortus Malabaricus,
m l.IV .M g . i i5, pi. LVI. Van-Rheede écrit encore
nuit tah. Les Portugais Vappellent cordàeira , les
Hollandois ylashout ; & Jean Commelin, dans feâ
notes, berberis indica aurahtice folio.
Cet arbre s’élève à la hauteur de vingt-cinq pieds ;
fur un tronc de fix pieds de hauteur , fur un pied de
diamètre , couronné par une cime fphérique , com-
polee de branches alternes, affez denfes, difpofées
circulairement, écartées fous un angle très-ouvert de
foixantedégrés. vertes, dont les vieilles font, comme
le tronc, à bois blanc, recouvert d’une écorce épaiffe
cendree. . * . 1
Sa racine eft fibreufe, affez longue, peu profonde;
traçante horizontalement près de la furface de la
terre , à-bois brun , couvert d’une écorce noirâtre.
Ses feuilles font difpofées alternativement & cir-'
culairement aunombre de quatre à fix , vers le bout
de chaque branche , qui eft nue en-bas dans les trois
quarts de fa longueur. Elles font elliptiques, pointues
par les deux extrémités , longues de trois à quatre
pouces , une fois Si demie moins larges , entières ;
épaiffes, fermes, liffes, luifantes, verd-noirès, comparables
à celles dé l’oranger , ou plutôt de certains
lauriers , relevées en - deffotts d’une côte longitudinale
, ramifiée en fix à huit paires de 'nervures
alternes , & portées horizontalement fur un pédicule
demi cylindrique, plat en-deffus & très-court.'
Du bout de chaque branche ou de l’aiffêlle de
chacune des trois feuilles fupérieures, il fort un épi
cylindrique, une fois plus court qu’elles, feflîle, quel-
quefois à deux branches, portant trente à quarante
fleurs feffiles, verd-pâles, difpofées horizontalement
fur toute fa longueur. Van-Rheede laiffe à entendre
que toutes ces fleurs font hermaphrodites ; mais M.
Linné, dans fa Flora Zeylanïca, imprimée en 1747
nous apprend , a ”. 3 5 7 , fans doute d’après l’examen
de cette plante feche, vue dans l'Herbier <fHermann,
qu elle eft dioïque , c’eft-â-dire , que ces épis ri’ônt
que des fleurs mâles fur certains pieds, pendant que
fur d autres pieds ils ne font compofés que de fleurs
femelles.
TTttt i)