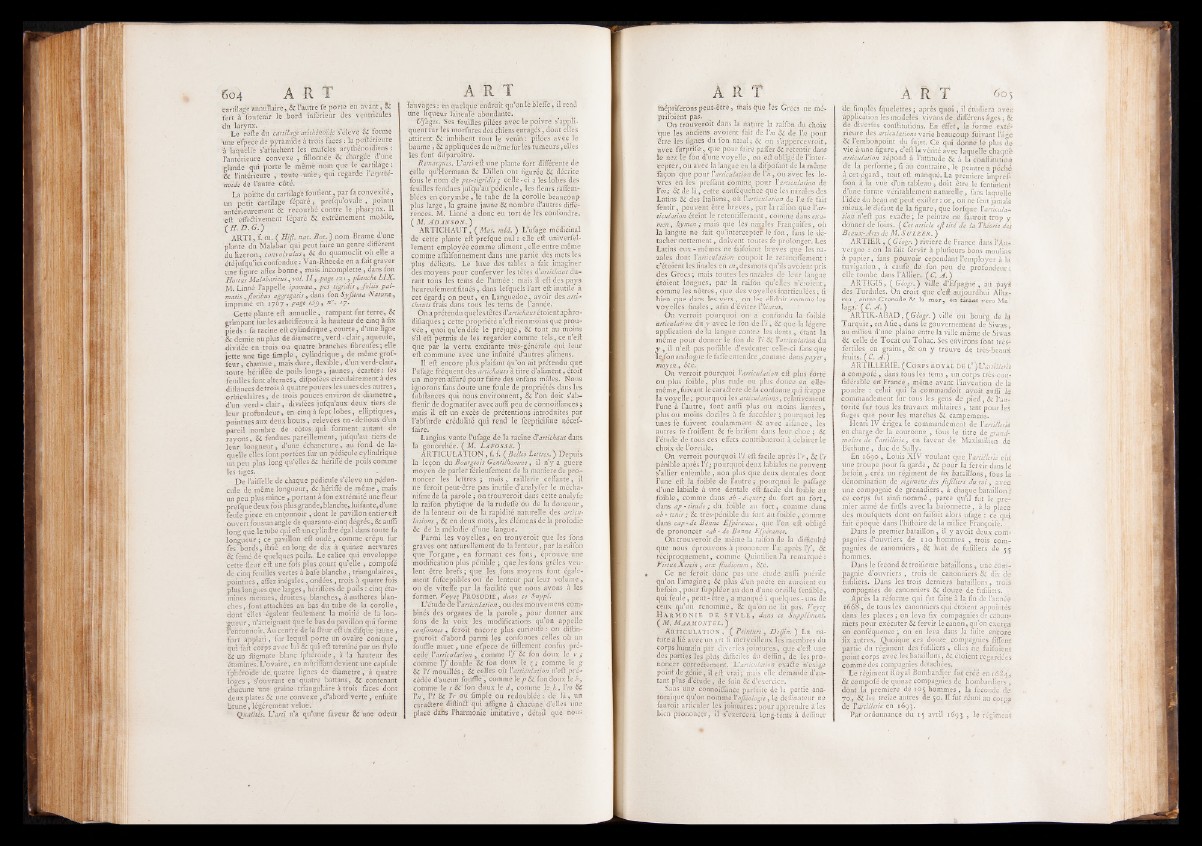
cartilage annuitaire, & l’autre fe porte 'èft avant, &
Tert à Tôuténir le bord inférieur dès ventricules
du larÿnx. . Y _ • ,, .
Le relie du cartilage ‘afuhtfitfçdt '$ elêŸê oÇ iofftie
\tnë èfpecé de pyramide à't'r'Oïs faces : là po^étieure
\ laquelle s’attachent tes mufcles arÿthénôïdiens :
l’anterieure convexe , iiïlônhéë Sc chargée d’une
.glande qui porte le rijêmé nom qué le cartila’ge :
& l’intérieuîé , toute Ainië , qui regarde Yarythè-
no'idt de d’autre côté.
La pointe du cartilage fpUtiènt, par fa convexité ,
un petit cartilage fép'aré 6 prefqu’ovale , pointu
antérieurement & recou'rbé contre le pharynx. Il
•eft effeftivement féparë .& extrêmement mobile.
( H .D .G . y
ARTÏ., r. m. ( Nijl. nat. Bot. ) nom Brame d’une
plante du "Malabar qui peut faire un genre différent
d u lizeron, convolyulus, & du quamoclit ou elle a
étéjufqu’ici confondue : Van-Rhèede en a fait graver
une figure affez bonne , mais inComplette, dans fon
Hortus Malabaricus, vol. 11, page 121 , planche LIX.
M. Linné ltappelle ipomoea, pes tigridis, foliis pal-
matis ‘fioribus aggregatisdans Ton Syjlema Natures-,
imprimé en 1767 , page fSc), n°. iy. .
Cette plante eft annuelle , rampant fur terre, &
grimpant fur les arbriffeaux à la hauteur de cinq à fix
pieds : fa racine eft cylindrique , courte, d’une ligne
' & demie au plus de diamètre, verd - clair, aqueufe,
diviiee en trois ou quatre branches fibreufes ; elle
jette une tige fimple , cylindrique , de même grof-
feur, charnue, mais dure, flexible, d’un verd-clair,
toute hérifféë de poils longs, jaunes-, écartés: fes
feuilles font alternes., difpofées circulairement à des
diftances de trois à quatre pouces les unes des autres,
orbiculaires, de trois pouces environ de diamètre,
d’un verd- clair , divrfées jufqu’aux deux tiers de
leur profondeur, en cinq à fept lobes ; elliptiques,
pointues aux deux-bouts, relevées en-deflbus d’un
pareil nombre de côtes,qui. forment autant de-
rayons, & fendues pareillement, jufqu’au tiers de
leur longueur, d’une échancrure, au fond de laquelle
elles font portées fur un pédicule cylindrique
un peu plus long qu’elles & hériffé de poils confine
les tiges.
De l’aiffelle de chaque pédicule s’élève un pédun-
cule de même longueur,, & hériffé de même, mais
un peu plus mince , portant à fon extrémité une fleur
prefqué deux fois plus grande, blanche, luifante, d’une
feule pièce en entonnoir , dont le pavillon entier eft
ouvert fous un angle de quarante-cinq dégrés, & auffi
long que le tube qui eft un cylindre égal dans toute fa
longueur ; ce pavillon eft ondé, comme crépu fur
fes bords , ftrié en long de dix à quinze nervures
&femé dè quelques poils. ' Le calice qui enveloppe
çétte fleur eft une fois plus court qu’elle , compofé
de cinq feuilles vertes à bafe blanche, triangulaires,
pointuéS, aifez. inégale s , ondées, trois à quatre fois
plus longues que larges, hériffées de poils : cinq étamines
menues, droites, blanches, à anthères blanches
, font attachées au bas du tube de la corolle,
dont 'ëïleS égalent feulement la moitié de la longueur
, n’atteignant que le bas du pavillon qui forme
Tënfohnoir, A u centre de là fleur .eft un difque jaune,
fort à'p'piau, fur lequel porte un ovaire conique,
qui fait corps avec lui & qui eft terminé par tin ftyle
&c un ftigmate blanc fpheroïde, à la hauteur des
étamines. L’ovaire, en muriffant devient une capfule
fphëfôïde de, quatre lignes de diamètre, à quatre
logés , s’ouvrant en ' quatre battans, & contenant
chacune une graine-triangulaire à trois faces dont
deux plates & .une convexe , d’abord verte, enfuite
brune, légèrement velue.
Qualités. Varti n’a qu’ttne faveur & une odeur
fauvages : ën quelque endroit qu’onîe bleffe, il rend
une liquèur laitëulé abondante.
V f âges. Ses feuilles pilées avec le poivré s’appli-
qüentfur lés morfures dêS chiens enragés, dont elles
attirent & imbibent tout le venin: pilées avec le
baume, '& appliquées de même fur lés tumeurs, elles
les font difparôître.
Remarques. Varti eft une plante fort différente de
cèlle qu’Hermann & Dillen ont figurée & décrite
fous le nom dé pYs-tigridis j celle-ci a les lobés des
feuilles fendues jufqu’aù pédicule, les fleurs raffem-
blées en corymbe, le tube de la 'corolle beaucoup
plus large, la graine jaune & nombre d’autres diffé-
rëricës. M. Linné a donc eu tort de lés confondre.
( M. ÀDÀNSON. )
ARTICHAUT, ( Mai. mèd. ) L’ufage médicinal
dé cëftë planté eft prefqué nul : elle eft ûriiverfel-
lement employée comme aliment, elle entre même
comme affaifonnement dans une partie dès mets les
plus délicats. Le luxe des tables a fait imaginer
des moyens pour confervër les têtes d’artichaut durant
tous les teins de l’année : mais il eft des pays
héurëufement fitués ,/dans lefquels l’art eft inutile à
cet égard ; on peut, en Languedoc, avoir dès artië
chauts frais dans tous lés tëms de l’année.
On à prétendu queles têtes $ artichaut étoient aphro-
difiaqùes ; cette propriété n’eft rien moins que prouvée
, quoi qu’en dife le préjugé, & tout au moins
s’il eft permis de les regarder comme tels, ce n’eft
que par la vertu excitante frès-générale -qui leur
eft commune avec une infinité d’autrèS allmens.
Il èft encore plus plaifant qu’on ait prétendu que
l’ufage fréquent, des artichauts à titre d’aliment, étoit
un moyen affuré pour faire des enfans mâles. Nous
ignorons fans doute une foule de propriétés dans les
fubftances qui nous environnent, & l’on doit s’ab-
ftenir de dogmatifer avec auffi peu de çônnoiffances ;
mais il eft un excès de prétentions introduites par
l’abfurdé crédulité qui rend le feepticifme qécef*
faire.
Làngius vante l’ufage de la racine $ artichaut dans,
la gonorrhée. ( M. La f o s s è . )
ARTICULATION, f. f. ( Belles Lettrés. ) Depuis
la leçon du Bourgeois Gentilhomme., il n’y a guere
moyen de parler ferieufement de ta maniéré de prononcer
les lettres ; mais , • raillerie ceffante, il
ne féroit peut-être pas inutile d’analyfer le rnécha-
nifinede la parole ; ôn trôuveroit dans cette analyfe
la raifon phyfique de larudeffe ou de la douceur,
de la lenteur ou dè ta rapidité naturelle des articulations
, & en deux mots, les élémens de la profodie
& de 1a mélodie d’une langue. ^
Parmi les voyelles, on trouveront qite les fons
graves ont hàtiirèUement de la lenteur, par la raifoh
que l’organe, en formant ces fons, éprouvé une
modification plus pénible ; que jes fons grêles veulent
être brefs ; que les .fons moyens font également
fufceptibles ôii de lenteur par leur volume ,
ou de vîteffe par ta facilité que nous avons à les
former. Voyeç Prosodie, dans ce Suppl.
L’étude dé l’articulation, ou des mouvemens combinés
des organes'de la parole, pour donner aux
fons de la voix les modifications qu’on appelle
confondes , feroit encore plus• curieufe : on diftin-
güéroit d’abord parmi les confonnés celles oh un
fouffle muet, une efpece’ de fifflement confus précède,
Y articulation comme 1 ’ƒ & fon doux le v ;
comme lÿ’ double & fon doux lé comme le g
& 17 mouillés; & celfes oh Y articulation, n’eft précédée
d’aucun fouffle'j' comme le p Sc fon doux le b ,
comme le t Si'fon doux le d, comme le k, Y/n Sc
Yn, 17 & IV ou fimple ou redoublée: de là , un
càrattere 'diftina qui affigne à ebaeûne d’elles une
placé dabs l’harmonie imitative, détail que nous
Kiépfiférôns peut-être, mais que les Grées ne hie-
pHfoiênt pas.
On trouverôit dans la nature ta raifon. du choix
que les âhciëbs avoient fait de Ym & de Yn pour
être lés lignes du fon nazal; & on s’appèrcevroit,
avec furprife-, que pour faire paffer & retentir dans
le nez lé fort d’ùnë voyelle, on eft obligé dè l’inter-
tepter, ou àvée la langue ën la difpöfant de la même
façon que pour Y articulation dé Y h , ou avec les le-
Vres ën les prëffant comme pour Y articulation dé
Ym; & dé là , cette conféquëncë qiië les hàzaîes des
Latins Si dés Italiens, ou Y articulation dè J’/z te fait
fentit, peuvent être brèves,, par là raifon que Y articulation
éteint le retentiffement, comme dans examen
, hymen ; mais que lés riâzalës Françoifes, oh
la langue ne fait qu’intércëpter le fon, fans le détacher
nettement, doivent toutes fe prolonger. Les
Latins eux - mêmes ne fàifoie'nt brèves que les nà-
zales dontXarticulation côupôit le retentiffement:
c’étoient les finales en «â , des mots qu’ils avoient pris
des Grecs ; mais toutes les nazales de leur langue
étôient longues, par la raifon qu’elles n’étoient,
comme les nôtres, que des voyelles inarticulées,; fi
bien que dans les vers, on les élidoit comme les
voyelles finales, afin d’éviter Y hiatus.
On verroit pourquoi ôn- a confondu la foiblé
articulation du j avec le fon de 17, & que la légère
application de la langue Contre les dents , étant la
même pour donner le fon de 17 & Y articulation du
y , i l rt’eft pas poffible d’exécuter celle-ci fans que
le.fon analogue fe faffe entendre, comme dans payer 5
moyen i & C .
On verroit pourquoi Y articulation eft plus fbrtë
bu plus foible, plus rude pu plus dotice en elle-
même, fuivant le caractère de la cônfonne qui frappé
la voyelle ; pourquoi les articulations, relativement
î’une à l’autre, font auffi plus ou moins liantes;
plus ou moins dociles à fe fuccéder ; pourquoi les
unes fe fuivent eoulamment & avec aifance, les
autres fe frôiffent & fe brifent dans leur choc ; &
l’étude de tous ces effets eontribueroit à éclairer le
choix- de l’oreille.
On verroit pourquoi 17 eft facile après IV, & i’r
pénible après 17; pourquoi deux labiales ne peuvent
S’allier enfemble, non plus que deux dentales dont
l’une eft la foible dé l’autre ; pourquoi le paffage
d’une labiale à une dentale eft facile du foible au
foible, comme dans ab - diquer; du fort au fort,
dans ap - titude ; du foible au fort, comme dans
ob - Cenir ; & très-pénible du fort au foible, comme
dans cap-de Bdnne Efpèrance, que l’on eft obligé
de prononcer cab - de Bonne Efpèrance. '
On trôuveroit de même la raifon de ta difficulté
que nous éprouvons à prononcer l’jç après I f , St
réciproquement, comme Quintilien l’a remarqué :
Firnis, Xércis $ arx fiudiorurn ; &e.
Ce rie feroit donc pas urie étude aiiffi puérile
qu’on l’imagine ; & plus d’un pôëte en aurôient eu
befoin , pour fuppléer au don d’une oreille fenfible,
qui feule, peut - être, a manqué à quelques - uns de
ceux qu’on renomme, & qu’on ne lit pas. Foye^
H a r Mö NIE DE s t y l e , dans ce Supplément.
( M . M a r m o n t e l . )
A r t i c u l a t i o n , ( Peinture ; Deffin. ) Là nature
à lié avec tin art fi mervéilléüx les membres du
corps humain par diverfes joiriturés, que c’eft une
dès parties les plus difficiles du dëffin, de. les pro-
ftoricer Côrreélemènt. Varticulation exa&e n’exige
pôïrit de génie, il èft vrai-; mais elle demande cl’au-
tàrit plus (d’éïude, de foin & d’exercice, " f
7 .Saiis une connoîffançe parfaite de la partie anatomique
qu’on nomme Yojléologie, le deffmateur ne
faufoit articüler les joiritiires : pour apprendre à les
bien prononcer, il s’exercera long-féms à deffiner
de fimpîés fquelettès ; après qu o i, il ctudierà avec
application les modelés vivâns de différens âges ; &
fle diverfes conftitutioris. En effet , la forme extérieure
des articulations varie beaucoup fuivant l’âgé
& l’emboripoint du fujet. Cé qui donne le plus de
vie à une figuré, c’eft la vérité avec laquelle chaque
articulation répond à l’attitude & à 1a c'ônftitutipn
dé là perfonne; fi au contraire, le peintré à péché
à cet égard, tout .eft manqué. La première impref-
fiori à la vuè d’un tableau ; dôit être le fehtiirierit
d’iirie forme véritâblemerif naturelle, fans laquelle
ridée du béait ne'peut exifter : o r, ori ne fent jamais
mieuxffe'défaut de ta figure, que lorfque Y articulation
n’eft pas exa&e ; le peintre né fauroit trop y
donner de foins. ( Cet article ejl tiré de la Théorie des
Beaux-Arts de M. S U L ZER . )
ARTIER , ( Géogp ) riviere de France dans i’Âu-
vergn’ê ■: on la fait fervir à plufieurs bons moulins
à papier, fans pouvoir cependant l’employer à là
navigation , à caufe de fon peu de profondeur :
elle tombe dans l’Ailier. ( Ç A .)
ARTIGIS, ( Géôgr.. ) ville d’Efpagrié , au day^
des Türdules. On croit que c’eft aujourdhui Alha-
nia, entre Grenade & la mer, en tirant vers Mai
M A. )
ARTIK.-ABAD, ( Géogr. ) ville bit bourg de là
Turquie, en A fie, dans le gouvernement dé Siwas,
au milieu d’une plaine entre la ville même de Siwas
& celle de Tocat ou Tohac. Ses eriviroris font très*
fertiles, en grains, & ori y trouve de très-beairé
fruits. (Ci Ai)
ARTILLERIE; ( C o r p s r o y a l De C)Vartillerie
à compofé ,. dans .tous lès tems , un corps très-cori*
fidéiable ëri France , même avant l’invention de la
poudre : celui qui la commandoit a voit auffi ls
ëôriimandement fur tons les gèris" de pied, & l’aii-
torité fur tous les travaux militaires , tant pour leS
fiegës que pour lés marches &c campemens.
Henri IV érigea le commaridèment de Y artillerie
ën charge de' la couronne , fous le .titre de grand-
maître de t artillerie-, ën faveur de Maximilien de
Béthune , duc de Sully.
En 1690 , Louis XIV voulant que ( Y artillerie eût
iine troupe pour fa garde, & pour la fervir dans lé
befoiri , créa un régiment de ux bataillons, fous la
dénomination cle régimerit des fujîliers du roi , avec
une compagnie de grenadiers, à chaque bataillon !
ce corps fut ainfi nommé, parce qu’il fut le premier
armé de fufils avec la baïonnette,, à la placé
des moufquets dont on faifoît alors ufagè : de qui
fait épôquè daris l’hiftôire de là milice Françoife.-
Dans le premier bataillon , il. y avoit deux compagnies
d’ouvriers de 110 Hommes , trois compagnies
de canonniers, & huit de fufiliers de 5 5
Hommes.
Dans le fécond & troifîeriie bataillons, uriè compagnie
d’ouvriers , trois de canonniers & dix de
fufiliers. Dans lés trois derniers bataillons, trois
eompàgriies de canonniers & douze de fufiliers.
Après la réforme qui fut faite à la fin de l’anriéë
i668 , de tous les canonniers qui étôient appointés
dans, les places ; on leva fix compagnies de canonniers
pour exécuter & fervir lècanon, qu’on exerça
en conféquëncë; on en leva dans la fuite encore:
iîx autres., Quoique, ces douze compagnies fiflerit
partie du régimerit des fufiliers , elles ne faifoient
point corps avec, les, bataillons& étoient regardées
eorrimé des compagnies détachéesf ,
’ Le régiment Royal Bombardier fut créé eft 168/ù
& compofé de quinze compagnies dé bombardiers,
dont Ta première de 105 hommes, la feeond.e de
70, & les treize autres de' 50. II fut réuni au corps
de Y artillerie en 1693.
Par ordonnance du 15 avril 1693 , le régiment