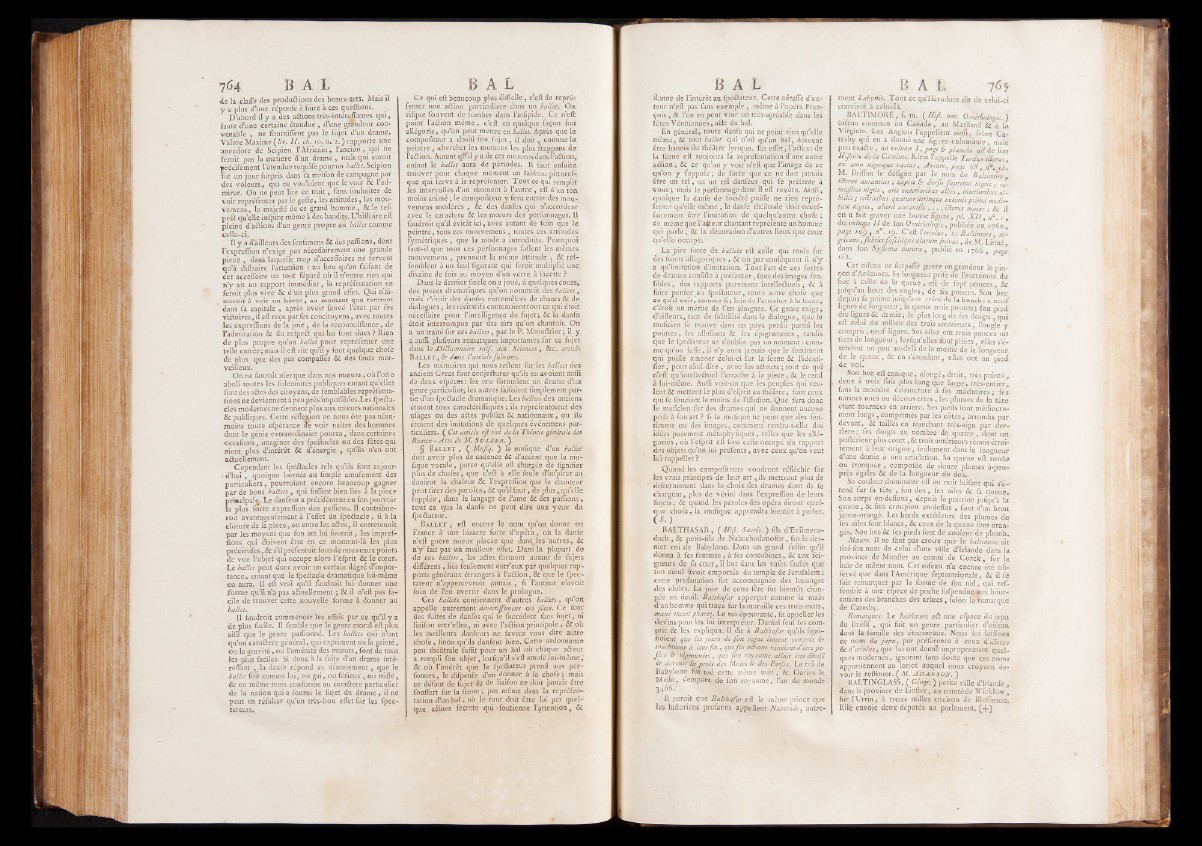
764 BAL
de la cîaffe des produirions des beaux-ârts. Mais il
y a plus d’une réponfe à faire à ces queftions.
D ’abord il y a des avions très-interefiantes qui,
faute d’une certaine étendue , d’une grandeur convenable
, ne fourniffent pas le fujet d’un drame.
Vaïere Maxime (liv. 11. ch.10. ru z . ) rapporte une
anecdote de Scipipn l’Africain, l’ancien, qui ne
feroit pas la matière d’un drame , mais qui auroit
terécifément l’étendue requife pour un ballet. Scipion
fut un jour furpris dans fa maifon de campagne par
des voleurs,, qui ne.vouloient que le voir ftc 1 admirer.
On ne peut lire ce trait, fans fouhaiter de
Voir repréfenter par le gefte, les attitudes, les mouvement,
la majefté de ce grand homme, Sc le ref-
peft qu’elle infpire même à des bandits. L’hiftbire eft
pleine d’a&ions d’un genre propre au ballet comme
celle-ci. .
Il y a d’aillêurs des fentimens & des paffions, dont
l’expreffion n’exige pas néceffairement une grande
piece , dans laquelle trop d’acceffoires ne fervent
qu’à diftraire l’attention : au lieu qu’en faifant de
cet accelToire un tout fépàré où il n’entre rien qui
n’y ait un rapport immédiat, la repréfentation en
feroit plus vive & d’un plus grand effet. Qui n’ai-
meroit à voir un héros, au moment que rentrant
’ dans fa capitale , après avoir fauvé l’état par fes
victoires, il eft reçu par fes concitoyens, avec toutes
les expreflions de la jo ie , de la recorinoiffance, de
l ’admiration & du refpeft qui lui font dues ? Rien
de plus propre qu’un ballet pour repréfenter une
telle entrée ; mais il eft sûr qu’il y faut quelque chofe
de plus que des pas compaffes Sc des fauts merveilleux.
On ne fauroit nier que dans nos moeurs, où l ’on a
aboli toutes les folemnités publiques entant qu’elles
font des a&es des citoyèns, de femblables repréfenta-
tions ne deviennent à peu près impqflibles.Les fpetta-
cles modernes ne tiennent plus aux moeurs nationales
& publiques. Cette réflexion ne nous ôte pas néanmoins
toute efpérance de voir naître des hommes
dont le génie extraordinaire pourra, dans certaines
occafions, imaginer des fpeftacles ou des fêtes qui
aient plus d’intérêt & d’énergie , qu’ils n’en ont
actuellement.
' Cependant les fpeâacles tels qu’ils font aujour-
. d’hui , quoique bornés au fimple amufement des
particuliers, pourroient encore beaucoup gagner
par de bons ballets, qui fuffent bien liés à la piece
principale. Le danfeur a précifément en fon pouvoir
la plus forte exprefîlon des paffions. Il contribuèrent
avantageufement à l’effet du fpe&acle , fi à la
clôture de la piece, ou entre les aftes, il entretenoit
par les moyens que fon art lui fournit, les impref-
fions qui doivent être en ce moment-là les plus
précieufes, Sc s’il préfentoit fous de nouveaux points
de vue l’objet qui occupe alors l’efprit & le coeur.
Le ballet peut donc avoir un certain dégré d’importance,
entant que le fpectacle dramatique lui-même
en aura. Il eft vrai qu’il faudroit lui donner une
forme qu’il n’a pas actuellement ; & i l n’eft pas facile
de trouver cette nouvelle forme à donner au
ballet.
Il faudroit commencer les effais par ce qu’il y a
de plus facile. Il femble que le genre moral eft plus
aifé que le genre paffionné. Les ballets qui n’ont
qu’un cara&ere général, qui expriment ou la gaieté,
ou la gravité, ou l’aménité des moeurs, font de tous
les plus faciles. Si donc à la fuite d’un drame inté-
reffant , la danfe répond au dénouement, que le
ballet foit comme lui, ou gai, ou férieux, ou trifte,
& en même tems conforme au cara&ere particulier
de la nation qui a fourni le fujet du drame , il ne
peut en réfulter qu’un très-bon effet fur les fpec-
tateurs..
B A L
Ge qui eft beaucoup plus difficile, c’eft de repré-î
fenter une a&ion particulière dans un ballet. On
rifque fouvent de tomber dans l’infipide. Ce n’eft:
point l’aftion même, c’eft en quelque façon fort
allégorie, qu’on peut mettre en ballet. Après que le
compofiteur a choifi fon fujet, il doit, comme le
peintre ; chercher les momens les plus frappans de
l’a&ion. Autant qft’il y a de ces momens dans l’aftion,
autant le ballet aura de périodes. Il faut enfuite
trouver pour chaque moment un tableau pittoref»
que qui ferve à le repréfenter. Tout ce qui remplit
les intervalles d’un moment à l’autre , eft d’un ton
moins animé ; le compofiteur y fera entrer des mou-,
vemens modérés , Sc des danfes qui s’accordent
avec le çaraftere & les moeurs des perfonnages. Il
faudroit qu’il évitât ic i, avec autant de foin que le
peintre, tous ces mouvemens , toutes ces attitudes
fymétriqües , que la mode a introduits. Pourquoi
faut-il que tous ces perfonnages faffent les mêmes
mouvemens , prennent la même attitude , Sc ref-
femblent à un feul figurant qui feroit multiplié une
dixaine de fois au moyen d’un verre à facette ?
Dans le dernier fiecle on a joué, à quelques cours,’
des pièces dramatiques qu’on nommoit des ballets ,
mais c’étoit des danfes entremêlées de chants & de
dialogues ; les récitatifs contenoient tout ce qui étoit
néceffaire pour l’intelligence du fujet; & la danfe
étoit interrompue par des airs qu’on chantoit. On
a un traité fur ces ballets, par le P. Meneftrier ; il y
a auffi plufieurs remarques importantes fur ce fit jet
dans le J)iclionnaire raif. des Sciences, &c. article.
B a l l e t , & dans Varticle fuivant.
Les mémoires qui.nous reftent fur les ballets des
anciens Grecs font.conjefturer qu’ils en avoient auffi
de deux efpèces: les uns formoient un drame d’un,
genre particulier; les autres faifoient Amplement partie
d’un fpeftacle dramatique. Les ballets des anciens,
étoient tous caraftériftiques ; ils repréfentoient des
ufages ou des aftes publics Sc nationnaux, ou ils
étoient des imitations de quelques événemens particuliers.
( Cet article ejl tiré de la Théorie générale des
Beaux - Arts de M. S U L ZER . )
§ B a l l e t , ( Mujîq. ) la mufîque d’un ballet
doit avoir plus de cadence & d’accent que la rau-
fique vocale, parce qu’elle eft chargée ae lignifier
plus de ehofes, que c’eft: à elle feule' d’infpirer au
danfeur la chaleur & l’expreffion que le chanteur
peut tirer des paroles, Sc qu’il faut, de p lu sq u ’elle
îupplée , dans le langage de l’ame Sc des pâmons „
: tout ce que la danfe ne peut dire aux yeux du
fpeftateur.
B a l l e t , eft encore le nom qu’on donne eri
France à une bizarre forte d’opéra, où la danfe
n’eft guere mieux placée que dans, les ‘autres, &
n’y* fait pas un meilleur effet. Dans la plupart de
de ces ballets, les aftes forment autant de: fujets
différens, liés feulement entr’eux par quelques rapports
généraux étrangers à l’a dion, & que le fpec-
tateur n’appercevroit jamais , fi l’auteur n’a voit
foin de l’en avertir dans le prologue.
Ces ballets contiennent d’autres ballets, qu’on
appelle autrement divertiffemens ou fêtes. Ce font
des fuites de danfes qui fe fuccédent fans fujet, ni
liaifon entr’elles, ni avec l’adion principale , & où
les meilleurs dànfeursme favent vous dire autre
chofe, finon qu’ils danfent bien. Cette ordonnance
peu théâtrale fuffit pour un bal où chaque a&eur
a rempli fôn objet, lorfqu’il s’eft amufé lui-même ,'
& où l’intérêt que le fpedateur prend aux per-
fonnes, le difpenfe d’en donner à la chofe ; mais
ce-défaut de fujet & de liaifon ne doit jamais être
fouffert fur la feene ; pas même dans la repréfentation
d’un b al, où le tout doit être lié par quelque
adion feçrete qui • foutienne l’attention, Sc
B A L
ft'onne de l’intérêt au fpédateur. Cette adreffe d’auteur
'n’eft: pas fans exemple , même à l’ôpéra François
, & l’on en peut voir un très-agréable dans les
fêtes Vénitiennes, ade du bal.
En général, toute dânfe qui né peint rien qu’elle
même, Sc.tout ballet qui n’eft: qu’un bal, doivent
être bannis du théâtre lyrique. En effet, l’adion de
la feené eft toujours la repréfentation d’une autre
adion , & ce qu’o iiy voit n’eft que l’image de ce
qu’on y fiippofe ; de forte que ce ne doit jamais
être un te l, ou un tel danfeur qui fe préfente à
Vous ; mais le perfonnagédont il eft revêtu. Ainfi,
quoique la danfe de fociété puiffe ne rien repréfenter
qu’elle même , la danfe théâtrale doit necef-
fairement être l’imitation de quelqu’autre chofe ;
de même que Fadeur chantant repréfentê un homme
qui parle , Sc la décoration d’autres lieux que Ceux
qu’elle Occupe.
La- pire forte de ballets eft celle qui roule fur
des fujets allégoriques , Sc où par confequent il n’y
a qu’imitation d’imitation. Tout l’art de ces fortes
de drames confifte à préfenter, fous des images fen-
fibles , des rapports purement intelleduels, & à
faire penfer au fpedateur, toute autre chofe que
ce qu’il voit, comme f i, loin de l’attacher à la feene,
c’étoit un mérite de Ten éloigner. Ce genre exige,
d’ailleurs, tant de fubtilxté dans le dialogue, que le
muficien fe trouve dans un pays perdu parmi les
poin’te s , les allufions & les epigrammes , tandis
que le fpedateur ne s’oublie pas un moment : comme
qu’on faffe, il n’y aura jamais que le fentiment
qui puiffe amener celui-ci fur la feene. & l’identifier
, pour ainfi dire , avec les adeurs ; tout ce qui
n’eft qu’intelleduel l’arrache à la piece, Sc le rend
à lui-même. Auffi voit-on que les peuples qui veulent
Sc mettent le plus d’efprit au théâtre, font ceux
quife foucient le moins'de l’illufion. Que fera donc
le muficien fur des drames qui ne donnent aucune
prife à fon art ? fi la mufique ne peint que des fen-
timerts ou des images, comment rendra-t-elle des
idées purement métaphyfiques, telles que lès allégories
, où l’efprit eft fans ceffe occupé du rapport
des objets qu’on lui préfente, avec ceux qu’on veut
lui rappetler ?
Quand les compofiteurs voudront réfléchir fur
les vrais principes de leur a r t , ils mettront plus de
difeernement dans le choix des drames dont ils fè
chargent, plus de vérité dans l’expreffion de leurs
fujets ; & quand les paroles des opéra diront quelque
chofe, la mufique apprendra bientôt à parler.
(■ *•)
BALTHASAR, ( Hifi. Sacrée. ) fils d’Evilmero-
dach , & petit-fils de Nabuchodonofbr, fut le dernier
roi de Babylone. Dans un grand feftin qu’il
donna à- fes femmes ,■ à fes concubines, & aux fei-
gneurs de fa cour, il but dans lés vafes facrés que
fon aïeul âvoit emportés du temple de Jérufalem :
cette profanation fut accompagnée des louanges
des idoles. La joie de cette fête fut bientôt changée
en deuil. Balthafar apperçut comme la main
d’un homme qui traça fur la muraille ces trois mots,
mané thecelphareç. Le roi épouvanté, fit appeller les
deVins pour les lui interpréter. Daniel feul les comprit
& les expliqua. Il dit à Balthafar qu’ils figni-
fioient que les jours de fort .régné étoient comptés &
touchoiertt à leur fin , que fis allions vénoient d'être pe-
fees & réprouvées , que fon royaume alloit être divifé
Cf devenir-la proie des Medes & des Perfes. Le roi de
Babylone fut tué cette même nuit, & Darius le
Mede, s’empara de fon royaume,-l’an du monde
34(36.'
II. paroît que Balthafar eft le même prince que
les hiftoriens profanes appellent Nabonide} autre-
B A L 76 f
BALTIMORE, C m. (Hiß. nat. Órnuholoeit.)
ùifëau commun au Canada, au Mariland & à la
Virginie. Les Anglois l'appellent ainfi, felon Ca-
tesby qui en a donné une figuré enluminée , mais
peu exaéie , au volurnt / , page & planche 48 de fon
Hifloirc de U Caroline. Klein l’appelle Turdus iSerus j
ex auro nigroque variuà, Avium, page 6'S h°. t5
M. Briffon le défigne par le nom de Baltimore1
icterus aurantius ; càpite & dorfo fupremo nigris ; re-
miglbus nigris, oils éxterioribus albis, Intetioribûs al-
bidis ; reclriçibus quatuor ütrinque extimisprima medie-
tatè nigris, alterâ aurantm , (i . . icterus minor : Sc it
en à fait graver une bonne figure, pl. X Î I , n°. / ,
du volume I I de fon Ornithologie, publiée .en 1760
page ïôr> , n°. IC). C ’eft ïoriolus, ,0 Baltimore, nigricans
, fubtus fafclaque àlarum fulvus, de M. Linné
dans fön Syflema natura, publié en 1766 , page.
i6z.
Cet oifëau ne furpâffé guère en grandeur le pinçon
d’Ardennes. Sa longueur prife de l’extrémité du
bec à celle de la queue , eft de fept pouces, Sc
jufqu’au bout des ongles, de fix pouces. Son bec
depuis fa pointe jufqu’aux coins de la bouche a neuf
lighes de longueur; fà queue trois pouces; fon pied
dix lignes & demie; le plus long de fes doigts , qui
eft celui du milieu -des trois antérieurs , l’ongle y.
compris-, neuf lighes. Ses ailes_ont trois pouces un
tiers de longueur; lorfqu’elles font pliées, elles s’étendent
un peu au-delà de la moitié de la longueur
de la queue, Sc en s’étendant, elles ont un pied
de vol.
Son bec eft conique, âlôngé, droit, très-pointu
deux à trois fois plus long que large , très-entier,
fans la moindre échancrure â fes mâchoires ; fes
narines nues ou découvertes , les pliimes de la tête
étant tournées en arriéré. Ses pieds font médiocrement
longs , comprimés par les côtés, arrondis par
devant, St taillés en tranchant très-aigu par derrière;
fes doigts au nombre de quatre , dont un
poftérieur plus court, Sc trois antérieurs réunis étroitement
à leur origine, feulement dans la longueur
d’une demie à une articlation. Sa queue eft ronde
ou tronquée , compofee de douze plumes à-peU-
près égales Sc de la longueur du dos.
Sa couleur dominante eft un noir îuifant qui s’étend
fur fa tête , fon dos, fes ailes- & fa. queue.
Son corps en-deffous , depuis la poitrine jufqu’à la
queue, & fon croupion en-deffus , font d’un beau
jaune-orangé. Les bords extérieurs des plumes de
fes ailes font blancs, & ceux de la queue font orangés.
Son bec & fes pieds font dè couleur de plomb.
Moeurs. Il né faut pas croire que le baltimore ait
tiré fon nom de celui d’une ville d’Irlande dans la
province de Munfter au comté de C orck , fur la
baie de même nom. Cet oifeàu n’a encore été ofi-
fervé que dans l’Amérique feptentrionale, Sc il fei
fait remarquer par la forme de fon nid, qui ref-
femble à une efpece de poche fufpendue.aux bifurcations
des branches des arbres, félon la 'remarque'
de Catesby.
Remarques. Le baltimore eft une efpece du japu
du Bréfil , qui fait un genre particulier d’oifeau
dans la famille des étourneaux. Nous lui laiffons
ce nom de ja p u , par préférence à ceux d'iclerus
Sc A'oriolüs, que lui ont donne improprement quelques
modernes, ignorant fans doute que ces noms
appartiennent au loriot âuqùel nous croyons devoir
le reftituer. ( M. A d a n s o n . j
BALTINGLASS, (. Geogr.'j petite ville d’Irlande3
dans la province de Linftet, au comté de Wicklow,
fur l’Urrin, à treize milles environ de BleffintOn,
Elle envoie deux députés au parlement, ( - f)