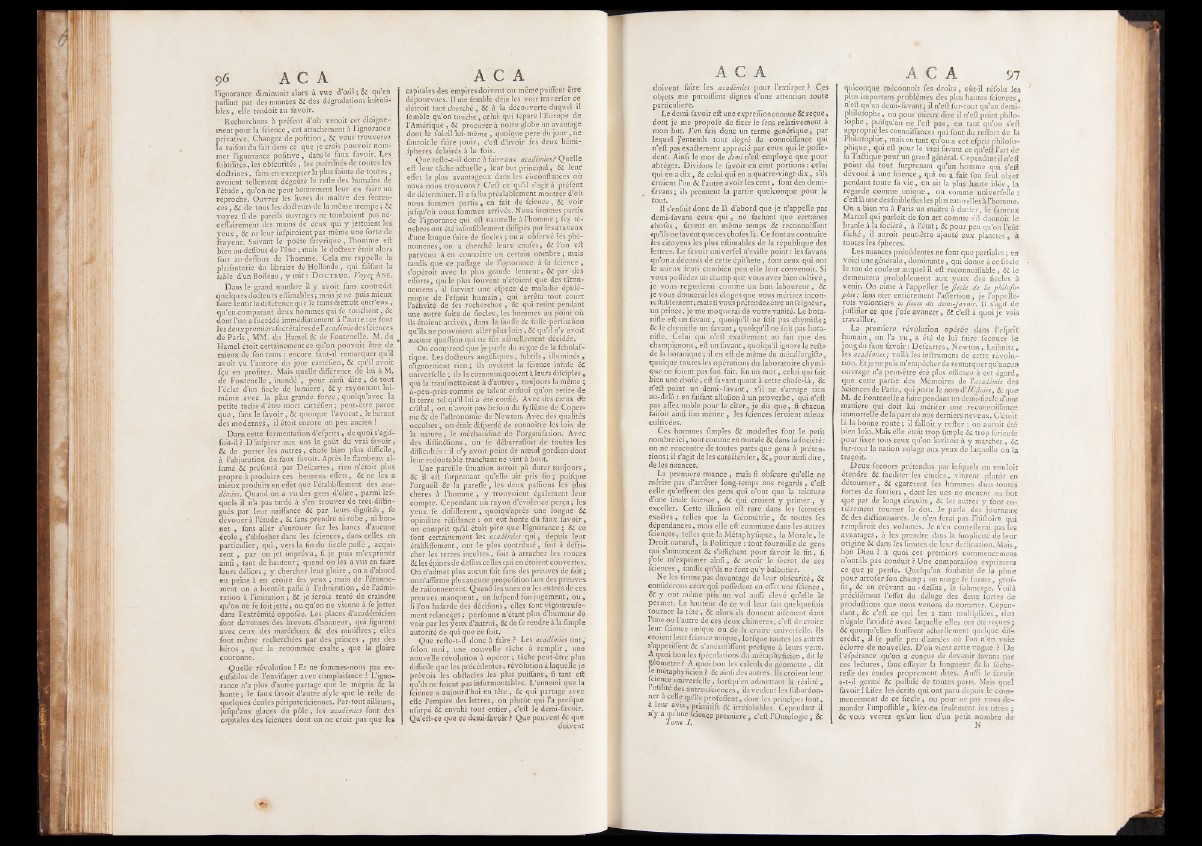
A C A
l ’ignorance diminuoit alors à vue d’oeil ; |jjj| cjù’efl
paffant par des nuances 8c des dégradations inlenfi*
b lé s , elle tendoit au favoir.
Recherchons à préfent d’où Venoit cet éloignement
pour la fcience, cet attachement à l’ignorance
privative. Changez de pofition , 8c vous trouverez
fa raifon du fait dans ce que je crois pouvoir nommer
l’ignorance pofitive, dans le^ faux favoir. Les
fubtilités, les obfcurités, les puérilités de toutes les
doftrines, fans eh excepter la plus fainte de toutes ,
avoient tellement dégoûté le refie des humains de
l’étude , qu’on ne peut bonnement leur en faire un
reproche. Ouvrez les livres du maître des fenten-
ce s , & de tous les do&eurs de la même trempe ; 8c
voyez fi de pareils ouvrages ne tomboient pas né-
ceffairement des mains de ceux qui y jettoïent les
y e u x , 6c ne leur infpiroient pas même une forte de
frayeur. Suivant le poëte fatyrique, l’homme eft
bien au-deffous de l’âne ; mais le docteur étoit alors
fort au-deffous de l’homme. Cela me rappelle la
plaifanterie du libraire de Hollande, qui faifant la
table d’un Boileau, y mit : D octeur. Voye^ Ane.
Dans le grand nombre il y avoit fans contredit
quelques dofteurs eflimables; mais je ne puis mieux
faire fentir la différence que le temsmettoit entr’eu x,
qu’en comparant deux hommes qui fe touchent, 6c
dont l’un a fuccédé immédiatement à l’autre : ce font
les deux premiers fecrétaires de Vacadémie, des fciences
de Paris , MM. du Hamel 6c de Fontenelle. M. du
Hamel étoit certainement ce qu’on pouvoit être de
mieux de fon tems : encore faut-il remarquer qu’il
avoit vu l’aurore du jour cartéfien, 6c qu’il avoit
fçu en profiter. Mais quelle différence de lui à M.
de Fontenelle , inondé , pour ainfi dire, de tout
l ’éclat d’un fieçle de lumière", 6c y rayonnant lui-
même avec la plus grande force, quoiqu’avec la
petite tacjie'd’être mort cartéfien ; peut-être parce
q u e , fans le favoir , 8c quoique l’avocat, le héraut
des modernes, il étoit encore un peu ancien !
Dans cette fermentation d’efprits , de quoi s’agif-
foit-il? D ’infpirer aux uns le goût du vrai favoir,
& de porter les autres, chofe bien plus difficile,
à l’abjuration du faux favoir. Après le flambeau allumé.
6c préfenté par Defcartes, rien n’étoit plus
propre à produire ces heureux effets, 6c ne les a
mieux produits en effet que l’établiffement &es académies.
Quand on a vu des gens d’élite , parmi lef-
quels il n’a pas tardé à s’en trouver de très-diftin-
gués par leur naiffance 6c par leurs dignités , , fe
dévouer à l’étude , 6c fans prendre ni robe, ni bonnet
, fans aller ^enrouer fur les bancs d’aucune
é co le , s’abforber dans les fciences, dans celles en
particulier, q u i, vers la fin du fiécle paffé , acquirent
, par un jet imprévu, fi je puis m’exprimer
ainfi , tant de hauteur ; quand on les a vus en faire
leurs délices / y chercher leur gloire , on a d’abord
eu peine à en croire fes yeux ; mais de l’étonnement
on a bientôt paffé à l’admiration, de l’admiration
à l’imitatipn ; 6c je ferois tenté de craindre
qu’on ne fe foit jetté, ou qu’on ne vienne à fe jetter
dans l’extrémité oppofée. Les places d’académicien
font devenues des brevets d’honneur, qui figurent
avec ceux des maréchaux 6c des miniftres ; elles
font même recherchées par des princes , par des
héros , que la renommée exalte, que la gloire
couronne.
Quelle révolution ! Et ne fommes-nous pas ex-
cufables de l’envifager avec complaifance ! L’ignorance
n’a plus d’autre partage que le mépris 6c la
honte ; le faux favoir d’autre atyle que le refte de
quelques écoles péripatéticiennes. Par-tout ailleurs,
jufqu’aux glaces du p ô le , les académies font des '
capitales des fciences dont on ne croit pas que les
A C A
Capitales des empires doivent ou mêmepuiffeht être;
dépourvues. Il me femble déjà les voir traverfer ce
détroit tant cherché, 6c à la découverte duquel il
femble qu’on'touche , celui qui fépare l’Europe de
l’Amériquë , 8c procurer à notre globe un avantage
dont le foleil lui-même , quoique pere du jou r , ne
fauroitle faire jouir, c’eft d’avoir fes deux hëmi-
fpheres éclairés à la fois.
Que refte-t-il donc à faireaux académies? Quelle
èft leur tâche âttuelle, leur but principal, 6c leur
effet le plus avantageux dans les circônftanCes oit
nous nous trouvons ? C’eff ce qu’il s’agit à préfent
de déterminer. Il a fallu préalablement montrer d’où
nous fommes partis, en fait de fcience, 6c voir
jufqu’oii nous fommes arrivés. Nous fommes partis
de l*ignorance qui eft naturelle à l’homme ; fé§ ténèbres
ont été infenfiblement diffipés par les «travaux
d’une longue fuite de fiecles ; on a obfervé lés phénomènes,
on a cherché leurs' caùfes, 8c l’on eft
parvenu à en connoître un certain nombre ; mais
tandis que ce paffage de l’ignorance à la fcience ,
s’opéroit avec la plus grande lenteur, 8c par‘ des
efforts, qui le plus fouvent n’étoient que des tâton-
nemens, il furvint une efpèce de maladie épidémique
de l’efprit humain, qui arrêta tout court
l’a&ivité de fes recherches , 8c qui retint pendant
une autre fuite de fiecles > les hommes au point oit
ils étoient arrivés, dans la fauffe 6c folle perfuâfion
qu’ils ne pouvoient aller plus loin , 6c qu’il n’y avoit
aucune queftion qui ne fût actuellement decidee.
On comprend que je parle du régné de la fcholaf-
tique. Les doCleurs angéliques , fubtils , illuminés ,
n’ignorôient rien ; ils avoient la fcience infufe 6c
univerfelle ;■ ils la communiquoient à leurs difciples ,
qui la trânfmettoient à d’autres, toujours la même ;
à-peu-près comme ce talent ënfoui qü’on retire de
la terre tel qu’il lui a été confié. Avec des cieux dé
criftal, on n’avoit pas befoin du fyftême dé Copernic
6c de l’aftronomie de Newton. Avec des qualités
occultes, on étoit difpenfé de connoître les loix de
la nature, le méchanifme de l’organifation. Avec
des diftinctions, on fe débarraffoit de toutes les
difficultés; : il n’y avoit point de noeud gordien dont
leur redoutable tranchant ne vînt à bout.
Une pareille fituation autoit pû durer toujours
8c il eft furprenant qu’elle ait pris fin ; puifque
l’orgueil 6c la pareffe, les deux paffions les plus
cheres à l’homme , y trouvoient également leur
compte. Cependant un rayon d’évidence perça ; les
yeux fe diffiilerent, quoiqu’àprès une longue 6c
opiniâtre réfiftance : on eut honte du faux favoir ,
on comprit qu’il étoit pire que l’ignorance ; 6c ce
font certainement les académies q ui, depuis leur
établiffement, ont le plus contribué, foit à défricher
les terres incultes, foit à arracher les ronces
6c les épines de deffus celles qui en étoient couvertes.
On n’admet plus aucun fait fans des preuves de fait ;
on n’affirme plus aucune propofition fans des preuves
de raifonnement. Quand les unes ou les autres de ces
preuves manquent, on fufpend fon jugement, o u ,’
fi l’on hafarde des décifions, elles font vigoureufe-
ment relancées ; perfonne n’étant plus d’humeur de
voir par les yeux d’autrui, 6c de fe rendre à la fimple
autorité de qui que ce foit.
Que reflert-il donc à faire ? Les académies ont,'
félon moi , une nouvelle tâche à remplir, une
nouvelle révolution à opérer ; tâche peut-être plus
difficile que les précédentes, révolution à laquelle je
prévois les obflacles les plus puiffans, fi tant eft
qu’ils ne foient pas infurmontables. L’ennemi que la
fcience a aujourd’hui en tête , 6c qui partage avec
elle l’empire des lettres, ou plutôt qui l’a prefque
ufurpé 6c envahi tout entier, c’eft le demi-favoir.
Qu’eft-ce que ce demi-favoir ? Que peuvent 6c que
doivent
A C A
doivent faire les académies pour l’extirper? Ces
objets me paroiffent dignes d’une attention toute
particulière.
Le demi-favoir eft une expreflîortconnue 8creçue,
dont je me propofe de fixer le fens relativement à
mon but. J’en fais donc un terme générique, par
lequel j’entends tout degré de eonnoiflance qui
n’eft pas exactement apprécié par ceux qui le poffe-
dent. Ainfi le mot de demi n’eft employé que pour
abréger. Divifons le favoir en cent portions : celui
qui en a dix, 6c celui qui en a quatre-vingt-dix, s’ils
croient l’un 6c l’autre avoir les cent, font des demi-
favans ; ils prennent la partie quelconque pour lç
tout.
Il s’enfuit donc de là d’abord que je n’appelle pas
demi-favans ceux q u i, ne fachant que certaines
chofès, favent en même temps 6c reconnoiffent
qu’ils ne favent que ces chofes là. Ce font au contraire
les citoyens les plus eflimables de la république des
lettres. Le favoir univerfel n’exifte point : les fàvans
qu’on a décorés de cette épithete, font ceux qui ont
le mieux fenti combien peu elle leur convenoit. Si
vous poffédez un champ que vous avez bien cultivé,
je vous regarderai comme un bon laboureur, 6c
je vous donnerai les éloges que vous méritez incon-
teftablement; mais fi vous prétendez être unfeigneur,
un prince, je me moquerai de votre vanité. Le bota-
nifte eft unfàvant, quoiqu’il ne foit pas chymifte ;
6c le chymifte un favant, quoiqu’il ne foit pas bota-
nifte. Celui qui n’eft exactement au fait que. des
champignons, eft un favant, quoiqu’il ignore le refte
de la botanique ; il en eft de même du métal!urgifte,
quoique toutes les opérations du laboratoire chymi-
que ne foient pas fon fait. En un mot, celui qui fait
bien Une chofe, eft favant quant à cette dhofe-là, 6c
t f eft point un demi-favant, s’il ne. s’arroge rien
au-delà : en faifant allufion à un proverbe, qui n’eft
pas affez noble pour le citer, je dis que, fi chacun
faifoit ainfi fon métier , les fciences leroient mieux
cultivées.
Ces hommes fimples 8c modeftes font le petit
nombre ic i, tout comme .en morale 6c dans la fociété:
on ne rencontre de toutes parts que gens à prétentions
; il s’agit de les caraCtérifer, 6c, pour ainfi dire,
de les nuancer.
La première nuance , mais fi obfcure qu’elle ne
mérite pas d’arrêter long-temps nos regards, c’eft
celle qu’offrent des gens qui n’ont que la teinture
d’une feule fcience, 6c qui croient y primer, y
exceller. Cette illufion eft rare dans les fciences
exaétes, telles que la Géométrie, 6c toutes fes
dépendances, mais elle eft commune dans les autres
fciences, telles que la M étaph y fiqu ela Morale, le
Droit naturel , la Politique : tout fourmille de gens
qui s’annoncent 6c s’affichent pour favoir le fin, fi
j’ofe m’exprimer ainfi, 8c avoir le feeret de ces
fciences , tandis qu’ils ne font qu’y balbutier.
Ne les tirons pas davantage de leur obfeurité, 6c
confidérons ceux qui poffedent .en effet une fcience ,
6c y ont même pris -un vol a.uffi élevé qu’elle le
permet. La hauteur de ce vol leur fait quelquefois
tourner la tê te , 6c alors ils donnent aifément dans
l’Cine ou l ’autre de ces deux chimères; c’eft de croire
leur fcience unique ou de la croire univerfelle,. Ils
croient leur fcience unique , lorfque toutes les autres
s’appetiflènt 6c s’anéantiffent prefque à leurs yeux.
A quoi bon les fpéculations du métàphyficie.n, dit le
geometre ? A quoi bon le’s calculs du géomètre , dit
le métaphyficien ? 8c ainfi des autres. Ilsicroient leur
fcience univerfelle, lorfqu’en admettant la réalité,
1 utïlite des autresdciences, ils veulent les fubordon-
ner à celle qu’ils profeffent, dont les principes font,
,leur avis, primitifs 6c inréfolubles. iCependant il
n y a qu une fcience première, c’eft l’Ontologie : 6c
Tome J,
A C A 97
quiconque méconnoît fes droits, eut-il réfolii les
plus importans problèmes des plus hautes fciences,
n’eft qu’un demi-favant; il n’eft fur-tout qü’un demi-
philofophe, ou pour mieux dire il n’eft point philo-
fophe, puifqu’on ne l’eft pas, en tant qu’on s’eft
approprié les connoiffançes qui font du rëffort de là
Philofophie, mais en tant qu’on a cet efprit philo fo-
phique, qui eft pour le vrai favant ce qu’eft l’art dé
la Taétiqiie pour un grand général. Cependant il n’eft
point dii tout furprenant qu’un homme qui s’eft
dévoué à une fcience, qui en a fait fon feul objet
pendant toute fa v ie , en ait la plus haute id ée. là
regarde comme unique , ou comme univerfelle :
c’ eft là une des foibleffes les plus naturelles à l’hommei
On a bien vu à Paris un maître à danfer, le fameux
Marcel qui parloit de fon art comme s’il donnoit lé
branle-à la fociété, à l’état ; 8c pour peu qu’on l’eût
fâché , il auroit peut-être ajouté aux planètes , à
toutes les fphères.
Les nuances précédentes ne font que partiales ; en
voici une générale, dominante, qui donne à ce fiecle
le ton de couleur auquel il eft reconnoiffabie, 6c le
demeurera probablement aux yeux des fiecles à
venir. On aime à l’appeÜer le fiecle de la philofo-
phie; fans nier entièrement l’affertion, je l’appelle-*
rois volontiers le fiecle du demi-favoir. Il s’agit de
juftifier ce que j’ofe avancer, 6c c’eft à quoi je vais
travailler.
La première révolution opérée dans l ’efpriC
humain, on l’a v u , a été de lui faire fedouer lé
joug du faux favoir : Defcartes-, Newton, Leibnitz ,
les académies; voilà les inftrümens de cette révolution.
Et je ne puis m’empêcher de remarquer qu’aucun
ouvrage n’a peut-être été plus efficace à cet égard,
que cette partie des Mémoires de Vaçàdémie des
Sciences de Paris , qui porte le nom d'Èifioire, 6c que
M. de Fontenelle a faite pendant un demi-fiecle d’une
maniéré qui doit lui mériter une reconnoiffançe
immortelle de la part de nos derniers neveux. C’étoit
là la bonne route ; il faifoit y refter on auroit été
bien loin. Mais elle étoit trop fimple 6ç trop férieufe
pour fixer tous ceux qu’on invitoit à y marcher, 6c
fur-tout la nation volage aux yeux de laquelle on la
traçoit.
Deux fecours prétendus par lefquels on vouloit
étendre 6c faciliter les études, vinrent plutôt en
détourner, 6c égarèrent les hommes dans toutes
fortes de fentiers, dont les uns ne mènent au but
que par de longs circuits , 6c les autres y font entièrement
tourner le dos. Je parle des journaux
6c des dictionnaires. J.ç-n’en ferai pas l’hiftoire qui
rempliroit des volumes. Je n’en contefterai pas les
avantages, à les prendre dans la fimplicité de leur
origine 6c dans les limites de leur deftination. Mais ,
bon Dieu ! à quoi ces premiers commencemens
n’ont-ils pas conduit ? Une comparaifon exprimera
ce que je penfe. Quelqu’un fouhaite de la pluie
pour arrofer fon champ ; un nuage fe forme, grof-
fit, 6c en crevant au - deffus , le fubmerge. Voilà
préçifément l’effet du déluge des deux for tes de
productions que nous venons de nommer. Cependant
, 6c c’eft ce qui les a tant multipliées, rien
n’égale l’avidité avec laquelle elles ont été reçues ;
6c quoiqu’elles fouffrent actuellement quelque dif-
çrédit, il fe paffe peu d’années où l’on n’en voie
éclorre de nouvelles. D ’où vient cette vogue ? D e
l’efpérance qu’on a conçue de devenir favans par
ces leâures, fans effuyer la longueur 6c la féche-
reffe des études proprement dites. Au.ffi le favoir
a-t-il germé 6c pullulé de toutes parts. Mais quel
favoir ! Liiez les écrits qui ont paru depuis le commencement
de ce fiecle., ou pour né pas vous demander
l’impoffible, lifez-en feulement, les titres. ;
ôc vous verrez qu’au lieu d’un petit nombre de
N