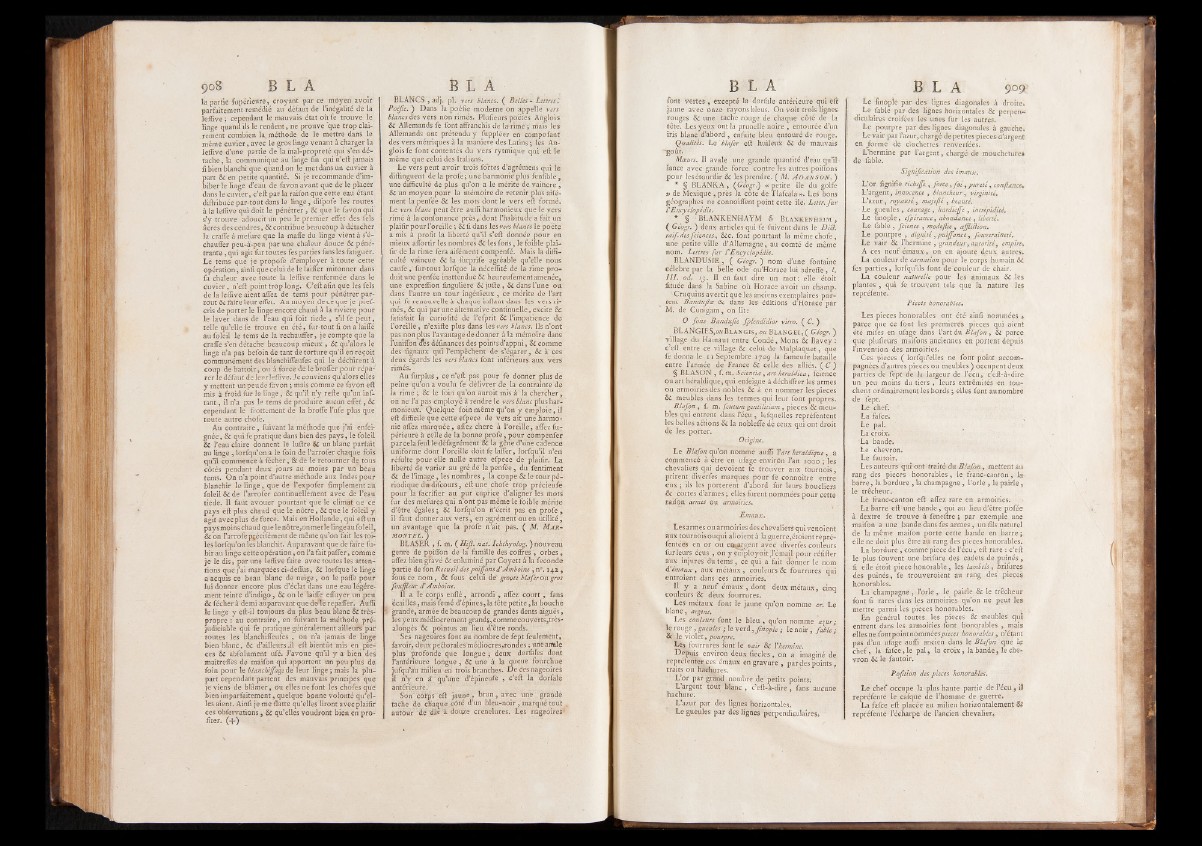
la partie fupérieure, croyant par ce. moyen avoir
parfaitement remédié au défaut de l’inégalité de la
leffive; cependant le mauvais état oùfe trouve le
linge quand ils le rendent, ne prouve 'que trop clairement
combien la. méthode de le mettre dans le
même cuvier, avec le gros linge venant à charger la
leffive d’une partie de la mai-propreté qui s’en détache
, la communique au linge fin qui n’eft jamais
fi bien blanchi que quand on le met dans un cuvier à
part & en petite quantité. Si je recommande d’imbiber
le linge d’eau de favon avant que de le placer
dans le cuvier, c’eft par la raifon que cette eau étant
diftribuée par-tout dans le linge, difpofe les' routes
à la leffive qui doit le pénétrer , & que le favon qui
s’y trouve adoucit un peu le premier effet des fels
âcres des cendres, & contribue beaucoup à détacher
la craffe à mefure que la maffe du linge vient à s’échauffer
peu-à-peu par une chaleur douce & pénétrante
, qui agit fur toutes fes parties fans les fatiguer.
Le tems que je propofe d’employer à toute cette
opération, ainfi que celui de le laiffer mitonner dans
fa chaleur avec toute la leffive renfermée dans le
cuvier, n’eft point trop long. C’eft afin que les fels
de la leffive aient affez de tems pour pénétrer partout
& faire leur effet. Au moyen de ce que je pref-
cris de porter le linge encore chaud à la riviere pour
le laver dans de l’èau qui foit tiede , s’il fé peut,
telle qu’elle fe trouve en été, fur-tout fi on a laiffé
au foleil le tems de la rechauffer, je compte que la
craffe s’en détache beaucoup mieux, & qu’alors le
linge n’a pas befoin dè tant de torture qu’il en reçoit
communément des blanchiffeufes qui le déchirent à
Coup de battoir, ou à forcé dé lebroffer pour réparer
le défaut de leurleffive. Je conviens qu’alors elles
y mettent un peu de favon ; mais comme ce favon éft
mis à froid fur le linge, & qu’il n’y refte qu’un in filant.,
il n’a pas le tems de produire aucun effet, &
cependant le frottement de la broffe l’ufe plus que
toute autre chofe. .
Au contraire, fùivant la méthode que j’ai enféi-
gnée, & qui fe pratique dans bien des pays, le foleil
& l’eau claire donnent le luftre & un blanc parfait
au linge, lorfqu’on a le foin de l’arrofer chaque fois
qu’il commencé à fécher, & dè le retourner dé tous
côtés pendant deux jours au moins par tiri beau
tems. On n’a point d’autre méthode aux Indes pour
blanchir le linge, que de l’expofer Amplement au
foleil & de l’arrofer continuellement avec dé l’éaü
tiede. Il faut avouer pourtant que lé climat ae ce
pays éft plus chaud que le nôtre, & que le foleil y:
agit avec plus de force. Mais en Hollande, qui eft urt
pays moins chaud que le nôtre,onm et le linge au foleil,
& on l’arrofe pjécifément de même qu’on fait les toiles
lorfqu’on les blanchit. Auparavant que de faire fu-
bir au linge cette opération, on l’a fait paffer, comme
je le dis, par une leffive faite avec toutes les attentions
que j’ai marquées ci-deffus, & lorfque le linge
a acquis ce beau blatte de neige, on le pàffë pour
lui donner encore plus d’éclat dans une eau légèrement
teinte d’indigo, & on le laiffé effuyér un peu
& fécher à demi auparavant que dealer ëpaffer. Auffi
le linge y eft-il toujours du plus beau blanc & très-
propre : au contraire, en fuivant la méthode préjudiciable.
qui fe pratique généralement ailleurs par
toutes les blanchiffeufes , on n’a jamais de linge
bien blanc, & d’ailleurs .il eft bientôt mis en pièces
& abfolument ufé. J’avoue qu’il y a bien dès1
maîtreffes de maifon qui apportent un peu plus de
foin pour le blanchiffage de leur linge ; mais la plupart
cependarit partent des mauvais principes que
je viens de blâmer, ou elles ne font les chofes que
bien imparfaitement, quelque bonne volonté qu’elles
aient. Ainfi je me flatte qu’elles liront avec plaifir
ces obfervations, & qu’elles voudront bien en profiter.
(+ ) <
BLANCS , adj. pl. vérifiants. ( Belles - Lettres'.
Poéfie. ) Dans la poéfie moderne on appelle" vers
blancs des vers non rimés. Plufieurs poètes Ahglois
& Allemands fe font affranchis de la-rime ; mais les
Allemands ont prétendu y fuppléer en compofant
des vers métriques à la maniéré des Latins ; les An-
glois fe font contentés du vers rytmique qùi eft le
même que celui des Italiens.
Le vers peut avoir trois fortes d’agrémerts qui le
diftinguent de la profe; une harmonie plus fenfible ,
une difficulté de plus qu’on a le mérite de vaihere ,
& un moyen pour la mémoire de retenir plus aifé-
ment la penfée & les mots dont le vers eft formé.
Le vers blanc peut être auffi harmonieux que le vers
rimé à la confonance près dont l’habitude a fait un
plaifir pour l’oreille ; & fi dans les vers blancs le poète
a mis à profit la liberté qu’il s’eft donnée pour en
mieux affortir les nombres & les foris, le foible plaifir
de la rime fera aifément compenfé. Mais la difficulté
vaincue & la furprife agréable qu’elle nous
canfe, fur-tout lorfque la néceffité dé la rime produit
une penfée inattendue & heureufement amenée,
une expreffion finguliere & jufte., & dans l’une ou
dans l’autre un tour ingénieux, ce mérite de l’art
qui fe renouvelle à chaque inftant dans les vers ri-
• més, & qui par une alternative continuelle, excite &
| fatisfait la curiofité de l’efprit & l’impatience de
l’oreille, n’exifte plus dans les vers blancs. Ils n’ont
pas non plus l’avantage de donner à la mémoire dans
l’uniffon dies définances des points d’appui, & comme
des fignaux qui l’empêchent de s’égarer, & a'ces
deux égards les vers blancs font inférieurs aux vers
rimés.
Au furpluS, ce n’eft pas pour fe donner plus de
peine qu’drt a voulu fe délivrer de la contrainte de
la rime ; & le foin qu’on auroit mis à la chercher ,
on ne l’a pas employé à rendre le vers blanc plus harmonieux.
Quelque foin même qu’on y emploie, il
eft difficile que cette efpece de vers ait une harmonie
affez marquée, affez chere à l’oreille, affezfu-
périeure à celle de là bonne profe, pour compenfer
par cela feul le défagrément & la gêne d’une cadencé
uniforme dont l'oreillé doit fe laffer, lorfqu’il n’eri
réfulte pour elle nulle autre efpece de plaifir. La
liberté de varier au gré de îâ penfée , du fentiment
& de l’image, lès nombres, la coupe & le tour périodique
du* difeours, eft une chofe trop précieufe
pour la facrifier au pur caprice d’aligner lès mots
fur des mefurës qui n’ont pas même le foible mérite
d’être égales ; & lorfqu’on rt’écrit pas èn profe ,
il faut donner aux vers, en agrément ou en utilité,
un avantagé que là profe n’ait pas. ( M . M a r -
mont el . )
BLASER., f. m. {Hiß. hat. Ichthyolog. ) nouveau
genrè de poiffon de la famille deS coffres , orbes ,
affez bien grâvé & enluminé par Coyett à la fécondé
partie d e ïo t i Recueil des poiffons d 'Amboine ,n°. 142 ,
fous ce nom, & fous celui de" groote b la fer ou gros
foußleUr (T Amboine.
Il a le corps enflé, àrrondi , affez court , fanà
écailles, mais femé d’épines, la tête petite, la bouche
4 grande, armée de beaucoup de grandes dents aiguës,
les ÿèüx médiocrement grands, comme couverts,très-
alongés & pointus au lieu d’être ronds.
Ses nageoires font au nombre de fept feulement,'
favoir, dèux péttorales médiocres,rondes ; une anale
plu's profonde que longue ; deux dorfales dont
l’antérieure longue, & Une à la queue fourchue
jufqu’àu milieu 'en trois branches. De Ces nageoires
il n’y en ä qu’une d’épineufe , c’eft la dorfale
antériëufé.
SônJ 'Côî'ôs eft jaune, brun, avec unè grande
tache de chaque côté d’un bleu-noir , marqué tout
autour dé dix 'à douze crenelures. Les nàgeoires1
font vèrtèS , excepté la dorfale antérieure qui eft
jaune avec ónze ràyons bleus. On voit trois lignes
rouges & une. tache rouge de chaque côté de la
tête. Les yeux-ont la prunelle noire , entourée d’un
iris blanc [d’abord , enfuite bleu èntouré de rouge.
Qualités. Le b la fer eft huileux & de mauvais
%©# ' L ’’ . . ,
Moeurs. Il avale une grande quantité d’eau qufil
lance avec grande force contre les autres poiflons
pour les étourdir & les prendre. ( M .A d an so n . )\
* § BLANK.A, (Géogr.) «petite île du golfe
» de Mexique , près la Côte de Tlafcala ». Les bons
géographes ne connoiffent point cette île. Lettr.fur
V Encyclopédie.
* ' § • BLANKENHAYM & Bl a n k e n h e im ,
( Géogr. ) deux articles qui fe fuivent dans le H ici.
raifdesfciences, & c. font pourtant la même chofe,
une petite ville d’Allemagne, au comté de même
nom. Lettres -fur l'Encyclopédie.
BLANDUSIE , ( Géogr. ) nom d’une fontaine
célébré par la belle ode'qu’Horace lui adreffe, /.
III. od, 13. Il en faut dire un mot : elle étoit
fituée dans la Sabine où Horace avoit un champ.
'Cruquîus avertit que les anciens, exemplaires portent
Bandujîoe & dans les éditions d’Horace par
M. de Cunigarn, on lit:
O fons Bandujîe fplendidior vitro. ( C. )
BLANGIES,o«Blangis, ou Blangei, ( G,éogr. )
village du Hainaut entre Condé, Mons & Bavey :
c’eft entre ce village & celui de Malplaquet, que
fe donna le 11 Septembre 1709 la fameufe bataille
entre l’armée de France & celle des alliés. ( C )
§ BLASON , f. m. Scientia , ars heraldica, fcience
pu art héraldique, qui enfeigne à déchiffrer les armes
ou armoiries des nobles & à en nommer les pièces
& meubles dans les termes qui leur font propres.
Blafon, f. m. feutum gendlitium, pièces & meubles
qui entrent dans l’écu , lefquelles repréfentent
les belles aérions & la nobleffe de ceux qui ont droit
de les porter.
Origine.
Le Blafon qu’on nomme auffi Vart héraldique, a
commencé à être en ufage environ l’an ipoô ; les
chevaliers qui dévoient fe trouver aux tournois,
prirent diverfes marques pour fe connoître entre
eux ; ils les portèrent d’abord fur leurs boucliers
& Cottes d’armes ; elles furent nommées pour cette
raifon armes ou armoiries.
Emaux.
Les armes ou armoiries des chevaliers qui venoient
aux tournois ouqui alloient à la guerre,étoient repré-
fentées en or ou eq^urgent avec diverfes couleurs
fur leurs éçus , on y employoit d’émail pour réfifter
aux injures du tems, ce qui a fait donner le nom
d’émaux, aux métâux , couleurs & fourrures qui
entroient dans ces armoiries.
Il y a neuf émaux , dont deux métaux, cinq
couleurs & deux fourrures.
Lesx métaux font le jaune qu’on nomme or. Le
blanc, argent. • •
L f Les couleurs font le bleu , qu’on nomme a^ur;
le rouge, gueules ; le verd ,Jinople ; le noir, fable ;
& le,violet, pourpre.
Les fourrures font' le vair & Vhtrminè.
Depuis environ deux fiecles, on a imaginé de
repréferifér ces émâux en gravure , par des points ,
traits ou hachures.
L’or par grand nombre de petits points;
L’argent tout blanc , c’ eft-à-dire , fans aucune
hachure.
L’azur par des lignes horizontales. -
Le gueules par des lignes perpendiculaires* !
Le iinôplé par des lignes diagonales à droite»
Le fable par des lignes horizontales & perpendiculaires
croifées. les unes fur les autres.
Le pourpre par des lignes diagonales à gauche»
Le vair par l’azur, chargé de petites pièces d’argent
en ^forme de clochettes renverfées»
L’hermine par l’argent, chargé de mouchetures
de fable.
Signification des émaux. ' '
L’or fignifie rkheffe, , force ,fa i , pureté, confiance»
L’argent, innocence , blancheur, virginité.
L’azur, royauté, majefié , beauté.
Le gueules , courage , kardieffe , tiptrépiduê.
Le finople, efpérance, abondance, liberté.
Le fable , fcience , modefiie , affliction.
Le pourpre , dignité, puiffance, fouverainèté.
Le vair & l’hermine , grandeur, autorité, empire»
A ces neuf émaux,, on en ajoute deux, autres*
La couleur de carnation pour le corps humain Ô£
fes parties, lorfqu’ils font de couleur de chair.
La couleur naturelle pour les animaux & lès
plantes , qui fe trouvent tels que la nature les
repréfente.
Pièces honorables.
Les pièces honorables ont été ainfi nommées «,
parce que ce font les premières pièces qui aient
été mifes en ufage dans l’art du Blafon, & parce
que plufieurs maifons anciennes en portent depuis
l’invention des armoiries; :
Ces pièces.( lorfqu’elles ne font'point accompagnées
d’autres pièces ou meubles) occupent.deux
parties de fept de la largeur de l’écu, c’eft-à-dire
un peu moins du tiers , leurs extrémités en tout
chent ordinairement les bords ; elles font au nombre
de fept.
Le chef.
La fafee.
Le pal.
La croix»
La bande.
Le chevron.'
Le fautoir.
Les auteurs qui ont traité du Blafoh, mettent au
rang des pièces ■ honorables, le franc-canton, la-
barre , la bordure , la champagne, l’orle , le pairie,
le trêcheur.
Le franc-canton eft affez rare en armoiries.
La barre eft - une bande, qui au lieu d’être pofée
à dextre fe trouve à feneftre ; par exemple une
maifon a une bande dans fes armes,. un fils naturel
de la même maifon porte cette bande en .barre ;
elle ne doit plus être au rang des pieçes honorables.
La bordure -, comme piece de l’écu, eft rare : c’ eft
le plus fouvent une brifure des cadets de. puînés,
fi elle étoit piece honorable, les lambels, brifures
des puînés, fe trouveroient au rang des' pièces
honorables.
La champagne, l’orle , le pairie & le trêcheuf
font fi rares dans les armoiries qu’on ne peut les
mettre parmi les pièces honorables.
En général toutes, les pièces & meublés qui
entrent dans les- armoiries font honorables , mais
ellesne font point nommées pieçes honorables, n’étant
pas d’un ufage auffi ancien dans le Blafon que le
chef, la fafee, le pal, la croix, la bande, le chevron
&. le fautoir.
Pojition des pièces honorables.
Le chef occupe la plus haute partie de l’écu , il
repréfentè le cafqüe de l’homme de guerre*
La fafee eft placée au milieu horizontalement Si
repréfente Técnarpe de l’ancien chevalier,