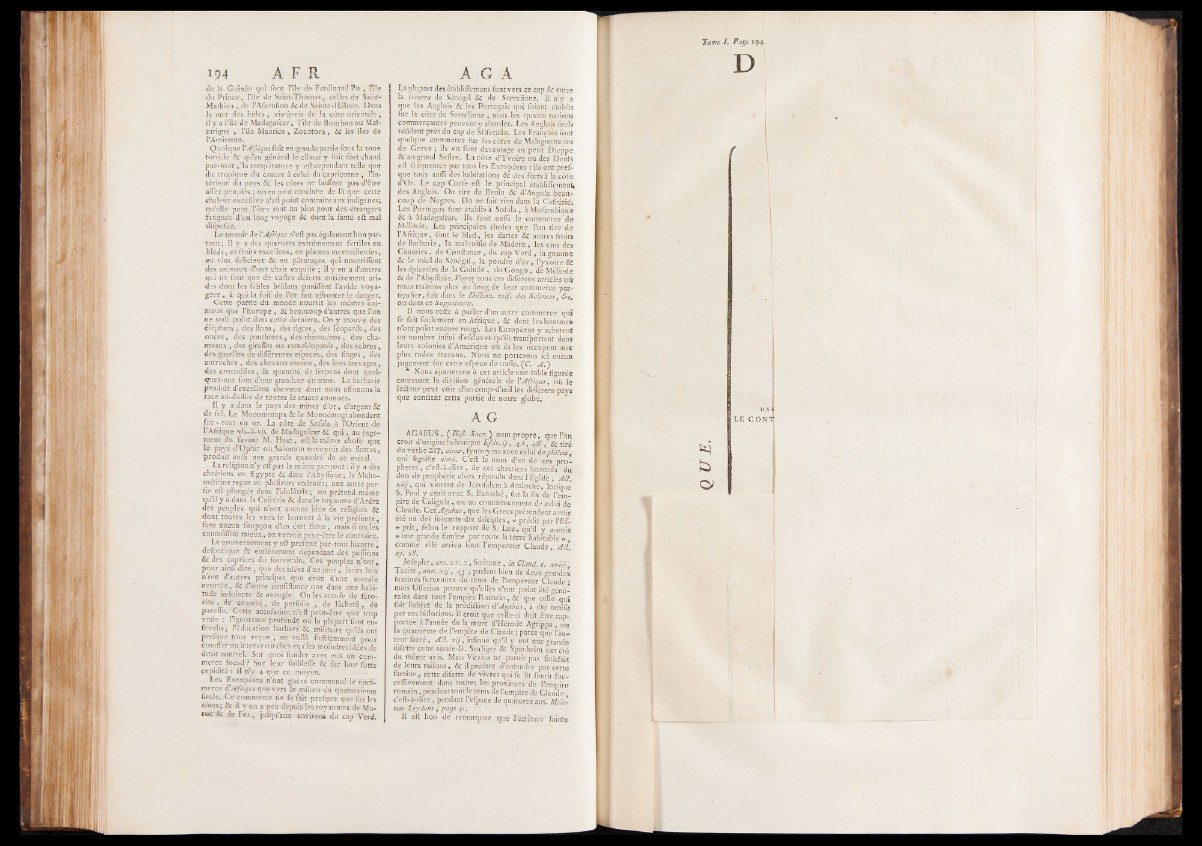
i?4 A F R
de la Guinée qui fo n t nie de Ferdinand P o , î’île
du Prince , Pile de Saint-Thomas, celles de Saint-
Mathieu , de l ’A fc e n fio n & de Sainte-Hélerie-. Dans
la mer des Indes, vis-à-vis de la côte orientale,
il y a l’île de Madagafcar, Tîle de Bourbon ou M a lcari
gn e , Pîle Maurice, Zocotora, & les îles de
l’A mirante.
Quoique P Afrique foit en grande partie fous la z o n e
torride & q u ’ en général le climat y foit fort chaud
par-tout /la température y eft cependant telle que
du tropique du cancer à celui ducapricorne , l’intérieur
du pays & les côtes ne laiflënt pas d’être
affez peuplés ; on en peut conclure de là que cette
chaleur e x c e ffiv e - n’eft point contraire aux indigènes;
qu’elle peut l’être tout au plus pour des étrangers
fatigués d’un long voyage & dont la fanté eft mal
difpofée, '
Le terroir de P Afrique n’eft pas également bon partou
t; il y a des quartiérs extrêmement fertiles en
bleds, en fru its-e x e e llen s ., en plantes merveilleufes,
en vins délicieux & en pâturages qui n o u r r iffe n t
des animaux d’une chair exquife ; il y en a d’autres
qui ne font que de vaftes déferts entièrement arides
dont les fables b rû la ns punirent l’avide voyageur
, à qui la foif de l’or fait affronter le danger.
Cette partie du monde •nourrit les mêmes animaux
que l’Europe, & beaucoup d’autres que l’on
ne voit point dans cette derniere. On y trouve des
•éléphans , des lions, des tigres, des léopards., des
onces, des panthères, des rhinocéros, des chameaux
, des giraffes ou cameléopards, des zébrés,
des gazelles de différentes efpeces, des finges , des
autruches , des chevaux marins, des ânes fauvages,
des crocodiles, & quantité, de .l'erpens dont quelques
uns font d’une grandeur énorme. La barbarie
produit d’excellens chevaux dont nous eftimons.la
race au-deffus de toutes le sraces connues.
Il y a dans le pays des mines d’o r , d’argent &
de fel. Le Monomotapa & le Monoémugi abondent
fu r - tout en or. La côte de Sofala à l’Orient de
l’Afrique vis-à-vis de Madagafcar & q u i, au jugement
du favant M. Huet, eft la même chofe que
le pays d’Ophir où Salomon envoyoit des flottes,
produit auflï une grande quantité de ce métal.
La religion n’y eft pas la même par-tout : il y a des
chrétiens en Egypte & dans'l’Àbyflïnie; le Maho-
métifme régné en plufieurs1 endroits ; une autre partie
eft plongée dans l’idolâtrie; on prétend même
qii’il y a dans la Cafrérie & dans le royaume d’Ard.ra
des peuples qui n’ont aucune’ idée de religion &
dont toutes les vues fe bornent à la vie préfenté,
fans aucun foûpçon d’un état futur ; mais fi on.lés
cqrinoiffoit mieux, on ver.roit peut-être le contraire.
Le gouvernement y eft p r e fq u e p a r - to u t b iz a r r e
defpotiquë & entièrement dépendant des paffions
& des caprices du fouverain. Ces p e u p le s n f o n t ,
pour ainfi dire , que des idées d’un jour , leurs loix
n’ont d’autres principes que ceux d’une . m o r a le
avortée., & d’autre confiftance que dans une h ab itu
d e in d o len te & aveugle. On les accufè de fé r o -
cite , de' cruauté, de perfidie. , de lâcheté, dé
pareffe. 'Cette accufation n’eft peut-être q u e ' trop
vraie : l’ignorance profonde où la plupart font en-
fevehs, l’éducation barbare & . militaire qu’ils ont
prefque tous reçue , èn; Vôilà ’ fuffifamment p o u r
étouffer d q in t e r v e r t i 'r c h e z e'qxTes m o in d re s id é e s xle
droit n a tu r e l. Sur quoi fonder avec eux un commerce
focial ? Sur leur fqibleffe & fu r leur fotte
cupidité : il n’y -a que c e . moyen.
Les Européens n’ont giièré -commencé le commerce
$ Afrique, que vers le milieu' du quatorzième
fiecle. Ce commerce ne fe fait prefque que furies
côtes; & il y en a peu depuis lès royaumes de Maroc
& de F e z , • jufqu’aux environs du càp Verd;
A G A
La plupart des établiffemens font vers ce cap & entre
la riviere de Sénégal & de Serrelione. Il n’y a
que les Anglois & les Portugais qui foient établis
fur la côte de Serrelione, mais les quatre nations
commerçantes pèuvent y aborder. Les Anglois feuls
refident près du cap de Miferado. Les François font
quelque commerce fur les côtes de Malaguette ou
de Greve ; ils en font davantage au petit Dieppe
& au grand Seftre. La côte d’Yvoire ou des Dents
eft fréquentée par tous les Européens : ils ont prefque
tous auflï des habitations & des forts à la côte
d’Or. Le cap Corfe eft le principal établiffemenfc
des Anglois. On tire de Bénin & d’Angola beaucoup
de Negres. On ne fait rien dans la Cafrérie.
Les Portugais font établis à Sofala , à Mofambique
& à Madagafcar. Ils font aufîi le commerce de
Mélinde. Les principales chofes que l’on tire de
l’Afrique, font le bled, les dattes & autres fruits
de Barbarie, la malvoifie de Madere ,1 les vins des
Canaries, de Confiance , du cap Verd , la gomme
& le miel du Sénégal, la poudre d’o r , l’yvoire &
les épiceries de la Guinée , du Gongo, 'de Mélinde
& d e l’Abyflinie. Voye^ tous ces différens articles où
nous traitons plus au long de leur commerce particulier,
foit dans le Diction, raif. des Sciences, &e.
ou dans ce Supplément.
Il nous, refte à parler d’un autre commerce qui
fé fait feulement en Afrique , & dont les hommes
n’oht point encore rougi. Les Européens y achètent
un nombre infini d’efclaves qu’ils transportent dans
leurs colonies d’Amérique où ils les occupent aux
' plus rudes travaux. Nous ne porterons ici aucun
jugement fur cette efpece de trafic. (G. A.')
* Nous ajouterons à cet article une table figurée
contenant la divifion générale de Y Afrique, où le
lecteur peut voir d’un coup-d’oeil les différens pays
que contient cette partie de notre globe.
A G
AGÀB'US , ( & if. Sacr. ) nom propre, que l’on
croit d’origine hébraïque Efdr. i j , 4 5 | a<3 & tiré
du verbe ÜJV, aimer, fynonyme avec celui dephilete ,
qui fignifie aimé. C’eft le nom d’un de ces prophètes
, c’eft-à-dire , de ces chrétiens honorés du
don de prophétie alors' répandu danM’Eglife , Act.
x i i j, qui vinrent de Jérufalem à Antioche, lorfque
S. Paul y étoit avec S. Barnabe, fur la fin de l’empire
de Caligula, ou au commencement de celui de
Claude. C etAgabus, que les Grecs prétendent avoir
été tin des fpixante-dix difciples, « prédit par l’Ef-
» prit, félon le rapport de S. Lu c, qu’il y auroit
» une grande famine par toute la terre habitable »
comme elle arriva fous l’empereur Claude, Act
x f .z8 .
Jofephe, ont. x x . 2., Suétone , in Claitd. c. xv iij;
Tacite , ann. x i j , 43 , parlent bien de deux grandes
famines furvenues du tems de l’empereur Claude *
mais Ufferius prouve qu’elles n’ont point.été générales
dans tout l’emçire Romain, & que celle qui
fait l’objet de la prédiftion à’Agabus, a été omife
par ces hiftoriens. Il croit que celle-ci doit être rapportée,
.à l’année de la'mort d’Hérode Agrippa, ou
la quatrième de l’empire de Claude ; parce que l’auteur
facré, Act. x ij , infinue qu’il y eut une grande
difette cette année-là.' Scaliger & Spanheim ont été
du même avis. Mais Vitzius ne paroît pas fatisfait
de leurs raifons, & il préféré d’entendre par cette
famine , cette difette de vivres qui fe fit fentir fiic-
ceflïvement dans toutes les provinces dé l’empire
romain, pendant toutle tems de l’empire de Claude
c’eft-à-dire , pendant l’efpace de quatorze ans. Mele-
tem Leydens , page 4/,
Il eft bon de remarquer que l’écriture fainta