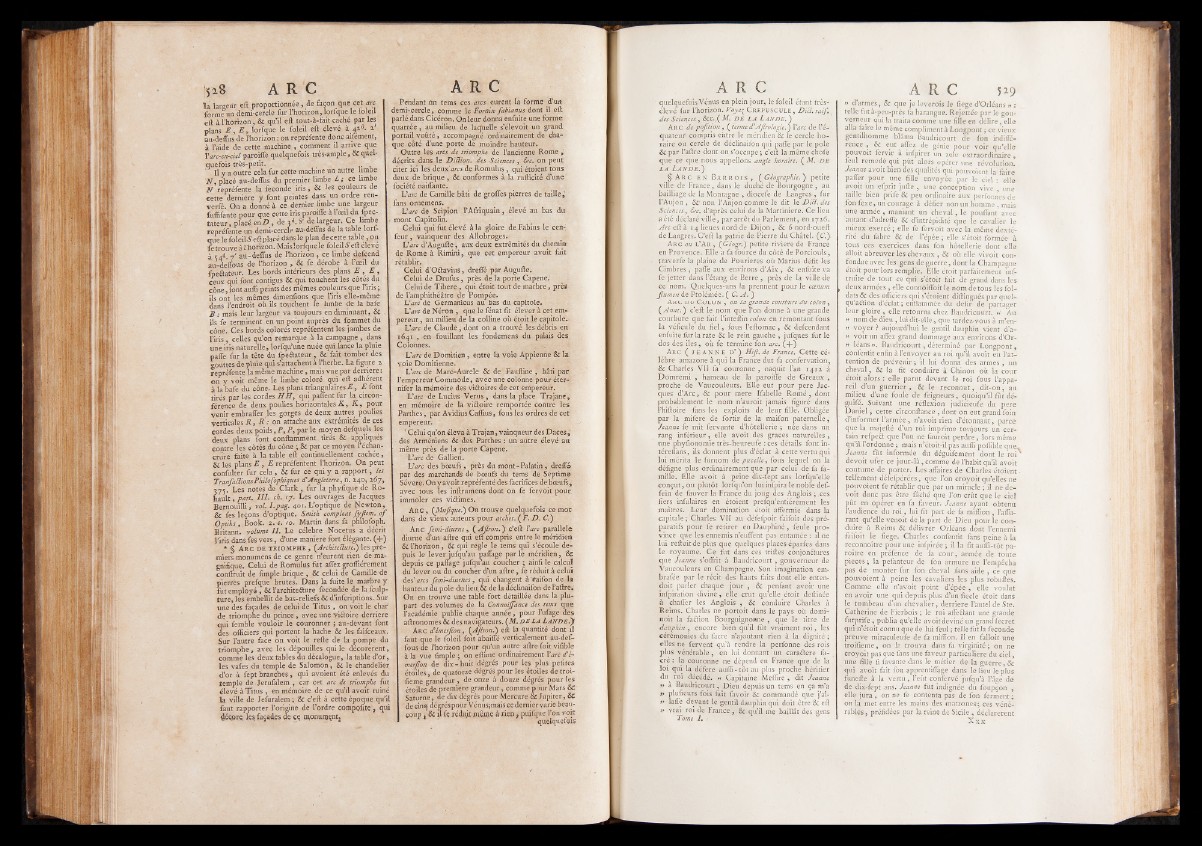
la largeur eft proportionnée , de façon que cet arc
forme un demi-cercle fur l’horizon, lorfque le foleil
eft à l’horizon, & qu’il eft tôut-à-fait cache par les
plans E , E y lorfque le foleil eft élevé à 41*. z
au-deffus de l’horizon : on repréfente donc aifément, à l’aide de cette machine , comment il arrive que
Varc-en-ciel paroiffe quelquefois très-ample, & quelquefois
très-petit.
Il y a Outre cela fur cette machine un autre limbe
N . placé au-deffus du premier limbe L ; ce limbe
N repréfente la fécondé iris, & les couleurs de
cette derniere y font peintes dans un ordre ren-
verfé. On a donné à ce dernier limbe une largeur
fuffifante pour que cette iris paroiffe à 1 oeil du lpec-
tateur, placé enZ>, de 3d. V de largeur. Ce limbe
repréfente un demi-cercle au-deffus de la table lorl-
que le foleil S eft placé dans le plan de cette table, ou
fe trouve à l'horizon. Mais lorfque le foleil S eft eleve
à 54d. 7' au-deffus de l’horizon , ce limbe defcend
au-deffous de l’horizon , & fe dérobe à l’oeil du
fpeâateur. Les bords intérieurs des plans E , E ,
ceux qui font contigus & qui touchent les côtés du
cône, font aufli peints des mêmes couleurs que l’iris ;
ils ont les mêmes dimenfions que l’iris elle-même
dans l’endroit oh ils touchent le limbe de la bafe
B : mais leur largeur va toujours en diminuant, & .
ils fe terminent en un point auprès du fommet du
cône. Ces bords colorés repréfentent les jambes de
l’iris, celles qu’on remarque à la campagne , dans
une iris naturelle, lorfqu’une nuée qui lance la pluie
paffe fur la tête du fpe&ateur, & fait tomber des
gouttes de pluie qui s’attachent à l’herbe. La figure 2
repréfente la même machine, mais vue par derrière:
on y voit même le limbe coloré qui eft adhérent
à la bafe du cône. Les plans triangulaires E , E font
tirés par les cordes H H , qui paffent fur la circonférence
de deux poulies horizontales K , K , pour
venir embraffer (les gorges de deux autres^ poulies
verticales R , R : on attache aux extrémités de ces
cordes deux poids, P , P, par le moyen defquels les
deux plans font conftamment tirés & appliqués
contre les côtés du cône ; & par ce moyen l’échancrure
faite à la table eft continuellement cachée,
& les plans E , E repréfentent l’horizon. On peut
confulter fur cela , & fur ce qui y a rapport, les
' TranfactionsPhilofopkiques d’Angleterre, n. 240, 267,
375. Les notes de C la rk , fur la phyfique de Ro-
hault, part. I II. ch. i j . Les ouvrages de Jacques
Bernouilli, vol. l.pag. 401. L’optique de Newton,
& fes leçons d’optique. Smith compleat fyfiem. o f
.Optiks ,B o o k . 2. c. 10. Martin dans fa philofoph.
Britann. volume II. Le célébré Nocetus a décrit
l ’iris dans,fes v ers, d’une maniéré fort élégante. (+ )
* § Arc d e TRIOMPHE , (Architecture.) les premiers
monumens de ce genre n’eurent rien de magnifique.
Celui de Romulus fut affez grofliérement
Pendant tin tems ces arcs eurent la forme d’un
demi-cercle, comme le Fornix fabianus dont il eft
parlé dans Cicéron. On leur donna enfuite une forme
quartée, au milieu de laquelle s’élevoit un grand
portail voûté, accompagné ordinairement de cha-,
que Coté d’une porte de moindre hauteur.
conftruit de fimple brique , & celui de Camille-de
pierrés prefque brutes. Dans la fuite le marbre y
fut employé, & l’architefture fécondée de la fculp-
ture, les embellit de bas-reliefs & d’infcriptions. Sur
une des façades de celui de Titus , on voit le char
de triomphe du prince , avec une vi&oire derrière
qui femble vouloir le couronner ; au-devant font
des officiers qui portént la hache & les faifceaux.
Sur l’autre face on voit le refte de la pompe du
triomphe, avec les dépouilles qui le décorèrent,
comme les deux tables du décalogue, la table d’o r,
les vafes du temple de Salomon, & le chandelier
d’or à fept branches, qui avoient été enlevés du
temple de Jerufalem , car cet arc de triomphe fut
élevé à Titus , en mémoire de ce qu’il avoit ruiné
la ville de Jefuralem ; & c’eft à cette époque qu’il
faut rapporter l’origine de l’ordre comporte , qui
gécprç les façades de ce monunjent.
Outre les arcs de triomphe de l’ancienne Rome
décrits ,dans le Diction, des Sciences, &c. on peut
citer ici les deux<zrc5 de Romulus, qui étoient tous
deux de brique , & conformes à la rufticité d’une
fociété naiffante.
Uarc de Camille bâti de groffes pierres de taille ^
fans ornemens.
L’arc de Scipion l’Afriquain, élevé au bas du
. mont Capitolin.
Celui qui fut élevé à la gloire de Fabius le cen-
feur , vainqueur des Allobroges.
L’arc d’Augufte, aux deux extrémités du chemin
de Rome à Rimini, que cet empereur avoit fait
rétablir.
Celui d’Oûavius, dreffé par Augufte.
Celui de Drufus, près de la porte Capêne.-
Celui-de Tibere , qui étoit tout de marbre, près
de l’amphithéâtre de Pompée.
L’arc de Germanicus au bas du capitole.
U arc de Néron , que le fénat fit élever à cet empereur
, au milieu de la colline oh étoit le capitole.
L’arc de Claudé, dont on a trouvé les débris en
1641 , en fouillant les fondemens du palais des
Colonnes. , ~ ..
L V c de Domitien, entre la voie Appienne & la
voie Domitienne.
L’arc de Marc-Aurele & de Fauftine , bâti par
l’empereur Commode, avec une colonne pour éter—
nifer la mémoire des viétoires de cet empereur.
L’arc de Lucius Verus, dans la place Trajane,
en mémoire de la vittoire remportée contre les
Parthes, par Avidius Caflius, fous les ordres de cet
empereur.
1 Celui qu’on éleva à Trajan, vainqueur des Dàces^
- des Arméniens & des Parthes : un autre élevé au
même près de la porte Capene.
L’arc de Gallien.
L’arc des boeufs, près du mont-Palatin, dreffa
par des marchands de boeufs du tems de Septimfe
Sévere. On y avoit repréfenté des facrifices de boeufs,'
avec tous les inftrumens dont on fe fervoit pour;
- immoler ces vi élimés.
Arc , (Mu/ïque.') On trouve quelquefois ce mot
dans de vieux auteurs pour archet. ( F-. D . C.)
A rc femi-diurne, ( Afiron. ) c’eft l’arc parallèle
diurne d’un aftre qui eft compris entre le méridien
& l’horizon, 8t qui réglé le tems qui s’écoule depuis
le lever jufqu’au paffage par le méridien, 8c
depuis ce paffage jufqu’au coucher ; ainfi le calcul
du lever ou du coucher d’un aftre, fe réduit à celui
des" arcs femi-diurnes, qui changent à Taifon de la
hauteur du pôle du lieuv8c de la déclinaifon de l’aftre.’
Pn en trouve une table fort détaillée dans la plupart
des volumes de la Connoijfance des. tems que
l’académie publie chaque année, pour l’ufage des
aftronomes & des navigateurs. (M. d e la La n d e .y
Arc démerjion, ( AJlron.) eft la quantité dont il
faut que le foleil foit abaiffé verticalement au-deffous
de l’horizon pour qu’un autre aftre foit vifible
à la vue fimple ; on eftime ordinairement Y arc d’é-
merfion de dix-huit degrés pour les plus petites
étoiles, de quatorze dégrés pour les étoiles de troi-
fieme grandeur , de onze à douze dégrés pour les
étoiles de première grandeur , comme pour Mars 8c
Saturne, de dix dégrés pour Mercure & Jupiter, 8c
de cinq dégrés pour Vénus;mais ce dernier varie beaucoup
. 8c il (ç réduit même à rien f puifque l’on voit
quelquefois
quelquefois,Vénus en plein jour, le foleil étant très-
élevé fur l’horizon. Voye^ CR EPUSCU LE, Dicl. raif. (
des Sciences, & c . , ( M . DE L A L a n d e . )
A r c de pofition, ( terme d’Aßrologie. ) Y arc de l’équateur
compris entre le méridien & le cercle horaire
ou cercle de déclinaifon qui paffe par le pôle
& par l’aftre dont on s’occupe ; c’eft la même chofe
que ce que nous appelions angle horaire; ( M ..d e
l a L a n d e .')
§ A r c e n B a r r o i s , ( Géographie. ) petite
ville de France, dans le duché de Bourgogne, au
bailliage de la Montagne , diocefe de Langres , fur
l’Aujon , & non l’Anjon comme le dit le Dicl. des
Sciences, &c. d’après celui de la Martiniere. Ce lieu
a été déclaré ville, par arrêt du Parlement, en 1726.
Arc eft à 14 lieues nord de Dijon , & 6 nord-oueft
de Langres. C’eft la patrie de Pierre du Châtel. (C.),
A r c ou l ’A r , (Géogr.) petite riviere de France
en Provence. Elle a faïburce du côté de Porciouls,
traverfe la plaine de Pourieres oh Marius défit les
Cimbres , paffe aux environs d’A ix , & enfuite va
fe jetter dans l’étang de Berre , près de la ville de
ce nom. Quelques-uns la prennent pour le coenum
flumen de Ptolémée. ( C. A . )
A r c DU CO LO N , ou la grande courbure'du colon ,
( Ahat. ) c’eft le nom que l’on donne à une grande
courbure que fait l’inteftin colon ,en remontant fous
la véficule du fiel, fous l’eftomac, & defcendant
enfuite fur laraje & le rein gauche , jufques fur le
dos des iles, oh fe termine fon arc. (+ )
A r c ( J e a n n e d’ ) Hiß. de France. Cette célébré
amazone à qui la France dut fa confervation,
& Charles VII fa couronne , naquit l’an 1412 à
Domremi , hameau de la paroiffe de Greaux ,
proche de Vaucouleurs. Elle eut pour pere Jacques
d’Arc, 8c pour mere Ifabelle Rome, dont
probablement le nom n’auroit jamais figuré dans
l’hiftoire fans les exploits de leur fille. Obligée
par la mifere de fortir de la maifon paternelle,
Jeanne fe mit fervante d’hôtellerie ; née dans un
rang inférieur, elle avoit des grâces naturelles,
une phyfionomie très-heureufe : ces détails font in-
téreffans, ils donnent plus d’éclat à cette vertu qui
lui mérita le fùrnom de pucelle, fous lequel on la
défigne plus ordinairement que par celui de fa famille.
Elle avoit à peine aix-fept ans lorfqu’elle
conçut, ou plutôt lorfqu’on lux infpira le noble def-
fein de fauver la France du joug des Anglois ; ,ces
fiers infulaires en étoient prefqu’entiérement les
maîtres. Leur domination étoit affermie dans la
capitale; Charles VII au défefpoir faifoit des préparatifs
pour fe retirer en Dauphiné, feule province
que les ennemis n’euffent pas entamée : il ne
lui reftoit de plus que quelques places éparfes dans
le royaume. Ce fut dans ces triftes conjonôures
que Jeanne s’offrit à Baudricourt, gouverneur de
Vaucouleurs en Champagne. Son imagination em-
brafée par le récit des hauts faits dont elle enten-
doit parler chaque jour , & penfant avoir une
infpiration divine, elle crut qu’elle étoit deftinée
à chaffer les Anglois , & conduire Charles à
Reims..Charles ne portoit dans le pays oh domi-
noit la faftion Bourguignonne , que le titre de
dauphin , encore bien qu’il fut vraiment ro i, les
cérémonies du facre n’ajoutant rien à la dignité ;
elles ne fervent qu’à rendre la perfonne des rois
plus vénérable, en lui donnant Un earaôere facre
: la couronne ne dépend en France que de la
loi qui la déféré aufli - tôt au plus proche héritier
du roi décédée « Capitaine Mefîire , dit Jeanne
» à Baudricourt, Dieu depuis un tems en ça m’a
» plufieurs fois fait favoir & commandé que j’al-
» lafle devant le gentil dauphin qui doit être & eft
,» vrai roi de France, 6c qu’il me baillât des gens
Tome I. .<
» d’armes, & que je leverois le fiege d’Orléans » :
telle fut à-peu-près fa harangue. Rejettée par le gouverneur
qui la traita comme une fille en délire, elle
alla faire le' même compliment à Longpont ; ce vieux
gentilhomme blâma Baudricourt de fon indifférence.,
& eut affez de génie pour voir qu’elle
pouvoit fervir à inlpirer un zele extraordinaire,
fëul remedê qui pût alors opérer une révolution.
Jeanne avoit bien des qualités qui pouvoient la faire
paffer pour une fille envoyée par le ciel : elle
avoit un efprit jufte , une conception vive , une
taille bien prife & peu ordinaire aux perfonnes de
fon fçxe, un courage à défier non un homme , mais
une armée , maniant un cheval, le pouffant avec
autant d’adreffe & d’intrépidité que le cavalier le
mieux exercé ; elle fie fervoit avec la même dextérité
du fabre & de l’épée ; elle s’étoit formée à
tous ces exercices dans fon hôtellerie dont elle
alloit abreuver les chevaux , & oh elle vivoit confondue
avec les gens de guerre, dont la Champagne
etoit pour lors remplie. Elle étoit parfaitement inf-
truite de tout ce qui s’étoit fait de grand dans les
deu x armees , elle connpiffoit le nom de tous les fol-
dats & des officiers qui s’étoient diftingués par quel-
qu’a&ion d’eclat ; enflammée du defir de partager
leur gloire , elle retourna chez Baudricourt. « Au
» nom de dieu, lui dit-elle, que tardez-vous à m’en-
» voyer ? aujourd?hui le gentil dauphin vient d’a-
» voir un affez grand dommage aux environs d’Or-
» léans ». Baudricourt, déterminé par Longpont,
confentit enfin à l’envoyer au roi qu’il avoit eu l’attention
de prévenir ; il lui donna des armes , un
cheval, & la fit conduire à Chinon oh la cour
étoit alors : elle parut devant le roi fous l’appareil
d’un guerrier , & le reconnut, dit-on, au
milieu d’une foule de feigneurs, quoiqu’il fût dé-
guifé. Suivant une réflexion judicieufe du pere
Daniel, cette circonftânce , dont on eut grand foin
d’informer l’armée, n’avoit rien d’étonnant, parce
que la majefté d’un roi imprime toujours un certain
refpeft que l’on ne fauroit perdre, lors même
qu’il l’ordonne ; mais n’étoit-il pas aufli poflible que.
Jeanne fut informée du déguifement dont le rox
devoit ufer ce jour-là, comme de l’habit qu’il avoit
coutume de porter. Les affaires de Charles étoient.
tellement défefpérées, que l’on croyoit qu’elles ne
pouvoient fe rétablir que par un miracle ; il ne devoit
donc pas être fâché que l’on crut que le ciel
put en opérer en fa faveur. Jeanne ayant obtenu
l’audience, du ro i, lui fit part de fa miflion , l’affu-
r'ant qu’elle venoit de la part de Dieu pour le conduire
à Reims & délivrer Orléans dont l’ennemi
faifoit le fiege. Charles confentit fans peine à la
reconnoître pour une infpir.ée ; il la fit auffi-tôt pa-
roxtre en préfence de fa cour, armée de toute
pièces ; la pefanteur de fon armure ne l’empêcha
pas de monter fur fon cheval fans aide , ce que
pouvoient à peine les cavaliers les plus robuftes.
Comme elle n’avoit point d’épée , elle voiilut
en avoir une qui depuis plus d’un fiecle étoit dans
le tombeau d’un chevalier, derrière l’autel de Ste.
Catherine de Fierbois ; le roi affeétant une grande
furprife , publia qu’elle avoit deviné un grand fecret
qui n’étoit connu que de lui feul ; telle fut la fécondé
preuve miraculeufe de fa miflion.. Il en falloit une
troifieme, on la trouva dans fa virginité; on né
eroyôit pas que fans une faveur particulière du ciel,
une fille fi fa vante dans le métier de la guerre, &
qui avoit fait fon apprentiffage dans le lieu le plus
funeffe à la vertu, l’eût confervé jufqu’à l’âge de
de dix-fept ans: Jeanne fut indignée du foupçon ,
elle jura, on ne fe contenta pas de fon ferment :
on la met entre les mains des matrones; ces vénérables,
préfidées par la reine de Sicile , déclarèrent
X x x