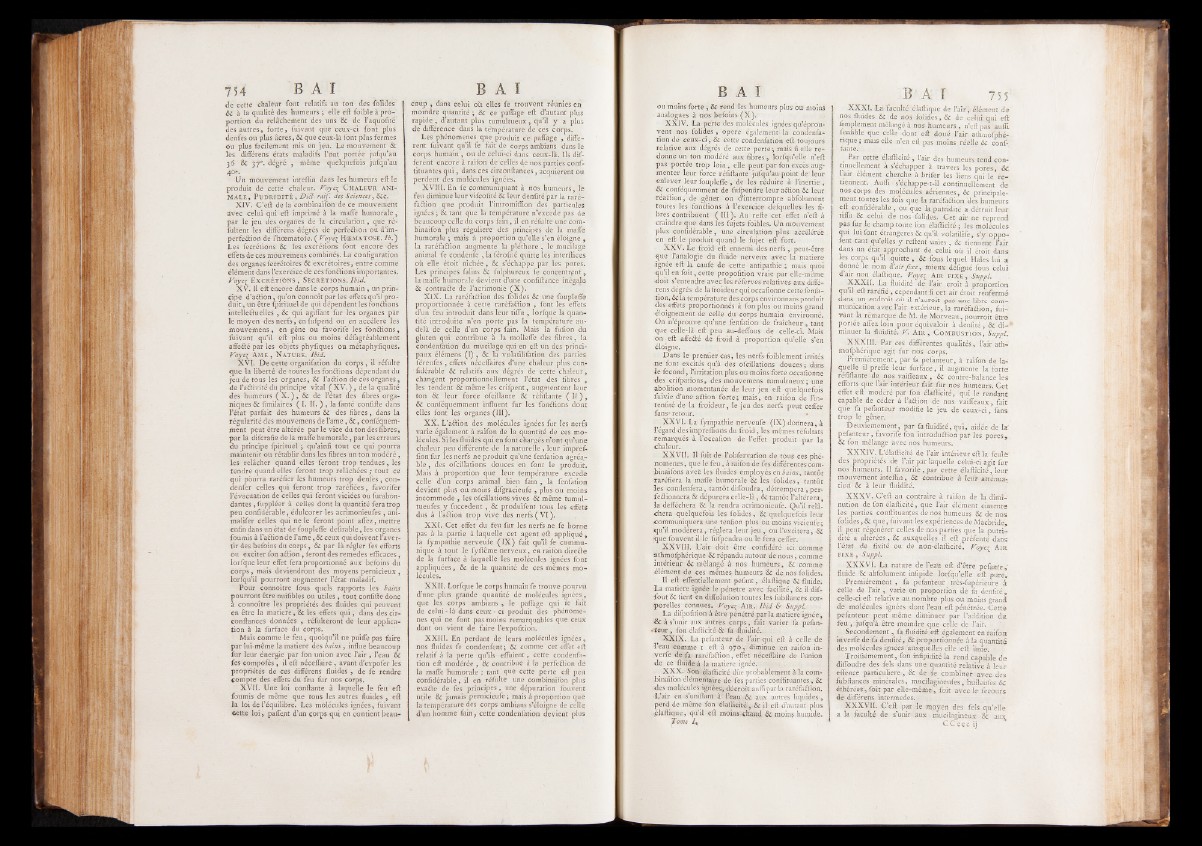
754 BAI
de cetté chaleur font relatifs au ton des folîdès
& à la qualité des humeurs ; elle eft foible à proportion
du relâchement des uns & de l’aquofité
des autres, forte, fuivant que ceux-ci font plus
denfes ou plus âcres, & que ceux-là font plus fermes
Ou plus facilement mis en jeu. Le mouvement &
les différens états maladifs l’ont portée jûfqu’au
36 & 37e. dégré , même quelquefois jufqu’au
40 c
Un m o u v em e n t in te ftin dans le s h um eu r s e ft le
p ro d u it d e c e t te ch a leu r . Foye%_ C h a l e u r a n i m
a l e , PuDRÏDITÉ , D i ci- raif. des Sciences, &C.
XIV. C’eft de la combinaifon de ce mouvement
avec celui qui eft-imprimé à la maffe humorale,
par le jeu des organes de la circulation, que ré-
fultent les différens degrés de perfection ou d’itn-
perféétion de I’hoemâtole. ( Foyè^ Hoe m a t o s e . Ib.')
Les fecrétions & les excrétions font encore des
effets de ces moüvemens combinés. La configuration
des organes fecrétoires & excrétoires, entre comme
élément dans l’exercice de ces fondions importantes.
Voyei E x c r é t i o n s , S é c r é t i o n s . Ibid.
XV. Il eft encore dans le corps humain , un principe
d’action, qu’on Connoît par les effets qu’il produit,
un être fpirituel de qui dépendent les fondions
intelleduelles , & qui agiffant fur les organes par
le moyen des nerfs, en fufpend ou en accéléré les
moüvemens, en gêne ou favorife les fondions,
fuivant qu’il eft plus ou moins défagréablement
affedé par les objets phyfiques ou métaphyfiques.
Voye^ A m e , N a t u r e . Ibid.
XVI. De cette organifation du corps, il réfulte
que la liberté de toutes les fondions dépendant du
jeu de tous les organes, & l’adion de ces organes,
de l’adivité du principe vital (X V . ) , de la qualité
des humeurs ( X . ) , & de l’état des fibres organiques
& fimilaires ( I. II. ) , la fanté confifte dans
l’état parfait des humeurs & des fibres, dans la
régularité des moüvemens de l’ame, & , conféquem-
riient peut être altérée par le vice du ton des fibres,
par la difcrafie de la maffe humorale, par les erreurs
du principe fpirituel ; qu’ainfi tout ce qui pourra
maintenir ou rétablir dans les fibres un ton modéré,
les relâcher quand elles feront trop tendues, les
tendre quand elles feront trop relâchées tout ce
qui pourra raréfier les humeurs trop denfes, con-
denfer celles qui feront trop raréfiées, favorifer
l’évacuation de celles qui feront viciées ou furabon-
dantes , fuppléer à celles dont la quantité fera trop
peu confidérable, édulcorer les acrimonieufes , ani-
malifer celles qui ne le feront point affez, mettre
enfin dans un état de foupleffe defirable, les organes
fournis à l’a&ion de l’ame, & ceux qui doivent l’avertir
des befoins du corps, & par là régler fes efforts
ou exciter fon aftion, feront des remedes efficaces,
lorfque leur effet fera proportionné aux befoins du
corps, mais deviendront des moyens pernicieux ,
lorfqu’il pourront augmenter l’état maladif.
Pour connoître fous quels rapports les bains
pourront être nuifibles ou utiles , tout confifte donc
à connoître les propriétés des fluides qui peuvent
en être la matière, & les effets q ui, dans des.cir-
conftances données , réfiüteront de leur application
à la furface du corps.
Mais comme le feu, quoiqu’il ne puiffe pas faire
par lui-même la matière des bains , influe beaucoup
fur leur énergie par fon union avec l’air , l’eau &
fes compofés , il eft néceffaire , avant d’expofer les
propriétés de ces différens fluides , de fe rendre
compte des effets du feu fur nos corps.
XVII. Une loi confiante à laquelle, le feu eft
fournis de même que tous les autres fluides , eft
la loi de l’équilibre. Les molécules ignées, fuivant
cette loi, paffejit d’un corps qui en contient beau-
B A I
coup , dans celui oh elles fe trouvent réunies en
moindre quantité ; & ce paffage eft d’aütant plus
rapide, d’autant plus tumultueux, qu’il y a plus
de différence dans la température de ces corps.
Les phénomènes que produit ce-paffage , diffe-
rerit fuivant qu’il fe fait de corps ambians dans lé
corps humain , ou de celui-ci dans ceux-là. Ils different
encoré à raifon de celles de nos parties conf-
tituantes q ui, dans ces cireonftances, acquièrent ou
perdent des molécules ignées.
XVIII. En fe communiquant à nos humeurs le
feu diminue leur vifcofité & leur denfité par la raréfaction
que produit rintromiffion des particules
ignées ; &. tant que la tempétaturé n’excede pas de
beaucoup celle du corps fairi, il en réfultë' une combinaifon
plus régulière des principes de la maffe
humorale ; mais à proportion qu’elle s’en éloigne ,
la raréfaction augmente la pléthore , le mucilage
animal fe condenle , la férofité quitte les interftices
oh elle étoit nichée, & s’échappe par les pores.
Les principes falins & fulphureux fe concentrant,
la maffe humorale devient d’une confiftance inégale
& contracte de l’acrimonie (X ).
XIX. La raréfadion des folides & une foupleffe
proportionnée à cette raréfaction , font les effets
d’un feu introduit dans leur tiffu , lorfque la quantité
introduite n’en porte pas la température au-
delà de celle d’un corps, fain. Mais la fufion du
gluten qui contribué à la molleffe des fibres, la
cOndenfation du mucilage qui en eft un des principaux
élémens (I) , & la volatilifation des parties
féreufes , effets néceffaires d’une chaleur plus con-
fidérable & relatifs aux dégrés de cette chaleur,
changent proportionnellement l’état des fibres ,
les tendent & même les crifpent, augmentent leur
ton & leur force ofcillante & réfiftante ( Il ) ,
& conféquemment influent fur les fondions dont
elles font les organes (III).
X X . L’adion des molécules ignées fur les nerfs
varie également à raifon de la quantité de ces molécules.
Si les fluides qui en font chargés n’ont qu’ une
chaleur peu différente de la naturelle , leur impref-
lion'fur les nerfs ne produit qu’une fenfation agréable
, des ofcillations douces en font le produit.
Mais à proportion que leur température excede
celle d’un corps animal bien fain , la fenfation
devient plus ou moins difgracieufe , plus ou moins
incommode , les ofcillations vives & même tumul-
tueufes y fuccedent, & produifent tous les effets
dus à l’adion trop vive des nerfs (V I ) .
XXI. Cet effet du feu fur les nerfs ne fe borne
pas à la partie à laquelle cet agent eft appliqué ,
la fympathie nerveufe ( IX ) fait qu’il fe communique
à tout le fyftême nerveux, en raifon direde
de la furface à laquelle les molécules ignées font
appliquées, & de la quantité de ces mêmes molécules.
XXII. Lorfque le corps humain fe trouve pourvu
d’une plus grande quantité de molécules ignées,
que les corps ambians , le paffage qui Te fait
de celui-là dans ceu x -c i produit des phénomènes
qui ne font pas moins remarquables que ceux
dont on vient de faire l’expofxtion.
XXIII. En perdant dé leurs molécules ignées,
nos fluides fe condenfent; & comme cet effet eft
relatif à la perte qu’ils effuient, cette condenfe-
tion eft modérée , & contribue à la perfedion dé
la maffe humorale : tant que cette perte eft peu
confidérable, il en réfulte une combinaifon plus
exade de fes principes, une dépuration fouvent
utile & jamais pernicieufe ; mais à propprtion que
la température des corps ambians s’éloigne de cellç
d’un homme fain, cette condenfation devient plus
B A I
ou moins forte , & rend les humeurs plus ou moins
• analogues à nos befoins (X ) .
XXIV. La perte des molécules ignées qu’éprouvent
nos folides, Opéré également- la condenfation
de ceux-ci, & cette condenfation eft toujours
relative aux dégrés de cette perte ; mais fi elle redonne
un ton modéré aux fibres, lorfqu’elle n’eft
pas portée trop loin, elle peut par fon excès augmenter
leur force réfiftante jufqu’au point de leur
enlever leur foupleffe, de les réduire à l’inertie ,
& conféquemment de fufpendre leur adion & leur
réadion, de gêner ou d’interrompre abfolument
toutes les fondions à l’exercice defquelles* les fibres
contribuent ( III ). Au relie cet effet n’eft à
craindre que dans les fujets foibles. Un mouvement
plus confidérable, une circulation plus accélérée
en eft le produit quand le fujet eft fort.
XXV. Le froid eft ennemi des nerfs , peut-être
que l’analogie du fluide nerveux avec la matière
ignée eft la caufe de cette antipathie ; mais quoi
qu’il en foit, cette propofition vraie par elle-même
-doit s’entendre avec les réferves relatives aux différens
dégrés de la froideur quioccafionne cette fenfa-
îion, &,la température des corps environnans produit
des effets proportionnés à fon plus ou moins grand
•éloignement de celle du corps humain environné.
On n’éprouve qu’une fenfation de fraîcheur , tant
que celle-là efl peu au-deffous de celle-ci. Mais
on.eft affedé de froid à proportion qu’elle s’en
éloigne.
Dans le premier cas, les nerfs foiblement irrités
ne font excites qu’à des ofcillations douces; dans
le fécond, l’irritation plus ou moins forte occafionne
des crifpatîons, des moüvemens tumultueux; une
abolition momentanée de. leur jeu eft quelquefois
fuivie d’une adion forte; mais, en raifon de l’in-
tenfité de la froideur, le jeu des nerfs peut ceffer
fans* retour.
XXVI. La fympathie nerveufe (IX) donnera, à
l ’égard des impreflions du froid, les mêmes réfultats
remarqués à l’occafion de l’effet produit par la
chaleur.
XXVII. Il fuit de l’obfervation de tous ces phénomènes,
que le feu, à raifon de fes différentescom-
Linaifons avec les fluides employés en bains, tantôt
raréfiera la maffe humorale & les folides, tantôt
les condenfera, tantôt diffoudra, détrempera, per-
fedionnera & dépurera celle-là, & tantôt l’altérera,
la dôfféchera & la rendra acrimonieufe. Qu’il relâchera
quelquefois les folides, & quelquefois leur
communiquera une tenfion plus ou moins vicieufe ;
qu’il modérera, réglera leur jeu , ou l’excitera, &
que fouvent il le fufpendra ou le fera ceflèr.
XXVIII. L’air doit être confidéré ici comme
athmofphérique & répandu autour de nous, comme
intérieur & mélangé à nos humeurs, & comme
élément de ces memes humeurs & de nos folides.
Il eft effentiellement pefant, élaftique & fluide.
La matière ignée le pénétré avec facilité, & il dif-
jfout & tient en diffolution toutes les fubftances corporelles
connues. Foye^ Air. Ibid & Suppl.
La difpofifion à être pénétré parla matière ignée,
& à s’unir aux autres corps, fait varier fa pefam
•teur, fon élafticité & fa -fluidité.- :
XXIX. La pefanteur de l’air qui eft à celle de
l ’eau comme 1 eft à 970.;. diminue en raifon’in-
.verfe de fa raréfadion, effet néceffaire de l’union
■ de ce fluide à la matière ignée.
v X XX. Son élafticité due probablement à la combinaifon
élémentaire de fes parties conftituames, &
des molécules ignées, décroît aufftpar la raréfadion.
L’air en s’unifiant à l’eau & aux autres liquides-,
perd de même fon élafticité-, & il eft d’autant plus
élaftique, qu’il eft moins-chaud & TOoin? humide.
Tome /,
B A I 755
XXXI. Là faculté elaftique de l’air, élément de
nos,fluides & de nos folides, & de celui qui eft
Amplement mélangé à nos humeurs , n’eft pas aufli
fenfible que celle dont efl doué l’air athmofphérique
; mais elle n’en eft pas moins réelle & confiante;
.
. ^ar Gette élafticité , l’air des humeurs tend continuellement
à s’échapper à travers les pores, &
l’air élément cherche à brifer les tiens qui le retiennent.
Aufli s?échappe-t-il continuellement de
nos corps des molécules aériennes, & principalement
toutes les fois que la raréfadion des humeurs
eft confidérable , ou que la putridité a détruit leur
tiffu & celui de nos folides; Cet air ne reprend
pas fur le champ toute fon élafticité ; les molécules
qui lui font étrangères & qu’il volàtilife, s’y oppo-
fent tant qu’elles y relient unies, & tiennent l’air
dans un état approchant, de celui où il étoit dans
les corps qu’il quitte, & fous lequel Haies lui a
donné le nom d’air f ix e , mieux défigné fous Celui
d’air non élaftique. Foye^ Air fixe , Suppl.
XXXII. La^ fluidité de l’air croît à proportion
qu il efl raréfié , cependant fi cet air étoit renfermé
dans un endroit où il n’auroit pas une libre communication
avec..l’air extérieur, la raréfadion, fuivant
la remarque de M. de Morveau, pourroit être
portée affez loin pour équivaloir à denfité, & di-*
minuer la fluidité. F. Air , C ombustion, Suppl.
XXXIII. Par ces différentes qualités, l’air athmofphérique
agit fur nos corps.
Premièrement, par fa pefanteur, à raifon de laquelle
il preffe leur furface, il augmente la forte
réfiftante de nos vaiffeaux , & contre-balance les
efforts que l’air inférieur fait fur nos humeurs. Cet
effet eft modéré par fon élafticité, qui le rendant
capable de céder à l’aftion de nos vaiffeaux, fait
que fa pefanteur modifie le jeu de ceux-ci, fans
trop le gêner.
Deuxièmement, par fa fluidité, qui, aidée de la’
pefanteur, favorife fon introduction par les pores,
& fon mélange avec nos humeurs.
XXXIV. L’élafticité de l’air intérieur eft la feulé:
des propriétés de l’air par laquelle celui-ci agit fur
nos humeurs. Il favorife, par cette élafticité, leur
mouvement inteftin, & contribue à leur atténuation
& à leur fluidité. '
XXXV. C’eft au contraire à raifon de la diminution
de fon élafticité, que l’air élément cimente
les parties conftituantes de nos humeurs & de nos
folides, & que, fuivant les expériences de Màcbride
il peut régénérer celles de nos parties que la putridité
a altérées, & auxquelles il eft préfehté dans
l’état de fixité ou de non-élafticité. Foye^ Air
fixe , Suppl»
XXXVI. La nature de l’eaü eft d’être pefantè-,
fluide & abfolument infipide lorfqu’elle eft pure.
Premièrement , la pefanteur rrès-fupérieu're à
celle de l’air , varie en proportion de fe denfité,
celle-ci eft relative au nombre plus ou moins grand
de molécules ignées dont l’eau eft pénétrée. Cetté
pefanteur peut même diminuer par l’addition d»
fe u , jufqu’à être moindre que celle de l’air.
Secondement, fa fluidité eft également en raifon
inverfede fe denfité, & proportionnée à la quantité
des molécules ignées auxquelles elle eft iinie.
Troifiémement, fon infipiditéla rend capable de
difibudre des fels dans une quantité relative à leur
effence particulière , & de fe combiner avec des
fubftances minérales, mucrlagineufes, huileufes &
éthérées, foit par elle-même , foit avec le fecours
de différens intermèdes, v
XXXVII. C’eft par le moyen des fels qu’elle
a la faculté de s’unir aux mucilagineux & au%
C C c c c ij