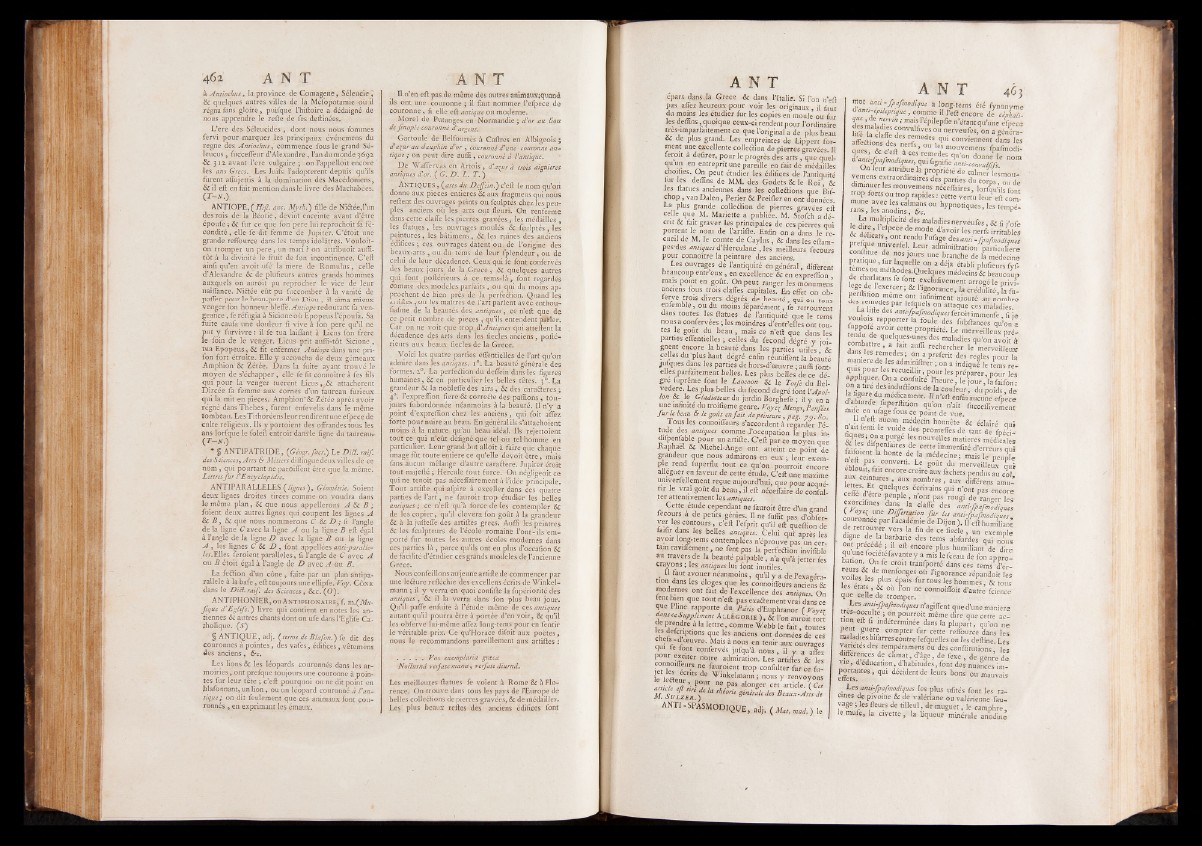
à Antiochus, la province de Comagene, Séleucie^
.& quelques autres villes de la Méfopotamie où il
régna fans gloire, puifque l’hiftoire a dédaigné de
nous apprendre le refte de fes deftinées.
L’ere des Séleucides dont nous nous fommes
fervi pour marquer les principaux événemèns du
régné des Antiochus i commence fous le grand Sé-
leucus j fuccefleur d’Alexandre, l’an du monde 3692
-& 312 avant l’ere vulgaire ; on Fappelloit encore
les ans Grecs. Les Juifs l’adopterent depuis qu’ils
furent aflùjettis à la domination de's Macédoniens,
& il eft en fait mention dans le livre des Machabées.
ANTIOPE, anc. Myth.) fille de Ni&ée,l\m
des rois de la Béotie, devint enceinte avant d’être
époufe ; & fur ce que fon pere lui reprochoit fà fécondité
, elle fe dit femme de Jupiter. C ’étoit une
grande reffource dans les temps idolâtres. Voulôit-
on tromper un pere, un mari ? on attribuoit auflï-
tôt à la divinité le fruit de fon incontinence. C ’eft
ainfi qu’en avoit ufé' la mere de Romulus, celle
d’Alexandre & de plufieurs autres grands hommes
auxquels on auroit pu reprocher le vice de leur
naiflance. Niftée eût pu fuccomber à la vanité de
palier pour le beau-pere d’un Dieu , il aima mieux“
venger fon honneur blefle. Antiope redoutant fa vengeance
, fe réfugia à Sicioneoii Epopeus Pépoufa. Sa
fuite caufa une douleur fi vive à fon pere qu’il ne
put y furvivre : il' fe tua laiflant à Licus fon frere
le foin de lé venger. Licus prit aufli-tôt Sicione,
tua Epopeus, & fit enfermer Antiope dans une pri-
fon fort étroite. Elle y accoucha de deux gémeaux
Amphion & Zétée. Dans la fuite ayant trouvé le
moyen de s’échapper, elle fe fit connôître à fes fils
qui pour la venger tuerent Licus 1(&c attachèrent
Dircée fa femme aux cornés d’un taureau furieux-
qui la niit en pièces.. Amphion* & Zétée après avoir
régné dansThebes, furent enfevelis dans le même
tombeau. LesTithôréens leur rendirent une efpece de
culte religieux. Ils y portoient des offrandes tous les
ans lorfque le foleil entroit dans'le ligne du taureau»-
( J - N . )
* § ANTIPATRIDE, (Gèogr.facr.) Le Dict. raif.
des Sciences, Arts & Métiers diftingue deux villes de ce
nom, qui pourtant ne parodient être que la même! '
Lettres fur C Encyclopédie.
ANTIPARALLELES {lignes^, Géométrie. Soient
deux lignes droites tirées comme on voudra dans
le même plan, & que nous appellerons A & B ;
foient deux autres fignes. qui coupent les lignes A
& B , & que nous nommerons C & D ; fi l’angle
de la ligne C avec la ligne A ou la ligne 5 efi: égal
à l’angle de la ligne D avec la ligne B ou la ligne
A , les lignes C & D , font appellées anti-paralle-
/es.Elles feroient parallèles, fi l’angle de C avec A
ou B étoit égal à l’angle de D avec A ou B.
La fecfion d’un cône, faite par un plan anti parallèle
à labafe, eft toujours une ellipfe. A'oy. C ône
dans le Dict. raif. des Sciences, & c . (O).'
AN T IPH O N lE R ,o u A n t i p h o n a i r e ^ f. m.{Mu-
Jique d’Eglifc.') liv re qui contient en notes les an-
tiennés & autres chants dont on ufe dans l’Eglife C a tholique.
(S')
§ ANTIQUE, adj. ( terme de B lof on. ) fe dit des
couronnes à pointes, des vafes, édifices, vêtemèns
des anciens , &c.
Les lions & les léopards couronnés dans les armoiries
, ont prefque toujours une couronne à pointes
fur leur tete ; c!eft pourquoi on ne dit point en
blafonnant, un lion, ou un léopard couronné à Üantique;
on dit feulement que ces animaux font couronnés
, en exprimant les émaux.
• Il n’en eft pas de même des autres animaux;quaod
ils ont une couronne ; il faut nommer l’efpece de
Couronne, fi elle eft antique ou moderne.
Morel de Putanges en Normandie ; d'or au lion
de Jinople couronné d'argent.
■ Gartoule de Belfourtès à Caftres en Albigeois ;
d’azur au dauphin dor , couronné d'une couronne antique
; on peut dire aufli, couronné a l'antique.
De Waffervas en Artois, d'azur à. trois aiguières
antiques d]or. ( G. D . L. T. )
A n t i q u e s , {arts du Dejfein.) c’eft le nom qu’on
donne aux pièces entières 6c aux fragmens qui nous
reftent des ouvrages peints ou fculptés chez les peur
pies'anciens où les, arts ont fleuri. On renferme
dans cette clafîe les pierres gravées, les médailles ,
les ftatues , les ouvrages moulés & fcu lp té s le s
peintures, les bâtimens ,_ 6c les ruines des anciens
édifices ; ces ouvrages datent ou,.de l’origine des
beaux-arts , .ou. du tems de leur fplendeur, ou de
celui de leur décadence. Ceux qui fe font confervés
des beaux jours de la Grece, & quelques autres
qui font poftérieurs à ce tems-là, font regardés
comme des,, modèles pariaits , ou qui du moins approchent
de bien près de la perfe&ion. Quand les
artiftes i ou les maîtres de l’art parlent avec enthou-
fiafme de la beautés des, antiques, ce n’eft que. de
ce petit nombre de pièces , qu’ils entendent parler.
Car on ne voit que trop,.d'Antiques qui atteftent la
décadence des arts dans les fiecles anciens, poflé-
rieurs aux beaux fiecles de la Grèce.
. Voici les quatre parties èflentiellés dé l’art qii’on
admire dans les antiques. i°. La beauté générale des
formes,20. La perfe&ion du deflein dans les figures
humaines , & en particulier les* belles têtes. 30. La
grandeur & la noblefle des airs , & des eara&eres*
40. l’expreflion fiere-Sc correéte des pallions , toujours
fubordonnée néanmoins à la beauté. Il n’y a
point d’expreflion chez les anciens, qui foit a fiez
forte pour nuire au beau. En général ils'.s’attachoient
moins à la nature, qu’au beau idéal. Ils rejettoiedt
tout ce qui n’eut défigné que tel où tel homme en
particulier. Leur grand but alloit à faire que chaque
image fut toute entière ce qu’elle devoit être, mais
fans aucun mélange d’autre carafterè.1 Jupiter étoit
tout majefté,; Hercule tout force. On négligeoit ce
qui ne tenoit pas riéceflairement à l’idée principale.
Tout artifte qui afpire à exceller dans ces quatre
parties de l’art, ne fauroit trop étudier les belles
antiques ; ce n’eft qu’à force dé les contempler &
de les copier , 'qu’il élevera fon goût à la grandeur
& à la juftefle des artiftes grecs. Aufli les peintres
& les fculpteurs de l’école romaine l’ont- ils'emporté
fur toutes les autres écoles modernes dans
ces parties là , parce qu’ils ont eu plus d’occafion &
de facilité d’étudier ces grands modèles de l’ancienne
Grece.
Nous confeillons au-jeune artifte de commencer par
une le&ure refléchie ,des excellens écrits de Winkel-
mann ; il y verra en quoi confifte.la fupériorité des
antiques, & il la verra dans fon plus beau jour.
Qu’il pafle enfuite à l’étude même de ces antiques
autant qu’il pourra être à portée d’en voir, & qu’il
les obferve lui-même allez long-tems pour en fentir
le vérjtable prix. Ce qu’Horace difoit aux poètes,
nous le recommandons pareillement aux artiftes :
. . . ; ■ . Vos exemplaria graca
Nocturnâ verjate manu, verfate dlurnâ.
Les meilleures ftatues fe voient à Rome & à Florence.
On trouve dans tous les pays de l’Europe de
belles çolleélions de pierres gravées, & de médailles.
Les plus beaux reftes des anciens édifices font
épars dansja Grece & dans l’Italie: Si l’on n’eft
■ pas affez heureux pour voir les originaux , il faut
du moins les étudier fur les copies en moule ou fur
les deffins, quoique ceux-ci rendent pour l’ordinaire
tres-imparfattement ce que l’original a de plus beau
oc de plus grand. Les empreintes de Lippert forment
une excellente colleélion de pierres gravées. Il
feroit à defirer, pour le progrès des arts , que quel-
qu un en entreprît une pareille en fait de médailles
chômes. On peut étudier les édifices de l’antiquité
fur les deflïns de MM. des Godets & le R o i, &
les ftatues anciennes dans les colleétions que Bif-
chop, van Dalen, Perier & Preifler en ont données.
La plus grande colleélion de pierres gravées eft
celle que M. Mariette a publiée. M. Stofch a décrit
& fait graver les principales de ces pierres qui
portent le nom de l’artifte. Enfin on a dans le recueil
de M. le comte de Caylus, Sc dans les eftam-
pes*des antiques d’Herculane , les meilleurs fecôurs
pour connoître la peinture des anciens.
Les ouvrages de l’antiquité en général, different
beaucoup entr’eu x, en excellence & en expreflion
mais point en goût. On peut ranger les monumens
anciens fous trois claffes capitales. En effet on ob-
ferve trms divers degrés, de beauté, qui ou tous
enlemble, ou du moins féparément, fe retrouvent
dans toutes lés ftatues de l’antiquité que le tems
nous a confervées ; les moindres d’entPelles ont toutes
le goût du beau , mais ce n’eft que dans les
parties effentielles ; celles du fécond dégré ,y joignent
encore la beauté dans les parties utiles, &
celles du‘plus haut dégré enfin réunifient la beauté
Jijfques dans les parties de hors-d’oeuvre ; aufli font-
elles parfaitement belles. Les plus belles de ce dégré
fuprême font le Laocoon & le Torfe du Bel-
vedere. Les plus belles du fécond degré font l'Apollon
& le Gladiateur du jardin Borghefe ; il y en a
une infinité du troifieme genre. Voye^ Mengs, Penfées
furie beau & le goût en fait de peinture , pag. 70. 80.
Tous les connoifleurs s’accordent à regarder l’é-
tude des antiques comme J’occupation la plus in-
dilpenfable pour un artifte. C ’eft par ce moyen que
.Raphaël & Michel-Ange ont atteint ce point de
grandeur que nous admirons en eux ; leur exem-
P..e, ren<^ fdperflu tout ce qu’on pourroit encore
alléguer en faveur de cette étude. C’eft une maxime
univerfellement reçue aujourd’hui, que pour acquérir
le vrai goût du beau, il eft néceffaire de consulter
attentivement les antiques.
Cette étude cependant ne fauroit être d’un grand
lecours à de petits génies. Il ne fuffit pas, d’obfer-
ver les contours , c’eft l’efprit qu’il eft queftion de
faifîr dans les belles antiques. Celui qui après les
avoir long-tems contemplées n’éprouve pas un certain
raviffement, ne fent pas la perfeffion invilible
au travers de la beauté palpable, n’a qu’à ietter fes
crayons ; les antiques lui font inutiles.
Il faut avouer néanmoins, qu’il y a de l’exagération
dans les éloges que les connoiffeurs anciens &
modernes ont fait de l’excellence des antiques. On
lent bien que tout n’eft pas exaaement vrai dans ce
que Pline rapporte du Paris d’Euphranor f Vàyer
rlans ce Supplément Aclégorie ) , & l’on aurait tort
^prendre à la lettre, comme V eb b le fait, toutes
rhefif Ci lpt‘° nS “ïue .les anciens ont données de ces
.ts -d oeuvre. Mais a nous en tenir aux ouvraees
qui fe font confervés jufqu’à nous, il y a alez
f l r ?*cuer n°tre admiration. Les artiftes & les
ièSSS fau™ ent troP confulter fur ce. fuie
de 1*,lnkelmann ; nous y renvoyons
_ ,fi S MUS ne Pas alonger cet article. (Cet
M. S u f z T l f thiorit m iu Beaux-Am ie
ANTI-SPASMODIQUE, adj. ( Mat. mai. ), le
mot imù-fpafmoiiqut a long-tems été fynonyme
d anu-epdepuque, comme il l’eft encore de cipkdli-
■ ■ “ f “ ; mais l’épilepfie n’étant qu’une efpece
hféTa llaffe’ T nïUlf" T ° U a généra!
diminuer les mouvemens néceffaires, lorfqu’ils font
mop forts ou trop rapides : cette vertu leu?" ft c ™ !
ra!“ k r a n ô l t T ° “ h^ n0tiî u“ > »
La multiplicité des maladies nerveufes, & fi j’ofe
. ,’ r.e ’ e Pece de mode d’avoir les nerfs irritables
& duiicats, ont rendu l’ufage d nanti-fparmoires
prefoue umverfel. Leur adrainiftrarion p/rticulfere
conft.tue.de nos jours: une branche de la méd" c i? '
rèm!qUe ’ lu,r,la5uelle on a déjà établi plufieurs fyf-
d e 1 °|l‘ fmethr° des-Ql'clques médecms& beaucoup
W e d ’ fe S exclnfivement arrogé le privL
ie% f , ‘ eïe-cer ; & ^S-orance, la crédulité, ia fu-
perftition meme ont infiniment ajouté au nombre
L X ! f 1>La 1,11e des aanr n‘-efrfpqai!f-dmSo i°iqnu Bes feroit immmeanlfaed £fs, ie
f im „ !S rapi-°rter la fouIe dés iubftances qu’on t
fuppofe avoir cette propriété. Le merveilles prétendu
de quelques-unes des maladies qu’on avoir à
combattre, a fait aufli rechercher Æ v e X i x
dans les remedes;,on a preferit des réglés pom“
maniéré de les adminiftrer ; on a indiqué le mmTre-
quis pour les recueillir, pour les préparer, pour 1«
MPa tiré de?" 1 S l’heure le^our, la faifon :
on a tire des induâions de la couleur, du poids de
da medl.c.a?l=nt. Il n’eft enfin aucune efpece
■ H l qn’° " n’ait fucceflivement
m n e,n ufage f ° us ce point de vue.
^ Il n eft aucun médecin honnête & éclairé au»
naitfenti le vuide des promeffes dè tant de fpéri-
& " ï ï d?ft,?„f"rge a 5 nouve.Ues matières médicales
& les difpenfaires de cette immenfité d’erreurs aui
fa.foien.la hon.e de la médecine; maisTe peupî"
éblouif i - ,COnvertl- Lf goto du merveilleux qui
éblouit, ftu encore croire aux fachets pendus au col,
t e e s Êr î ^ •}0T br.e s ’ aux difterens amucceelflfei
dd’ êetrleq peluqpTle , en™ onvta lpnass î ruoi ung’io, ndte rangeenrc olerse
exorcifmes dans la claflÿ des ?nti-fpa}ZiqueS
( .p V ‘ 1 une Dpertatwn fur tes ami-fpafmoiiqles
couronnée par 1 academie de Dijon ). ÏI eft humiliant
de retrouver vers la fin de ce lie c le , un exTmrf?
digne de la barbarie des tems abfurdes qui nous
ont précédé ; d eft-encoie plus humiliant^ dire
bation a mis “ 'eaù de fou approreurs%
d. T ' ' ran{p°,rté dans ces 'ems d’ér-
vToOidleess ^leess pnlruesn ?é°pna?ise-rfu°rÙ t olu'Ss” l,0e1s, 3h"o“m rmépeas,n d&o itto luess
les états , & oit l’on ne connoiffoit d’aurië ftieme
que celle de tromper. ..
Les nnti-fpafmoiiques n’agiffent que d’une maniéré
! ! n r • ’,‘?n P°“rro,t même dire que cette action
eft fi indéterminée dans la plupart, qu’on ne
peut guere compter fur cette reffource dans les
maladies btfarres contre lefque'lles on les deftine. Les
variétés des tempéramens ou des conffitutions les
différences de climat, d’âge, de fexe , de genre de
v ie , d éducation, d’habitudes, font des nuances im-
e& t sPKS’ qUi décidentde lei,rs bons ou mauvais
Les anti-fpafînodiques les plus ufités font les racines
de pivoine & ,de valériane ou valérienne fau-
vage ; les fleurs de tilleul, de muguet, le camphre
le mufe, la civette, la liqueur minérale anodine