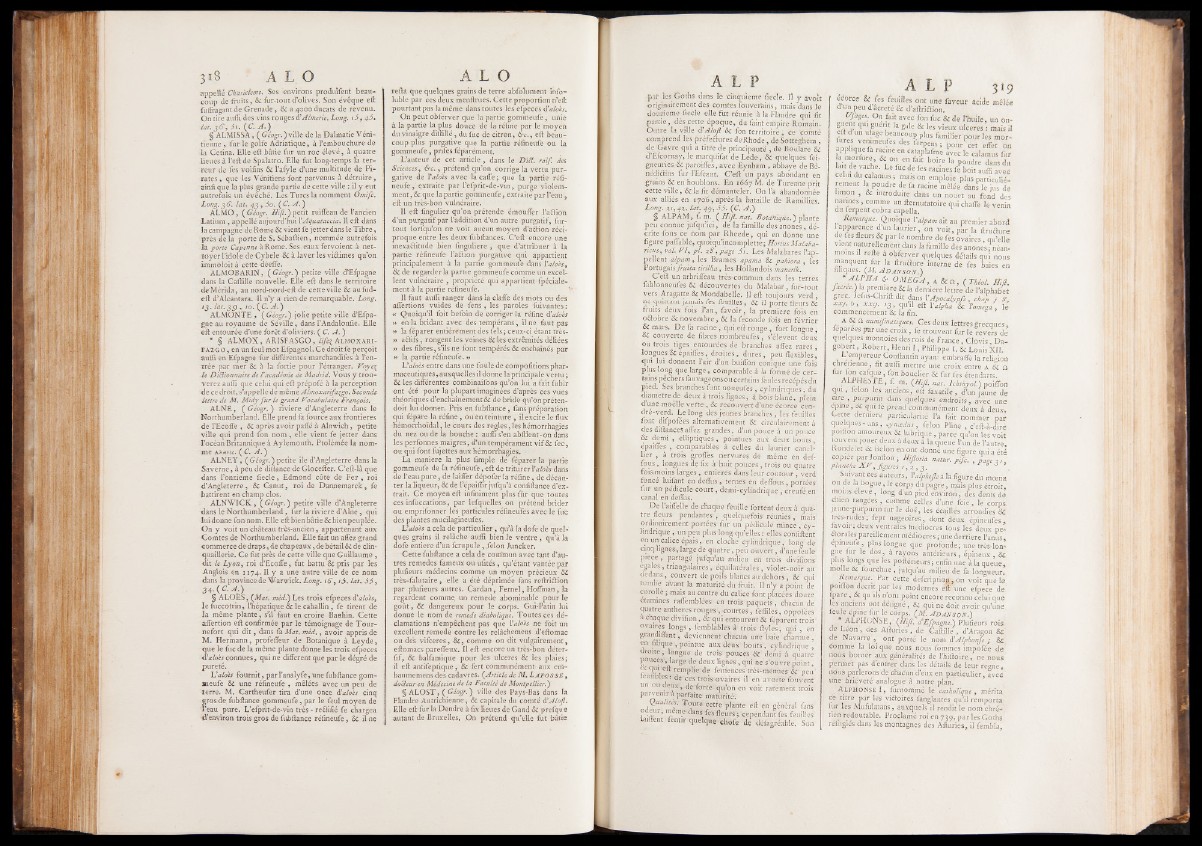
appelle Ckarideme. Ses environs produïfent beaucoup
de fruits, 8c fur-tout d’olives. Son évêque eft
fuffragant de Grenade, 8c a 4000 ducats de revenu.
On tire aufli des vins rouges d’Almerie. Long. i5 , 45.
lut. 3 S , 5i-, ( C .A . )
§ ALMISSA, ( Géogr. ) ville de la Dalmatie Vénitienne
, fur le golfe Adriatique, à l’embouchure de
la Cetina. Elle eft bâtie fur un roc élevé, à quatre
lieues à l’eft de Spalatro. Elle fut long-temps la terreur
de fes -voifins 8c l’afyle d’une multitude de Pirates
, que les Vénitiens font parvenus à détruire,
ainfi que la plus grande partie de cette ville : il y eut
autrefois un évêché. Les Turcs la nomment Omifc.
Long.3 £ lat. 47, » f c { C- A ‘ ) .^
A LM O , (Géogr. Hifi.) petit ruiffeau de l’ancien
Latium , appellé aujourd'hui YAquataccia. 11 eft dans
la campagne de Rome 8c vient fe jetter dans le Tib re,
près de la porte de S. Sébaftien , nommée autrefois
la porte Capenne à Rome. Ses, eaux fervoient à nettoyer
l’idole de Cybele 8c à laver les viftimes qu’on
immôloit à cette aéefl’e.
ALMOBARIN, (Géogr.) petite ville d’Efpagne
dans la Caftille nouvelle. Elle eft dans le territoire
de Mérida, au nord-nord-eft de cette ville 8c aufud-
eft d’Alcantara. Il n’y a rien de remarquable. Long.
13. lat. 3 '(j, /o. ( C. A . )
ALMONTE , (Géogr.) jolie petite ville d’Efpagne
au royaume de Séville, dans l’Andaloufie. Elle
eft entourée d’une forêt d’oliviers. (C . A . )
* § ALM O X , ARISFASGO, Hfe^ A l m o x a r i -
F A Z G O , en un feulmot Efpagnol. Ce droitfe perçoit
aufli en Efpagne fur différentes marchandifes à l’entrée
par mer 8c à la fortie pour l’étranger. Foye^
le Dictionnaire de l'académie de Madrid. Vous y trouverez
aufli que celui qui eft prépofé à la perception
de ce droit, s’appelle de même Almoxarifaçgo. Seconde,
lettre de M. Midy fur le grand Focabulaire François.
ALNE, (Géogr.) riviere d’Angleterre dans le
Northumberland. Elle prend fa fource aux frontières
de l’Ecoffe , 8c après avoir paffé à Alnwich, petite
ville qui prend fon nom, elle vient fe jetter dans
l’océan Britannique à Aylemouth. Ptolémée la nomme
AXapoç. ( C. A . )
ALN E Y , ( Géogr.) petite île d’Angleterre dans la
Saverne, à peu de diftance de Glocefter. C ’eft-là que
dans l’onzieme fiec le, Edmond côte de F e r , roi
d’Angleterre, 8c Canut, roi de Dannemarck, fe
battirent en champ clos.
ALN’W LCK, ( Géogr. ) petite ville d’Angleterre
dans le Northumberland, fur la riviere d’Alne, cjui
lui donne fon nom. Elle eft bien bâtie 8c bien peuplée.
On y voit un château très-ancien, appartenant aux
Comtes de Northumberland. Elle fait un affez grand
commerce de draps, de chapeaux, de bétail & de clin-
quaillerie. Ce fut près de cette ville que Guillaume ,
dit le Lyon, roi d’Ecôffe, fut battu 8c pris par les
Anglois en 1174. Il y a une autre ville de ce nom
dans la province de "Warwick. Long. tG, 16. lat. 5 5 ,
3 4 . ( C .X . )
§ ALOES, (Mat. méd.) Les trois efpeces d’aloès,
le fuccotrin, l’hépatique 8c le caballin, fe tirent de
la même plante, s’il faut en croire Banhin. Cette
affertion eft confirmée par le témoignage de Tour-
nefort qui d i t , dans fa Mat. méd., avoir appris de
M. Hermann, profeffeur de Botanique à Leyde,
que le fuc de la même plante donne les trois efpeces
d'aloïs connues, qui ne different que par le dégré de
pureté.
Ualoès fournit, parl’analyfe, une fubftance gom-
aneufe 8c une réfineufe , mêlées avec un peu de
terre. M. Cartheufer tira d’une once d’aloès cinq
gros de. fubftance gommeufe, par le feul moyen de
l ’eau pure. L’efprit-de-vin très - reélifié fe chargea
d’environ trois gros de fubftance réfineufe, 8c il ne
reftâ que quelques grains de terre abfolument info-
luble par ces deux menftrues. Cette proportion n’eft
pourtant pas la même dans toutes les efpeces dY aloès.
On peutobferver que la partie gommeufe, unie
à la partie la plus douce de la réfine par le moyen
du vinaigre diftillé, du fuc de citron, &c., eft beaucoup
plus purgative que la partie réfineufe ou la
gommeufe, prifes féparément.
L’auteur de cet article, dans le Dict. raif des
SciencesS & c ., prétend qu’on Corrige la vertu purgative
de Yaloès avec la caffe ; que la partie réfineufe
, extraite par l’efprit-de-vin, purge violemment
, 8c que la partie gommeufe, extraite par l’eau,
eft un très-bon vulnéraire.
Il eft fingulier qu’on prétende émouffer l’aftion
d’un purgatif par l’addition d’un autre purgatif, fur-
tout lorfqu’on ne voit aucun moyen d’aftion réciproque
entre les deux fubftances. C’eft encore une
inexa&itude bien finguliere , que d’attribuer à la
partie réfineufe l’a&ion purgative qui appartient
principalement à la partie gommèule dans l'aloes,
8c de regarder la partie gommeufe comme un excel lent
vulnéraire , propriété q u i appartient fpéciale-
ment à la partie réfineufe.
Il faut aufli ranger dans la elaffe des mots ou des
affertions vuides de fens , les paroles fuivantes :
« Quoiqu’il foit befoin de corriger la réfine d! aloès
» en la bridant avec des tempérans, il ne faut pas
» la féparer entièrement des fels; ceux-ci étant très-
» a â ifs , rongent les veines 8c lesextrêmités déliées
» des fibres, s’ils ne font tempérés 8c enchaînés par
»‘ la partie réfineufe. »
Ualoès entre dans une foule de compofitions pharmaceutiques
, auxquelles il donne la principale vertu ;
& les différentes combinaifons-qu’on lui a fait futur
ont été pour la plupart imaginées d’après ces vues
théoriques d’enchaînement & de bride qu’on préten-
doit lui donner. Pris en fubftance , fans préparation
qui fépàre la réfine, ou en teinture , il excite le flux
hémorrhoïdal, le cours des réglés, les hémorrhagies
du nez ou de la bouche : aufli s’en abftient-on dans
les perfonnes maigres, d’un tempérament v i f 8c fe c ,
ou qui font fujettes aux hémorrhagies.
La maniéré la plus fimple de féparer la partie
gommeufe de la réfineufe, eft de triturer Y aloès dans
de l’eau pure, de laiffer dépofer la réfine, de décanter
la liqueur, & de l’épaiflir jufqu’à confiftance d’extrait.
Ce moyen eft infiniment plus fur que toutes
ces infuccations, par lefquelles on prétend brider
ou emprilbnner les particules réfineufes avec le fut
des plantes mucilagineufes.
Ualoès a cela de particulier, qu’à la dofe de quelques
grains il relâche aufli bien le ventre, qu’à la
dofe entière d’un fcrupule, =fèlpri Juncker.
Cette fubftance a cela de com’mun avec tant d’autres
remedes fameux ou u fités, qu’étant vantée par
plufieurs médecins comme un moyen précieux 8c
très-falutaire, elle a été déprimée fans reftriéHon
par plufieurs autres. Cardan, Fernel, Hoffman, la
regardent comme, un remede abominable pour le
goût, 8c dangereux pour le corps. Gui-Patin lui
donne le nom de remede diabolique. Toutes ces dé-
• clamations n’empêchent pas que Yaloès ne foit un
excellent remede contre les relâchemens d’eftomac
ou des vifceres, 8c, comme on dit. vulgairement,
eftomacs pareffeux. Il eft encore un très-bon déter-
fif, 8c balfamique pour les ulcérés 8c les plaies;
il eft antifeptique, 8c fert communément- aux em-
baumemens des cadavres. (Article de M. L a f o s s e ,
docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier d)
§ A LO ST , ( Géogr. ) ville des Pays-Bas dans la
Flandre Autrichienne, 8c capitale du comté d’Alo/l.
Elle eft fur la Dendre à fix lieues de Gand 8c prefque
autant de Bruxelles. .On prétend qu’elle fut bâtie
•pat leS Godas dans Iè 'cinquième fieèîe. îî y àvoït
originairement des comtes louVerains, mais dans le
dotirieme fiecle elle fut réunie à la Flandre qui fit
.partie, dès cette époque, du faint empire Romain»
Outre la ville d A l o f i 8c fon territoire, ce Comté
comprend les préfectures de-Rhode, dé Sotteghem ,
de -GaVre qui a titre de principauté , de Boulare 8C
d’Efeqrnay,-le marqûrfat de Lede, 8c quelques fei-
gneuries. 8c paroifles, avec Eynham , abbaye de Bénédictins
fur l’Efcaut.. G’eft un pays abondant en
grains 8c en houblons. En 1667 M. de Turenne prit
cette ville, :8c la .fit démanteler. On l’à abandonnée
aux alliés en 1706 ; après la bataille de Ra'millies.
Long, z i, 42. lat. 4y-; 55. (C. A.)
§ ALPAM, f. m. ( Llïfi. nat. Êoiahiqtle.) plante
peu connue jufqu’ic i, de la famille des anones, décrite
fOUs ce nom par Rheede, qui en donne une
figure paffable, quoiqu’incomplette; Hortus Malaba-
ricus, vol. F I , pi. z 8 , page 5 t. Les Malabares l’appellent
alpam, les Brames àpdma 8c pahiora , les
Portugais fruita tirilha, les Hollandois manerik.
G’eft un arbriffeau très-commun dans les tefres
fablonneufes 8c découvertes du Malabar, fur-tout
vers Aragatte 8c Mondabelle. 11 eft toujours v e rd ,
ne quittant jamais fes feuilles, 8c il porte fleurs 8c
fruits deux fois l’an, lavo ir , la première fois en
oétobre 8c novembre, 8c là féconde fois en février
8c mars» De fa racine, qui eft rouge , fort longue
8c couverte de fibres nombreüfes , s’élèvent deux
ou trois tiges entourées de branches aflez ra re s-
longues 8c épaiffes, droites, dures, peu flexibles’
qui lui donnent 1 air d’un buiflbn conique une fois
plus long que large, comparable à la forme de certains
pêchers fauvageonsou certains fauies recépés du
pied. Ses branches font nöueufes , cylindriques, du
djametre de deux à trois lignes, à bois blanc, plein
d uné moelle verte , 8c recouvert d’une écorce cen-
dré-verd. Le long des jeunes branches, les feuilles
font difpofées alternativement 8c circulairement à
des diftances aflez graridês, d’un pouce à un pouce
8c demi , elliptiques,: pointues aux deux bouts,
épaiffes , comparables à celles du laurier canel-
lier , à trois groffes nervures de même en def-
fous, longues, de fix à huit pouces , trois ou quatre
fois,moins larges, entières dans leur contour , verd
foncé luifant en deffus , ternes én deffous, portées
fur un pédicule court, demi-cylindrique , ereufé.en
canal én-deffus.
De l’aiffelle de chaque feuille fortent deux à quatre
fleurs pendantes , quelquefois réunies mais
ordinairement portées-fur un pédicule mince , cylindrique
, un peu plus-long qu’elles : elles cohfiftent
en un calice épais, en cloche cylihdrique, long de
cinq lignes , large de quatre, peu ouvert, d’une mule
pie ce , partagé jufqu’au milieu en trois divifions
egales*, triangulaires, équilatérales, violet-noir au
dedans, couvert de poils blancs àu clehor's, 8c qui
tombe avant la maturité du fruit. Il n’y a point de
corollè ; mais au centre du calice font placées-douze
etamines raffemblees en trois paquets, chaciin de
quatre anthères'rougesyeourtes , feflîles, oppoféés '
à chaque divifion, & qui entourent 8c féparent troisi
ovaires longs , femblablés à- trois ftyles, qui , en
grandiffantdeviennent chacun une baie charnue ,/
en filique , pointue aux deux boiirs, cylindrique,
droite, longue de trois pouces 8c demi à quatre'
poucès ', large 'de deux lignés, qui ne s’ouvre point,
c T i rem'P^':^ 'fefatehces:très^mén'àes Ôt peu;
lenlrbles : de' ces trois^ovairès il' en avorte fouvent
lin oumeùx , de-Tortè qu’on en voit rarement trois
parveninà parfaite maturité.
Qualités. Toute cetre plante eft en général fans
f • a-111 ! r^em5 c^ansi fes fleurs ; -cependant fes feuilles '
laiffent ; fèntir quelque chofe de défagréable. Son
edorce &c {es feuilles ont Une faveur acide mêlée
d Un peu d âcreté 8c d’aftriftion.
UJàges. On fait avec fon fuc 8c de l’huile, un on-
^U1 ^uerî t §a^e & les vieux ulcérés : mais il
/- -a^e eaucOup plus familier pour les morfuies
vemmeufes des lerpens ; pour cet effet rin
laaP mmoorrffuurree ,T & on en fait boire *lvae cp oleu dre dans &d*u*
lait de vache. Le fuc de fes racines fe boit suffi avec
celui du calamus; mais on emploie plus particuliérement
la poudre de fa racine mêlée dans le jus de
limon , & introduite dans un nouet au fond des
narines , comme un lïernutatoire qui chaffe le venin
du lerpent cobra capella.
Remarque. Quoique l’alpam ait au premier abord
1 apparence d un laurier, on vo it, par la ftrufture
de fes fleurs & par le nombre de fes ovaires, qu’elle
vient naturellement dans la famille des ànones; néan-
moins tl relie d obferver quelques détails qui nous
manquent fur la ftruélufe interne de fes baies en
lliiques. (M. A d a x s o n .')
W B Ê m * 0 U E G ^ , A 8 C C l , ( T h ê o l . H i f i .
facree.) la première & la derniere lettre de l’alphabet
grec. Jelus-Chriil dit dans TApocafypfi, chap. j . À
B Q '3 , qu’il eft l’alpha 5£ I M l j
commencement 8c la fin.
A 8c a n um ifm a t iq u e s . G es deux lettres grecques*
feparees par une croix, fe trouvent fur le devers de
quelques monnoiès dès rois de France , Clovis, Da*
gobert, Robert, Henri I , Philippe I. 8c Louis XII.
L empereur Conftantin ayant embrafle là religion
chrétienne, fit aufli mettre une croix entré a 8c a
fur fon calque, fon bouclier 8c fur fes étendarts.
ALPHë STÉ j f. m. (Hijt. nat. lchthyol.) pôiffort
qui, félon les anciens, eft faxarile, d’un jaune de
cire , purpurin dans quelques endroits, avec une
epine, 8c qui fè prend communément deux à deux4
Cette derniere particularité l’a fait nommer par
quelques-uns, cyncedüs, félon Pline , c’eft-à-dire
poifton amoureux 8c Lubrique, parce qu’on les voit
H l i i deux à deLlx à la queue l’un de l’autre.
Rondelet 8c Belon én ont donné une figure qui a été
copiée par Jonfton ; Hijlària natur. pife. . paSc 7,
planche X F ' figurés /, z , 3 . 8 3 \
Suivant ces auteurs, Yalphéjte a la figure du meena
ou de la bogue , le corps du pagre, mais plus étroit,
moins elev e, long d’un pied environ, des dents dé
chien rangées, comme celles d’une feie, le corps
jaune-purpurinïur le dos , lés écailles arrondies 8c
très-rudes ; fept nageoires, dont deux épineufes ,
lavoir; deux ventrales médiocres fous les deux pe*
«orales pareillement médiocres ;une derrière l’anus,
epinetife, plus longue que profonde; une très-longue
fur le dos, à rayons antérieurs, épineux 8c
plus longs que les poftérieurs; enfin une à la queue,
molle 8c fourchue, jufqu’au milieu de fa longue un
R em a r q u e . Par Cette defcriptiôn, on voit que le
poifton décrit par les modernes eft une efpece de
fpare, 8c qu’ils n’ont point encore reconnu celui que
les anciens ont déligné, 8c qui ne doit avoir qu’une
feule épine fur le corps. (M . A d a n s o n , )
* ^^^-GN SE, (Hif. d’Efpagne.) Plufieurs rois
de Leon , des Ailuries, dé Caftille , d’Aragon &
de Navarre , ont1 porté le nom d’Alphonfe ; 8c
comme- la loi que nous, nous fommes impofée de
nous borner aux généralités de Phiftoire, ne nous
permet pas denfrer dans les détails de leur régné,
pdüs parlerons de Gh'adün d’eux en particulier avec
une brièveté analogue à notre plan.
Alphonse I, furnomme lé c a t h o l i q u e , mérita
ce titre par les victoires fanglantes qu’il remporta
fur les Mufulmans, auxquels il rendit le nom chré^
tien redoutable. Proclamé roi en 739, par les Goths
réfugiés dans lès montagnes des Afturies, il fembla,