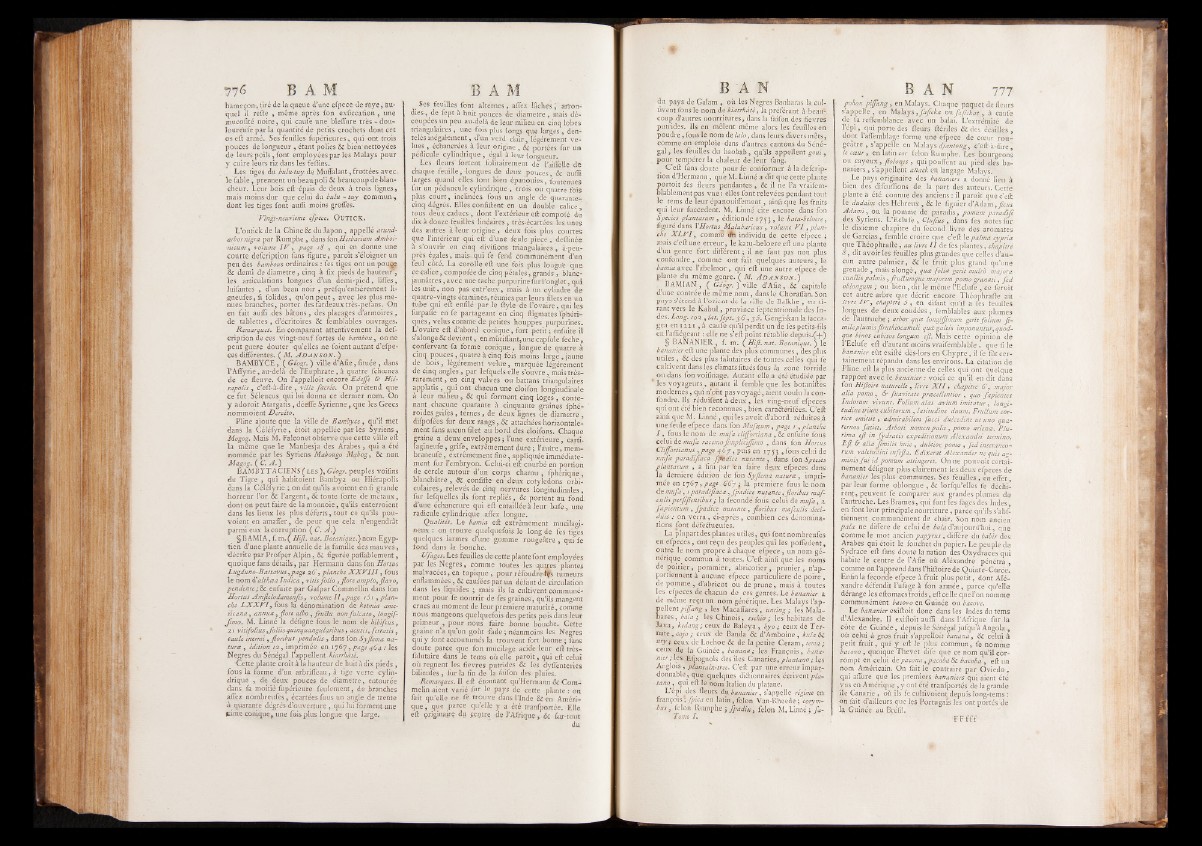
hameçon-, tiré de la queue d’une efpece de raye, auquel
il reîte , même après fon exficcation , une
mucofité noire, qui caufe une' bleffure très - dou-
loûréùfe par la quantité de petits crochets dont cet
os eft armé. Ses feuilles fupérieures-, qui ont trois
pouces de longueur , étant polies & bien'nettoyées
de leurs poils, font employées par les Malays pour
y cuire leurs riz dans les-feftins.
Les tiges du bulu-tuy. de Muffalant, frottées avec,
le fable, prennent un-beaiupoli & beaucoup de-blancheur.
Leur bois eft-épais de-deux à trois lignes ,
mais moins dur que celui du buhi - tuy commun,
«dont les tiges font-aufli moins großes.
VVngt-neuv'iimt efpece. OuTICK.
L’outick de la Chine & du Japon, appelle arund-
arbor nigra par Rumphe , dans fon Herbarium Amb'oi-
•nicum, volume I V , page -/<? ., qui en donne une
courte defcription fans figure, paroît s’éloigner un
peu des bambous ordinaires : fes tiges ont un pou®
& demi de diamètre , cinq à fix pieds de hauteur,
les articulations longues d’un demi-pied, liftes,
luifantes , d’un beau noir , prefqu’entiérement li-
.gneufes, fi folides, qu’on peut, avec les plus menues
branches, porter des fardeaux très-pefans. On
en fait aufli .des bâtons, des placages d’armoires ,
de tablettes, d’écritoires & lemblables ouvrages.
Remarques. En comparant attentivement la defcription
de ces vingt-neuf fortes de bambou, on ne
peut guère douter -qu’elles ne foient autant d’efpe-
ces différentes..( M. A d a n s o n .,)
BAMBYCE, ( Géogr. ) ville d’Afie, fituée, dans
ï’Affyrie, au-delà de l’Euphrate, à quatre fchoenes
de ce fleuve. On l’appelloit encore Edejfe & Hié-
rapolis, c*eft-à-dire , ville facrée. On prétend que
Ce fut Séleucus qui lui donna ce dernier nom. On
y adoroit Atargatis, déeffe Syrienne, que les Grecs
nommoient Derclto.
Pline ajoute que la ville de Banibyce, qu’il met
dans la Céléfyrie, étoit appellée par lés Syriens ,
Mogog. Mais M. Falconet obfervè que cette ville eft
la même que le Manbesja des Arabes, qui a été
nommée par les Syriens Mabougo Mqbog, & non
Magog. ( C .A . )
B AM BYT A CIENS ( l e s ) , Géogr. peuples voifins
du Tigre , qui habitoient Bambya ou Hiérapolis
dans la Céléfyrie ; on dit qu’ils avoient en fi grande
horreur l’or & l’argent, & toute forte de métaux,
dont on peut faire de la monnoie, qu’ils enterroient
dans les lieux les plus déferts, tout ce qu’ils pou-
voient en amaffer, de peur que cela n’engendrât
parmi eux la corruption ( C. A .)
§ B AMIA, f. m. ( Hiß. nat. Botanique.') nom Egyptien
d’une plante annuelle de la famille des mauves-,
décrite par Profper Alpin, & figurée paffablement,
quoique fans détails, par Hermann dans fon Hortus
Lugduno-Battavus, page z 6 , planche X X V I I I , fous
le nom tfalthoea Indica, vitis folio , flore amplô^flavo,
pendente ; & enfuite par Gafpar Commellin dans fon
Hortus Amßelodamenßs, volume I I , page lâi , planche
LX X V I , fous la dénomination de ketmia ame-
ricana, annua, flore albo , fruclu non fulcato, longif-
Jimo. M. Linné la défigne fous de nom de hibifeus,
Zi vitifolius,/oâisquinquangularibus, acutis, ferratis ,
caule inermi, floribus .pendulis , dans fon Syflema natura
, édition 12, imprimée en 1767, page 464. : les
Negres du Sénégal l’appellent kiarrhàté.
■ Cette plante croît à la hauteur de huit à dix pieds ,
fous la forme d’un arbriffeau, à tige verte cylindrique
, de deux pouces de diamètre, entourée
dans fa moitié fupériëure feulement, de branches
affez nombreufes, écartées fous un angle de trente
à quarante degrés 1 d’ouverture, qui lui forment une
pime.conique, une fois plus longue que large.
Ses feuilles font alternes, affez lâchés j arrondies,
de fept à huit .pouces de diamètre , mais découpées
un peu au-delà de leur milieu en cinq lobes
triangulaires, une fois plus longs que larges , dentelés
inégalement, d’un verd clair, légèrement velues
, echancrees à leur origine , & portées fur un
pédicule cylindrique , égal à leur longueur.
Les fleurs fortent folitairement de l’aiffelle de
chaque feuille, -longues de deux pouces- & âuflï
larges quand elles font bien épanouies, foutenues
fur un péduncule cylindrique , trois ou quatre fois
plus court, inclinées fous un angle de quarante-
cinq degrés. Elles confiftent en un double calice
tous deux caducs , dont l’extérieur eft compofé de
dix à douze feuilles linéaires, très-écartées les unes
des autres à leur origine , deux fois plus courtes
que l’intérieur qui eft d’une feule piece, deftinée
à s’ouvrir en cinq divifions triangulaires, à-peu-
près égales, mais~qui fe fend communément d’un
feul cote. La corolle eft une fois plus longue que
ce calice, compofée de cinq pétales, grands , blanc-
jaunâtres ,avec une tache purpurine fur l’onglet, qui
les unit, non pas entr’eux, mais à un cylindre de
quatre-vingts étamines, réunies par leurs filets en un
tube qui eft enfilé par le ftyle de l’ovaire, qui les
furpaffe en fe partageant en cinq ftigmates fphéri-
ques, velus comme de petites houppes purpurines.
L’ovaire eft d’abord conique, fort petit $ enfuite il
s’alonge & devient, en mûriffant,une cap fuie feche,
confervant fa forme conique, longue de quatre à
cinq pouces, quatre à cinq fois moins large, jaune
de. bois, legerement velue, marquée légèrement
de cinq angles, par lefquels elle s’ouvre, mais très-
rarement , en cinq' valves ou battans triangulaires
applatis , qui ont chacun une cloifon longitudinale
à leur milieu, & qui forment cinq loges , contenant,
chacune quarante à cinquante graines fphé-
roïdes grifes , ternes, de deux lignes de diamètre ,
difpofèes fur deux rangs, & attachées horizontalement
fans aucun filet au bord des cloifons. Chaque
graine a deux enveloppes ; l’une extérieure, carti-
lagineufe, grife, extrêmement dure ; l’autre, mem-
braneufe, extrêmement fine, appliquée immédiatement
fur l’embryon. Celui-ci eft courbé en portion
de cercle autour d’un corps charnu , fphérique,
blanchâtre, & confifte en deux cotylédons orbi-
culaires, relevés de. cinq nervures longitudinales,
fur lefquelles ils font repliés , & portent au fond,
d’une échancrure qui eft entaillée à leur bafe, une
radicule cylindrique affez longue. .
Qualités. Le bamia eft extrêmement mucilagi-
neux : on trouve quelquefois le long de fes figes
quelques larmes d’une gomme rougeâtre , qui fe
fond dans la bouche.
'Vfâges. Les feuilles de cette plante font employées
par les Negres, comme toutes les qutres plantes
malvacées,en topique, pour réfoudre l f s tumeurs
enflammées, & caufees par un défaut de circulation
dans les liquides ; mais ils la cultivent communément
pour fe nourrir de fes graines, qu’ils mangent
crues au moment de leur première maturité, comme
nous mangeons quelquefois des petits pois dans leur
primeur , pour nous faire bonne bouche. Cette
gr-aine n’a qu’un goût fade ; -néanmoins les Negres
oui y font accoutumés la trouvent fort bonne ; fans
doute parce que fon mucilage acide leur eft très-
falutaire dans le tems oii elle paroît, qui eft celui
où régnent les fievres putrides & les dyffenteries
bilieuîes, fur la fin de la faifon des pluies.
Remarques. Il eft étonnant qu’Hermann & Com-
melin aient varié fur le pays de cette plante : on
fait qu’elle ne fe trouve dans l’Inde & en Amérique
, que parce qu’elle y a été transportée. Elle
eft çriginaire du pentre de l’Afrique, & fur-tout
du
du pays de Galam , où les Negres Banbaras la cultivent
fous le nom de kiarrhàté, la préférant à beau-,
coup, d’autres nourritures, dans la faifon des fievres
putrides. Ils en mêlent même alors les feuilles en
poudre, fous le nomdelalo, dans leurs diversmêts,
comme on emploie- dans d’autres cantons du Sénégal,
les feuilles du baobab, qu’ils appellent goui,
pour tempérer la chaleur de leur fang.
C’eft fans doute pour fe conformer à la defcription
d’Hermann , que M. Linné a dit que cette plante
portoit fes fleurs pendantes , & il ne l’a vraifem-
blablement pas vue : elles font relevées pendant tout
le tems de leur épanouiffement, ainfi que les fruits
qui leur fuccedent. M. Linné cite encore dans fon
Spteies plantarum , édition de 1753 , le hatu-beloere,
figure dans l’Hortus Malabaricus , volume V I , planche
X L V I , comme tfh individu de cette efpece ;
mais c’eft une erreur, le katu-beloere eft une plante
d’un genre fort différent ; il ne faut pas non plus
confondre , comme ont fait quelques auteurs, le
bamia avec l’abelmor, qui eft une autre efpece de
plante du même genre. ( M . A d a n s o n . )
} BAMIAN , ( Géogr. ) ville d’Àfîeç, .& capitale
d’une contrée de même nom, dans le Choraffan. Son
pays s’étend à l’orient de la ville de Balkhe , en tirant
vers le Kabul, province feptentrionale des Indes.
Long. 102 , lat. fept. j (T, 3 5. Gengiskan la facca-
gea en 1221 , à caufe qu’il perdit un de fes petits-fils
en l’afliégeant : elle ne s’eft point rétablie depuis/-)-)
§ BANANIER, f. m; {Hifl.nat. Botanique.) le
bananier eft. une plante des plus communes, des plus
utiles , & des plus falutaires de toutes celles qui fe
cultivent dans les climats fitués fous la zone torride
ou dans fon voifinage. Autant elle a été étudiée par
les voyageurs , jutant il femble que les botaniftés
modernes, qui n’.ont pas voyagé, aient voulu la confondre.
Ils réduifent à deux , les ving-neuf efpeces
qui ont été bien reconnues, bien caraâérifées. C’eft
ainfi que M. Linné, qui les avoit d’abord, réduites,à
une feule efpece dans fon Mufceum, page / , planche
I , fous le nom de mu fa cliffortiana , & enfuite fous
celui de mufa racemofimplicifflmo , dans fon Hortus
Cliffortianus, page 4 B y , puis en 1753 , fous celui de
mufa paradijutca ffladice nutante , dans fon Species
plantarum , a fini par ’en faire deux efpeces dans
la derniere édition de fon Syflema natures, imprimée
en 1767, page 6 6j • la première fous le nom
de mufa 91 paradifiaca, fpadice nutante, floribus maf-
culis perftflentibus ; la fécondé'fous celui de mufa, 2
fapientum , fpadice nutante , floribus mafeulis décidais•:
on verra, ci-après, combien ces dénominations
font défe&ueufes.
La plupart des plantes utiles, qui font nombreufes
en efpeces, ont reçu des peuples qui les poffedent,
outre le nom propre à chaque efpece, un nom générique
commun à toutes. C’eft ainfi que les noms
de poirier, pommier, abricotier, prunier, n’appartiennent
à aucune efpece particulière de poire ,
de pomme , d’abricot ou de prune, mais à toutes
les efpeces de chacun de ces genres. Le^ bananier a
de même reçu un nom générique. Les Malays l’appellent
piffang , les Macaffares, unting ; les Mala-
bares, bala ; les Chinois, tschio ; les habitans de
Java, kedang; ceux de Baleya , byo; ceux de Ter-
nate, cojo ; ceux de Banda & d’Amboine , kula &
“O'» ceux de Loehoe & de la petite Ceram, tema ;
ceux de la Guinée, banana; \ts François, bananier
; les Efpagnols des îles Canaries, plantano; les
Anglois , plantain-tree. C’eft par une erreur impardonnable,
que quelques diftionnaires écrivent pla-
tano , qui eft le nom Italien du platane.
L’épi des fleurs du bananier, s’appelle régime en
françois ; fpica en latin, félon Van-Rheede ; corym-
bus, félon Rumphe 5 fpadix, félon M, Linné ; fa-
Tomc I. . ' 1
pohon p iffa n g en Malays. Chaque paquet de fleurs
s’appelle, en Malays ffaflcka ou faflekat, à caufe
de fa reffemblance avec un balai. L’extrémité de
l’épi, qui porte des fleurs ftériles & des écailles,
dont l’affemblage forme une efpece de coeur rougeâtre
, s’appelle en Malays djantong^ c’eft-à-dire,
le coeur, en latin cor félon Rumphe. Les bourgeons
011 cayeux, flolones, qui pouffent au pied des bananiers.,
s’appellent anack en langage Malays.
Le pays originaire des bananiers a donné lieu à
bien des difcuffions de la part des auteurs. Cette
plante a été- connue des anciens : il paroît que c’eft
le dudaïm. des Hébreux, & le figuier d’Adam, ficus
Adami, ou la pomme de paradis, pomum paradiji
des Syriens. L’Eclufe , Clufius, dans fes notes fur
le dixième chapitre du fécond livre des aromates
de Garcias , femble croire que c’eft le palma cypria
que Théophrafte, au livre I I de fes plantes, chapitré
8, dit avoir les feuilles plus grandes que celles d’aucun
autre palmier, & le fruit plus.grand qu’une
grenade , mais alongé , quat folia gerit multb majora
cunctis palmis, fruclumque majorent porno granati, fed
oblongum ; ou bien , dit le même l’Eclufe , ce feroit
cet autre arbre que décrit encore Théophrafte ait
livre I V , chapitre 5 , en difant qu’il a les feuilles
longues de deux coudées , femblables aux plumes
de l’autruche ; arbqr quee longiffimum gerit folium fî-
mileplumisflruthiocameli quagaleis imponuntur, quod-
que binos cubitos longum ef. Mais 'cette opinion de
l’Eclufe eft d’autant moins vraifemblable, que fi le
bananier eut exifté dès-lors en Chypre, il fe fut certainement
répandu dans les environs. La citation de
Pline eft la plus ancienne de celles qui ont quelque
rapport'avec le bananier.: voici ce qu’il en dit dans
fon Hifoire naturelle , livre X I I , chapitre (f, major
alia porno, 6* fuavitate proecel'lentior , quo fapientes
Indorum vivant. Folium alas avium imitatur, longi-
tudine trium cubitorum , latitudine duum. Fruclum cor-
tice emittit, admirabilem fucci dulcedine ut uno qua-
ternos fatiet. Arbori nomen paies , porno arienoe. Plu-
rima efl in fydracis expeditionum Alexandri termino.
Bjl & alla Jimilis huïe , dulcior porno , Jed interaneo-
rum valetudini infefla. Edixerat Alexander ne quis ao~
minis fu i id pomum attingeret. On ne pouvoit certainement
défigner plus clairement les deux efpeces de
bananier les plus communes. Ses feuilles , en effet
par leur forme oblongue , & lorfqu’elles fe déchi-
renj, peuvent fe comparer aux grandes plumes de
l’autruche. Les Brames, qui.font les fages des Indes,
en font leur principale nourriture, parce qu’ils s’abf-
tiennent.communément de chair. Son nom ancien
pala ne différé de celui de bala d’aujourd’hui, que
comme le mot ancien papyrus, diffère du babir des
Arabes qui étoit le .fouchet du papier. Le peuple çle
Sydrace eft fans doute la nation des Oxydraces qui
habite le centre de l’Afie où Aléxandre pénétra ,
comme on l’apprend dans l’hiftoire de Quinte-Carce.
Enfin la fécondé efpece à fruit plus petit, dont Alexandre
défendit l’ufage à fon armée, parce qu’elle
dérange les eftomaes froids, eft celle que l’on nomme
communément bacovo en Guinée ou bacove.
Le bananier exiftoit donc dans les Indes du tems
d’Alexandre. Il exiftoit aufli dans l’Afrique fur la
cote de Guinée, depuis le Sénégal jufqu’à Angola ,
où celui à gros fruit s’appelloit banana , & celui à
petit fruit, qui y eft le plus commun, fe nomme
bacovo , 'quoique Thevet dife que ce nom qu’il corrompt
en celui de pacona, pacoba & bacoba , eft un
nom Américain. On fait le contraire par Oviedo,
qui affure que les premiers bananiers qui aient été
vus en Amérique , y ont été tranfportés de la grande
île Canarie , où ils fe cultivoient depuis long-tems :
on fait d’ailleurs que les Portugais les ont portés de
la Guinée au Bréfil,
f
F F f f f