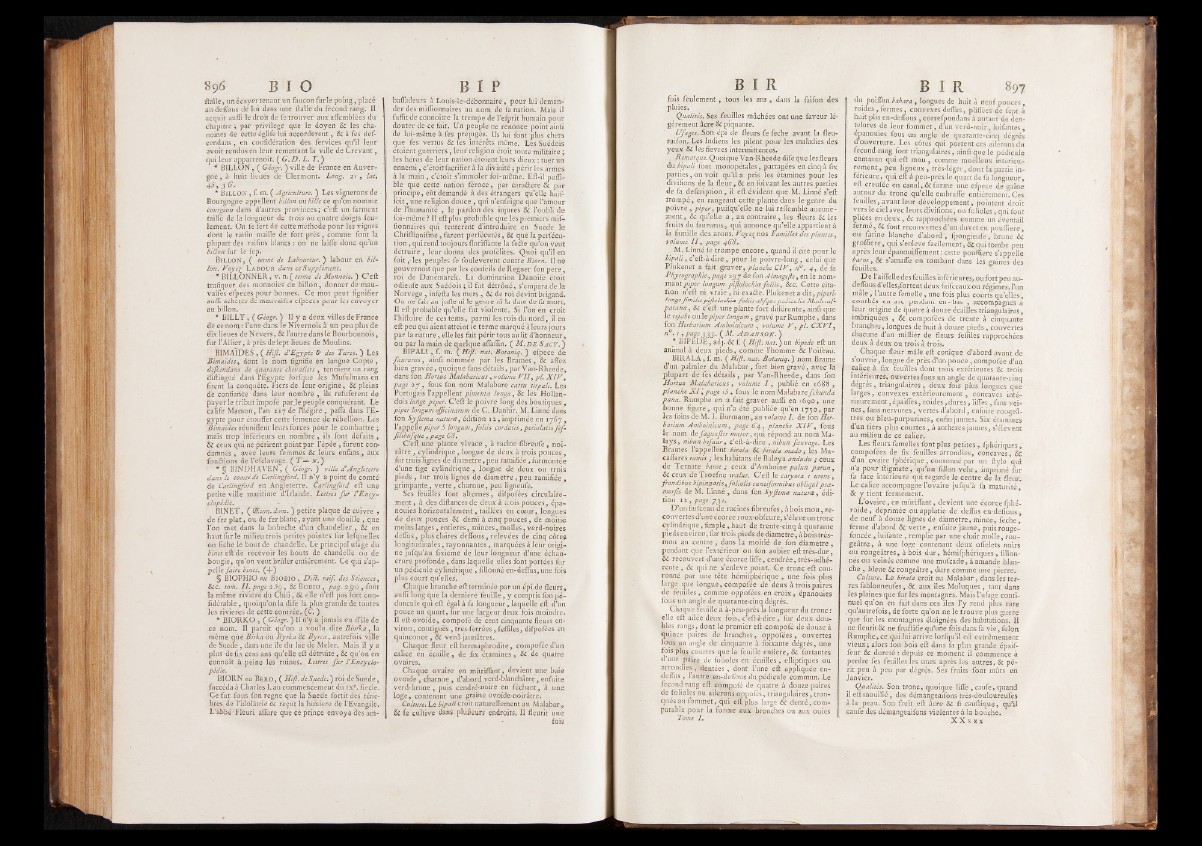
ftallé, un écuyer tenant un faucon furie poing, placé !
au-d'eflous de lui dans une Halle du fécond rang. Il
acquit auffi le droit de fe trouver aux affemblées du
chapitre ; par privilegë que le doyen 8c lés chanoines
de cette églife lui accordèrent, 8c à fes def-
cendans, en cormdétation dés fervices qu’il leur
avoit rendus en leur remettant la ville de Crevant,
qui leur apparténôit. ( G. D. L. T. )
* BILLON, ( Gêogr. ) ville de France en Auvergne,
à huit lieues de Clermont. Long. z'i , lat,
4 $ , $ 6 .
* Billon , f. m. ( Agriculture. ) Les vignerons de
Bourgogne appellent billon ou bille ce qu’on nomme
èourgeon dans d’autres provinces ; c’eft un farment
faille de la longueur de trois ou quatre doigts feulement.
On fe fert de cette méthode pour les vignes
dont le raifin maille de fort près, comme font la
plupart des raifins blancs : on ne laifl'e donc qu’un
billon fur le fep.
Billon, ( terme de Laboureur.') labour en billon.
Voye£ Labour dans ce Supplément.
* BILLONNER,' v. n;( terme de Monnoie. ) C’eft
. trafiquer des monnoîes de billon, donner de mauvaifes
efpeces pour bonnes. Ce mot peut lignifier
auffi acheter de mauvaifes efpecès pour les envoyer
au billon.
* BILLY, ( Gêogr. ) Il y a deux villes de France
dé ce nom : l’une dans le Nivernois à un peu plus de
dix lieues de NeVers, & l’autre dans le Bourbonnois,
fur l’Ailier, à près de fept lieues de Moulins.
BIMAIDES , (Hiß. d’Egypte & des Turcs. ) Les
Bimaïdés, dont le nom lignifié en langue Copte,
defcehdaris de quarante chevaliers , tenoient un rang
diftîngùé dans l’Égypte lorfqüe les Mùfulmaris ën
firent la conquête. Fiers de- leur origine, 8c pleins
de confiance dans lèur nombre , iß refuferent de
payer le tribut impofé par lé peuple conquérant. Le
calife'Mamon, Pan 217 de l’hégire , paffa dans l’Égypte
pour étouffer cette femencé de rébellion. Les
Bimaïdés réunifient leurs forces pour le combattre ;
mais trop inférieurs en nombre , ils font défaits ;
8c ceux qui ne périrent point par l’épée , furent condamnes
, avec leurs femmes & leurs enfaiis, aux
fondions de l’efclavage. ( T — N .j
' * § B1NDHAVEN, ( Gcogr. ) ville <TAngleterre
dans le comté de Carlingford. Il n’y a point de comté-
de' Carlingford en Angleterre. Carlingford éft une
petite ville maritime d’Irlande. Lettres fur VEncyclopédie.
BINET, ( (Ètcôn.dôm. ) petite plaque de cuivre ,
de fer plat., ou-de fer blanc, ayant une douille , ;qùe
l’on met dans la bobèche d’un chandelier , 8c en
haut fur le milieu trois petités pointes fur lesquelles
ôn fiche le bout de chandelle. Le principal ufage du
bïnet eftdè fécévôïr les bouts de chandelle où dé
bougie, qu’on veut brûler entièrement. Cè qui s’appelle
faire binet. (+ )
§ BIOPHIÖ ou B iO B lO , Dicl. raif. des Sciences,
& c . tom. II. page z 5c), 8c B o B lO , pag. 2 C)q ,■ font
l a m ê m e r i v i è r e d u C h i l i , 8c e l l e h ’é f t p a s f o r t c o n -
f i d é r a b l e , q u o i q u ’o n l a d if e la p lu s g r a n d e d é t o u t e s
l e s r iv i è r e s d e c e t t e c o n t r é e . (C. )
* BIORKO , ( Gêogr. ) Il n’y a jamais eu d’îlè de
ce nom. Il paroît qu’ôri a voulu dire Biorka, la
même qüè Birkaow Byrka&C Byrca, autrefois ville
de Suede, dàns ùné îlë du lac de Meier. Mais il y a
plus de fix cens ans qu’elle eft détruite, 8c qu’on en
connoît à peine les ruinés. Lettres fur f Encyclopédie.
BIORN ou Bero, ( Hiß. de Suède. ) roi de Suede,
fuccéda à Charles I. au commencement du IXe. fiecle.
Ce fut fous fon regne que la Suede fortit des ténèbres.
de l’idolâtrié 8c reçut la lumière de l’Evangile.-
L’abbé-Fleuri afliire que cè prince envoya des ambafladeurs
à Louis-le-débonnaire, pour lui demander
des millionnaires au nom de fa nation. Mais il
fuffit de connoître là trempe de l’efprit humain pour
douter de ce fait. Un peuple ne renonce point ainfi
de lui-même à fes préjugés. Ils lui font plus chers
que fes vertus & fes intérêts même. Les Suédois
étoient guerriers, leur religion étoit toute militaire ;
les héros de leur nationétoient leurs dieux: tuer un
ennemi, c’étoit facrifier à la divinité ; périr les armes
à la main , c’étoit s’immoler foi-même. Eft-il poffi-
ble que cetté nation féroce, par cara&ere 8c par
principe, eût demandé à dés étrangers qu’elle haïf-
foit, une religion douce , qui n’enfeigné que l’amour
de l’humanité , le pardon des injures 8c l’oubli de
foi-même? 11 eft plus probable que les premiers miffionnaires
qui tentèrent d’introduire en Suede le
Chriftianifine, furent perfécutés, 8c que la perfécu-
tion, qui rend toujours florifl'ante la fefte qu’on veut
détruire, leur donna des profélites. Quoi qu’il en
fo it ,- les peuples fe fouleverent contre Biorn. Il né
gouvernoit que par les confeils de Regner fon pere,
roi de Danëmarek. La domination Danoife étoit
odieufe aux Suédois ; il fut détrôné, s’empara de la
Norvège , infefta les mers , Sc.de roi devint brigand.
On ne fait au jufte ni le genre ni la date de fa mort.
Il eft probable qu’elle fut violente. Si l’on en croit
l’hiftoire dé ces tems, parmi les rois du nord, il en
eft peu qui aient atteint le terme marqué à leurs jours
par la nature, elle les fait périr tous au lit d’honneur,
ou par la main de quelque affaffin. ( M. d e Sac y . )
BIPALI , f. m. ( Hiß. nat. Botaniq. ) efpeee de
faururus, ainfi nommée, par les Brames, 8c affez
bien gravée, quoique fans détails, par Van-Rheede,
dans fon Hortus Malabaricus , volüme V il , pl. X IV ,
page 2 7 , fous fon nom Malabare cattu tirpali. Les
Portugais l’appellent pimenta longa, 8c les Hollan-
dois longe peper. C’eft le poivre long dés boutiques ,
piper longurn officinarum de C . Danhir. M. Linné dans
fon Syßema natures, édition 1 2 ,imprimée en 1767,
l’appelle piper 5 longurn, foliis cordatis , petiolatis fef-
ßlibüfque, page G8.
C’eft' .une plante vivace , à racine fibrëùfe , noirâtre
, cylindrique, longue de deux à trois pouces ,
fur trois lignes de diamètre, peu ramifiée, furmontée
d’une tige cylindrique , longue de deux ou trois
pieds , lùr trois lignes de diamètre, peu ramifiée ,
grimpante, verte, charnue, peu lignéufe.
Ses feuilles font alternes, difpofées circulaire-
ment, à des diftances de deux à trois pouces, épanouies
horizontalement, taillées en coeur, longues
de deux pouces 8c demi à cinq pouces, de moitié
moins larges, entières, minces, molles, verd-noires
deflùs, plus claires deffous, relevées de cinq côtes
longitudinales, rayonnantes, marquées à leur origine
jufqu’au fixieme de leur longueur d’une échancrure
profonde, dans laquelle elles font portées fur
un pédicule cylindrique , fillonné en-deflùs,une fois
plus court qu’elles.
Chaque branche eft terminée par un épi de fleurs,
auffi long que la dernière feuille, y compris fon pc-
duncule qui eft égal à fa longueur, laquelle eft d’un
pouce un quart, fur une largeur deux fois moindre.
11 eft ovôiae, compofé de cent cinquante fleurs environ,
contiguës, très-ferrées, feffiles, difpofées en
quinconce, 8c verd-jaunâtres.
Chaque fleur eft hermaphrodite, compoféed’un
calice en écaille, de fix étamines , 8c de quatre
.ovaires..
Chaque ovaire en mûriflant, devient une baie
ovoïde, charnue , d’abord verd-blanchâtre, enfuite
verd-brune , puis cendré-noire en féchant, à une
loge., contenant une graine ovoïde-noirâtre.
Culturti Le bipali croît naturellement au Malabar ,
8c fe cultive dans plufieurs endroits, Il fleurit une
• fois
fois feulement, tous les ans , dans la faifon des
pluies.
Qualités. Ses feuilles mâchées ont une faveur légèrement
âcre 8c piquante.
Ufages. Son épi de fleurs fe feche avant la fleu-
raifon. Les Indiens les pilent pour les maladies des
yeux 8c les fîevres intermittentes.
Remarque. Quoique Van-Rheede dife que les fleurs
du bipali font monopétalès, partagées eh cinq à fix
parties, on voit qu’il-a pris les étamines pour les
divifions de la fleur, 8c en fuivant les autres parties
de fa defeription, il eft évident que M. Linné s’eft
trompé, en rangeant cette plante dans le genre du
poivre , piper, puifqu’elle ne lui reffemble aùcune-
ment, 8c qu’elle a , au contraire, les fleurs 8c les
fruits du faururus, qui annonce qu’elle appartient à
la famille des arons. Voye^nos Familles des plantes,
volume I I , page 468.
M. Linné fe trompe encore, quand il cite pour le
bipali, c’eft-à-dire, pour le poivre-long , celui que
Plukenet a fait graver, planche CIV, n°. 4, de fa
Phytographie, page z y j de fon Almagefle, en le nommant
piper longurn piflolochioe foliis, 8cc. Cette citation
n’eft ni vraie , ni exatte. Plukenet a dit ,piperi-
longofimilis pißolochia foliis ab f que pediculis Maderaf-
patana, Sc c’eft une plante fort différente, ainfi que
le tsjabe ou le piper longurn, gravé par Rumphe, dans
fon Herbarium Amboinicum , volume V , pl. CX V I,
n°. 1 , page j j j . ( M. A d a n so n . )
* BIPEDE, adj. 8c f. ( Hiß; nat. ) un bipede eft un
animal à deux pieds, comme l’homme 8c l’oifèau.
BIRALA, f. m. ( Hiß. nat. Botaniq. ). nom Brame
d’un palmier du Malabar, fort bien gravé, avec la
plupart de fes détails, par Van-Rheede, dans fon
Hortus Malabaricus, volume 7 , publié en 1688,
planche X I ,' page i5 , fous le nom Malabare fehunda
pana. Rumphe en a fait graver auffi en 1690, une
bonne figure, qui n’a été publiée qu’en 1750, par
les foins de M. J. Burmann, au volume I. de fon Herbarium
Amboinicum, page 6 4 , planche X I V , fous
le nom de faguafier major, qui répond au nom Ma-
la y s , nibun befaar, c’eft-à-dire , nibun fauvage. Les
Brames l’appellent birala 8c birala mado ; les Ma-
caffares ramis ; les habitans de Baleya andudu ; ceux
de Ternate baroe ; ceux d’Amboine palun parun,
8c ceux deTroefne walut. C ’eft le caryota / urens,
frondibus bipinnatis, foliolis cuneiformibus obliqué pra-
morfis de M. Linné, dans fon Syßema natura, édition
12 , page 731.
D’un faifeeau de racines fibreufes, à bois mou, recouvertes
d’une écorce roux-obfcure, s’élève un tronc
cylindrique, fimplc, haut de trente-cinq à quarante
pieds environ, fur trois pieds de diamètre, à bois très-
mou au centre , dans la moitié de fon diamètre,
pendant que l’extérieur ou fon aubier eft très-dur,
8c recouvert d’une écorce liffe, cendrée, très-adhérente
, 8c qui ne s’enleve point. Ce tronc eft couronné
par une tête hémifphérique , une fois plus
large que longue, compofée de deux à trois paires
de feuilles, comme oppofées en croix, épanouies
fous un angle de quarante-cinq dégrés.
Chaque feuille a à-peu-près la longueur du tronc :
elle eft ailée deux fois, c’eft-à-dire, fur deux doubles
rangs, dont le premier eft compofé de douze à
quinze paires de branches, oppofées, ouvertes
fous un angle de cinquante à-foixante dégrés, une
fois plus courtes que la feuille entière, 8c fortantes
d’une paire de folioles en écailles , elliptiques ou
arrondies, dentées , dont l’une eft appliquée en-
deflùs , l’autrè en-deffous du pédicule commun. Le
fécond rang eft compofé de quatre à douze paires
de folioles ou ailerons oppofés, triangulaires, tronques
au fommet, qui eft plus large 8c denté, comparable
pour la forme aux bronches ou aux ouies j
Tome I,
du poiflon babara , longues de huit à neuf pouces,
roides , fermes, convexes deflùs, pliflëes de fept à
huit plis en-deffous , correfpondans à autant de dentelures
de leur fommet, d’un verd-noir, Iuifantes ,
épanouies fous un angle de quarante-cinq dégrés
d’ouverture. Les côtes qui portent ces ailerons du
feçond rang font triangulaires, ainfi que le pédicule
commun qui eft mou, comme moelleux intérieurement
, peu ligneux, très-léger, dont la partie inférieure,
qui eft à peu-près le quart de fa longueur,
eft creufée en canal, 8c forme une efpeee de gaine
autour du tronc qu’elle embraffe entièrement. Ces
feuilles, avant leur développement, pointent droit
vers le ciel avec leurs divifions, ou folioles, qui font
P:hées en deux, 8c rapprochées comme un éventail
ferme, 8c font recouvertes d’un duvet en pouffiere,
ou farine blanche d’abord , fpongieufe, brune 8c
groffiere, qui s’enleve facilement, 8c qui tombe peu
après leur épanouiffement : cette pouffiere s’appelle
baroe, 8c s’amaffe en tombant dans les , gaines des
fouilles.
De l’aiffelle des fouilles inférieures, ou fort peu au-
deffous d’elles,fortent deux faifeeaux ou régimes, l’un
mâle, l ’autre femelle, une fois plus courts qu’elles,
courbés en arc pendant en - bas , accompagnés à
leur origine de Quatre à douze écailles triangulaires,
imbriquées , 8c compofées de trente à cinquante
branches, longues de huit à douze pieds , couvertes
chacune d’un millier de fleurs feffiles rapprochées
deux à deux ou trois à trois.
Chaque fleur mâle eft conique d’abord avant de
s’ouvrir, longue de près d’un pouce, compofée d’un
calice, à fix feuilles dont trois extérieures 8c trois
intérieures, ouvertesfous un angle de quarante-cinq
dégrés, triangulaires, deux fois plus longues que
larges, convexes extérieurement, concaves intérieurement
, épaiffes, roides, dures, liffes, fans veines,
fans nervures, vertes d’abord, enfuite rougeâtres
ou bleu-purpurines, enfin jaunes. Six étamines
d’un tiers plus courtes , à anthères jaunes, s’élèvent
au milieu de ce calice.
Les fleurs femelles font plus petites, fphériques
compofées de fix feuilles arrondies, concaves, 8c
d’un ovaire fphérique, couronné par un ftyle qui
n’a pour ftigmate, qu’un fillon velu, imprimé fur
fa face intérieure qui regarde le centre de la fleur.
Le calice accompagne l’ovaire jufqu’à fa maturité,
& y tient fermement.
L’ovaire, en mûriflant, devient une écorce fphé-
roïde, déprimée ou applatie de deflùs en-deffous,
de neuf à douze lignes de diamètre, mince, feche,
ferme d’abord 8c v erte, enfuite jaune, puis rouge-
foncée , luifante , remplie par une chair molle, rougeâtre
, à une loge contenant deux offelets noirs
ou rougeâtres, à bois dur, hémifphériques , fillon-
nés ou veinés comme une mufeade, à amande blanche
, bleue 8c rougeâtre, dure comme une pierre.
Culture. Le birala croît au Malabar, dans les terres
fablonneufes, 8c aux îles Moluqués , tant dans
les plaines que fur les montagnes. Mais l ’ufage continuel
qu’on en fait dans ces îles l’y rend plus rare
.qu’autrefois, de forte qu’on ne le trouve plus guère
que fur les montagnes éloignées des habitations. Il
ne fleurit 8c ne fruôifie qu’une fois dans fa v ie , félon
Rumphe, ce qui lui arrive Iorfqu’il eft extrêmement
vieux ; alors fon bois eft dans fa plus grande épaif-
feur 8c dureté : depuis ce moment il commence à
perdre fes feuilles les unes après les autres, & périt
peu à peu par dégrés. Ses fruits font mûrs en
Janvier.
Qualités. Son tronc, quoique liffe , caufe, quand
il eft mouillé, des démangeaifons très-douloureufes
à la peau. Son fruit eft âcre 8c fi cauftique, qu’il
caufe des démangeaifons violentes à la bouche.
X X x x x