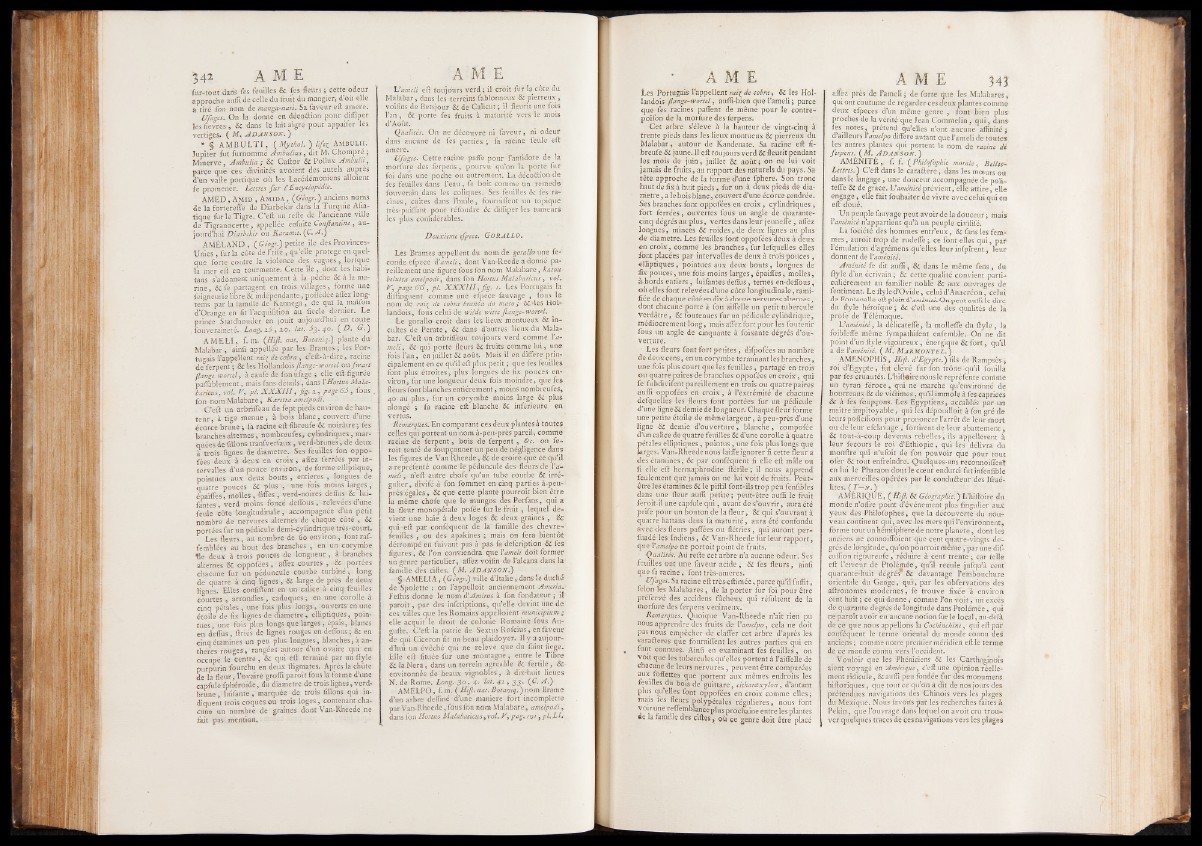
fur-tout 'dans fes feuilles & fes fleurs ; cette odeur
approche aufli de celle du fruit du mangier, d’oîi elle
â tiré fon nom de manga-nari. Sa faveur eft amère.
[/(âges. On la donne en déco dion pour difliper
les fievres -, & dans le lait aigre polir appaifer les
vertiges. ( M . A d a n -s o n . )
* § A M B U L T I , ( MytJiol. ) lifei A mbu lh.
Jupiter fut furhommé Âmbülius, dit M. Chompre;
Minerve 5 Ambulia ,■ O a l to r & Pollux Amhulii,
parce que ces divinités avoient des autels auprès
d’un vafte portique ou les Lacédémoniens alloient
fe promener. Lettres fur VEncyclopedie.
AMED, Amid , Amida , (Géogr. ) anciens noms
de la fortérelîe de Diarbekir dans la Turquie Asiatique
fur le Tigre. C ’eft un refte de l’ancienne ville
de Tigranocerte , appelléè énfuite Conflantine , aujourd’hui
Diarbekir ou Raramit. (C. A.)
ÀMÉLAND , {Géogr.) petite île des Provinces-
Unies', furila côte de Frife , qu’elle protégé en quelque
forte; contre la violence , des- vagues , dorique-
la mer eft en tourmente. Cette île , dont les habitons
s’adonnent uniquement à la pêche oc à la marine,
& fe partagent en trois villages , forme une
feigneurie libre & indépendante, poflèdée allez long-
tems par la famille de Kannega, de qui la maifon
d’Oranere en fit Tacquifition au fiecle dernier. Le
prince Statdhouder en jouit aujourdhui en toute
, fouveraineté. Long. 2 S , 20. lat. S3. 4°* ( L). )
A M E L I , f. m. (Hift. nat. Botaniq.)plante du
Malabar , ainfi appellée par les Brames ; les Portugais
l’appellent rai{ decctbra, c’eft-a-dire, racine
de ferpent ; & les Hollandois jlange-wortel ou fwart
fange wortel, à caufe de fonufage ; elle eft-figurée
paflablement, mais fans détails, dans 1’Hortus Mala-
baricus, vól. V, pi. X X X I I I , fig. 2 , page 6 5 , fous .
fon nom Malabare, Raretta amelpodi. ■ ■
C ’eft un arbriffeau de fept pieds environ de hauteur
à tige menue, à bois blanc, couvert d’une
écorce brune ; -fa racine eft fibreufe & noirâtre'; fes
branches alternes, nombreufes, cylindriques, marquées
de filions tranfverfaux, verd-brunes, de deux
à trois lignes de diamètre. Ses feuilles fon oppofées
deux à d eu x ’en croix , affez ferrées par intervalles
d’un pcrucë environ , de forme elliptique,
pointues aux deux bouts , entières', longues de
quatre pouces & plus ., une fois moins larges,
épaifles, molles, 'liffes, Vferd-noires deffus & -lui-
fantes; verd moins’foncé d'effous , relevées’d’une
feule cote longitudinale , accompagnée d’un petit
nombre de nervures alternes de chaque coté , &
portées fur un pédicule dëmi-eyKndriqué très^court.
Les fleurs , au nombre de 60 environ , fontraf-
femblées au bout des branches , en un corymbe
^e deux à-trois pouces de : longueur , à' branches
alternes & oppofées , - affez courtes , & portées
chacune fur un peduncule courbe turbine, long
de quatre à cinq lignes*, & large de près de deux
lignes. Elles confiftent en un calice-à cinq feuilles
courtes , arrondies, caduques ; en une corolle à
cinq pétales, une fois plus -longs-, ouverts'en une
étoile de fix lignes de diamètre, elliptiques, pointues,
une fois plus longs que larges, épais-, blancs
en deffus, ftriés de lignes rouges emdeflbus ; & en
cinq étamines un peu plus longues, blanches, a anthères
rouges, rangées autour d’un ovaire qui en
occupé le Centré , & qui eft terminé par un ftyle
purpurin fourchu en deux ftigmates. Après la chute
de la fleur, l’ovaire grofti paroît fous là forme d’une
capfule fphéroïde, du diamètre de trois lignes, verd-
. brune , luifante , marquée - de trois filions, qui indiquent
trois coques ou trois loges, contenant chacune
un nombre de graines dont Van-Rheede ne
Jàit pas; mention.
Uameli eft toujours verd ; il croît fur la côte du
Malabar-, dans les terreins fablonneux & pierreux,
voifîns de Betsjour & de Çalicut ; il fleurit une fois
1*30, & porte fes frliits à maturité vers le mois
d’Août.
Qualités. On ne découvre ni faveur, ni odeur
dans aucune de fes parties ; fa racine feule eft
ameré.
Ufâges. Cette racine paffe pour l’antidote de la
morfure des ferpens, pourvu qu’ôn la porte fur
foi dans une poche ou autrement. La décoftion de
fes feuilles dans l’eau, fe boit comme tin remedo
fouverain dans les coliques. Ses feuilles & fes racines,
cuites dans l’huile, folirniffent un topique
très-puiffant pour réfoudre & difliper les tumeurs
les plus confidérâbles.
Deuxieme efpece. G o r a l l o .
Les Brames appellent du nom de gorallo une fécondé,
efpece iïameli, dont Van-Reéde a donné pareillement
une figure fous fon nom Malabare, katou.
belutta amelpodi, dans fon Hortus Malabaricus , vol.
y , page 6 6 , pl. X X X I I I , fig. r. Les Portugais la
diftinguent comme une efpece fauvage , fous le
nom de raiz de cobra branca do mato ; & ‘les Hollandois;
fous celui de wilde witte flange-wortel.
Le gorallo croît dans les lieux montueux & incultes
de Perate,- & dans d’autres lieux du Malabar.
C’ eft un àrbriffeau toujours verd comme l'a-
meli, & qui porte fleurs & fruits comme lui ; une
fois l’an , en juillet & août. Mais il en différé principalement
en ce qu’il eft plus petit ; que fes feuilles
font plus étroites, plus longues de fix pouces environ,
fur une longueur deux fois moindre, que fes
fleurs font blanches entièrement, moins nombreufes,
40 au plus, fur un corymbe moins large & plus
alongé ; fa racine eft blanche & inférieure en
vertus.
Remarques. En comparant ces deux plantes à toutes
celles qui portent un nom à-peu-près pareil; comme
radine de ferpent, bois de ferpent , &c. on fe-
roit tenté de foupçonner Un peu de négligence dans
les figures de Van Rheede, & de croire que ce qu’il
a repréfenté comme Té pëdüncule des fleurs de l’a-
méli, n’eft autre chofe qu’un tube courbe & irrégulier,
divifé-à fon fominet en cinq parties à-peu-1
près égales, & que cette plante pour-roit bien être
la même chofe que le mungos des Perfans, qui a
la fleur monopétale pofée fur le fruit , lequel devient
une baie à deux loges & deux graines , &
qui -eft par conféquent de la famille des chèvrefeuilles
, ou des apakines ; mais on fera bientôt
détrompé en fuivânt pas à*pas fa defcription & fes
figures, & l’on conviendra que Uameli doit former
un genre particulier, affez voifin de l’alcana dans la
famille des ciftes. ( M . A d a n s o n é)
§ -AMELIA, (Géogr.) ville d’Italie, dans le duché
de Spolette : on l’appelloit anciennement Amenai
Feftus donne le nom 6 A miras à fon fondateur ; il
paroît, par des infcriptions^ qu’elle devint line de
ces villes que les Romains appelaient municipium ;
elle acquit le droit de colonie Romaine fous Au-
gufte. C’éft la patrie de Sextus Rofcius, en faveur
de qui Cicéron fit un beau plaidoyer. Il y a aujourd’hui
un évêché qui ne releve que du faint fiege.
Elle eft fituée fur une montagne, entre le Tibre
& la N era, dans un ferrein agréable & fertile, &
environnée de beaux vignobles, à dix-huit lieues
N. de Rome. Long, 3 0 , 4. làt. 4 2 , 3 3 . (C. A.)
AMELPO, f. m. ( fâijl. nat. Botaniq'. ) nom Brame
d’un arbre deffiné d’une maniéré fort incomplette
par Van-Rheede, fôus fon nom Malabare, amelpodi,
dans fon Hortus Malabaricus, vol. y , pag, iqi t pl. LL
Les Portugais Rappellent rai[ de cobra ; & les Hollandois
flange-wortel, aufli-bien que l’ameli ; parce
que fes racines paffent de même pour le contre-
poifon de la morfure des ferpens.
Cet arbre s’élève à- la hauteur de vingt-cinq à
trente pieds dans les lieux montueux & pierreux du
Malabar , autour de Kandenate. Sa racine eft fibreufe
& jaune. Il eft tou jours verd & fleurit pendant
les mois de j u i n ; juillet & août; on ne lui voit
jamais de fruits ; au rapport des naturels du pays. Sa
tête approche de la forme d-’une fphere. Son tronc
haut de fixa huit pieds , fur un, à- deux pieds de diamètre
, a le bois blanc, couvert d’une écorce cendrée.
Ses branches font oppofées en cro ix, cylindriques ;
fort ferrées, ouvertes fous un angle de quarante-
cinq dégrés au plus, vertes dans leur jeuneffe, affez
longues, minces &c roides, de deux lignes au plus
de diamètre. Les feuilles font oppofées deux, à deux
en croix, comme les branches, fur l e f q u e l l e s elles
font placées par intervalles de deux à trois pouces ,
elliptiques, pointues aux deux bouts, longues de
•lïx pouces, une fois moins larges, épaiffes, molles, à, bords entiers , luifantes deffus, ternes en-deffous,
o i i elles font relevées d’une côté longitudinale, r a m i f
i é e de chaque côté en dix à douze nervures alternes,
dont chacune porte à fon aiffelle un petit tubercule
Verdâtre, & Soutenues fur un pédicule cylindrique ,
médiocrement long, mais affez fort pour les foutenir
fous u n angle de cinquante à foixante dégrés d’ouverture.
' Les f l e u r s font fort petites, difpofées au nombre
de deux cens , en un corymbe terminant les branches,
une fois plus court que les feuilles , partagé en trois-
ou quatre paires de branches oppofées en croix, qui
fe fubdivilent pareillement en trois ou quatre paires
aufli Oppofées en croix, à l’extrémité de chacune:
defqueiles -les fleurs font portées fur un pédicule
d’une ligne & demie de longueur. Chaque f l e u r forme
une petite étoile de même largeur, à peu-près d’une
ligne & demie d’ouverture, blanche, compofée'
d’un calice de quatre feuilles & d’une corolle à quatre
pétales elliptiques, pointus, une fois plus longs que
larges. Van-Rheede nous laiffe ignorer fi cette fleur a
des étamines, & par conféquérit fi elle eft mâle ou
li elle eft hermaphrodite ftérile ; il nous apprend
feulement que jamais on ne lui voit de fruits. Peut-
être les étâmirtes & le piftil font-ils trop peu fenfibles
dans une fleur aufli petite ; peut-être aufli le fruit
feroit-il une capfule q u i, avant de s’ouvrir, aura été
prife pour un bôuton de la fleur, & qui s’ouvrant à
quatre battons dans fa maturité, aura été confondu
avec des fleurs paffées ou flétries, qui auront per-
fuadé les Indiens, & Van-Rheede fur leur rapport,
q u e Vamelpo ne portoit point de fruits.
Qualités. Au refte cet arbre n’a aucune ôdèur. Ses
feuilles ont une faveur acide , & fes fleurs, ainfi
que f a racine, font t r è s - a m c r e s ;
Ufages. Sa racine eft très-eftimée, parce qu’il fuflit,
félon les Malabares , de la porter fur foi p o u r être
préfervé des accidens fâcheux qui réfultent de la
morfure des ferpens venimeux.
Remarques. Quoique Van-Rheede n’ait rien pii
nous apprendre des fruits de Vamelpo, cela ne doit
pas nous empêcher de claffer cet arbre d’après les
caraQeres que fourniffent les autres parties qui en
font connues. Ainfi en examinant fes feuilles, on
voit que les tubercules qu’elles portent à l’aiffelle de
chacune de leurs nervures, peuvent être comparées
âux foffettes que portent aux mêmes endroits les
feuilles^du bois de guittare, citharcexylon, d’autant
plus qu elles font oppofées en croix comme elles ;
mais fes fleurs polypétales régulières, nous font
v 01 r une reffemblance plus prochaine entre les plantes
«ç la tamiuç des ciftes, où ce genre doit être placé
; affez près de l’ameli ; de forte tpie les Malabares,
qui ont coutume de regarder ces deux plantes comme
deux efpeces d’un même genre , font bien plus
proches de la vérité que Jean Commelin , q u i, dans
fes notes prétend qu’elles n’ont aucune affinité ;
d ailleurs 1 am e lp o différé autant que l’ameli de toutes
les autres plantes qui portent le nom de r a c in e d i
f e r p e n s . (M. A d a n s o n . ')
AMÉNITÉ,, f. f. ( Philofôphie morale, Belles*
Lettres. ) C’eft dans le cara&ere, dans les moeurs oit
dans le langage, une douceur accompagnée de poli-
teffe & de grâce. L’aménité prévient, elle attire, elle
engage, elle fait fouhaiter de vivre avec celui qui en
eft doué;
Un peuple fauvage peut avoir de la douceur ; mais
Y aménité n’appartient qu’à un peuple- civilifé.
La fociété des hommes entr’eux, & fans les femmes
, auroit trop de rudeffe ; ce fönt elles qui, par
l’émulation d’agrémens qu’elles leur infpfrent, leur
donnent de l'aménité.
Aménité fe dit aufli , Si dans le même ferts, dit
ftyle d’un écrivain ; & cette qualité convient parti-*
euliérement au familier noble & aux ouvrages de
feritiment» Le ftyle d’Ovide, celui d’Anacréôn, celui
de Fontenelle eft plein 6 aménité. On peut aufli le dire
du ftyle héroïque; ÔC c’eft une des qualités de la
profe de Télémaque.
L’aménité, la deÜcatèffe, la mollefle dti ftyle , la
foibleffe même fympathifent enfemble. On ne dit
point d’un ftyle-vigoureux, énergique & fo r t , qu’il
a de Vaménité. ( M. MarMonte l. )
AMENOPHIS, Hiß. d'Egypte.') fils de Raiiipsès,
roi d’Egypte, fut élevé für fon trône-qu’il fouilla
par fes cruautés. L’hiftoire nous le repréfente comme
un tyran féroce, qui- ne marché qu’envirOnné1 de
bourreaux & de yiriimes, qu’il immole à fes caprices
& à fes foupçons. Les Egyptiens, accablés par un
maître impitoyable ^ quiles dépOuilloit ä fon gré dé
leurs poffeflions pour prononcer l’arrêt de leur mort
Ou de leur efelavage > fortïrent dé leur abattement,
& tOut-à-coup devenus rebelles, iis appellerent à
leur fecours lé roi d’Ethiopie, qui les ' délivra du
monftre qui n’ufôit de fon pouvoir que pour tout
ofer & tout enfreindre. -Quelques-uns reconnoifferit
en lui le Pharaon dont le coeur endurci fut infenfible
aux merveilles opérées par le eondu&eur des Ifraé-
lites. ( T— N. )
AMÉRIQUE, ( Hiß. & Géographie.) -L’hiftoire du
monde n’offre point d’événement plus fingulier aux
yeux des:Philofophes, que la découverte du nouveau
continent qui, avec les mers qui l’environnent,
forme tout un hémifphere de notre planete, dont les
anciens ne connoiffoient que cent quatre-vingts degrés
de longitude, qu’On pôurroit même, par une dif-
euflion rigourëufe, réduire à cent trente; car telle
eft l’erreur, de Ptolémée, qu’il recule jufqu’à cent
quarantë-hiïit dégrés- & davantage l’embouchure
orientale du Gange, qui, par les obfervatiöns des
aftronörries modernes, fe trouve fixée a environ
cent huit ; ce qui donnecomme l’On v o it , un excès
de quarante degrésdë longitude dans Ptolémée, qui
ne paroît avoir eu audune notion fur le local, au-delà
de ce que nous appelions la Cochinchtne, qui eftpâr
conféquent le terme Orientai du monde connu deä
anciens ; comme notre premier méridien eft le terme
de ce monde connu vêts l’occident.
Vouloir que les Phéniciens &. les Carthaginois
aient voyagé ert Amérique, c’eft une Opinion réellement
ridicule, & aufli peu fondée fur des monumens
hiftoriques, que tout ce qu’on a dit de nos jours des
prétendues navigations des Chinois vers les plages
du Mexique. NousfavOrts par les recherches faites à
Pékin, que l’ouvrage darts lequel on a voit cru trouver
quelques traces de ces navigations vers les plages