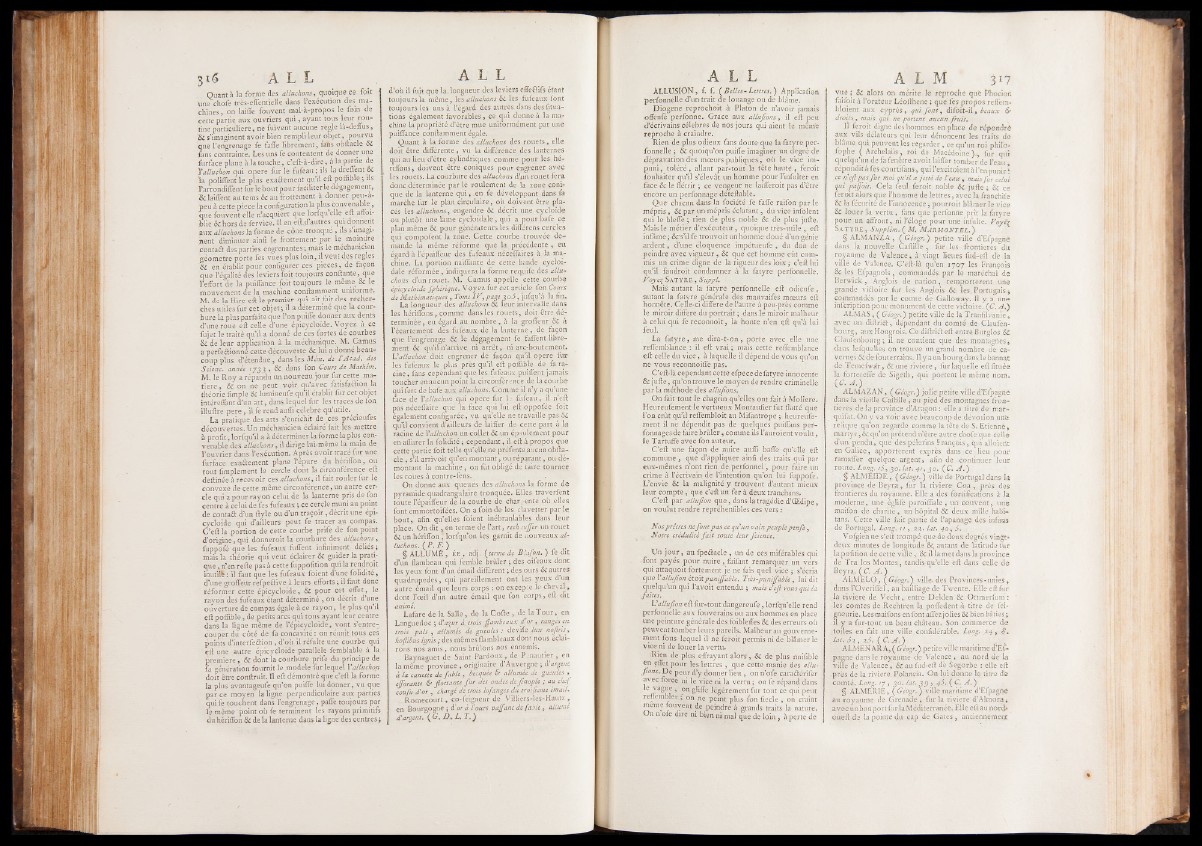
Quant à la forme des alluchons, quoique ce fait
une chofe très-effentielle dans l’exécution des machines
, on laiffe fouvent mal-à-propos le foin de
cette partie aux ouvriers q u i, ayant tous leur routine
particulière, ne fuivent aucune réglé là-deffus,
& s’imaginent avoir bien rempli leur objet, pourvu
que l’engrenage fe faffe librement, fans obftacle 8c
fans contrainte. Les uns fe contentent de donner une
furface plane à la touche, c’eft-à-dire -, à la partie de
Yalluchon qui opéré fur le fufeau ; ils la dreflent 8c
la poliffent le plus exactement qu’il eft poffible ; ils
l’arrondiffent fur le bout pour faciliter le dégagement,
& laiffent au tems 8c au frottement à donner peu-à-
peu à cette piece la configuration la plus convenable,
que fouvent elle n’acquiert que lorfqu elle eft affoi-
blie 8c hors de fervice. Il en■ efM’autres q # donnent
aux alluchons la forme de cône tronqué , ils s’imaginent
diminuer ainfi le frottement par te moindre
contact des parties engrenantes ; mais 1e méchanicien
géomètre porte fes vues plus loin, il veut des réglés
& en établit pour configurer ces' pièces, de façon
que l’égalité des leviers foit toujours confiante, que
l’effort de la puiffance foit toujours 1e même 8c le
mouvement de la machine conftamment uniforme.
M. de la Hire eft le premier qui ait fait des recherches
utiles fur cet objet; il a déterminé que la courbure
la plus parfaite que l’on puiffe donner aux dents
d’une roue eft celte d’une épicycloïde. Voyez à ce
fujet le traité qu’il a donné de ces fortes de courbes
& de leur application à la méchanique. M. Camus
a perfectionné cette découverte 8c lui a donné beaucoup
plus d’étendue, dans tes Mêrn. de I Acad, des
Scienc. année 173 3 , 8c dans fon Cours dt Mathem.
M. le R oy a répandu un nouveau jour fur cette matière,
& on ne peut voir qu’avec fatisfaction la
théorie fimple & lumineufe qu’il établit fur cet objet
intéreffant d’un art, dans.lequel fur les traces de fon
illuftre pere, il fe rend aufli célébré qu’utile.^
La pratique des arts s’enrichit de ces précieufes
découvertes. Un méchanicien éclairé fait les mettre
à profit, lorfqu’il a à déterminer la forme la plus convenable
des alluchons, il dirige lui-meme la main de
l’ouvrier dans l’exécution. Après avoir tracé fur une
furface exactement plane l’épure du hériffon, ou
tout Amplement 1e cercle dont la circonférence eft
deftinée à recevoir- ces alluchons, il fait rouler fur le
Convexe de cette même circonférence, un autre cercle
qui a pour rayon celui de la lanterne pris de fon
centre à celui de fes fufeaux ; ce cerçle muni au point
de contaCt d’un ftyle ou d’un traçoir, décrit une epi-
cycloïde qui d’ailleurs peut fe tracer au compas.
C ’eft la portion de cette courbe prife de fon point
d’origine, qui donneroit la courbure des alluchons,
fuppofé que tes fufeaux fuffent infiniment délies ;
mais la théorie qui veut éclairer & guider la pratique
, n’ en refte pas à cette fuppofition qui la rendroit
inutili : il faut que les fufeaux foient d’une folidité,
d’une groffeür refpeftive à leurs efforts ; il faut donc
réformer cette épicycloïde, 8c pour cet effet, le
rayon des fufeaux étant déterminé , on décrit d’une
ouverture de compas.égale à ce rayon, 1e plus qu’il
eft poffible, de petits arcs qui tous ayant leur centre
dans- la ligne même de l’épicycloïde, vont s’entrecouper
du côté de fa concavité: on réunit tous ces
points d’interfe&ion, d’oii il réfulte une courbe qui
eft une autre épicycloïde parallèle femblable à la
première, & dont la courbure prife du principe de
fa génération fournit 1e modèle fur lequel Yalluchon
doit être conftruit. Il eft démontré que c’eft la forme
la plus avantageufe qu’on puiffe lui donner, vu que
par ce moyen la ligne perpendiculaire aux parties
quife touchent dans l’engrenage, paffe toujours par
le même ’point où fe terminent les rayons primitifs
du hériffon 8c de la lanterne dans la ligne des centres ;
d’où il fuit que la. longueur des leviers effeflifs étant
toujours la même, les alluchons 8c tes fufeaux font
toujours les uns à l’égard des autres dans desfitua-
ticjns également favorables, ce qui donne à la machine
la propriété d’être mue uniformément par une
puiffance conftamment égale.
Quant à la forme des alluchons des rouets, elle
doit être différente, vu la différence des lanternes
qui au lieu d’être cylindriques comme pour tes hé-
riffons, doivent être coniques pour engrener avec
tes rouets. La courbure des alluchons d’,un rouet fera
donc déterminée par le roulement de la zone conique
de la lanterne q ui, .en fe développant dans fa
marche fur le plan circulaire, où doivent être placés
les alluchons 9 engendre 8c décrit une cycloïde
ou plutôt une lame cycloïdale, qui a pour bafe ce
plan même 8c pour générateurs les différens cercles
qui compofent la zone. Cette courbe trouvée der
mande la même réforme que la précédente , eu
égard-à l’épaiffeur des fufeaux néceffaires à la mar
chine. La portion naiffante de cette bande cycloïdale
réformée, indiquera la forme requife des allu-
chons d’un rouet. M. Camus appelle cette courbe
épicycloïde J'phérique. Voyez fur cet article fon Cours
de Mathématiques , Tome page 3 o i , jufqu’à la fin.
La longueur des alluchons 6c leur intervalle dans
tes hériffons, comme dans les rouets, doit être déterminée,
eu égard au nombre, à la groffeür & à
l’écartement des fufeaux de la lanterne , de façon
que l’engrenage 8c 1e dégagement fe faffent librement
8c qu’il n’arrive ni arrêt, ni arc-boutement.
L'alluchon doit engrener de façon qu’il opéré fur
tes fufeaux le plus près qu’il eft poffible de fa racine,
fans cependant que tes fufeaux puiffent jamais
toucher en aucun point la circonférence de la courbe
quifert de bafe aux alluchons. Comme il n’y a qu’une
face de Yalluchon qui opéré fur le fufeau, il n’eft
pas néceffaire que la face qui lui eft oppofée foit;
également configurée,' vu qu’elle ne travaille pas 8c
qu’il convient d’ailleurs de îaiffer de- cette part à la
racine de Yalluchon un collet 8c un épaulement pour
en affurer la folidité ; cependant, il eft à propos que
cette partie foit telle qu’elle, ne préfente auciin obftacle
, s’il arrivoit qu’en montant, où réparant, ou démontant
la machine, on fut obligé de faire tourner
les roues à contre-fens. - -
On donne aux queues des alluchonsla forme de
pyramide quadrangulaire.tronquée. Elles traverfent
toute l’épaiffeur de la courbe de charpente où elles
font emmortoifées. On a foin de les clavetter par le
bout, afin qu’elles foient inébranlables dans leur
place. On d i t , en terme de l’art, rech mffer un rouet
& un hériffon, lorfqu’on tes garnit de nouveaux alluchons.
( P . F.')
§ ALLUMÉ, ÉE , adj. ( terme de BLifon. ) fe dit
d’un flambeau qui femble brfiler ; des oifeaux dont
tes yeux font d’un émail different ; des ours & autres
quadrupèdes, qui pareillement ont tes yeux d’un
autre .émail que leurs corps : ôn exçepte le cheval,
dont l’oeil d’un autre émail que fon corps, eft dit
animé.
Lafare de la Salle, de la Cofte ,- de la T ou r , ert
Languedoc ; d’azur à trois flambeaux ' d or, ranges en
trois pals , allumés de gueules : devife lux noflris,
hoflibus ignis ; des mêmes flambleaux dont nous éclairons
nos amis, nous brillons nos ennemis.
Baynaguet de Saint Pardoux, de P„'nantie^* , en
la même province , originaire d’Auvergne ; d argent
à la canette de fable , becquée & allumée de gueules ,
efforante & flottante fur des ondes de flnople ; au chef
coufu d'or , chargé de trois lof anges du troifieme émail-
Romecourt, co-feigne.ur de Villiers-les-Hautz ,
en Bourgogne ; d'or à l'ours paffant de fable, allume
£ argent, (G , D* L ,T .)
ALLUSION, f. f. (Belles-Lettres.) Application
perfonnelle d’un trait de louange ou de blâme.
Diogene reprochoit à Platon de n’avoir jamais
offenfé perfonne. Grâce aux alluflons, il eft peu
d’écrivains célébrés de nos jours qui aient le mem'e
reproche à craindre.
Rien de plus odieux fans doute que la fatyre perfonnelle
; 8c quoiqu’on puiffe imaginer un degré de
dépravation des moeurs publiques,. où le vice impuni
, toléré, allant par-tout la tête haute , feroit
louhaiter qu’il s’élevât un homme pour l’infulter en
face & le flétrir ; ce vengeur ne laifferoit pas d’être
encôre un perfonnage dëteftablè.
Que chacun dans la fociété fe faffe raifon par 1e
mépris, & par un mépris éclatant, du vice infolent
qui le bleffe ; rien de plus noble & de plus jufte.
Mais le métier d’exécuteur, quoique très-utile , eft
infâme ; & ‘s’il fe trouvoit un homme doué d’un génie'
ardent, d’une éloquence impétueufe , du don de
peindre avec vigueur, 8c que cet homme eut commis
un crime digne de la rigueur des loix ; c’eft lui
qu’il faudroit condamner à la fatyre perfonnelle.
Voye^ S a t y r e , Suppl.
Mais autant la fatyre .perfonnelle eft odieufe ,
autant la fatyre générale des mauvaifes moeurs eft
honnête. Celle-ci différé de l’autre à pëu-pr.ès comme
1e miroir différé du portrait ; dans 1e miroir malheur
à celui qui fe reconnoît, la honte n’en eft qu’à lui
feul.
La fatyre, me dira-t-on, porte avec elle une
reffemblanee : il eft vrai ; mais cette reffemblance
eft celle du v ice, à laquelle il dépend de vous qu’on
ne vous reconnoiffe pas.
C ’eft-là cependant cette efpece de fatyre innocente
8c jufte, qu’on trouve 1e moyen de rendre criminelle
par la méthode des alluflons.
On fait tout 1e chagrin qu’elles ont fait à Moliere.
Heureufement le vertueux Montaufier fut flatté que
l’on crût qu’il reffembloit au Mifantrope ; heureufement
il ne dépendit pas de quelques puiffans per-
fonnages de faire brûler * comme ils l’auroient voulu,
le Tartuffe avec fon auteur.
C ’eft une façon de nuire aufli baffe qu’elle eft
commune , que d’appliquer ainfi des traits qui par
eux-mêmes n’ont rien de perfonnel", pour faire un
crime à l’écrivain de l’intention qu’on lui fuppofe.
L ’envie 8c la malignité y trouvent d’autant mieux
leur compte, que c’eft un fer à deux tranchans.
C ’eft par allufion que, dans la tragédie d’OEdipe,
on voulut rendre repréhenfibles ces vers :
Nos prêtres ne font pas ce qu'un vain peuple penfe.
Notre crédulité fait toute leur fcience.
Un jo u r , au fpeûacle , un de ces miférables qui
. font payés pour nuire, faifant remarquer un vers
qui attaquoit fortement je ne fais quel vice ; s’écria
que Y allufion étoit punijfable. Trés-puniffable , lui dit
quelqu’un qui l’avoit entendu ; mais c'efl vous qui la
faites.
L’allufion eft fur-tout dangereufe, lorfqu’elle rend
perfonnelle aux fouverains ou aux hommes en place
une peinture générale des foibleffes & des erreurs où
peuvent tomber leurs pareils. Malheur au gouverne-
m.ent fous lequel il ne feroit permis ni de blâmer le
vice ni de louer la vertu.
(Rien de plus effrayant alors, & de plus nuifible
en effet pour les lettres , que cette manie des allu-
fions. De peur d’y donner lieu , on n’ofe caraétérifèr
avec force ni le vice ni la vertu ; on fe répand dans
.le vague , on gliffe légèrement fur tout ce qui peut
reflembler ; on ne peint plus fon fiecle , on craint
meme fouvent de peindre à grands traits la nature,
ü n n oie dire ni bien ni mal que de loin, à.perte de j
vue J & alors on mérite le reproché que Phocion
' faifoit à l’orateur Léofthene ; que f e s propos reflèm-
bloient aux cyprès, qui fo n t , difoit-il, beaux &
droits,mais qui ne portent aucun fruit.
il feroit digne des hommes en place de répondrè
aux vils délateurs qui leur dénoncent les traits dé
blâme qui peuvent les regarder , ce qu’un roi philo^
fophe ( Archelaiis, roi de Macédoine ),, fur qiti
quelqu’un de fa fenêtre avoit Iaiffer tomber de l’eau
-répondit à fes courtifans ■, qui l’excitoient à l’en punir ï
ce nefi pas fur moi qu'il a jetté de l'eau , mais fur celui
qui pàffoLt. Cela feul feroit noble & jufte ; & ce
feroit alors- que l’homme de lettres, avec la franchife
8c la fécurite de l’innocence, pourroit blâmer le vice
8c louer la v ertu , fans que perfonne prît la fatyre
pour un’ affront, ni l’éloge pour une infulte. V oy \
Sa t y r e , Supplém. ( M. M â r m o n t e l . )
§ ALMANZA , ( Géogr. ) petite ville d’Efpagne
dans la.nouvelle Caftille, , fur les- frontieres dit
royaume de Valence, :à- vingt lieues fud-eft de la
villë de Valence. C ’eft-là qu’en 1707 les François
& les Efpagnols , commandés par le maréchal de
Berwick, Anglois de nation, remportèrent une
grande victoire-.fu r .les Angiois & les. Portugais ,
commandés par 1e comté de Gallo^vay. Il y a une
i'nfcription pour monument de cette victoire. (C. A l)
ALMA S , ( Géogr. ) petite ville de la Tranfilvanie,
avec un diftrift, dépendant du comté de Claufen-
bourg, auxHOngroiSi Ce diftri&eft enfre,BurgIos 8c
Claufenbourg ; il., ne contient que des-montagnes,
dans lefquelle.s on trouve un grand nombre de; cavernes
& de fouterrains. Il y a un bourg dans 1e bannat
de TemefWa'r, & une riviere, fur laquelle eft fituée
la fortereffe de Sigeth, qui portent le même nom.
:(C- 4 .)
ALMAZAN, ( Géogr.') jolie petite ville d’Efpagne
dans la vieille Caftille, au pied des montagnes frontières
de la province d’Aragon : elle a titré de mar-
quifat. On y va voir avec beaucoup de dévotion une
relique quon regarde comme la tête d,e S. Etiennè,
martyr ,& qu’ on prétend n’être autre chofe "que celte
d un pendu, que dès pèlerins François, qui alloieiit
en Galice , apportèrent exprès dans , Ce., lieu pour
ramaffer quelque argent, afin de continuer leur
route. Long. i5 , go. lat. 4/, 30. (C. A .)
§ AL M EIDE, ( Géogr. ) ville de Portugal dans- la
province de Beyra , fur la riviere Çoa ,_près des
frontières du royaume. Elle a des fortifications à la
moderne, une églife paroiffiale, un couvent, une
maifqn de charité, un hôpital & deux mille habi-
. tans. Cette ville fait partie de l’apanagé. des infans
de Portugal. Long. //, 22. lat. 40, 5. ,
Vofgien ne s’eft trompé que de deux degrés vingt-
. deux minutes de longitude & autant de latitude iùr
la pofition de cette v ille , 8c il la met dans la province
de Tra los Montes, tandis:qu’elle eft dans celte de
Beyra. (C . A . )
ALMELO, (Géogr.) ville, des Provinces-unies,
dans i’Overiffel, au bailliage de Twente. Elle eft fur
la riviere de Vecht, entre Delden 8c Ottmerfum:
les Comtes .de,Rechtren la poffedent à titre de féi-
gneiirie. Lesmaifons en font affezjôlies 8c bien bâties;
il y a fur-tout un beau château. Son commerce de
toiles en fait une ville confidérable. Long.-2.4, <$*.
lac. 5x , 26. ( C. A . )
ALMENARA, ( Géogr.) petite ville maritime d’Efpagne
dans le royaume .de Valence, . au nord de la
ville de Valence, & au fud-eft dè Segorbe : elle eft
près de la riviere Polancia. On lui donne le titre dé
comté. Long. 17, 30. lat.,3^ >.4S. ( C. A. )
§ ALMERIEj (Géogr.) ville maritime d’Efpagnê
au royaume de Grenade , fur la riviere d’Almora»
avec un bon port fur,la Méditerranée. Elle eft au nord»
oueft de la pointe du cap de Gates , anciennement