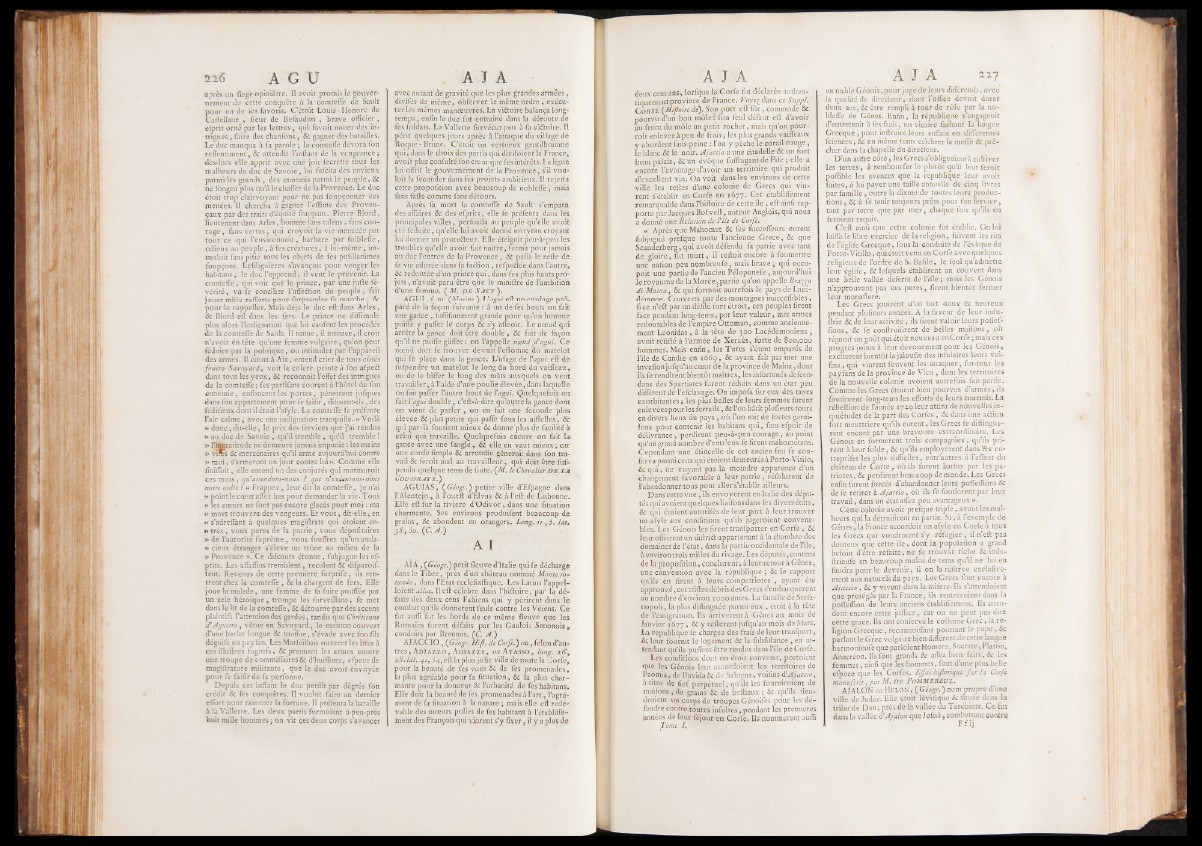
aaS A G U
après un fiege opiniâtré. Il avoit promis lé gouvernement
de cette conquête à la comtefle de Sault
pour un de fies favoris. C ’étoit Louis - Honoré de
Caftellane , fîèu'r de Befaudun , brave officier,
efprit orné par les lettrés, qui favoit nouer des intrigues
, faire des chànfons, & gagner dés batailles.
Le duc manqua à fa parole ; la comtefle dévora ion
reffentiment, & attendit l’inftant de la vengeance ;
dès-lors elle apprit avec une joie fecrette tous les
malheurs du duc de Savoie, lui fufcita des envieux
parmi les grands , des ennemis parmi le peuple, &
ne fongea plus qu’à le chaffer de la.Provence. Le duc
étoit trop clairvoyant pour ne pas foupçonner ces
menées. Il chercha à gagner l’eftime des Provenu
eaux par des traits d’équité fràppans. Pierre Biord,
lieutenant dans Arles, homme fans talens, fans courage
, fans vertus, qui croyoit fa vie menacée par
tout ce -qui l’environnoit, barbare par foiblefle,
odieux au peuple, à fes créatures, à liii-même , im-
moloit fans pitié tous les objets de fes pufillanîmes
foupçons. Lefdiguieres s’avaneoit pour venger le*s
habitans , le duc l’apprend, il veut le prévenir. La
comtefle , qui voit que le prince, par Une jufte fé-
vérité, va fe concilier l’affeftion du peuple, fait
jouer mille reflbrts pour furprendre fa marche , &
pour le rappeller. Mais déjà le duc eft dans Arles ,
& Biord eft dans les fers. Le prince' ne diffimule
plus alors l’indignation que lui caufent les procédés
de la comtefle de Sault. Il tonne, il menace, il croit
n’avoir en tête qu’une femme vulgaire , qu’on peut
féduire par la politique, ou intimider par l’appareil
des armes. Il court à Aix, entend crier de tous côtés
fouero Savoyard, voit la colere pèintè à fon afpeft
dans tous les yeux, & reconnoît l’effet des intrigues
de la comtefle; fes partifans courent à l’hôtel de fon
ennemie, enfoncent les portes, pénétrent jufqués
dans fon appartement pour fe faifir, difoient-ils, dés
féditieux dont il étoit l’afyle. La comtefle fe préfehfe
l’air calme, avec une indignation tranquille. «Voilà
» donc, dit-elle, le prix des fervices qüe'j’ai rèndUs
■ » au duc de Savoie , qu’il tremble , qu’il tremble !
» l'ingratitude ne demeure jamais impunie : les mains
h vires & mercénaires qu’il arme aujourd’hui contre
» moi, s’armeront un jour contre lui». Comme elle
finiffoit, elle entend un dès conjurés qui murmuroit
ces mots, qiûattendons-nous ? que ri exécutons- nous
notre ordre ? « Frappez, leur dit la comtefle, je n’ai
» point le coeur affez bas pour demander la yie. Tous
» les coeurs ne font pas encore glacés pouf moi : ma
» mort trouvera des vengeurs. Et v ous , dit-ellë, en
» s’adreflant à quelques magiftrats qui étoient en-
» très , vous peres de la patrie, vous dépofitaires
» de l’autorité fuprême, vous fouffrez qu’un auda-
» çieux étranger s’élève un trône au milieu de la
» Provence ». Ce difeours étonne, fubjiigue les ef-
prits. Les affafîïns tremblent, reculent & difpatoif-
fent. Revenus de cette première furprife, ils rentrent
chez la comtefle , & la chargent de fers. Elle
joue la malade, une femme de fa fuite pouffée par
un zele héroïque, trompe les furveillans, fe met
dans le lit de la comtefle, &; détourne par des accens
plaintifs l’attention des gardes, tandis que Chrétienne
£ A guerre, vêtue en Savoyard, le menton couvert
d’une barbe longue & touffue, s’évade avec fon fils
déguifé en payfan. Les Marfeillois ouvrent les bras à
ces illuftrés fugitifs, & prennent les armes contre
une troupe de commiffaires & d’huifliers, efpece de
ïnagiftrature militante, que le duc avoit envoyée
pour fë faifir de fa perfonne.
Depuis cet inftant le duc perdit par degrés fon
crédit & fes conquêtes. Il voulut faire un dernier
effort pour ramener la fortune. Il préfenta la bataille
à la Valiette. Les deux partis formoient à-peu-près
huit mille hommes ; on yit ces deux corps s’avancer
A J A
avec autant de gravité que les plus grandes armées,
divifés de même, obferver le même ordre ; exécuter
les mêmes manoeuvres. La vi&oire balança longtemps,
enfin le duc fut entraîné dans la déroute de
fes foldats. La Valiette furvécut peu à fa victoire. II
périt quelques jours après à l’attaque du village de
Roque - Brune» C ’étoit un vertueux gentilhomme
qui, dans le choix des partis qui divifoiêht la France,
avoif plus confulté fon coeur que fes intérêts. La ligue
lui offrit le gouvernement de'la Provence, s’il voit-
loitla fecohder dans fes projets ambitieux. Il rejettà
cette propofition avec beaucoup de nobleffe, mais
fans fàfte comme fans détours.
Après fa mort là comtefle de Sault s’empara
des affaires & des efprits, elle fe préfenta dans les
principales villes, perfua'dà au peuple qu’ elle avoit
été féduite, qu’elle lui avoit donné un tyran croyant
lui donner un protefteur. Elle éteignit peu-à-peu les
troubles qu’elle avoit fait naître, ferma pour jamais
au duc l’entrée de la Provence, & paHâ lè relie dé
fa vie adorée dans-fa faélion, rèfpeftée dans l’autre,
& redoutée d’un prineè qui, dans fes.plus hauts pro1
je ts , n’avoit paru être que le miniftre de l’ambition
d’une femme. (A/, d é S a c y ),
AGU1, f. m. {Marine.') Uagui eft un cordage préparé
de la façon fuivante : à uii de fes bouts on fait
une gârice , fuffifamment grande pour qu’un homme
puifle y pafler le" corps & s’y àffeoir. Le noeud qui
arrêté la gance doit être double, & fait de façon
qu’il ne puifle gliflèr : ort l’appelle noeud 'jfagui. Ce
noeud doit fe trouver devant l’eftômac du matelot
qui fé place dans la gance» L’ufâge de Vagui eft dè
fufpendre un matelot le long du bord du vaifféau,
ou de le hiffer le long des mâts auxquels on veut
travailler, à l’aide d’une poulie élevée, dans laquelle
on fait pafler l’autre bout de Y agui, Quelquefois on
fait'l’agui double , c’eft-rà-dire qu’outre la gance dont
on vient de parler , on en fait une fécondé plus
élevée & plus petite qui paffe fous les aiffelles, &
qui par-là fondent mieux & donne plus de facilité à
celui .qui travaille. Quelquefois .encore on fait la
gance avec une fangle, & elle en vaut mieux ; car
une corde fimple & arrondie gêneroit dans fon travail
8c fer oit mal au travailleur, qui doit être fuf-
pendu quelque tems de fuite. (M. le Chevalier d e l a
Co u d r a y e .)
AGUIAS, ( Géogr.) petite ville d’Efpagne dans
l’Alentejo , à l’oueft d’Éivas & à l’eft de Lisbonne.
Elle eft fur la riviere d’Odivor, dans une fituation
charmante. Ses environs produifent beaucoup de
grains, & abondent en orangers. Long. 11, 3. lat.
g8 , 5o. (C .A .)
A I
A IA , {Géogr.) petit fleuve d’Italie qui fe décharge
dans le Tibre, près d’un château nommé Monte ro-
tundo, dans l’Etat eccléfiaftique. Les Latins l’appel-
loient allia. Il eft célébré dans l’hiftoire, par la défaite
des deux cèns Fabiens qui y périrent dans le
combat qu’ils donnèrent feuls contre lesVéiens. Ce
fut aufli fur les bords de ce même fleuve que les
Romains furent défaits par les Gaulois Senonois,
conduits par Brennus. (Ç. A .)
A JA C C IO , {Géogr. Hifl. de Corfe.) ou, félon d’autres
, Ad ja zzô , Ad ja z ze , ou à y a s so , long. z& 9
z8. lût. 4/, 34, eft la plus jolie ville de toute la Corfe,
pour la beauté de fes vues &: de fes promenades,
la plus agréable pour fa fituation , & là plus charmante
pour la douceur ôt l’urbanité de fies habitans.
Elle doit la beauté de fes promenades à l’art, l’agrément
de fa fituation à la nature ; mais elle eft redevable
des moeurs polies de fes habitans à l’établifle-
ment des François qui vinrent s’y fixer, il y a plus de
A J A
deux cens ans, lorfque la Corfe fut déclarée authentiquement
province de France. Voÿ<\ dans ce Suppl.
Corse {Hilloire dé). Son port eft fu r , commode &C
pourvu d’un bon môle? fon feul défaut eft d’avoir
au front du môle un petit rocher, mais qu’on pour-
roit enlever à peu de frais ; les plus grands vaifleaux
y abordent fans peine : l’on y pêche le corail rouge,
le blanc & le noir. Ajaccio a une citadelle & un fort
beau palais, & un évêque fuffragant de Pife ; elle a
encore l’avantage d’avoir un territoire qui produit
d’excellent vin. On voit dans les environs de cette
ville les reftes d’une colonie de Grecs qui vinrent
s’établir en Corfe en 1677. Cet établiffement
remarquable dans l’hiftoire de cette î l e , eft ainfi rapporté
par Jacques Bofwell, auteur Anglois, qui nous
a donné une Relation de Vîle de Corfe.
« Après que Mahomet & fes fuccefleurs eurent
fubjugué prefque toute l’ancienne Grece, & que
Scanderberg, qui avoit défendu fa patrie avec tant
de gloire, fut mort, il reftoit encore à foumettre
une nation peu nombreufe, mais brave ; qui occu-
poit une partie de l’ancien Péloponefe , aujourd’hui
le royaume de la Morée, partie qu’on appelle Bruno
di-Maina, & qui formoit autrefois le pays de Lacédémone.
Couverts par des montagnes inacceflibles,
fi ce n’eft par un défilé fort étroit, ces peuples firent
face pendant long-tems, par leur valeur, aux armes
redoutables de l’empire Ottoman, comme anciennement
Léonidas , à la tête de 300 Lacédémoniens ,
avoit réfifté à l’armée de Xerxès, forte de 800,000
hommes. Mais enfin, les Turcs s’étant emparés de
Fîle de Candie en 1669, & ayant fait par mer une
invafionjufqu’aucoeur de la province de Maina, dont
ils fe rendirent bientôt maîtres, les infortunés defeen-
dans des Spartiates furent réduits dans un état peu
différent de l’efclavage. On impofa fur eux des taxes
exorbitantes ; les plus belles de leurs femmes furent
enlevées pour les ferrails, & l’on bâtit plufieurs tours
en divers lieux du pays, où l’on mit de fortes garni-
fons pour contenir les habitans qui, fans efpoir de
délivrance, perdirent peu-à-peu courage, au point
qu’un grand nombre d’entr’ eux fe firent mahométans.
Cependant une étincelle de cet ancien feu fe con-
ferva parmi ceux qui étoient demeurés à Porto-Vitilo,
& qui, ne voyant pas la moindre apparence d’un
changement favorable à leur patrie, réfolurent de
l’abandonner tous pour aller s’établir ailleurs.
Dans cette v u e , ils envoyèrent en Italie des députés
qui avoient quelques liaifons dans fes divers états,
& qui étoient autorifés de leur part à leur trouver
un afyle aux conditions qu’ils jùgeroient convenables.
Les Génois les firent tranfporter en C o rfe, &
leur offrirent un diftriû appartenant à la chambre des
domaines de l’état, dans la partie occidentale de File,
à environ trois milles du rivage. Les députés,contens
delà propofition, conclurent, à leur retour à Gênes,
une convention avec la république ; & le rapport
qu’ils en firent à leurs compatriotes , ayant été
approuvé, ces triftes débris des Grecs s’embarquèrent
au nombrë d’environ 1000 âmes. La famille de Stefa-
nopoli, la plus diftinguée parmi eux , étoit à la tête
de l’émigration. Ils arrivèrent à Gênes au mois de
Janvier 16 7 7 , & y refterent jufqu’au mois de Mars.
La république fè chargea des frais de leur tranfport,
& leur fournit le logement & la fubfiftance , en attendant
qu’ils puflènt être rendus dans l’île de Corfe.
Les conditions dont on étoit convenu, portoient
que les Génois leur accordoient les territoires de
Paomià, de Buvida & de Salogna, voifins d’Ajaccio,
à titre de fief perpétuel;,qu’ils les fourniroient de
maifons, de grains & de beftiaux ; qu’ils tien-
droient un corps de troupes Génoifes pour les défendre
contre toutes infultes, pendant les premières
jannées de leur féjour en Corfe. Ils nommèrent aufli
Jomt /,
A J A «7
un noble Génois, pour juge de leurs différends, avec
la qualité de dire&eur, dont l’office devoit durer
deux ans, & être rempli à tour de rôle par la no-
bleffe de Gênes. Enfin, la république s’engageoit
d’entretenir à fes frais, un vicaire fiachant la langue
Grecque , pour inftruire leurs enfans en différentes
fciences, & en même tems célébrer la meffe & prêcher
dans la chapelle du dire&eur.
D ’un autre cô té, les Grecs s’obligeoient à cultiver
les terres, à rembourfer le plutôt qu’il leur feroit
poflible les avances que la république leur avoit
faites, à lui payer une taille annuelle de cinq livres
par famille, outre la dixme de toutes leurs productions,
& à fe tenir toujours prêts pour fonfervice,
tant par terre que par mer, chaque fois qu’ils en
feroient requis.
C ’eft ainfi que cette colonie fut établie. On lui
laiffa le libre exercice de la religion, fuivant les rits
de l’églife Grecque, fous la conduite de l’évêque de
Porto-Vitillo, qui étoit venu en Corfe avec quelques
religieux de l’ordre de S. Bafile, le feul qu’admette
leur églife, & lefquels établirent un couvent dans
une belle vallée déferte de l’ifle ; mais les Génois
n’approuvant pas ces peres, firent bientôt fermer
leur monaftere;
Les Grecs jouirent d’un fort doux & heureux
pendant plufieurs années. A la faveur de leur indu-
ftrie & de leur aélivité, ils firent valoir leurs poflèf-
fions, & fe conftruifirent de belles maifons, ou
régnoit un goût qui étoit nouveau en Corfe ; mais ces
progrès joints à leur dévouement pour les Génois,
excitèrent bientôt la jaloufie des infulaires leurs voifins
, qui vinrent fouvent les attaquer, fur-tout les
payfans de la province de V ic o , dont les territoires
de la nouvelle colonie avoient autrefois fait partie.
Comme les Grecs étoient bien pourvus d’armes, ils
foutinrent long-temsles efforts de leurs ennemis. La
rébellion de l’année 1729 leur attira de nouvelles inquiétudes
de la part des Gorfes , & dans une action
fort méurtriere qu’ils eurent, les Grecs fe diftingue-
rent encore par une bravoure extraprdinaire. Les
Génois en formèrent trois compagnies , qu’ils prirent
à leur folde, & qu’ils employèrent dans Ifes en-
treprifes les plus difficiles, entr’autres à l’affaut du
château de C o r te, où ils furent battus par les patriotes,
& perdirent beaucoup de monde. Les Grecs
enfin furent forcés d’abandonner leurs pofl'eflions &
de fe retirer à Ajaccio, où ils fe foutinrent par leur
travail, dans un état affez peu avantageux».
Cette colonie avoit prefque triplé, avant les malheurs
qui la détruifirent en partie. S i, à l’exemple de
Gênes, la France accordoit un afyle en Corfe à tous
les Grecs qui voudroient s’y réfugier, il n’eft pas
douteux que cette î le , dont la. population a grand
befoin d’être refaite, ne fe trouvât riche & indu-
| ftrieufe en beaucoup moins de tems qu’il ne lui en
faudra pour le devenir, fi on la réferve exclufive-
ment aux naturels du pays. Les Grecs font encore à
Ajaccio , & y vivent dans la mifere. Ils s’attendoient
que protégés par la France, ils rentreroient dans la
poffeflion de leurs anciens établiffemens. Ils attendent
encore cette juftice, car on ne peut pas dire
eette grâce. Ils ont confervéle coftume Grec, la religion
Grecque , reconnoiffant pourtant le pape, &:
parlant le G rec vulgaire bien différent de cette langue
harmonieufe que parloient Homere, Socrate, Platon,
Anacréon. Ils font grands & affez bien faits, & les
femmes, ainfi que les hommes, font d’une plus belle
efpece que les Corfes. EJfai hiforique fur la Corfe
manuferit, par M. DE P om mereul.
AJALON ou He lg n , {Géogr.) nom propre dune
ville de Judée. Elle étoit lévitique & fituée dans la
tribu de Dan, près de la vallée du Térébinte. Ce fut
dans la vallée d' A jalon que Jofué, combattant contre
F f i j