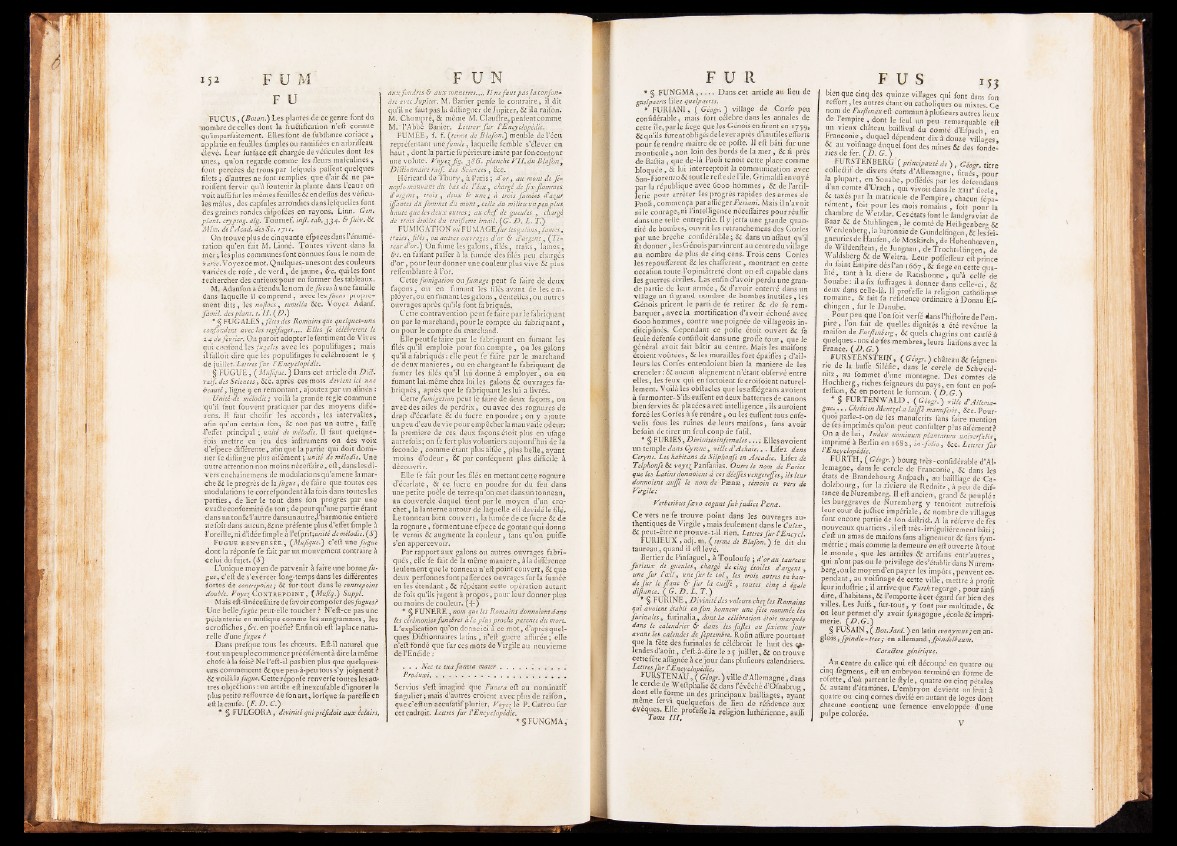
F U
FUCUS, (Botan.) Les plantes -de ce genre font du
nombre de celles dont la fru&ifi,cation n’eft connue
qu’imparfaitement. Elles font -de fubftance coriace ,
applatie en feuilles fimplesou ramifiées en arbriffeati
élevé. Leur furface eft chargée de véficules dont les
unes,, qu’on regardé comme les fleurs mafculines ,
font percées de trous par lesquels paffent quelques
filets.; d’autres ne font remplies que d’air & ne pa-
roiffent fervir qu’à foutenir la plante dans l’eau : on
voit auffi fur les mêmes feuilles & en defîus des véficules
mâles, descapfules arrondies danslefquelles font
des graines rondes difpofées en rayons. Linn. G en,
plant, cryptog. alg. Tournef. injl. tab, 334. & fuiv, &
Man. de CAcad, des Sc. lyi 1.
On trouve plus de cinquante efpeces dans l’énumération
qu’en fait M. Linné. Toutes vivent dans la
mer ; lés plus communes font connues fous le nom de
i'drec. Voyez ce mot. Quelques-unes ont des couleurs
■ Variées de rofe , de verd, de jaune, &c. qui les font
rechercher des curieux pour en former des tableaux.
M. Adanfon a étendu le nom de fucus à une famille
dans laquelle il comprend, avec les .ƒ««/* propreT
ment dits, les nojlocs, tutnella &c. Voyez Adanf.
fàmil. des plant, t. IL. (Z?.)
* § FUG A LES, fêtes des Romains que quelques-uns
confondent avec lesregiftiges.,.. Elles Je célébrèrent Le
a a de février. ©n paraît adopter le fentiment de Vives
cjui confond hsfugales avec les populifuges; mais
il falloit dire que les populifuges le célébraient le 5
<le juillet. Lettres fur VEncyclopédie.
§ FUGUE, ( Mufique. ) Dans cet article du Dicl
raif. des Sciences, &c. après ces mots devient ici une
’beauté, ligne 9 en remontant, ajoutez par un alinéa :
Unité ’de mélodie ; voilà la grande réglé commune
•qu’il faut fouvent pratiquer par des moyens diffé-
refis. Il faut choifir les accords, les intervalles,
-afin qu’un certain l'on, & non pas un autre, faffe .
4’effet principal ; unité de mélodie. Il faut quelquefois
mettre en jeu des inftrumens ou des voix
d ’efpece différente , afin que la partie qui doit dominer
fie diftingue plus aifément ; unité de mélodie. Une
•autre attention non moins ncceffaire, eft, dans les divers
enchaînemens de modulations qu’amene la marche
& le progrès de la fugue, de faire que toutes ces
modulations fie correfpondent à la fois dans toutes les
parties, de lier le tout dans fon progrès par une
cxaûe conformité de ton ; de peur qu’une partie étant
■ dans un ton& l’autre dans un autre,l’harmonie entière
ne foit dans aucun, & ne préfente plus d’effet fimple à
l ’oreille, ni d’idée fimple à l’efprïv,unité de mélodie. {S)
Fugue renversée , (Mufique.) c’eft une fugue
■ dont la réponfe fie fait par un mouvement contraire à
celui du fujet. (S')
L’unique moyen de parvenir à faire une bonne fu gue,
c’ eft de s’exércer long-temps dans les différentes
fortes de contrepoint; & fur-tout dans le contrepoint
double. Voye^C o n tr e poin t, ( Mufiq.,) Suppl.
Mais eft-ilnéceffaire de favoir compofer desfugues?
"Une belle fughe peut-elle toucher ? N’eft-ce pas une
pédanterie en mufiqué comme les anagrammes, les
acroftiches, &c. en poéfie? Enfin où eft laplace naturelle
d’une fugue ?
Dans prefique tous les choeurs. Eft-il naturel que
tout un peuple commence précifément à dire la même
chofeàla fois? Ne l’eft-il pas bien plus que quelques-
uns commencent & que peu-à-peti tous s’y joignent ?
& voilà la fugue. Cette réponfe renverfe toutes les autres
objé&ions : un artifte eft inexcufable d’ignorer la
■ plus petite reffource de fon art, lorfque fa pareffeen
eft la caufe. {F. D. C.) •
* § FULGORA, divinité qui préfidoit aux éclairs,
aux,.foudres & aux tonnerres.... I l ne faut pas la confondre
avec Jupiter. M. Banier penfe le contraire , il dit
qu’il ne faut pas la diftinguer de Jupiter, & ila raifon.
M. Chompré, & même M. Clauftre, pe-nfentcomme
M. l’Abbé Banier. Lettres* fur C Encyclopédie.
FUMÉE, f. f. {terme de Blafon.) meuble del’éc.tt
r'epréfentant un e fumée, laquelle fie m b le s’élever en
haut, dont la partie fupérieure imite par fon contour
une volute. Voyeq_ fig. 386. planche VII. du,Blafon'9
Dictionnaire raif. des Setences , &c.
Héricard de Thury, à Paris ; d'o , au mont de f i noplemouvant
du bas de Vécu.,, cha gé de f ix flammes
d'argent, trois , deux & une; à r/ois fumées daqiir ■ s du fommet du mont, celle du milieu un peu plas,
haute que Us deux autres ; au chef de gueules , chargé
de trois étoiles du troifieme émail. (G. D . L. T.)
FUMIGATION ou îAPsGHfur les galons., James 9
traits, filés, ou autres ouvrages d'or £ d'argent, ( Tireur
d’or.') On fume lés galons, filés., traits,, lames ,
&c. en faifant pafler à la fumée des filés peu chargés
d’o r , pour leur donner une couleur plus vive & plus,
reffemblante à l’or.
Cette fumigation ou fumage peut fie faire de deux
façons, ou en fumant les files avant de les employer,
ou en fumant les galons, dentelles,ou autres
ouvrages après qu’ils font fabriqués.
Cette contravention peut fe faire par le fabriquant
ou par le marchand, pour le compte du fabriquant,
ou pour le compte du marchand.
Elle peut fie faire par le fabriquant en fumant les
filés qu’il emploie pour fon compte , ou les galons
qu’il a fabriqués : elle peut fie faire par le marchand
de deux maniérés, ou en chargeant le fabriquant de
fumer les filés qu’il lui donne à employer, ou en
fumant lui-même chez lui les galons & ouvrages fabriqués
, après que le fabriquant les lui a livrés.
Cette fumigation peut fe faire de deux façons, ou
avec des ailes de perdrix, ou avec des rognures de
drap d’écarlate & du fuere en poudre ; on y ajoute
lin peu d’eau de vie pour empêcher la mauvaife odeur:
la première de ces deux façons étoit plus en ufage
autrefois; on fe fert plus volontiers aujourd’hui de la
fécondé , comme étant plus aifée , plus belle, ayant
moins d’odeur , & par confisquent plus difficile à
découvrir.
Elle fe fait pour les filés en mettant cette rognure
d’écarlate, & ce fucre en poudre fur du feu dans
une petite poêle de terre qu’on.met dansun tonneau,
au couvercle duquel tient par-le moyen d’un crochet
, la lanterne auto’ur de laquelle eft dévidé le filé.
Le tonneau bien couvert, la fumée de ce fucre &: de
la rognure, forment une efpece de gomme qui donne
le vernis & augmente la couleur, fans qu’on puifle
s’en appercevoir.
Par rapport aux galons ou autres ouvrages fabriqués
, elle fe fait de la même maniéré, à la différence
feulement que le tonneau n’eft point couvert, & mie
deux perfonnes font pàffer ces ouvrages fur la fumée
en les étendant, & répétant cette opération autant
de fois qu’ils jugent à .propos, pour leur donner plus
ou moins de couleur-, (-j-)
* § FUNERE, nom que les Romains donnoient dans
les cérémonies funèbres a la plus proche parente du mort.
L ’explication qu’on donne ici à ce mot, d’après quelques
Diftionnaires latins, fi’eft guère affurée; elle
n’eft fondé que fur ces mots de Virgile au neuvième
de l’Enéide ;
. . . Nec -te tua finira mater..............; . . . .
Produxi. y ; > ; . . . . . .... .
Servius s’eft imaginé que Fanera eft au nominatif
fingulier ;-mais d’autres croient avec plus de raifon,
que c’eft un accufatif plurier. Voyer le P. Catrou fur
cet endroit. Lettres fur VEncyclopédie.
§ FUNGMA
* § FU N GM A , . . . . Dans cet article au lieu de
guelpaerts lifez quelpatrts.
* FU R IA N I , ( Géogr. ) village de C o r fe peu
confidérable, mais fort célébré dans les annales de
cette île, par le fiege que les Génois en firent en 1759,
& qu’ils furent obliges de le v e r a près d’inutiles efforts
pour fe rendre maître de ce pofte. Il eft bâti fur une
monticu le , non loin des bords de la m e r , & fi près
de Baftia, que de-là Paoli tenoit cette placé comme
bloquée , & lui interceptait la communication avec
San-Fiorenzo & toutle refte de l’île. Grimaldi envoyé
par la république av e c 6000 hommes, & de l’artillerie
pour arrêter les progrès rapides des armes de
P a o li, commença par affiégerFuriani. Mais il n’avo it
ni le courage, ni l’intelligence néceflaires pourréuflîr
dans une telle entreprife. Il y jetta une grande quantité
de bombes,'ouvrit les retranchemens des Corfes
par une breche confidérable; & dans un affaut qu’il
fit d onn er, les Génois parvinrent au centre du village
au nombre de plus de cinq cens. T rois cens Corfes
les repoufferent & les chafierent, montrant en cette
occafion toute-l’opiniâtreté dont on eft capable dans
les guerres civiles. Las enfin d’a vo ir perdu une grande
partie de leur armé e , & d’avo ir enterré dans un
village un fi grand nombre de bombes inutiles , les
Génois prirent le parti de fe retirer & de fe remb
a rq u e r , a y ec la mortification d’av o ir échoué avec
6000hommes, contre une poignée de villageois in-
diiciplinés. Cependant c e pofte étoit o uv ert & fa
feule défenfe confiftoit dans une groffe to u r , que le
général avoit fait bâtir au centre. Mais les maifons 1
ëtoient v oû té es , & les murailles fo rt épaifles ; d’ailleurs
les Corfes entendoient bien la maniéré de les
creneler : & aucun alignement n’étant obfervé entre i
e lle s , les feux qui en lortoient fe croifoient naturellement.
Vo ilà les obftacles que les affiégeans avoient
à furmonter. S’ils euffent eu deux batteries de canons
bien fervies & placées avefc intelligence, ils auraient
fo rcé les C orfe s à fe ren dre, ou les.euffent tous enfe-
v e lis fous les ruines de leurs maifons, fans avo ir
befoin de tirer un feul coup de fufil.
* § FURIES, Divinités infernales. . . ; Elles avoient
lin temple dans Cyrtne, ville d'Achaie.. . Lifez dans
Ceryne. Les habitans de Silpkonfe en Arcadie. Lifez de
Telphonfe & voye£ Panfanias. Outre le nom de Furies
que les Latins donnoient à ces déeffes vengerejfes, ils leur
donnoient auffi le nom de Pænæ, témoin ce vers de
Virgile:
Verberibus feevo cogunt fub judice Pana.
C e vers ne fie trouv e point dans les ouvrages authentiques
de V irgile , .mais feulement dans le Culex,
& peut-être ne prouve-t-il rien. Lettres fur CEncycl.
FUR IEUX , adj. m, ( terme de Blafon. ) fe dit du
taureau., quand il eft lev é.
Bertier de Pinfaguel, à T ou lou fe ; d’or au taureau
furieux de gueules, charge de cinq étoiles dargent ,
une fur l ail , une fur le cql, les trois autres en bande
fur le flanc & fur la cuijfe , toutes cinq à égale
difiance.I G. D. L. T. ) 5
* § Ftj RINE, Divinité.des voleurs che£ les Romains
qui avoient .établi en fon honneur une fête nommée les
furinales, furinalia, dont la célébration étoit marquée
dans le calendrier & dans les faftes au jixieme jour
avant les calendes.de feptembre. Rofin affure pourtant J
que la fête des furinales fe célébrait le huit des <a-
lendes^d’août , c’eft-à-dire le M juillet, & on trouve
cettefête affignée à ce jour dans plufieurs calendriers.
Lettres fur t Encyclopédie.
FUk STENAU , ( Géogr f v ille d’Allemagne, dans
le cercle de Weftphalie &. dans l’évêché d’Ofnabrug,
dont elle forme un des principaux bailliages, ayant
meme fervi quelquefois . .de lieu de réfidencé aux
e v e q u e s .,E lle profeffe la religion luthérienne, auffi
Tome III,
■ bien que cinq des quinze villages qui font dans fon
reffort, les autres étant ou catholiques ou mixtes. Ce
nomdeFurfîenàueü communi plufieurs autres lieux
de l’empire , dont le feul un peu remarquable eft
un vieux château baillival du comté d’Efpach eu
Francome , duquel dépendent dix à douze villaaes,
& au .VP.finage dnqùel font des mines & des fonde-
ries de fer. ( D . G. )
ER<^ ( principauté d e ) , Géogr. titre
collectif de divers états d’Allemagne, fitués pour
la plupart, en Souabe, poffédés par les defeendans
d un comte d Urach, qui vivoit dans le xm e fiecle
& taxes par la matricule de l’empire, chacun fépa-
rement, foit pour lês mois romains , foit pour la
chambre de Wetzlar. Ces états font le landgraviat de
Baar & de Stuhlingen, le comté de Heiligenberg &
Werdenberg, la baronnie de Gundelfingen, & les fei-
gnëuries de Haufen, de Moskirch, de Hohenhoeven
de Wildenftein, de Jungnau , de Trochtëlfingen, de’
Waldsberg & de Weitra. Leur poffeffeur eft prince
du faint Empire des l’an 1667 » & fiege en cette qualité
, tant à la diete de Ratisbonne, qu’à celle de
Souabe : il a ux fuffrages à donner dans celle-ci, &
deux dans celle-là. Il profeffe la religion catholique
romaine, & fait fa réfidence ordinaire à Donau Ef-
chingen , fur le Danube.
Pour peu que l’on foit verfé dans l’hiftoire de l’empire
, 1 on fait de quelles dignités a été revêtue la
maifon de Furflenberg, & quels chagrins ont caufé à
quelques-uns de fies membres, leurs liaifons avec la
France. (D .G .)
• ^ y ^ ^ ^ S T E IN , ( Géogr. ) château & feigneu-
rie de la baffe Silefie, dans le cercle de S chweid-
nitz, au fommet d’une montagne. Des comtes de
Hochberg, riches feigneurs du pays, en font en pofi-
leffion, &: en portent le furnom. ( D .G )
* § FURTENWALD, ( Géogr. ) ville d’A llem a -
o.ne\' • • Chrétien Mentqel a laiffè manufent, &c. Pourquoi
parle-t-on de fes manuferits fans faire mention
de Tes imprimés .qu’on; peut confulter plus aifément?
On a de lui, Index nominum plantamm nniverfatÙ'
imprimé à Berlin en 1682, in-folio, &c. Lettres Fur
l’Encyclopédie.
FURTH, ( Géogr. ) bourg très - confidérable d’Allemagne,
dans le cercle de Franconie, & dans les
états de Brandebourg Anfpach, au bailliage de Ca-
dolzboiyg, fur la riviere de Rednitz , à peu de distance
de Nuremberg. II eft ancien, grand & peuplé :
les burggraves de Nuremberg y tenoient autrefois
leur cour de juftice impériale, & nombre de villages
font encore partie de fon diftrid. A la réferve de fes
nouveaux quartiers , il eft très-irréguIiérement bâti ;
c’eft un amas de maifons fans alignement & fânsfym-
métrie ; mais comme la demeure en eft ou verte à tout
le monde, que les artiftes & artifans entr’autres,
qui n?ont pas ou le privilège de s’établir dans Nuremberg
, ou le moyen d’en payer les impôts, peuvent cependant
, au voifinage de cette v ille, mettre à profit
leur induftrie ; il arrive que Furth regorge, pouràinfi
dire, d habitans, & l’emporte à cet égard fur bien des
villes. Les Juifs, fur-tout, y font par multitude, &
on leur permet d’y avoir fynagogue, école & imprimerie.
{D .G .)
§ FUSAIN, ( Bot. Jard. ) en latin evonymüsjen an-
glois, fpindle - tree ; en allemand, fpindelbaum.
Caractère générique.
Au centre du calice qui eft découpé en quatre ou
cinq fegmens, eft un embryon terminé en forme de
rofette, d’où partent le ftyle, -quatre ou cinq pétales
& autant d’étamines. L’embryon devient un fruit à
.quatre ou cinc[ cornes divifé en autant de logés dont
.chacune contient une femence enveloppée d’une
pulpe colorée.
V