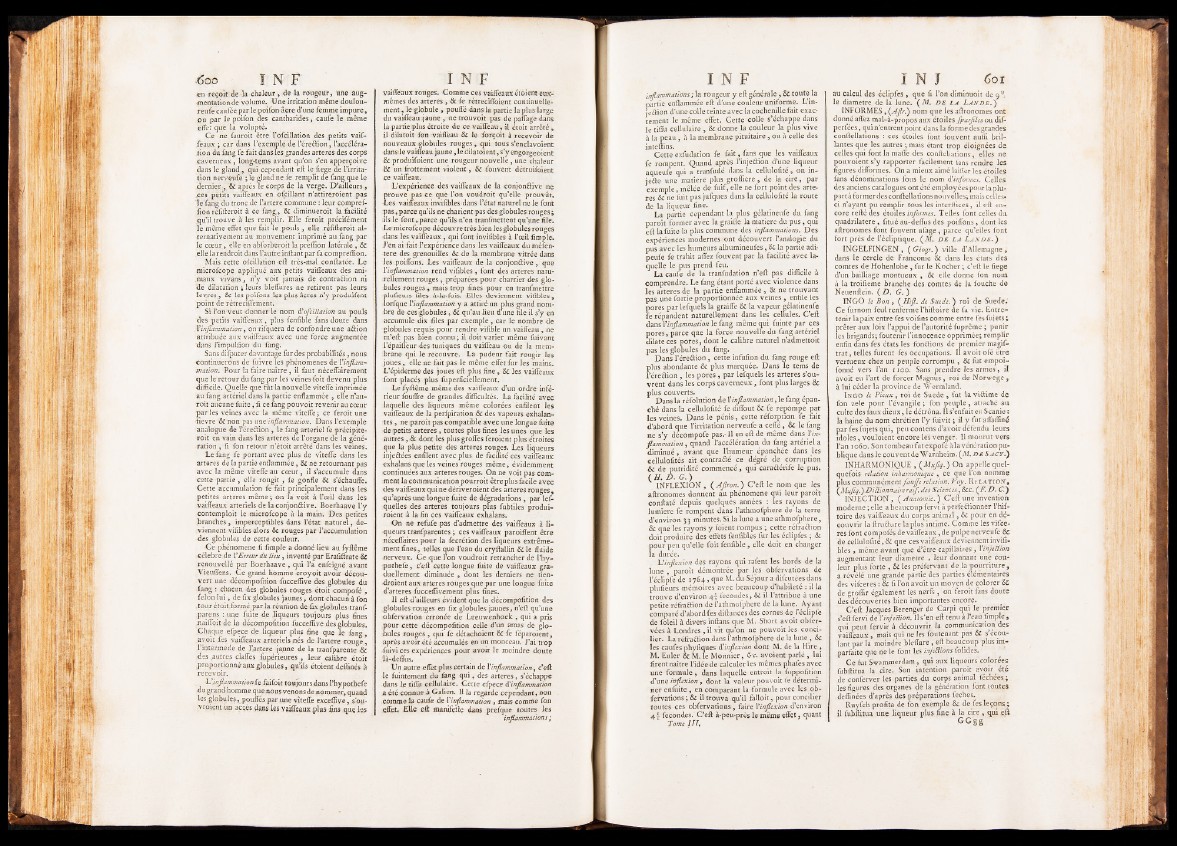
«n reço it1 de la cha leu r , de la rougeur, ïihè àùg-
■ mentation-de volume. Une irritation même doulou-
reufe caufée par le poifon âcre d’une femme impure,
ou par le poifon des cantharides, caufe le même
effet que la volupté.
Ce ne fauroit être l’ofcillation des petits vaiffeaux
; car dans l’exenjple de l’ére&ion, l’accéléra-
.tion du fang fe fait dans les,grandes arteres des corps
.caverneux, long-tems avant qu’on s’en apperçoive
dans le g l a n d q u i cependant eft le fiege de l’irritation
nerveufe ; le gland ne fe remplit de fang que le
.dernier , & après le corps de la verge. D ’ailleurs,
.ces petits vaiffeaux en ©(cillant n’attireroient pas
l e fang du tronc de l’artere commune : leur compref-
fiori réfifteroit à ce farçg,, & diminueroit la facilité
.qu’il trouve,à les remplir. Tille feroit préeifément
le même effet que fait 4e pouls , elle réfifteroit alternativement
au mouvement imprimé au fang par
le coe u r , elle en abforberoit la preffion laté rale , 6c
.elle la rendront dans l’autrejnftant par fa comprëffion.
.Mais, cette o fcillatione ft très'-mal conftatée. L e
microfcope appliqué aux petits vaiffeaux des animaux
v iv a n s , n’y v o it jamais de contraûion ni
d é dilatation ; leurs bleffures ne retirent pas leurs
le v r e s , & les poifons.les plus âcres n’y produifent
point de Tétreciffement.
Si l’on veu t donner le nom d’ofcillation au pouls
des petits v aiffeau x, plus fenfible fans doute dans
yinjla.nima.tion, on rifquera de confondre une aftion
attribuée aux vaiffeaux avec une force augmentée
dans l’impulfion du fang.
Sans difputer davantage fur des probabilités, nous
continuerons de fuivre les phénomènes de Vinflammation.
Pour la faire naître , il faut néceffairemenî
que le retour du fang par les veines foit devenu plus
difficile. Quelle que fût Ta nouvelle vîteffe imprimée
au fang artériel dans la partie enflammée , e llen ’au-
roit aucune fu ite , fi ce fang pouvoit revenir au coeur
par les veines avec Ta même vîteffe; ce feroit une
•fievre & non pas une inflammation. Dans l ’exemple
analogue de l’éreêtion , le fang artériel fe précipite-
roit en vain dans les arteres de l’organe de la génération
, fi fon retour n’étoit arrêté dans les veines.
L e fang fe portant avec plus de vîteffe dans les
arteres de la partie enflammée, 6c ne retournant pas
a v e c la même vîteffe au coe u r , il s’accumule dans
cette pa r tie , elle ro u g it , fe gonfle & s’échauffe.
C ette accumulation fe fait principalement dans les
petites arteres même ; on la voit à l’oeil dans les
vaiffeaux artériels de la conjonôive. Boerhaave l’y
contemploit le microfcope à la main. D e s petites
branches, imperceptibles dans l’état na ture l, deviennent
vifibles alors 6c rouges par l’accumulation
des globules de cette couleur.
C e phénomène f i fimple a donné lieu au fyftême
célébré de Y Erreur du lie u , inventé par Erafiftrate &
renouvellé par Boe rhaa v e , qui l’a enfeigné avant
Vieuffens. Ce grand homme c ro y o it avoir découv
e r t une déeompofition fucceffive des globules du
fang : chacun des globules rouges étoit compofé ,
félon lu i , de fix globules jaunes, dont chacun à fon
.tour étoit.formé par la réunion de fix globules >tranf-
parens : une fuite de .liqueurs toujours plus fines
.naiffoit de la déeompofition fucceffive des globules.
Chaque efpece de liqueur plus fine que le fang
ayoit fes vaiffeaux ,ar-teriels nés de l’a.rter.e -rouge,
l ’inteqnede de l’artere jaune de la tranfparente &
.des autres çlaffes fiipérieures , -leur .calibre étoit
proportionné aux globules, qu ’fis étoient d.eflinés à
rece vo ir.
\Jinflammation fie faifoit tou jo.urs.dans l’hypothefe
du grand-homme quenous venons de nommer, quand
les globules , pouffés par une vîteffe e xceffiv e, s'ou-
vrpient Un accès dans fes vaiffeaux plus fins que les
vaiffeauX rouges. Comme ces vaiffeaux étoient eux-
mêmes des a rte res , & fe rétreciffoient continuellement,
le globule , pouffé dans la partie la plus large
du vaiffeau qaunè , ne trouvoit pas de paüage dans
la partie plus étroite de ce vaiffeau , il étoit arrêté ,
i l dilatoit fon vaiffeau 6c le foriçoit à rece vo ir de
nouveaux globules rouges , qui tous s’enelavoient
dansTe vaiffeau jaun e , le dilatoient, s’y engorgeoient
& produifoient une rougeur nouvelle , une chaleur
6c un frottement v io le n t , & fiouvent détruifoient
.ce vaiffeau.
L ’expérience des vaiffeaux de la conjonérive ne
prouve pas ce que l’on voudroit qu’elle prouvât.
-Les vaiffeaux invifibles dans l’état naturel ne le font
pas., parce qu’ils ne charient pas des globules rouges ;
ils le font, parce qu’ils n’en tranfmettent qu’fine file.
Le m icrofcope découvre très-bien les globules rouges
dans les vaiffeaux , qui font invifibles à l’oeil fimple.
J ’en ai fait l’expérience dans les vaiffeaux du méfen-
tere des grenouilles & de la membrane vitrée dans
les poiffons. Les vaiffeaux de la conjonctive, que
Y inflammation rend v ifib le s , font des arteres naturellement
rou g es , préparées pour charrier des globules
rouges., mais trop fines pour en tranfmettre
-plufieurs files à-la-fois. Elles deviennent v ifib les ,
tlorfque Yinflammation y a attiré im plus grand nomb
re de .ces g lobule s, 6c qu’au lieu d’une file il s’y en
accumule dix files par e xemple, car le nombre de
globules requis pour rendre vifible un vaiffeau , ne
m?eft pas bien connu ; il doit varier même fuivant
l ’épaiffeur des tuniques du vaiffeau ou de la membrane
qui le recouvre. L a pudeur fa it rougir les
.joues., elle-ne fait pas le même effet fur les mains.
L ’épiderme des joues eft plus fine, & les vaiffeaux
•font placés plus fitperficiellement.
Le fyftême même des vaiffeaux d’un ordre inférieur
fouffre de grandes difficultés. La facilité avec
laquelle des liqueurs même colorées ènfilent les
vaiffeaux de la perfpiration 6c des vapeurs exhalantes
, ne paroît pas compatible a v e c une longue fuite
de petits a rte res , toutes plus fines les unes que les
autres , & dont les plus groffes feroient plus étroites
que la plus petite des arteres rouges. Les liqueurs
injeftées enfilent avec plus de facilité ces vaiffeaux
exhalans que les veines rouges même, évidemment
continuées aux arteres rouges. On ne v oit pas comment
la communication pourroit être plus facile avec
des vaiffeaux qui ne dériveroient des arteres rouges ,
qu’après une longue fuite de dégradations , par lef-
quelles des arteres toujours plus fubtiles produi-
roient à la fin ces vaiffeaux exhalans.
On ne refufe pas d’admettre des vaiffeaux à liqueurs
tramfparentes ; ces vaiffeaux paroiffent être
néceffaires pou r la fecrétion des liqueurs extrêmement
fines, telles que l’eau du cryftallin 6c le fluide
nerveux. -Ce -que l’on voudroit retrancher de l ’hy -
po the fe , c’eft cette longue fuite de vaiffeaux graduellement
diminuée , dont les derniers ne tien-
■ droient aux arteres rouges que par une longue fuite
d’arteres fucceffivement plus fines.
Il eft d ’ailleurs évident que la déeompofition des
globules rouges en fix globules jaunes, n’eft qu’une
obfervatiom erronée de Leeuwenhoek , qui a pris
pour .cette déeompofition celle d’un amas de globules
ronges , qui fe détachoient & fe féparoient ,
après av o ir été accumulés en un monceau. J’ai trop
fiiivi ces .expériences pour avoir le moindre doute
Ià-,deffus.
Un autre -effet plus certain de Yinflammation, c’eft
le fuintement du fang q u i , dès arteres, s’échappe
dans le tiffii cellulaire. Cette efpece d’inflammation
a été connue à Galien. Il la regarde cependant, non
comme la caufe de Yinflammation, mais comme fon
effet. Elle eft manifeitc dans prefque toutes les
inflammations ;
inflammations ; la rougeur y eft g én érale , & toute la
partie enflammée eft d’une couleur uniforme. L ’in-
ie&ion d’une colle teinte avec la cochenille fait exactement
le même effet. Cette colle s’ échappe dans
le tiffu cellulaire , 6c donne la couleur la plus v iv e
à la p e a u , à la membrane pituitaire, ou à celle des
inteftins. .
Cette exfudation fe f a i t , fans que les vaiffeaux
fe rompent. Quand après l’inje&ion d’une liqueur
aqueufe qui a tranfudé clans la c ellulofité, on in-
ie d e une matière plus groffiere , de la c ir e , par
e xemple, mêlée de fu if , elle ne fo rt point des arteres
& ne fuit pas jufques dans la cellulofité la route
de la liqueur fine.
L a partie cependant la plus gélatineufe du fang
paroît former avec la graille la matière du p u s , qui
eft la fuite la plus commune des inflammations. D e s
expériences modernes-ont découvert l’analogie du
pus av e c les humeurs albumineufes, 6c la partie adi-
peufe fe trahit affez fouvent par la facilité av e c laquelle
le pus prend feu.
La caufe de la tranfudation n’eft pas difficile à
comprendre. Le fang étant porté a v e c v iolence dans
les arteres de la partie enflammée, & ne trouvant
pas une fortie proportionnée aux veines , enfile les
pores par lefquels la graiffe 6c la vapeur gélatineufe
fe répandent naturellement dans les cellules. C ’eft
dans Yinflammation le fang même qui fuinte par ces
p o r e s , parce que la force nouvelle du fang artériel
dilate ces po res , dont le calibre naturel n’admettoit
pas les globules du fang.
Dans l’ére&ion , cette infufion du fang rouge eft
plus abondante 6c plus marquée. Dans le tems de
l ’éreftion , les pores , par lefquels les arteres s’ouvrent
dans les corps ca v e rn eu x , font plus larges 6c
plus couverts.
Dans la réfolution de Yinflammation, le fang épanché
dans la cellulofité fe diffout 6c fe repompé par
les veines. Dans le pénis, cette réforption fe fait
d’abord que l’irritation nerveufe a c e ffé , 6c le fang
ne s’y deeompofe pas.* 11 en eft de même dans Yinflammation
, quand l’accélération du fang artériel a
d iminué, avant que l’humeur épanchée dans les
cellulofités ait contracté ce dégré de corruption
& de putridité commen cé, qui cara&érife le pus.
( H. D . G. )
INFLEX ION , ( Aflron. ) C ’ eft le nom que les
aftronomes donnent au phénomène qui leur paroît
conftaté depuis quelques années : les rayons de
lumière fe rompent dans l ’athmofphere de la terre
d’environ 3 3 minutes. S i la lune a une athmofphere,
& que les rayons y foient rompus ; cette réfraûion
doit produire des effets fenfibles fur les éclipfes ; &
pour peu qu’elle fo it fenfible , elle doit en changer
la durée.
L’ inflexion des rayons qui rafent les bords de la
lune , paroît démontrée par les obfervations de
l ’éclipfe de 1 7 6 4 , que M. du Séjour a difeutées dans
plufieurs mémoires avec beaucoup d’habileté : il la
trou v e d’environ 4^ fécondés, & il l ’attribue à une
petite réfra&ion de l’athmofphere de la lune. Ayant
comparé d’abord fes diftances des cornes de l’éclipfe
de foleil à divers inftans qu e 'M. Short a voit obfer-
v ée s à Londres , il v it qu’on ne pouvoit les concilie
r. La réfraftion dans l’athmofphere de la lune , &
les caufes phyfiques d'inflexion dont M. de la Hire ,
M. Euler & M. le Monnier, &c. avoient parlé , lui
firent naître l’idée de calculer les mêmes phafes avec
une fo rm u le , dans laquelle entroit la fuppofition
d’une inflexion, dont la valeur pouvoit fe déterminer
enfuite , en comparant la formule avec les obfervations
; & il trouva qu’il fa llo it, pour concilier
toutes ces ob fe rva tions , faire Yinflexion d’environ
4 T fécondés. C ’eft à-peu-près le même e ffe t, quant
Tome I I I ,
au calcul des éclipfes , que fi l’on diminuoit de d É
le diamètre de la lune. (A L d e l a La n d e .')
INFORMES, (AJlr.") nom que les aftronomes ont
donné affez mal-à-propos aux étoiles fparflles ou dif-
perfées, qui n’entrent point dans la forme des grandes
conftellations : ces étoiles font fouvent auffi brillantes
que les autres ; mais étant trop éloignées de
celles qui font la maffe des conftellations, elles ne
pouvoient s’y rapporter facilement fans rendre les
figures difformes. On a mieux aimé laiffer les étoiles
fans dénominations fous le nom d’informes. C elles
des anciens catalogues ont été employées pour la plupart
à former des conftellations nouvelles; mais celles-
ci n’ayant pu remplir tous les interitices, il eft encore
refté des étoiles informes. Telles font celles du
quadrilatère , fitué au-deffus des poiffons, dont les
aftronomes font fouvent ufage , parce qu’elles font
fort près de l’écliptique. (A L d e l a L a n d e .')
IN G E L F IN G EN , ( Giogr. ) v ille d’Allemagne,
dans le cercle de Franconie 6c dans les états des
comtes de Hohenlohe , fur le Kocher ; c’ eft le fiege
d’un bailliage montueux , 6c elle donne fon nom
à la troifieme branche des comtes de la fouche de
Neuenftein. ( D . G. )
IN G O le B o n , ( Hifl. de Suede. ) roi de Suède.’
C e furnom feul renferme l’hiftoire de fa vie. Entretenir
la paix entre fes voifins comme entre fes fujets;
prêter aux loix l’appui de l’autorité fuprême ; punir
les brigands; foutenir l’innocence opprimée; remplir
enfin dans fes états les fondions de premier inagif-
t r a t , telles furent fes occupations. Il avoit ofé être
v ertueux chez un peuple corrompu , & fut empoi-
fonné vers l’an 1100, Sans prendre les armes, il
avoit eu l’art de forcer Magnus, ro i de N o rw e g e ,
à lui céder la province de Wermland.
INGO le P ieu x , roi de Suede , fut la vi&ime de
fon zele pour l’évangile ; fon p eu p le , attaché au
culte des faux d ieux, le détrôna. Il s’enfuit en Scanie :
la haine du nom chrétien l’y fuivit ; il y fut affaffiné
par fes fujets q u i, peu contens d’avoir défendu leurs
id o le s , vouloient encore les venger. Il mourut v ers
l’an 1060. Son tombeau fut expofé à la vénération publique
dans le couvent de Warnheim. (AT. d e S acjtI)
INHARMONIQU E , ( Mufîq. ) O n appelle quelquefois
relation inharmonique , ce que l’on nomme
plus communément fauffe relation. V oy. Relat ion,
(Mufiq.) Dictionnaire raif. des Sciences, & c . (F*. D . Cl)
INJECT ION , ( Anatomie. ) C ’eft une invention
moderne ; elle a beaucoup fervi à perfe&ionner l’hiftoire
des vaiffeaux du corps animal, 6c pour en découv
rir la ftrufture la plus intime. Comme les vifee-
res font compofés de vaiffeaux, de pulpe nerveufe &
de cellulofité, & que ces vaiffeaux deviennent invifibles
, même avant que d’être capillaires, Yinjection
augmentant leur diamètre , leur donnant une couleur
plus forte , 6c les préfervant de,la-pourriture,
a révélé une grande partie des parties élémentaires
des vifeeres : 6c fi l’on avoit un moyen de colorer &
de groffir également les nerfs , on feroit fans doute
des découvertes bien importantes encore.
C ’eft Jacques Berenger de Carpi qui le premier
: s’eft fervi de Yinjection. Il s’en eft tenu a l’eau fimple ,
qui peut feryir à découvrir la communication des
vaiflèaux , mais qui ne les foutenant pas 6c s écoulant
par la moindre bleffure , eft beaucoup plus imparfaite
que ne le font les injections folides.
C e fut Swammerdam, qui aux liqueurs'cojorées
fubftirua la Cire. Son intention paroît avoir été
de conferver les parties du corps anima) féchées,;
les figures des organes de la génération font toutes
deffinées d’après des préparations feches.
J Ruyfch profita de fon exemple & de fes leçqn ç ;
il fubftitua une liqueur plus fine à la cire , qui eft
‘ QG g g