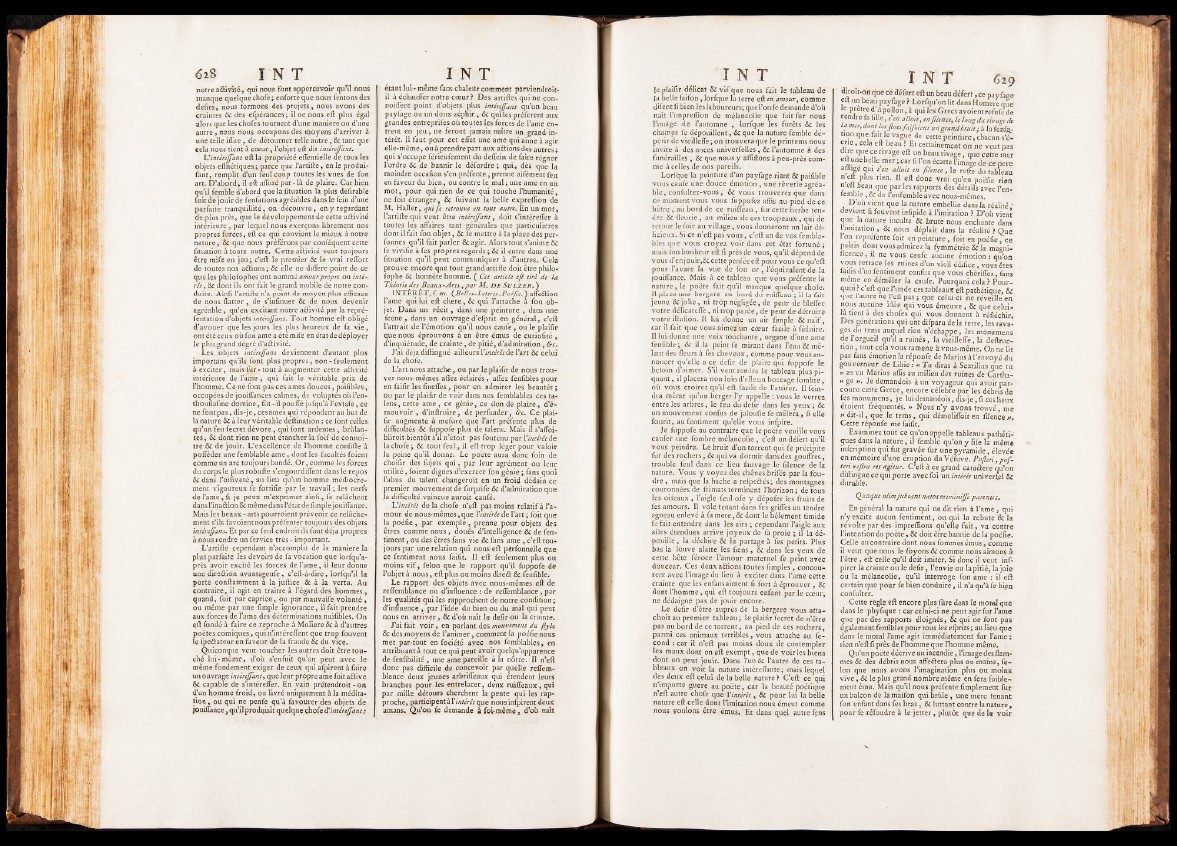
notre aôivité, qui nous font appercevoir qu’il nous
manque quelque chofe ; enforte que nous Tentons des
defirs, nous formons des projets, nous avons des
craintes 8c des efpérances; il ne nous eft plus égal
alors que les chofes tournent d’une maniéré ou d’une
autre,- nous nous occupons des moyens d’arriver à
une telle iffue, de détourner telle autre, & tant que
cela nous tient à coeur, l’objet eft dit intéreffant,
L’intéreffant eft la propriété effentielle de tous les
objets efthétiques ; parce que l’artifte, en le produi-
fant, remplit d’un feul coup toutes les vues de fon
art. D ’abord, il eft afliiré par-là de plaire. Car bien
qu’il femble d’abord que la fituation la plus delirable
ioit de jouir de fenfations agréables dans le fein d’une
parfaite tranquillité, on découvre, en y regardant
de plus près, que le développement de cette adivité
intérieure, par lequel nous exerçons librement nos
propres forces, eft ce qui convient le mieux à notre
nature, 8c que nous préférons par conféquent cette
fituation à toute autre. Cette a&ivilé veut toujours
être mife en jeu; c’eft le premier ôc le vrai reffort
de toutes nos a&ions; & elle ne différé point de ce
que lçs philosophes ont nommé amour propre ou intérêt
, 6c dont ils ont fait le grand mobile de notre conduite.
Ainfi l’artifte n’a point de moyen plus efficace
de nous flatter , de s’infinuer ÔC de nous devenir
agréable, qu’en excitant notre adivité par la représentation
d’objets intèreffans. Tout homme eft obligé
d’avouer que les jours les plus heureux de fa v ie ,
ont été ceux où fon ame a été mife en état de déployer
le plus grand degré d’adivité.
Les. objets intèreffans deviennent d’autant plus
importans qu’ils font plus propres, non - feulement
à exciter, mais fur - tout à augmenter cette adivité
intérieure de l’àme, qui fait le véritable prix de
l’homme. Ce ne font pas ces âmes douces, paifibles,
occupées de jouiflances calmes, de voluptés oii Pen-
thoufiafme domine, fut-il pouffé jufqu’à l’extafe, ce
ne font pas, dis-je, ces âmes qui répondent au but de
la nature 6c à leur véritable deftination : ce font celles
qu’un feu fecret dévore , qui font ardentes, brûlantes
, 6c dont rien ne peut étancher la foif de connoî-
tre 6c de jouir. L’excellence de l’homme confifte à
pofféder une femblable ame, dont les facultés foient
comme un arc toujours bandé. O r , comme les forces
du corps le plus robufte s’engourdiffent dans le repos
ôcdans l’oifiveté, au lieu qu’un homme médiocrement
vigoureux fe fortifie par le travail ; les nerfs
de l’ame, fi je peux m’exprimer ainfi, fe relâchent
dansl’inadionôcmême dans P état de fimplejouiffance.
Mais les beaux - arts pourroient prévenir ce relâchement
s’ils favoientnouspréfenter toujours des objets
intèreffans. Et par ce feul endroit ils font déjà propres
à nous rendre un fervice très - important.
L’artifte cependant n’accomplit de la maniéré la
plus parfaite les devoirs de fa vocation que lorfqu’a-
près avoir excité les forces de l’ame, il leur donne
une diredion avantageufe, c’eft-à-dire, lorfqu’il la
porte conftamment à la juftice & à la vertu. Au
contraire, il agit en traître à l’égard des hommes,
quand, foit par caprice, ou par mauvaife volonté,
ou même par une fimple ignorance, il fait prendre
aux forces de l’ame des déterminations nuifibles. On
eft fondé à faire ce reproche à Moliere & à d’autres
poètes comiques, qui n’intéreffent que trop fouvent
le fpedateur en faveur de la fraude 6c du vice.
Quiconque veut toucher les autres doit être touché
lui-même, d’où s’enfuit qu’on peut avec le
même fondement exiger de ceux qui afpirent à faire
un ouvrage intéreffant, que leur propre ame foit adive
8c capable de s’intéreffer. En vain prétendroit - on
d’un homme froid, ou livré uniquement à la méditation
, ou qui ne penfe qu’à favourer des objets de
jouiffance, qu’il produisît quelque chofe d’intéreffant:
étant lui - même fans chaleitr comment parviendroit-
il à échauffer notre coeur ? Des artiftesqui ne con-
noiffent point d’objets plus intéreffans qu’un beau
payfage ou un doux zéphir, 6c qui les préfèrent aux
grandes entreprifes où toutes les forces de l’ame entrent
en jeu , ne feront jamais naître un grand intérêt.
Il faut pour cet effet une ame qui aime à agir
elle-même, ou à prendre part aux adions des autres ;
qui s’occupe férieufement du deffein de faire régner
l’ordre 6c de bannir le défordre ; qui, dès que la
moindre occafion s’en préfente, prenne aifément feu
en faveur du bien, ou contre le mal ; une ame en un
mot , pour qui rien de ce- qui touche l’humanité ,
ne foit étranger, 6c fuivant la belle expreflion de
M. Haller, qui fe retrouve en tout autre. En un mot,
l’artifte qui veut être intéreffant, doit s’intérefier à
toutes les affaires tant générales que particulières
dont il fait fon objet, 6c fe mettre à la place des per-
fonnes qu’il fait parler 6c agir. Alors tout s’anime 6c
fe vivifie à fes propres regards; 6c il entre dans une
fituation qu’il peut communiquer à d’autres. Cela
prouve encore que tout grand artifte doit être philosophe
6c honnête homme. ( Cet article ejl tiré de la
Théorie des Beaux-Arts, par M. DE SüLZER. )
INTÉRÊT, f. m. (Belles-Lettres. Poéfie. ) affedion
l’ame qui lui eft chere, 6c qui l’attache à fon objet.
Dans un ré c it, dans une peinture , dans une
fcene, dans un ouvrage d’efprit en général, c’eft
l’attrait de l’émotion qu’il nous caufe, ou le plaifir
que nous éprouvons à en être émus de curiofité ,
d’inquiétude, de crainte, de pitié, d’admiration , &c.
J’ai déjà diftingué ailleurs l’wwé/-& de l’art 6c celui
de la chofe.
L’art nous attache, ou par le plaifir de nous trouver
nous-mêmes affez éclairés, affez fenfibles pour
en faifir les fineffes, pour en admirer les beautés ;
ou par le plaifir de voir dans nos femblables ces ta-
lens, cette ame, cë génie, ce don de plaire, d’émouvoir
, d’inftruire, de perfuader, &c. Ce plaifir
augmente à mefure que l’art préfente, plus de
difficultés 6c fuppofe plus de talens. Mais il s’affoi-
bliroit bientôt s’il n’étoit pas foutenu par l’intérêt de
la chofe ; 6c tout feul, il eft trop léger pour valoir
la peine qu’il donne. Le poète aura donc foin de
choifir des fujets qui, par leur agrément ou leur
utilité, foient dignes d’exercer fon génie ; fans quoi
l’abus du talent changeroit en un froid dédain ce
premier mouvement de furprife 6c d’admiration que
la difficulté vaincue auroit caufé.
L’intérêt de la chofe n’eft pas moins relatif à l’amour
de nous-mêmes, que l’intérêt de l’art ; foit que
la poéfie, par exemple, prenne pour objets des
êtres comme nous, doués d’intelligence 6c de fentiment
, ou des êtres fans vie 6c fans ame, c’eft toujours
par une relation qui nous eft pérfonnelle que
ce fentiment nous faifit. Il eft feulement plus ou
moins v i f , félon que le rapport qu’il fuppofe de
l’objet à nous, eft plus ou moins dire# 6c fenfible.
Le rapport des objets avec nous-mêmes eft de
reffemblance ou d’influence : de reffemblance, par
les qualités qui les rapprochent de notre condition ;
d’influence r par l’idée du bien ou du mal qui peut
nous en arriver, 6c d’où naît le defir ou la crainte.
J’ai fait v o ir , en parlant des mouvemens du flyle
6c des moyens de l’animer, comment la poéfie nous
met par-tout en fociété avec nos femblables, en
attribuant à tout ce qui peut avoir quelqu’apparence
de fenfibilité , une ame pareille à la nôtre. Il n’eft
donc pas difficile de concevoir par quelle reffemblance
deux jeunes arbriffeaux qui étendent leurs
branches pour les entrelacer, deux ruiffeaux,qui
par mille détours cherchent la pente qui les rapproche,
participent à M intérêt que nousinfpirent deux
amans. Qu’on fe demande à foi-même, d’où naît
le plaifir délicat St v if que nous fait le tableau dé
]a belle faifon, lorfque la terre eft en amour, comme
difent fi bien les laboureurs; quel’on-fe demande d’où
naît l’impreffion de mélancolie que fait fur nous
l’image de l’automne , lorfque les forêts 6c les
champs fe dépouillent, 6c que la nature femble dépérir
de vieilleffe ; on trouvera que le printems nous
invite à des noces univerfelles , 6c l’automne à des
funérailles , ôc que nous y affilions à peu-près comme
à celles de nos pareils.
Lorfque la peinture d’un payfage riant 6c paifible
vous caufe une douce émotion , une rêverie agréable
, confiiltez-vous, 6c vous trouverez que dans
ce moment vous vous fuppofez affis au pied de ce
hêtre, au bord de ce ruiffeau , fur cétte herbe tendre
6c fleurie, au milieu de ces troupeaux, qui de
retour le foir au village, vous donneront un lait délicieux.
Si ce n’eft pas vous, c’eft un de vos femblables
que vous croyez voir dans cet état fortuné;
mais fon bonheur eft fi près de vous, qu’il dépend de
vous d’en jouir,6c cette penfée eft pour vous ce qu’eft
pour l’avare la vue de fon o r , l’équivalent de la
jouiffance. Mais à ce tableau que vous préfente la
nature, le poète fait qu’il manque quelque chofe.
Il place une bergere au bord du ruiffeau ; il la fait
jeune 6c jolie, ni trop négligée, de peur de bleffer
votre délicateffe, ni trop parée, de peur de détruire
votre illufion. Il lui donne un air fimple 6c naïf,
car il fait que vous aimez un coeur facile à féduire.
Il lui donne une voix touchante, organe d’une ame
fenfible; 6c il la peint fe mirant dans l’eau ôc mêlant
des fleurs à fes cheveux, comme pour vous annoncer
qu’elle a ce defir de plaire qui fuppofe le
befoin d’aimer. S’il veut rendre le tableau plus piquant
, il placera non loin d’elle un boccage fombre,
où vous croirez qu’il eft facile de l’attirer. Il feindra
même qu’un berger l’y appelle : vous le verrez
entre les arbres,Je feu du defir dans les yeux ; 6c
un mouvement confus de jaloufie fe mêlera, fi elle
fourit, au fentiment qu’elle vous infpire.
Je fuppofe au contraire que le poète veuille vous
caufer une fombre mélancolie , c’efi un défert qu’il
vous peindra. Le bruit d’un torrent qui fe précipite
fur des rochers, 6c qui va dormir dans des gouffres,
trouble feul dans ce lieu fauvage le filence de la
nature. Vous y voyez des chênes brifés par la foudre
, mais que la hache a refpedés; des montagnes
couronnées de frimats terminent l’horizon ; de tous
les oifeaux , l’aigle feul ofe y dépofer les fruits de
fes amours. Il vole tenant dans fes griffes un tendre
agneau enlevé à fa mere, 6c dont le bêlement timide
fe fait'entendre dans les airs ; cependant l’aigle aux
ailes étendues arrive joyeux de fa proie ; il la dépouille
, la déchire ôc la partage à fes petits. Plus
bas la louve alaite les fiens, 6c dans les yeux de
cette bête féroce l’amour maternel fe peint avec
douceur. Ces deux adions toutes Amples , concourent
avec l’image du lieu à exciter dans l’ame cette
crainte que les enfans aiment fi fort à éprouver , ôc
dont l’homme, qui eft toujours enfant par le coeur,
ne dédaigne pas de jouir encore.
Le defir d’être auprès de la bergere vous atta-
choit au premier tableau ; le plaifir fecret de n’être
pas au bord de ce torrent, au pied de ces rochers,
parmi ces animaux terribles, vous attache au fécond
: car il n’eft pas moins doux de contempler
les maux dont on eft exempt, que de voir les biens
dont on peut jouir. Dans l’un 6c l’autre de ces tableaux
on voit la nature intéreffante ; mais lequel
des deux eft celui de la belle nature ? C’eft ce qui
n’importe guere au poète, car la beauté poétique
n’eft autre chofe que'Yintérêt, 8c pour lui la belle
nature eft celle^dont l’imitation nous émeut comme
nous voulons etre émus. Et dans quel autre fens
I diroit-on que ce défert eft un beau défert, ce payfage
elt un beau payfage ? Lorfqu’on lit dans Homere que
I le pretre d’Apollon, à qui les Grecs avoientfefufé de
rendre fa fille, s’en alloit, enfilence, le long du rivage de
a mer, dont les flots faifoient un grand bruit; k la fenfe-
tmn que fait le vague de cette peinture, chacun s’écrie
, cela eft beau ! Et certainement on ne veut pas
dire que ce rivage eft un beau rivage, que cette mer
elt unebelle mer ; car fi l’on écarte l’image de ce pere
afflige qui s’en alloit en filence , le refte du tableau
n,eJf Plus rien. Il eft donc vrai qu’en poéfie rien
n eft beau que par les rapports dê.s détails avec l’en-
lemble, 6c de Penfemble avec nous-mêmes.
. ^ ~ * u uu v ient
que la nature inculte 6c brute nous enchante dans
1 imitation, 8c nous déplaît dans la réalité ? Que
l’on repréfente foit en peinture, foit en poéfie, ce
palais dont vous admirez la fymmétrie 6c la magnificence,
il ne vous caufe aucune émotion î qu’on
vous retrace les ruines d’un vieil édifice, vous êtes
faifis d’un fentiment confus que vous chériffez, fans
même en démêler la caufe. Pourquoi cela } Pourquoi
? c’eft que l’unde ces tableaux eft pathétique, ôc
que l’autre ne l’eft pas ; que celui-ci ne réveille en
nous aucune idée qui vous émeuve , 6c que celui-
là tient à des chofes qui vous donnent à réfléchir;
Des générations qui ont difparu delà terre, les ravages
du tems auquel rien n’échappe, les monumens
de l’orgueil qu’il a ruinés, la vieilleffe, là deftruc-
tion, tout cela vous ramene à vous-même. On ne lit
pas fans émotion la réponfe de Marius à l’envoyé du
gouverneur de Libie : « Tu diras à Sextilius que tu
» as vu Marius affis au milieu des ruines de Cartha-
» ge ». Je demandois à un voyageur qui avoit parcouru
cette G rece, encore célébré par les débris de
fes monumens, je lui demandois, dis-je, fi ces lieux
étoient fréquentés. » Nous n’y avons trouvé, me
» dit-il, que le tems, qui démoliffoit en filence ».
Cette réponfe me faifit.
Examinez tout ce qu’on appelle tableaux pathétiques
dans la nature, il femble qu’on y life la même
infeription qui fut gravée fur une pyramide, élevée
en mémoire d’une éruption du Véfuve. Pofteri, pof-
teriyeflra res agitur. .C’eft à ce grand caradere qu’on
diftingué ce qui porte avec foi un intérêt univerfel 6c
durable.
Quceque olimjubeant natos meniiniffe parentes.
En général la nature qui ne dit rien à l’ame, qui
n’y excite aucun fentiment, ou qui la rebute 6c la
révolté par des impreffions qu’elle fuit, va contre
l’intention du poète, 6c doit être bannie de la poéfie.
Celle au contraire dont nous fommes émus, comme
il veut que nous le foyons 6c comme nous aimons à
l’être , eft celle qu’il doit imiter. Si donc il veut inf-
pirer la crainte ou le defir, l’envie ou la pitié, la joie
ou la mélancolie, qu’il interroge fon ame : il eft
certain que pour fe bien conduire, il n’a qu’àfe bien
confulter.
Cette réglé eft encore plus fûre dans le moral que
dans le phyfique : car celui-ci ne peut agir fur l’ame
que par des rapports éloignés, 6c qui ne font pas
egalement fenfibles pour tous les efprits ; au lieu que
dans le moral l’ame agit immédiatement fur l’ame;
rien n’eft fi près de l’homme que l’homme même.
Qu’un poète décrive un incendie, l’image des flammes
6c des débris nous affedera plus ou moins, félon
que nous avons l’imagination plus ou moins
v iv e , 6c le plus grand nombre même en fera foible-
ment ému. Mais qu’il nous préfente Amplement fur
un balcon de la maifon qui brûle , une mere tenant
fon enfant dans fes bras, 6c luttant contre la nature ,
pour fe réfoudre à le jetter, plutôt que de U voir