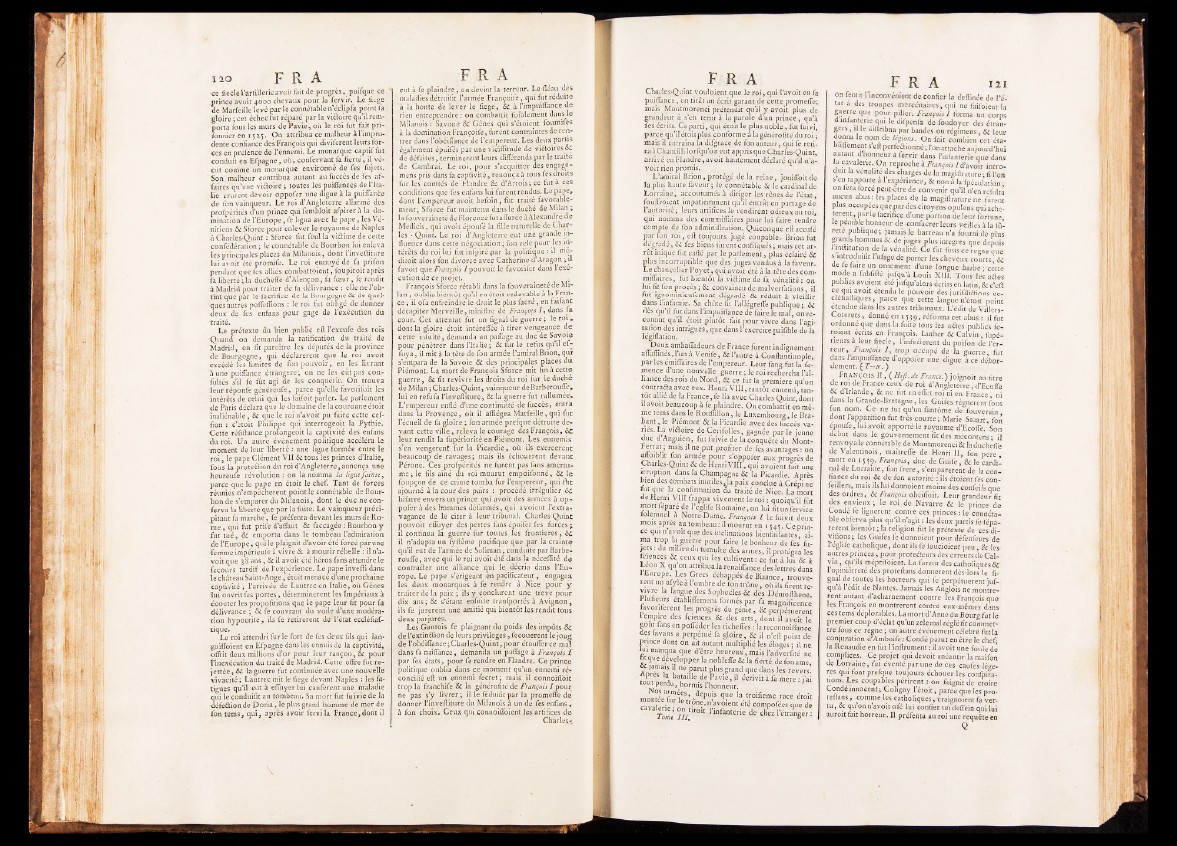
ce fieclel’artillerieavoit fait de progrès, puifque ce
prirfce avoit 4000 chevaux pour la fervir. Le ficge
de Marfeille levé par le connétable n’éclipfa point fa
gloire ; cet échec rut réparé par la viüoire qu’il remporta
fous les murs de Pavie, où le roi fut fait prisonnier
en 1515. p n attribua ce malheur à l’imprudente
confiance des François qui diviferent leurs forces
en préfence de l’ennemi. Le monarque captif fut
conduit en Efpagne, où, confervant fa fierte, il vécut
comme un monarque environné de fes fujets.
' Son malheur contribua autant au fuccès de fes affaires
qu’une viftoire ; toutes les puiffances de l’Italie
crurent devoir oppofer une digue à la puiffance
de fon vainqueur. Le roi d’Angleterre allarmé des
profpérités d’un prince qui fembloit afpirer à la domination
de l’Europe, fe ligua avec le pape, les Vénitiens
& Sforce pour enlever le royaumé de Naples
à Charles-Quint : Sforce fut feul la victime de cette
confédération; le connétable de Bourbon lui enleva
les principales places du Milanois, dont l’inveftiture
lui avoit été promife. Le roi ennuyé de fa prifon
pendant que fes alliés cômbattoient, foupiroit après
fa liberté;la ducheffe d’Alençon, fa fceur, fe rendit
à Madrid pour traiter de fa délivrance : elle ne l’obtint
que par le facrifice de la Bourgogne 6c de quelques
autres poffefîions : le roi fut obligé de donner
deux de fes enfans pour gage de l’exécution du
traité. '
Le prétexte dû bien public eft l’excufe des rois
Quand on demanda. la ratification du traité de
Madrid, on fit paroître les députés de la province
de Bourgogne, qui déclarèrent que le roi avoit
excédé les limites de fon pouvoir', en les livrant
à une puiffance étrangère; on ne les eut pas consultés
s’il fe fût agi de les conquérir. On trouva
-leur réponfe généreufe, parce qu’elle favorifoit les
intérêts de celui qui les faifoit parler. Le parlement
de Paris déclara que le domaine de la couronne étoit
inaliénable, 6c que le roi n’avoit pu faire cette cef-
iion : c’étoit Philippe qui interrogeoit la Pythie.
Cette réfiftance prolongeoit la captivité des enfans
du roi. Un autre événement politique accéléra le
moment de leur liberté : une ligue formée entre le
ro i, le pape Clément VII 6c tous les princes d’Italie,
fous la prote&ion du roi d’Angleterre, annonça une
heureufe révolution: on la nomma la ligue fainte,
parce que le pape en étoit le chef. Tant de forces
réunies n’empêcherent point le connétable de Bourbon
de s’emparer du Milanois, dont le duc ne con-
ferva la liberté que par la fuite. Le vainqueur précipitant
fa marche, fe préfenta devant les murs de Rome
, qui fut prife d’affaut 6c faccagée : Bourbon y
fut tué, 6c emporta dans le tombeau l’admiration
de l’Europe, qui le plaignit d’avoir été forcé par une
femme impérieufe à vivre & à mourir rébelle : il n’a-
"voit que 3 8 ans, 6c il avoit été héros fans attendre le
Secours tardif de l’expérience. Le pape inverti dans
le château Saint-Ange, étoit menacé d’une prochaine
captivité ; l’arrivée de Lautrec en Italie, où Gênes
lui ouvrit fes portes, déterminèrent les Impériaux à
dcouter les propofitions que le pape leur fit pour fa
délivrance ; 6c fe couvrant du voile d’une modération
hypocrite, ils fe retirèrent de1 l ’état eçcléfiaf-
tique.
Le roi attendri fur le fort de fes deux fils qui lan-
.guiflbient en Efpagne dans les ennuis de la captivité,
offrit deux millions d’or pour leur rançon, 6c pour
l’inexécution du traité de Madrid. Cette offre fut re-
^ettée, 6c la guerre fut continuée avec une nouvelle
vivacité-; Lautrec mit le liege devant Naples : les fatigues
qu’il eut à effuÿer lui cauferent une maladie
qui le conduifit au tombeau. Sa mort fut fuivie de la
défeâionde Doria, le plus grand homme dé mer de
Sontems, qui, après avoir fervila France,dont il
eut à fe plaindre, en devint la terreur. Le fléau d,es
' maladies détruifit l’armée Françoife , qui fut réduite
à la honte de lever le fiege, 6c à l’impuiffance de
rien entreprendre : on combattit foiblement dans le
Milanois : Savone 6C Gênes qui s’étoient foumifes
à la domination Françoife, furent contraintes de rentrer
dans.l’obéiffançe de l’empereur. Les deux partis
également épuiles par une vicirtitude de viftoires 6c
dé défaites, terminèrent leurs différends par le traité
’ de Cambrai. Le roi, pour s’acquitter des engagénie
ns pris dans fa captivité, renonça à tous fes droits
fur les comtés de Flandre 6c d’Artois; ce fut à ces
conditions que fes enfans lui furent rendus. Le pape,
dont l’empereur avoit befoin, fut traité favorablement;
Sforce fut maintenu dans le duché de Milan ;
la fouveraineté de Florence fut affurée à Alexandre de
Medicis, qui avoit époufé la fille naturelle de Charles
- Quint. Le roi d’Angleterre eut une grande influence
dans cette négociation;fon zele pour les.intérêts
du roi lui fut infpiré par la politique : il nic-
ditoit alors fon divorce avec Catherine d’Aragon ; il
favoit que François I pouvoir,le favorifer dans l’execution
de ce projet.
François Sforce rétabli dans la fouveraineté de Milan
, oublia bientôt qu’il en étoit redevable à la France
; il ofa enfreindre le droit le plus facré, en faifant
décapiter Merveille, miniftre de François l , dans fa
cour. Cet attentat fut un lignai de guerre ; le r o i,
dont la gloire étoit intéreffée à tirer vengeance de
cette infulte, demanda un paffage au duc de Savoie
pour pénétrer dans l’Italie ; & lur le refus qu’il ef-
fuya, il mit à la tête de fon armée l’amiral Brion, qui
s’empara de la Savoie 6c des principales places dû
Piémont. La mort de François Sforce mit fin à cette
guerre, 6c fît revivre les droits du roi fur le duché
de Milan ; Charles-Quint, vainqueur deBarberouffe,
lui en refufa l’inveftiture, 6c la guerre fut rallumée.
L’empereur enflé d’une continuité de fuccès, entra
dans la Provence, où il afliégea Marfeille, qui fut
l’écueil de fa gloire ; fon armée pr.efque détruite devant
cette ville , releva le courage des François, 6c
leur rendit la fupériorité en Piémont. Les ennemis
s’en vengerent fur la Picardie, .où ils exercèrent
beaucoup de ravages; mais ils échouèrent devant
Péroné. Ces profpérités ne furent pas fans amertume
; le fils aîné du roi mourut empoifonné, 6c le
foupçon de ce crime tomba fur l’empereur, qui fût
ajourné à la cour des pairs. : procédé irrégulier 6c
bifarre envers un prince qui avoit des armées à opr>
pofer à des hommes défarmés, qui avoient l’extravagance
de le citer à leur tribunal. Charles-Quint
pouvoit effuyer des pertes fans épuifer fes forces 5
il continua la guerre fur toutes les frontières, 6c
il n’adopta un fyftême pacifique que par la crainte
qu’il eut de l ’armée de Soliman, conduite par Barbe-
roufle, avec qui le roi avoit été dans la néceflité de
contra&er une alliance qui le,.décria dans l’Europe.
Le pape s’érigeant en pacificateur, engagea
les deux monarques à fe rendre à Nice pour y
traiter de la paix ; ils y conclurent une treve pour
dix ans ; 6c s’étant enfùite tranfportés à Avignon,
ils fe jurèrent une amitié qui bientôt les rendit tous
deux parjures.
Les Gantois fe plaignant du poids des impôts 6ç
de l’extinûion de leurs privilèges, fecouerent le joug
de l’obéiffance; Charles-Quint, pour étouffer ce mal
dans fa naiffanc.e, detnanda un paffage à François X
par fes états, pour fe rendre en Flandre. Ce prince
politique oublia dans ce moment qu’un ennemi ré*
concilié eft un ennemi fecret ; mais il connoifl’oït
trop la franchife & la généralité de François X pour
ne pas s’y livrer ; il le féduifit par la promeffe de
donner l’inveftiture du Milanois à un de fes enfans ,
à fon choix. Ceux qui connoifloient les artifices de
Charlesr.
Charles-Quint vouloient que le roi, qui I’avoit en fa'
puiffance , en tirât un écrit garant de cette,promeffe;
mais Montmorenci prétendir qu’il y avoit plus de
grandeur à s’en tenir â la parole d’un prince, qu’à
les, écrits. Ce parti, qui étoit le plus noble, fut fuivi,
.parce qu’il.étoit plu« .conforme à la générofité du roi ;
ihais il entraîna la difgrace de fon auteur, qui fe retira
à Ghantilli Iorfqu’on eut appris que, Çharles-Quint,
arrivé en Flandre,avoit hautement déclaré qu’il n’â-
Voit rien promis.
L’amiral Brion, protégé de la reine, jouiffoitde
la plus haute faveur; le. connétable Soie cardinal de
Lorraine, accoutumés à diriger les rênes de l’état,
fouffroient impatiemment qu’il entrât en partage de
rautôrité.;. leurs artifices le rendirent odieux au roi,
qui nomma des çommiffaires pour lui faire rendre
compte de fon adminiftration. Quiconque eft accufé
par fon roi , eft toujours jugé coupable. Brion fut
«flphie;, 6c fes biens furent confifqués; mais cet arrêt
inique fut caffé par le, parlement, plus éclairé 6c
plus incorruptible que des juges vendus;à la faveur.
Le chancelier Poyet, quj avoit été à la tête des com-
miffaires, fut bientôt la viélimé de fa, vénalité: on
lui fit fon procès ; 6c convaincu de malverfations, il
fut jgnominieufement dégradé 6c réd.uit à vieillir
dans l’mfamie. Sa chute fit l’allégreffe publique ; 6c
dès qu’il fut dans l’impuiflance dé faire le mal, on re-
connut qu il etoit,,plutôt. fait pour vivre dans l’agi-
tation des intrigues, que dans l ’exercice paifibie de la
legiflation.
zr'R?11? am^)a^'acieurs de France furent indignement
affafiinés,f’un à Venife, 6c l’autre à Conftantinople, .
par les emiffaires de l’empereur. Leur fang fut la fe-
mence d’une nouvelle guerre ; le roi rechercha l’al-
- liance desrois du Nord, 6c ce fut la première qu’on
eontraaa avec eux." Henri'VIU, tantôt ennemi, tantôt
aÿmde la France, fe lia avec,Charles Quint,dont'
il avoit beaucoup à fe plaindre. On combattit en me-.
mÇ|Jms dans le RoitffiUon, le Luxembourg, le Brabant,
le Piéiponf &,ia Picardie avec des, fuccès va-
I 4 t syf-a viûoire deCenfôlles, gagnée parle jeune
d t | d ’Anguien, fut buîyie de la çanguête du Mont-
ne put profiter de fes avantages : on
affoiblit fon armée pour s’oppofer aux progrès de
Charles-Quint & de Henri VIII, qui avoient mit une
irruption dans la Champagne 5c la Picardie. Après^
bien des combats inutiles la paix conclue à Crépine
tut que la confirmation du traité de Nie,e. La mort
de Henri VIII frappa vivement le roi ;
niort tepare de l’égiife Romaine, on lui .fitun fervice
lplemnei à Notre-Dame. François 1 le f.iivit deux
mmaptès au tondieau : il mourut en 1 545. Ce pria,
çe qui n ayoït que des inclinations bienfaifantes ai-
“ a tI;,0P “ ,.gu.ef re PÇUf.faire le bonheur-de fes fu-
jets : du milieu du tumulte des armes, il protégea les
& ceux qui les cultivenoece fut à lui & à
Leqn X qu on attribua la renaiiïance des lettres dans
1 Europe. Les Grecs..échappés de.Bizance, trouvèrent
un afyle a 1 ombre de fon trône ,.,gb-iis firent re-'
vivre la langue des Sophocles 5c dés Démoflhene.
Plufieurs etabliffemens formés par fa magnificence
favoriferent les progrès du génie, 5c perpétuèrent
1 empire des fciences 5c des arts., dont il avoit le
goût fans en pofleder les richeflès : la.r.econnoiflance
deslavEins a perpétue fa gloire, 5c il n’éft-psint de
prince dont on ait autant multiplié,les ^ogesi; il ne.
lui manqua que d’être heureux, mais j ’adverfité ne
“ 9ue développer la nobleffe 8c la fierté de fon ame
« jamais il ne parut plus grand que dans les revêts!,
f o u t o u ba;aale Ë P d « e ,ü écrivit à fa H
t o i i t p e r d u , h o rm i s l ’h o n n e u r .
q -‘ e Ia % 1ï e« !e :?'a c e é to i t
i ü H B *e P a b o ie n t é té c o m p o s e s q u e de
d e ch e z l ’é t r a n g e r :
on fêntit l’inconvénient de confier la deftinée de l’état
à des troupes mercenaires, qui ne faifoient la
guerre que pour piller. François I forma un corps
a infanterie qui le difpenfa de foudoyer des étrangers
, il le diftribua par bandes ou régimens 6c leur
donna le nomde légions. On fait combien cet éta-
bhflement s eft perfectionné ; l’on attache aujourd’hui
autant d honneur à fervir dans l’infanterie que dans
la cavalerie. On reproche à François / d’avoir introduit
la vénalité des charges de la magiftrature ; fi l’on
s en rapporte à l’expérience, & non à lafpéeulation
on fera forcé peut-être de convenir qu’il n’en réfulta
aucun abus : les places de la magiftrature ne furent
plus occupées que par des citoyens opulens qui achetèrent,
par le facrifice d’une portion de leur fortune
le penible honneur de confacrer leurs veilles à la fû-
rete publique; jamais le barreau n’a fourni de plus
grands hommes & de juges plus intégrés que depuis
linftmirion de la vénalité. Ce fut fous ce regne que
s îmroduifit l’ufage de porter les cheveux courts, 6c
de fe faire un ornement d’une longue barbe ; cette
mode a fubfifté jufqu’à Louis XIII. Tous les aûes
publics avoient été jufqu’alors écrits en latin, & c ’eft
ce qui avoit étendu le pouvoir des jurifdiûions ec-
clefiaftiques, parce que cette langue n’étoit point
etendue dans les autres tribunaux. L’édit de Villers-
Coterets, donné en 1539» réforma cet abus : il fut
ordonné que dans la fuite tous les aâes publics fe-
roient écrits en François. Luther 6c C a lv in fu p é -
rieurs à leur fiecle, l’infetterent du poifon de l’erreur,
François J, trop occupé de la guerre fut
dans l’impuiffance d’oppofer une digue à ce débordement.
( T—n . y „
François II, ( Hiß. de France.') joignoit au titre
de roi de France ceux de roi d’Angleterre, d’Ecoffe
6c d’Irlande, & ne fut en effet roi ni en France ni
dans la Grande-Bretagne,. les Guifes régnèrent fous
fon nom. Ce ne fut qu’un fantôme de fouverain
dont l’apparition fut très,courte; Marie Stuart,- fon
époufe, lui avoit apporté le royaume d’Ecoffe. Son
début dans le gouvernement fît des mécontens ; il
renvoya le connétable de Montmorenci 6c la duchefle
de Valentinoist,; •maîtreffe de Henri II, fon p ere,
mort en 15 59. François, duc de.Guife, 6c le cardi-
nal de Lorraine, fon frere, s’emparèrent de la confiance
du roi 6c de fon autorité : ils étoient fes côn-
feillers, mais ils lui donnoient moins des confeilsque
des ordres, 6c François obéiffoit. Leur grandeur fit
des envieux ; Me roi de Navarre 6c le prince de
Condé fe liguèrent contre ces princes : le Connétable
obferva plus qu’il n’agit : les deux partis feTépa-
rerent bientôt ; la religion fut le prétexte de ces di-
vifions ; les Guifes fe donnoient pour défenfeurs de
l’églife catholique, dont ils fe foucioient peu, & les
autres princes., pour protefteurs des erreurs de Calvin,
qu’ils méprifoient. La fureur des catholiques &
l’opiniâtreté des proteftans donnèrent dès-lors le lignai
de toutes les horreurs qui fe perpétuèrent jufqu’à
l’édit de Nantes. Jamais les Anglois ne montre-
, r.ent autant d’acharnement contre les François que
les François en montrèrent contre eux-mêmes dans
ces tems déplorables. La mort d’Anne du Boura fut le
premier coup d éclat qu’un zelemalréglé fit commettre
fous ce regne ; un autre événement célébré fut la
j conjuration d’Amboife : Condé parut en être le chef-
la Renaudie.en fut l ’inftrument : il avoit une foule de
complices. Ce projet qui devoit anéantir la maifon
de Lorraine, fut éventé par une de ces caufes-lége-
res qui font prefque toujours échouer les confpira-
tions. Les, coupables périrent : on feignit de croire
Condé innocent ; Coligny l’étoit, parce que les proteftans
, comme les catholiques, craignoient fa vér-
tu, 6c qu’on n’avoit ofé lui confier uq defl’ein qui lui
auroit fait horreur. Il préfenta au roi une requête en
Q