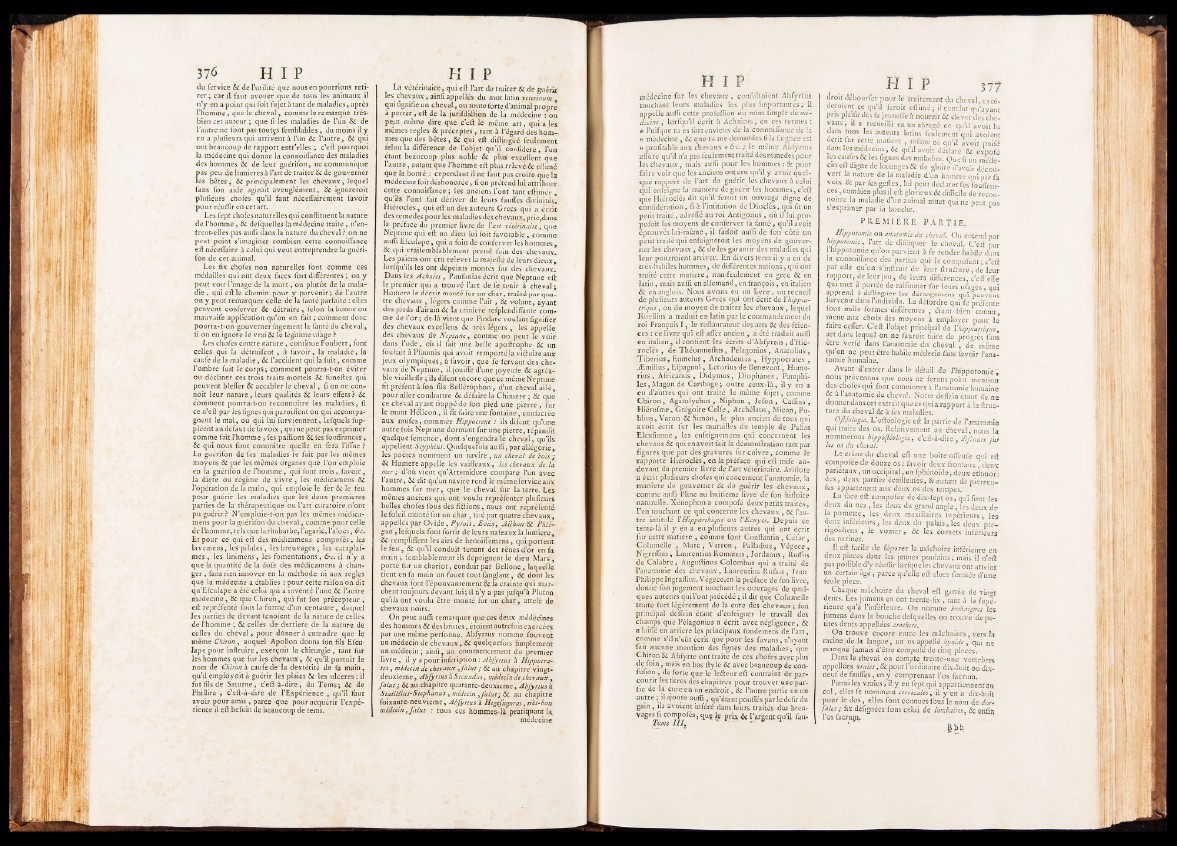
da fervice & de l’utilité que nous en pourrions retirer;
car il faut avouer que de tous les animaux il
n’y en a point qui foit fujet à tant de maladies, après
l’homme, que ie cheval, comme le remarque très-
bien cet auteur ; que fi les maladies de l’un 6c de
l’autre ne font pas toutes femblables, du moins il y
' en a plufieurs qui arrivent à l’un & l’autre, 6c qui
ont beaucoup de rapport entr’elles ; c’eft pourquoi
la médecine qui donne la connoiflance des maladies
des hommes 6c de leur guérifon, ne communique
pas peu de lumières à l’art de traiter.& de gouverner
les bêtes, 6c principalement les chevaux, lequel
fans fon aide agiroit aveuglément, 6c ignoreroit
plufieurs chofes qu’il faut néceffairëment favoir
pour réuflïr en cet art.
Les fept chofes naturelles qui conftituent la nature
de l’homme, 6c defquelles la médecine traite, n’entrent
elles pas aufli dans la nature du cheval ? on ne
peut point s’imaginer combien cette connoiflance
eft néceffaire à celui qui veut entreprendre la guéri-
lon de cet animal.
Les fix chofes non naturelles font comme ces
médailles qui ont deux faces fort differentes ; on y
peut voir l’image de la mort, ou plutôt de la maladie
, qui eft le chemin pour y parvenir ;• de l’autre
on y peut remarquer celle de la fanté parfaite : elles
peuvent conferver 6c détruire, félon la bonne ou
mauvaife application qu’ on en fait ; comment donc
pourra-t-on gouverner fagement la fanté du cheval,
fi on en ignore le vrai 6c le légitime ufage ?
Les chofes contre nature , continue Foubert, font
celles qui la détruifent , à favoir, la maladie, la
caufe de la maladie, 6c l’accident qui la fuit, comme
l ’ombre fuit le corps ; comment pourra-t-on éviter
ou décliner ces trois traits mortels 6c funeftes qui
peuvent bleffer 6c accabler le cheval, fi on ne con-
noît leur nature, leurs qualités 6c leurs effets ? 6c
comment pourra-t-on reconnoître les maladies, fi
ce n’eft par les lignes qui paroiffent ou qui accompagnent
le mal, ou qui lui fur viennent, lefquels fup-
pléent au-défaut de fa v o ix , qui ne peut pas exprimer
comme fait l’homme, les pallions 6c les fouffrances,
6c qui nous font connoître quelle en fera l’ilTue ?
La guérifon de fes maladies le fait par les mêmes
moyens 6c par les mêmes organes que l’on emploie
en la guérifon de l’homme, qui font trois, favoir,
la diete ou régime de v iv re , les médicamens 6c
l’opération de la main, qui emploie le fer 6c le feu
pour guérir les maladies que les deux premières
parties de la thérapeutique ou l’art curaroire n’ont
pu guérir ? N’emploie-t-on pas les mêmes médica-
mens pour la guérifon du cheval, comme pour celle
de l’homme, t els qu e la rhubarbe, l’agaric, l’aloès, &c.
Et pour ce qui eft des médicamens compofés, les
lavemens,les pilules, les breuvages, les cataplaf-
mes , les linimens , les fomentations , &c. il n’y a
que la quantité de la dofe des médicamens à changer
, fans rien innover en la méthode ni aux réglés
que la médecine a établies : pour cette raifonon dit
qu’Efculape a été celui qui a inventé l’une 6c l’autre
médecine, 6c que Chiron, qui fut fon précepteur ,
eft repréfenté fous la forme d’un centaure, duquel
les parties de devant tenoient de la nature de celles
de l’homme ; 6c celles de derrière de la nature de
celles du cheval, pour donner à entendre que le
même Chiron, auquel Apollon donna fon fils Efcu-
lape pour inftruire, exerçoit la chirurgie , tant fur
les hommes que fur les chevaux, 6c qu’il portoit le
nom de Chiron à caufe de la dextérité de fa main,
qu’il employoit à guérir les plaies 6c les ulcérés : il
fut fils de Saturne, c’eft-à-dire, du Tems; & de
Phillira , c’eft-à-dire de l’Expérience , qu’il faut
avoir pour amis , parce que pour acquérir l’expérience
il eft befoin de beaucoup de tems.
La vétérinaire, qui eft l’art de traiter 6c de guérir
les chevaux, ainfiappellés du mot latin yeterinum ,
qui lignifie un cheval, ou toute forte d’animal propre
a porter, eft de la jurifdiéfion de la médecine : on
pe^it meme dire que c’eft le même art, qui a les
mêmes réglés & préceptes, tant à l’égard des hommes
que des bêtes, 6c qui eft diftingué feulement
félon la différence de l’objet qu’il confidere, l’un
étant beaucoup plus noble 6c plus excellent que
■ l’autre, autant que l’homme eft plus/elevé 6ç ellîmé
que la bonté : cependant il ne faut pas croire que la
! médecine foit déshonorée, fi on prétend lui attribuer
cette connoiflance ; les anciens l’ont tant eftimée ,
qu’ils l’ont -fait dériver de leurs fauffes divinités.
Hiéroclès, qui eft un des auteurs Grecs qui a écrit
des remedes pour les maladies des chevaux, prie,dans
la préface du premier livre de Y art vétérinaire, que
Neptune qui eft un dieu lui foit favorable, comme
aufli Elculape, qui a foin de conferver les hommes,
& qui vraifemblablement prend foin des chevaux.
Les païens ont cru relever la majefté de leurs dieux,
lorfqu’ils les ont dépeints montés fur des chevaux.
Dans les Achaïes, Paufanias écrit que Neptune eft
le premier qui a trouvé l’art de fe tenir à cheval;
Homere le décrit monté fur un char, traîné par quatre
chevaux , légers comme l’a ir , 6c volant, ayant
des pieds d’airain 6c la crinière refplendiflante comme
de l’or; de là vient que Pindare voulantlignifier
des chevaux excellens 6c très-légers , les appelle
des chevaux de Neptune, comme on peut le voir
dans l’ode, oit il fait une belle apoftrophe 6c un
fouhait à Pfaumis qui avoit remporté la viftoire aux
jeux olympiques, à favoir , que fe fervant des chevaux
de Neptune, il jouiffe d’une joyeufe 6c agréable
vieilleffe ; ils difent encore que ce même Neptune
fit préfent à fon fils Bellérophon, d’un cheval ailé,
pour aller combattre 6c défaire la Chimere ; 6c que
ce cheval ayant frappé de fon Ipied une pierre , fur
le mont Hélicon , il fit faire une fontaine, confacrée
aux mufes, nommée Hippocrene : ils difent qu’une
autre fois Neptune dormant fur une pierre, répandit
quelque femence, dont s’engendra le cheval, qu’ils
appellent Scypkius. Quelquefois aufli, par-allégorie,
les poètes nomment un navire , un cheval de bois ;
6c Homere appelle les vaiffeaux, les chevaux de la,
mer ; d’où vient qu’Artemidore compare l’un avec,
l’autre, 6c dit qu’un navire rend le même fervice aux
hommes fur mer, que le cheval fur la terre. Les
mêmes anciens qui ont voulu repréfenter plufieurs
belles chofes fous des fidions, nous ont repréfenté
le foleil monté fur un char, tiré par quatre chevaux,
appellés par Ovide, Pyroïs, Eoits, Aclhon 6c Pklé-
gon , lefquels font fortir de leurs nafeaux la lumière,
ËC rempliffent les airs de henniffemens,. qui portent
le feu , 6c qu’il conduit tenant des rênes d’or en fa
main ; femblablement ils dépeignent le dieu Mars ,
porté fur un chariot, conduit par Bellone , laquelle
tient en fa main un fouet tout fanglant, 6c dont les
chevaux font l’épouvantement 6c la crainte qui marchent
toujours devant lui; il n’y a pas jufqu’à Pluton
qu’ils ont voulu être monté fur un char, attelé de
chevaux noirs.
On peut aufli remarquer que ces deux médecines
des hommes 6c des brutes, étoient autrefois exercées
par une même perfonne. Abfyrtus nomme.fouvent
un médecin de chevaux, & quelquefois Amplement
un médecin ; ainfi, au commencement du premier
livre , il y a pour infcriptiôn : Abfyrtus à Hippocrates
, médecin de chevaux,falut ; 6c au chapitre vingt-
deuxieme, Abfyrtus à Secundus, médecin de chevaux ,
falut ; & a u chapitre quarante-deuxieme, Abfyrtus h
Statillius-Stephanus , médecin ,falut; 6c. au chapitre
foixante-neuvieme, Abfyrtus à Hegefugoras, tris-bon
médecin y falut : tous ces hommes-là pratiquant la.
medecine
H I P
médecine fur les chevaux , confultoîent Abfyr'tùè
touchant leurs maladies les plus importantes ; il
appelle aufli cette profefîïon du nom Ample dé médecine
, lorfqu’il écrit à Achaïcus, en ces termes :
« Puifque tu es fort envieux de la connoiflance de la
» médecine , 6c que tu me demandes fi la faignée eit
»profitable aux chevaux » &c. ; le même Abfyrtus
aflure qu’il n’a pas feulement traite des remedes pour
les chevaux, mais aufli pour les hommes : & pour
faire voir que les anciens ont cru qu’il y avoit quelque
rapport de l’art de guérir les chevaux à celui
qui enfeigne la maniéré de guérir les hommes, c’eft
que Hiéroclès dit qu’il feroit un ouvrage digne de
confidération, fi à l’imitation de Dioclès, qui fit un
petit traité, adrefle au roi Antigonus , où il lui pro-
pofoit les moyens de conferver fa fanté, qu’il avoit
éprouvés lui-même, il faifoit aufli de fon côté un
petit traité qui enfeigneroit les moyens de gouverner
les chevaux, 6c de les garantir des maladies qui
leur pourroient arriver. En divers tems il y a eu de
très-habiles hommes, de différentes nations, qui ont
traité cette matière, non-feulement en grec 6c en
latin, mais aufli en allemand, en françois , en italien
6c en anglois. Nous avons eu un liv re, un recueil
de plufieurs auteurs Grecs qiii ont écrit de Yhippia-
trique , ou du moyen de traiter les chevaux, lequel
Ruellius a traduit en latin par le commandement du
roi François I , le reftaurateur des arts & des feien-
ces : ce livre qui eft a l l e z ancien , a été traduit aufli
en italien, il contient les écrits d’Abfyrtus, d’Hié-
roclès , de Théomneftus, Pélagonius, Anatolius ,
Tiberius, Eumelus , Archodemus , Hyppocrates ,
Æmilius, Efpagnol, Letorius de Benevent, Hume-
rius , Africanus , Didymus, Diophanes , Pamphi-
le s , Magon de Carthage ; outre ceux-là, il y en a
eu d’autres qui ont traité le même fujet, comme
Chiron, Agatolychus , Niphon , Jefon , Cafîius ,
Hiérofme, Grégoire Celfe, Archélaus, Micon, Pu-
blius,Varon & Simon, le plus ancien de tous qui
avoit écrit fur les murailles du temple de Pallas
Eleufienne , les enfeignemens qui concernent les
chevaux 6c qui en avoit fait la démonftration tant par
figures que par des gravures fur cuivre, comme le
rapporte Hiéroclès, en la préface qui eft mife au-
devant du premier livre de l’art vétérinaire. Ariftote
a écrit plufieurs chofes qui concernent l’anatomie, la
maniéré de gouverner 6c de guérir les chevaux,
comme aufli Pline au huitième livre de fon hiftoire
naturelle. Xénophon a compofé deux petits traités,
l ’un touchant ce qui concerne les chevaux , 6c l’autre
intitulé l’Hipparchique ou VEcuyer. Depuis ce
tems-là il y en a eu plufieurs autres qui ont écrit
fur cette matière , comme font Conftantin , Céfar,
Columelle , Marc, Varron , Palladius, Végece,
Nigreflius, Laurentius Romanus , Jordanus, Ruffus
de Calabre, Auguftinus Colombus qui a traité de
l ’anatomie des chevaux, Laurentius Rufius, Jean
Philippe Ingraflius. Végece,en la préface de fon livre,
donne fon jugement touchant les ouvrages de quelques
auteurs quil’ont précédé ; il dit que Columelle
traite fort légèrement de la cure des chevaux ; fori
principal deflein étant d’enfeigner le travail des
champs que Pélagonius a écrit avec négligence, 6c
a laifle en arriéré les principaux fondemens de l’art,
comme s’il n’eût écrit que pour les favans, n’ayant
fait aucune mention des Agnes des maladies ; que :
Chiron & Abfyrte ont traité de ces chofes avec plus
de foin, mais en bas ftyle 6c avec beaucoup de con-
fufion, de forte que le le&eur eft contraint de parcourir
les titres des chapitres pour trouver une partie
de la cure en un endroit, 6c l’autre partie en un
autre ; il ajoute aufli, qu’étant pouffés par le defir du
gain , ils avoient inléré' dans leurs traités des breu-
yages fi compofés, quç le prix & l ’argent qu’il fau-
Tome ///» - •
H I P 377
aroit débourfer pour le traitement du cheval, excé*
deroient ce qu’il feroit eftimé; il conclut qu’ayant
pris plaifir dès fa jeuneffe à nourrir 6c élever des chevaux,
il a recueilli en un abrégé ce qu’il avoit lu
dans tous les auteurs latins feulement qiii avoient
écrit fur cette matière , même ce qu’il avoit puifé
dans les médecins, 6c qu il avoit déclaré 6c expofé
les caufes & les fignes des maladies. Que fi un médecin
eft digne de louanges 6c de gloire d’avoir découvert
la nature de la maladie d’un homme qui par fa
voix 6c par fes geftes, lui peut déclarer fes fouffrances
, combien plus il eft glorieux 6c difficile de recon-
noitre la maladie d’un animal muet qui ne peut pas
s exprimer par fa bouche. r
P R E M I E R E P A R T I E .
Hippotoniie ou anatomie du cheval. On entend par
hippotômièy l’art de difléquer le cheval. C’eft par
hippotomie qu’on parvient à fe rendre habile dans
la connoiflance des parties qui le compofent ; c’eft
par elle qu’on s’inftruit de leur ftruéhire , de leur
rapport, de leurjeu, de leurs différences, c’eft elle
qui met à portée de raifonner für leurs ufages, qui
apprend à diftinguer les dérangemens qui peuvent
furvenir dans l’individu. Le défordre qui fe préfente
tous mille formes différentes , étant bien connu
mene aux choix des moyens à employer pour le
aire cefler. Ceft 1 objet principal de Vhippiatrique9
art dans lequel on ne fauroit faire de progrès fans
etre verfé dans l’anatomie du cheval , de même
qu’on ne peut être habile médecin fans favoir l’anatomie
humaine.
Avant d entrer dans le détail de I’hipporomie ;
nous prévenons que nous ne ferons point mention
des chofes qui font communes à l’anatomie humainè
6c à l’anatomie du cheval. Notre deflein étant de ne
donner dans cet extrait que ce qui a rapport à la ftruc-
ture du cheval 6c à fes maladies.
OJleologie. L’oftéologie eft la partie de l’anatomie
qui traite des os. Relativement au cheval, nous la
nommerons hippoféologie, c’eft-à-dire , dihours fur
les os du cheval,
Le crâne du cheval eft une boîte ofléufe qui eft
com^ofée de douze os : favoir deux frontaux, deui
pariétaux, un occipital, un fphénoïde, deux ethmoï j
des, deux parties écailleufes, & autant de pierreu-
fes appartenant aux deux os'des tempes.
La face eft compoféê de dix-fept o s , qui font les
deux du nez, les deux du grand angle, les deux de
lapomette, les deux maxillaires fuperieurs, les
deux inférieurs, les deux du palais, les deux pte-
rigoïdiens , le vomer, 6c les cornets inférieurs
des narines.
Il eft facile de féparer la mâchoire inférieure en
deux pièces dans les jeunes poulains ; mais il n’eft
pas poffibte d’y réufllr lorfque les chevaux ont atteint
un certain âge, parce qu’elle eft alors formée d’une
feule pièce.
Chaque mâchoire du cheval eft garnie de vingt
dents. Les jumens en ont trentê-fix, tant à la fupé-
rieure qu’a l’inférieure. On nomme brehaignes les
jumens dans la bouche deiquelles on trouve de petites
dents appellées crochets.:' •’
On trouve encore entre les mâchoires, vers la
racine de la langue , un os appelle hyoïde, qui ne
manque jamais d’être compofé de cinq pièces.
Dans le cheval on compte trente-une vertébrés
appellées vraies, & pour l’ordinaire dix-huit ou dix-
neuf de fauffes, en y comprenant l’os facrum.
Parmi les vraies, il y en fept qui appartiennent ait
Col, elles fe nomment cervicales, il y en a dix-huit
pour le dos, elles font connues fous le nom de </or-
fales ; fix défignées fous celui de lombaires, 6c enfitl
l’os facrupi.
g b b