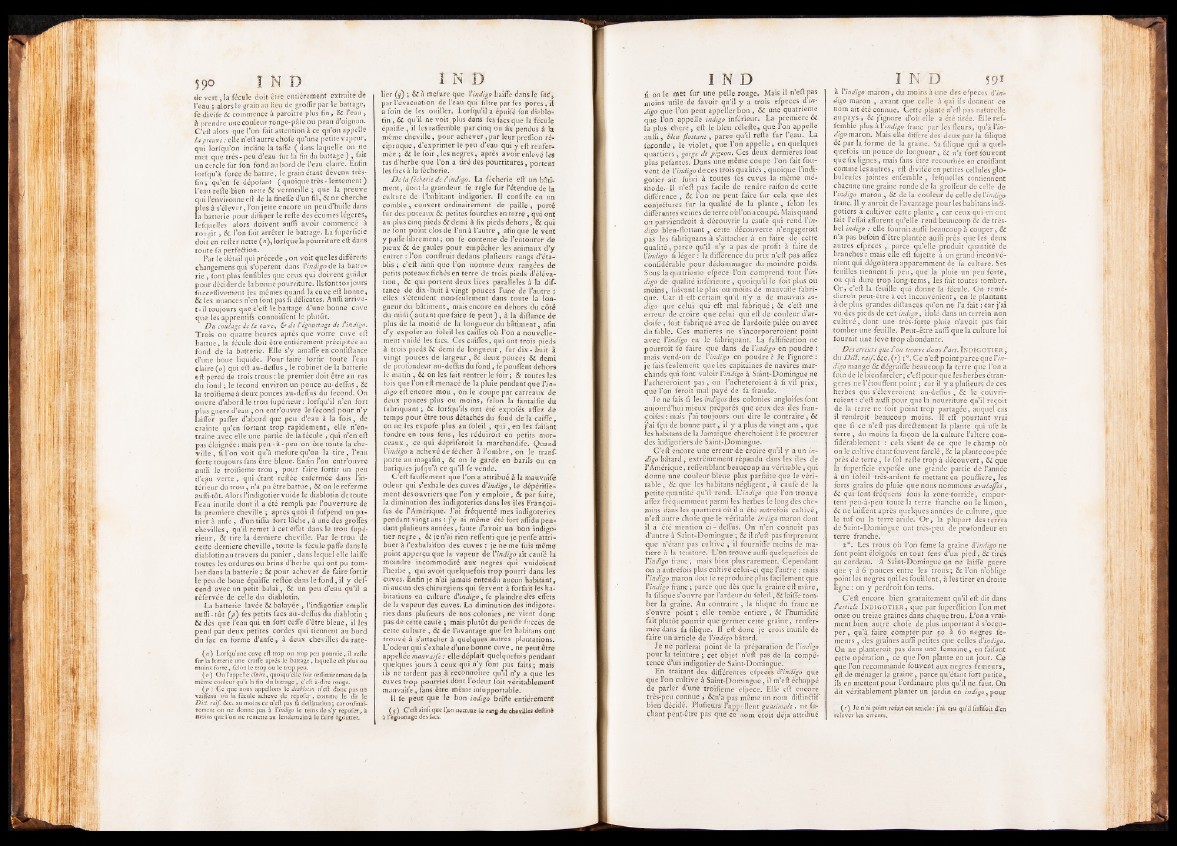
5 9° I N D
de v e r t , la fécule doit êtte entièrement extraite de
l ’eau ; alors le grain au lieu de groflir par le battage,
fe divife 6c commence à paroître plus fin , & l’ eau ,
à prendre une couleur roüge-pâlèou peau d’oignon.
C ’eft alors que l’on fait attention à ce qu’on appelle
la preuve : elle n’eft autre chofe qu’une petite vapeur,
qui lorfqu’on incline la taffe ( dans laquelle ôn ne
met que très -p eu d’eau fur la fin du battage) , fait
un cercle fur fon fondait bord de l’eau claire. Enfin
lorfqu’à force de battre, le grain étant devenu très-
fin ; q.u*en fe dépofant ( quoique très - lentement )
l ’eau refte bien nette & vermeille ; que la preuve
qui l’environne eft de la fineffe d’un fil, 6c ne cherche
plus à s’é le v e r , l’on jette encore un peu d’huile dans
la batterie pour diflîper le refte des écumes légères,
lefquelles alors doivent auflî avoir commencé à
rougir , & l’on fait arrêter le battage. La fuperficie
doit~en refter nette (n ),lor fq ue la pourriture eft dans
toute fa pérfe&ion.
Par le détail qui précédé , on v oit que les différeris
changemens qui s’opèrent dans Vindigo de la batterie
, font plus fenlibles que ceux qui doivent guider
pour décider de la bonne pourriture. Ils font toujours
fucceflivement les mêmes quand la cuve eft bonne,
6 les nuances n’en font pas fi délicates. Audi arrive-
t - i l toujours que c’ eft le battage d’une bonne cuve
que les apprentifs connoiffent le plutôt.
D u coulage de la cuve, & de £ égouttage de £ indigo.
T ro is ou quatre heures après que vo tre cuve eft
ba ttue, la fécule doit être entièrement précipitée au
fond de la batterie. Elle s’y a m'a lie en confiftafice
d’une boue liquide. Pour faire fortir toute l’eau
claire (o ) qui eft au-deflùs, le robinet de la batterie
eft percé de trois trous : le premier doit être au ras
du fond ; le fécond environ un pouce au-deflus, 6c
la troifieme à deux pouces au-deflus du fécond. On
o uv re d’abord le trou fupérieur: lorfqu’il n’en fort
plus guere d’eau , on entr’ouvre le fécond pour n’y
laitier palier d’abord que peu d’eau à la fo is , de
crainte qu’en fortant trop rapidement, elle n’entraîne
avec elle une partie de la fécule , qui n’en eft
pas éloignée : mais peu - à - peu on ô te toute la chev
ille , fi l’on voit qu’à mefure qu’on la t i r e , l ’eau
forte toujours fans être bleue. Enfin l’on entr’ouvre
aulfi le troifieme trou , pour faire fortir un peu
d’eau v erte , qui étant reliée enfermée dans l ’intérieur
du trou , n’a pu être ba ttue, & on le referme
aufli-tôt. Alors l’indigotier vuide le diablotin de toute
l’eau inutile dont il a été rempli par l’ ouverture de
la première cheville ; après quoi il fufpend un panier
à anfe , d’un tilïu fo rt lâche , à une des groffés
ch e v ille s , qu’ il remet à cet effet dans le trou fupér
ie u r , 6c tire la derniere cheville. Par le trou de
cette derniere ch e v ille , toute la fécule paffe dans le
diablotin au travers du panier, dans lequel elle laifle
toutes les ordures ou brins d’herbe qui ont pu tomb
e r dans la batterie ; & pour achever de faire fortir
le peu de boue épaiffe reftée dans le fo n d , il y def-
cend avec un petit b a la i, 6c Un peu d’eau qu’il a
réferv ée de celle du diablotin.
La batterie lavée 6c balayée , l’indigotier emplit
auflî - tôt (/>) fes petits faes du-deflus du diablotin ;
& dès que l’eau qui en fort ceffe d’être bleue, il les
pend par deux petites cordes qui tiennent au bord
du fac en forme d’an fe , à deux chevilles du rate-
(ra) Lorfqu’une cuve eft trop ou trop peu pourrie , il refte
fur la batterie une crafle après le battage, laquelle eft plus ou
moins forte, félon le trop ou le trop peu.
( o ) On l’appelle claire, quoiqu’elle foit ordinairement de la
même couleur qu’à la fin du battage, c’eft à-dire rouge.
(/? ) Ce que nous appelions le diablotin n’eft donc pas un
Vaiiïeau où la fécule achevé de répofer, comme le dit le
Di(l. raif. & c. au moins ce n’eft pas ta deftination ; carordinai-
fement on ne donne pas à l'indigo le tems de s’y repofef, à
moins que l ’on ne remette au lendemain-à le faire égoutter.
lie r (q) ; & à mefiire que 1*indigo baiffe dans îê fàd,
par l’évacuation de l’eau qui filtre par fes p o re s , il
a foin de les ouiller. Lorfqu’il a épuifé fon diablo*
tin , 6c qu’il ne voit,plu s dans fes fàcs que là fécule
épaiffe , il les raffemble par cinq ou fix pendus à la
même ch e ville , pour a ch e v e r ,p a r leurprefliôn ré*
cip roqu e , d’exprimer le peu d’eau qui y eft renfermée
; 6c le fo i r , les negres, après avo ir enlevé les
tas d ’herbe que l’on a tiré des pourritures, portent
les faes à la fécherie.
D e la fécherie de l'indigo. La fécherie eft ün bâtiment,
dont la grandeur fe réglé fur l’étendue de la
culture de l'habitant indigotier. Il confifte en un
c om b le , couvert ordinairement de paille , porté
fur des poteaux 6c petites fourches en terre , qui ont
au plus cinq pieds 6c demi à fix pieds dehors , & qui
ne font point clos de l’un à l’autre , afin que le vent
y paffe librement ; on fe contente de l’ entourer de
pieux 6c de gaules pour empêcher les animaux d’y
entrer : l ’on conftruit dedans plufieurs rangs d’établis
; c’ eft âinfi qile l’on nomme deux rangées de
petits poteaux fichés en terre de trois, pieds d’élévation
, 6c qui portent deux lices parallèles à la dif*
tance de dix-huit à vingt pouces Tune de l’autre i
elles s’étendent non-feulement dans toute la longueur
du bâtiment, mais encore en dehors du côté
du n^idi( autant que faire fe p eu t) , à la diftance de
plus de la moitié de la longueur du bâtiment, afin
d’y expofer au foleil les Caiffes où l ’on a nouvellement
vuidé les faes. Ces caiffes, qui ont trois pieds
à trois pieds 6c demi de longueur , fur dix - huit à
vingt pouces de la rg eu r , & deux pouces 6c demi
de profondeur au-deflus du fo n d , fe pouffent dehors
le matin , 6c on les fait rentrer le foir ; & toutes les
fois que l’on eft menacé de la pluie pendant que Vindigo
eft encore mou , on le coupe par carreaux de
deux pouces plus ou moins, félon la fantaifie du
fabriquant ; 6c lorfqiï’ils ont été expûfés affez de
temps pour être tous détachés du fond de la caiffe,
on ne les expofe plus au foleil , q u i , en les fartant
fondre en tous fens, les réduiroit en petits morceaux
, ce qui dépriferoit la marchandise. Quand
l 'indigo a achevé de fécher à l’omb re , on le tranfi
porte au magafin, 6c on le garde en barils ou en
banques jufqu’à ce qu’il fe vende.
C ’eft fauffement que l’on a attribué à la mauvaife
odeur qui s’exhale des cuves d’indigo, le dépériffe-
ment des ouvriers que l’on y em p lo ie , & par fuite,
la diminution des indigoteries dans les îles Françoi-
fes de l’Amérique. J’ai fréquenté mes indigoteries
pendant vingt ans : j’y ai même été fort aflïdu pendant
plufieurs années, faute d’avoir un bon indigotier
negre , & je n’ai rien reffenti que je penfe attribuer
à l’exhalaifon des cuves : je ne me fuis même
point apperçu que la vapeur de Yindigo ait caufé la
moindre incommodité aux negres qui vuidoienf
l’herbe , qui avoit quelquefois trop pourri dans les
cuves. Enfin je n’ai jamais entendu aucun habitant,
ni aucun des chirurgiens qui fervent à forfait les habitations
en culture d'indigo , fe plaindre des effets
de la vapeur des cuves. La diminution des indigoteries
dans plufieurs de nos co lo n ie s , ne vient donc
pas de cette caufe ; mais plutôt du peu de fuccès de
cette culture , 6c de l’avantage que les habirans ont
trouv é à s’attacher à quelques autres plantations.
L’odeur qui s’exhale d’une bonne c u v e , ne peut être
appellée mauvaife : elle déplaît quelquefois pendant
quelques jours .à ceux qui n’y font pas fa its; mais
ils né tardent pas à reconnoître qu’il h’ y a que les
cuves trop pourries dont l'odeur foit véritablement
mauvaife, fans être même infupportabie.
11 fe peut que le bon indigo brûle entièrement
(fl ) C ’eft ainfi que l’en neaine le rang d e chevilles deftiné
à l’égouftage des Tacs.
fi on le met fur une pelle rouge. Mais il n’ eft pas
moins utile de favoir qu’il y a trois efpeces d’i/z-
digo que l’on peut appeller b o n , 6c une quatrième
que l ’on appelle indigo inférieur. La première 6c
la plus ch e re , eft le bleu c éle fte, que l’on appelle
au flî, bleu flottant, parce qu’il refte fur l’eau. La
fé c o n d é , le v io le t , que l’on a p p e lle , en quelques
quartiers , gorge de pigeon. Ces deux dernieres font
plus pefantes. Dans une même coupe l’on fait fou-
vent de Yindigo dé ces trois qualités, quoique l’indigotier
ait fuivi à toutes fes cuves la même méthode."
Il n’eft pas facile de rendre raifon de cette
différence , 6c l’on ne peut faire fur cela que des
conjectures fur- la qualité de la plante , félon les
différantes veines de terre oùl’on a coupé. Mais quand
on parviendroit à découvrir la caufe qui rend Y indigo
bleu-flottant , cette découverte n’engageroit
pas les fabriquans à s’attacher à en faire de cette
q u a lité , parce qu’il n’y a pas de profit à faire de
Yindigo fi léger : la différence du prix n’eft pas affez
confidérable pour dédommager du moindre poids.
Sous la quatrième efpece l’on comprend tout Yindigo
de qualité inférieure , quoiqu’il le foit plus ou
mo in s , fuivant le plus ou moins de mauvaife fabrique.
C a r il eft certain qu’il n’y a de mauvais indigo
que celui qui eft mal fabriqué ; & c’eft une
erreur de croire que celui qui eft de couleur d’ar-
doife , foit fabriqué av e c de l’ardoife pilée ou avec
du fable. C es matières ne s’incorporeroient point
a v e c Yindigo en le fabriquant. La falfification ne
pourroit fe faire que dans de Yindigo en poudre :
mais vend-on de Yindigo en poudre ? Je l’ignore :
je fais feulement que les capitaines de navires marchands
qui font valoir Yindigo à Saint-Domingue ne
l ’acheteroient pas , ou l ’acheteroient à fi v il p r ix ,
que l’on feroit mal payé de fa fraude.
Je ne fais fi les indigos des colonies angloifes font
aujourd’hui mieux préparés que ceux des îles fran-
ç ’oifes : mais j’ai toujours ouï dire le con tra ire, 6c
j’ai fçu de bonne p a r t, il y a plus de vingt ans , que
les habitans de la Jamaïque cherchoient à fe procurer
des indigotiers de Saint-Domingue.
C ’eft encore une erreur de croire qu’il y a un indigo
bâ tard , extrêmement répandu dans les îles de
l’Amérique, reffemblant beaucoup au véritable , qui
donne une couleur bleue plus parfaite que le véritable
, 6c que les habitans négligent, à caufe de la
petite quantité qu’il rend. L'indigo que l’on trouve
affez fréquemment parmi les herbes le long des chemins
dans les quartiers où il a été autrefois cultivé,,
n’eft autre chofe que le véritable indigo maron dont
il a été mention ci - deffus. On n’en connoît pas
d ’autre à Saint-Domingue ; 6c il n’eft pas furprenant
que n’étant pas cultivé ; il fourniffe moins de matière
à la teinture. ' L ’bn trouve auflî quelquefois de
Yindigo fran c, mais bien plus rarement. Cependant
on a autrefois plus cultivé celui-ci que l’autre : mais
Yindigo maron doit fe reproduire plus facilement que
Yindigo franc ; parce que dès que la graine eft mûre,
la filique s’ouvre par l’ardeur du fo le il, & laifle tomber
la graine. Au con tra ire , la filique du franc ne
s’ouvre point ; elle tombe enriere , 6c l’humidité
fait plutôt pourrir que germer cette graine, renfermée
dans fa filique. Il eft donc je crois inutile de
faire un article de Yindigo bâtard.
Je ne parlerai point de la préparation de Yindigo
pour la teinture ; cet objet n’eft pas de la compétence
d’uni indigotier de Saint-Domingue.
En traitant des différentes efpeces d'indigo que
que l’on cultive à Saint-Domingue, il m’eft échappé
de parler d’une troifieme efpece. Elle eft encore
très-peu connue , & n ’a pas même un nom diftinétif
bien décidé. Plufieurs l’appdlent guadmale, ne fa-
chant peut-être pas que ce nom étoit déjà attribué
à Yindigo ma ron, du moins à une des efpeces 6'indigo
maron , avant que celle à qui ils donnent ce
nom ait été connue. Cette plante n’eft pas naturelle
au p a y s , 6c j’ignore d’où elle a été tirée. E lle r e f-
lemble plus à Yindigo franc par les fleurs; qu’à Yindigo
maron. Mais elle différé des deux par la filique
6c par la forme de la graine. Sa filique qui a quelquefois
un pouce de longueur, & n’a fo r tfo u y en t
que fix lignes, mais fans être recourbée en croiffant
comme les autres, eft divifée en petites cellules glo-
buleufes jointes enfemble , lefquelles contiennent
chacune une graine ronde de la groffeur de celle de
Yindigo maron , & de la couleur de celle de Yindigo
franc. Il y auroit de l’avantage pour les habitans indigotiers
à cultiver cette plante , car ceux qui en ont
fait l’effai affurent qu’elle rend beaucoup 6c de très-
bel indigo : elle fournit auflî beaucoup à c o u p e r , 6c
n’a pas befoin d’être plantée auflî près que les deux
autres efpeces , parce qu’elle produit quantité de
branches : mais elle eft fujette à un grand inconvénient
qui dégoûtera apparemment de fa culture. Ses
feuilles tiennent fi p e u , que la pluie un peu fo r te,
ou qui dure trop long-tems, les fait toutes tomber.
O r , c ’eft la feuille qui donne la fécule. On remé-
dieroit peut-être à cet inconvénient, en le plantant
à de plus grandes diftances qu’on ne l’a fait : car j’ai
vu des pieds de cet indigo, ifolé dans un terrein non
cu ltiv é , dont une très-forte pluie n’avoit pas fait
tomber une feuille. Peut-être auflî que la culture lui
fournit une fe ve trop abondante.
Des erreurs que l'on trouve dans £art. I n d iGOTIER ,
du Dicl. raif. 6cc. (r) i °. C e n’eft point parce que Yindigo
mange Sc dégraiffe beaucoup la terre que l ’on a
foin de le bien fa rd e r ; c’eft pour que les herbes étrangères
ne l ’étouffent point ; car il y a plufieurs de ces
herbes qui s’éleveroient au-deffus , 6c le cou v ri-
roient : c’eft auflî pour que la nourriture qu’il reçoit
de la terre ne foit point trop partagée, auquel cas
il rendrôit beaucoup moins. Il eft. pourtant vrai
que fi ce n’eft pas diréétément la plante qui ufe la
terre , du moins la façon de la culture l’altéré con -
fidérablement : cela vient de ce que le champ où
on le cultive étant fouvent fa rc ie , 6c la plante coupée
près de te r r e , le fol refte trop à d é co u v e rt, & que
la fuperficie expofée une grande partie de l’année
à un foleil très-ardent fe mettant en pou flie re , les
forts grains de pluie que nous nommons avalaffes,
6c qui font fréquens lous la zone-torride, emportent
peu-à-peu toute la terre franche ou le limon,
6c ne laiffe.nt.après quelques années de culture, que
le tu f ou. la terre aride. O r , la plupart des terres
de Saint-Domingue ont très-peu de pr«fondeur en
terre franche.
1 ° . Les trous où l’on feme la graine üindigo ne
font point éloignés en tout fens d’un pied , & tirés
au cordeau. A Saint-Domingue pn ne laifle guere
que 5 à 6 poiices entre les trbu s ; & Ton n’oblige
point les negres qui les fou illent, à les tirer en droite
ligne : on y perdroit fon tertis.
. C ’eft encore bien gratuitement qu’il eft dit dans
£ article I n d ig o t i e r , que par fuperftition l ’on met
onze ou treize graines dans chaque trou. L ’on a vraiment
bien autre chofe de plus important à s’occuper
, qu’à, faire compter par 50 à 60 negres fe-
meurs , des graines auflî petites que celles d'indigo.
On ne planteroit pas dans une femain e , en faifant
cette opération , ce que l’on plante en un jour. C e
que l’on recommande fouvent aux negres femeurs,
eft de ménager la graine, parce qu’étant fort pe tite ,
ils en mettçntpour l’ordinaire plus qu’il ne faut. On
dit véritablement planter un jardin en indigo, pour
(r ) Je n’ai point refait cét article : j ’ai cru qu’il fuffifoit d’en
relever les erreurs.