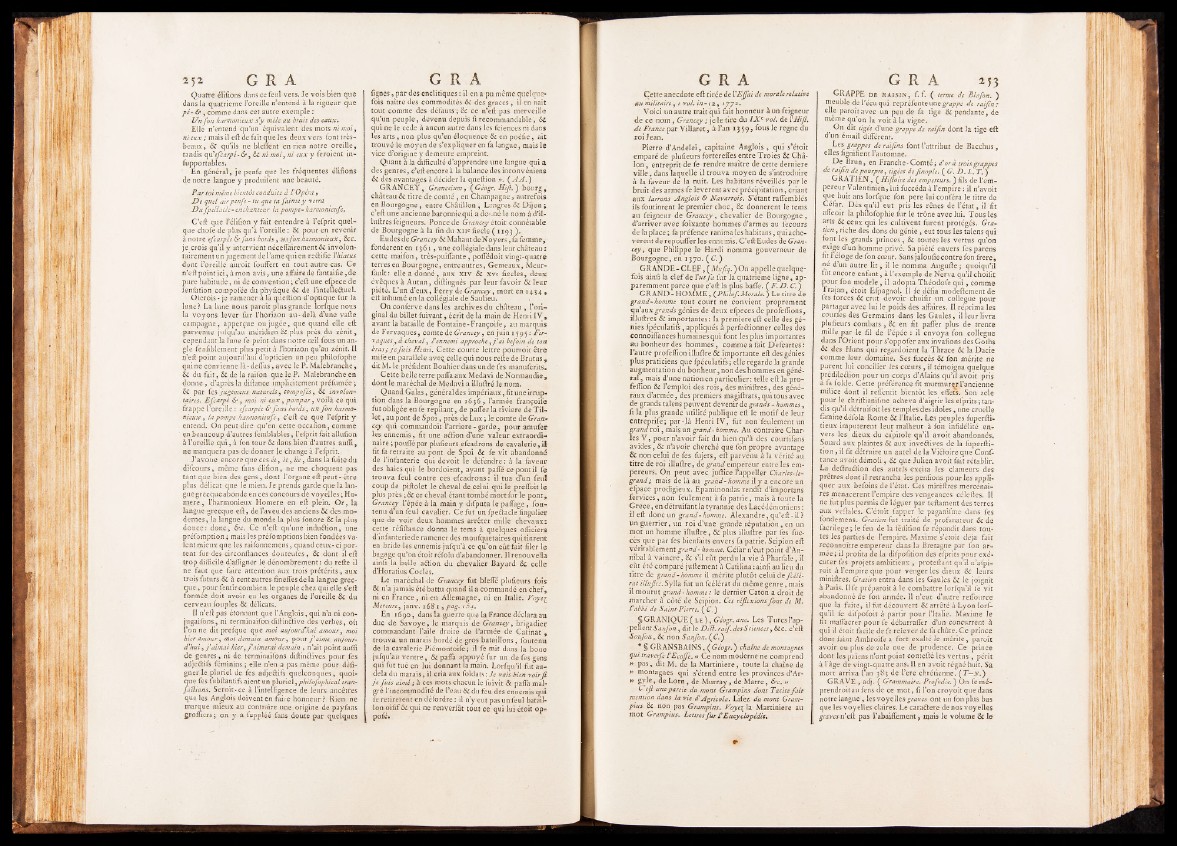
Quatre élifions dans ce feul vers. Je vois bien que
dans la quatrième l’oreille n’entend à la rigueur que
pé- & , comme dans cet autre exemple :
Un fon harmonieux s'y mêle, au bruit des eaux.
Elle n’entend qu’un équivalent 'des mots ni moi,
ni eux ; mais il eft de fait que les deux vers font très-
beaux, & qu’ils ne bleffent en rien notre oreille,
tandis qu'efcarpé-& 9 êc ni moiy ni eux y feroient in-
fupportables.
En général, je penfe que les fréquentes élifions
de notre langue y produilent une beauté.
Par toi même bientôt conduite à L’ Opéra ,
D e quel air penfe- tu que ta faintey verra
Du fpeclacle - enchanteur la pompe-harmomeufe.
C’eft que l’élifion y fait entendre à l’efprit quelque
chofe de plus qu’à l’oreille : 5c pour en revenir
à notre efcarpée & fans bords , au jon harmonieux, 5cc.
je crois qu’il y intervient néceffairement 6c involontairement
un jugement de l’ame qui en rectifie Yhiatus
dont l’oreille auroit fouffert en tout autre cas. Ce
n’eft point ic i, à mon avis, une affaire de fantaifie, de
pure habitude, ni de convention; c’eft une efpece de
îenfation compofée du phyfique 6c de l’intelle&uel.
Oferois - je ramener à la queftion d’optique fur la
lune? La lune nous paroît plus grande lorfquenous
la voyons lever fur l’horizon au-delà d’une vafte
campagne, apperçue ou jugée, que quand elle eft
parvenue jufqu’au méridien & plus près du zénit,
cependant la lune fe peint dans notre oeil fous un angle
fenfiblement plus petit à l’horizon qu’au zénit. Il
n’eft point aujourd’hui d’opticien un peu philofophe
qui ne convienne là- deffus, avec le P. Malebranche,
ôc du fait, & de la raifon que le P. Malebranche en
donne , d’après la diftance implicitement préfumée ;
ÔC par fes jugemens naturels, compofés, 6c involontaires.
EJcarpe & , moi ?ii ejtx, pompar, voilà ce qui
frappe l’oreille : efcarpée & fans bords, un fon harmonieux
, la pompe harmonieufe, c’eft ce que l’efprit y
entend. On peut dire qu’en cette occafion, comme
en beaucoup d’autres femblables, l’efprit fait allufion
à l’oreille qui, à fon tour 6c dans bien d’autres auffi,
ne manquera pas de donner Je change à l’efprit.
J’avoue encore que ces ee, ie, üe, dans la fuite du
difcours, même fans élifion, ne me choquent pas
tant que bien des gens, dont l’organe eft peut - être
plus délicat que le mien. Je prends garde que la langue
grecque abonde en ces concours de voyelles ; Homère,
l’harmonieux Homere en eft plein. O r , la
langue grecque eft, de l’aveu des anciens 6c des modernes.,
la langue du monde la plus fonore 6c la plus
douce: donc, &c. Ge n’eft qu’une induftion, une
préfomption ; mais les préfomptions bien fondées valent
mieux que les raifonnemens, quand ceux- ci portent
fur des circonftances douteules, 6c dont il eft
trop difficile d’alfigner le dénombrement: du refte il
ne faut que faire attention aux trois prétérits., aux
trois futurs 6c à cent autres fineffes de la langue grecque
, pour fentir combien, le peuple chez qui elle s’eft
formée doit avoir eu les organes de l’oreille 6c du
cerveau fouples 6c délicats.
II n’eft pas étonnant que l’Anglois, qui n’a ni con-
jugaifons, ni terminaifon diftinâiive des verbes, oit
l’on ne dit prefque que moi aujourd'hui amour , moi
hier amour, moi demain amour, pour j ’aime aujourd'hui
, j'aimai hier.y j'aimerai demain , n’ait point auffi
de genres, ni de terminaifons diftinctives pour fes
adjectifs féminins ; elle n’en a pas même pour défi-
gner le pluriel de fes adje&ifs quelconques, quoique
fes fubftantifs aient un pluriel, philofophical tran-
factions. Seroit-ce à l’intelligence de leurs ancêtres
que les Anglois doivent en faire honneur? Rien ne
marque mieux au contraire une. origine de payfans
groffiers ; on y a fupplçé fans doute par quelques
lignes, par des enclitiques : il en a pu même quelque*
fois naître des commodités 6c des grâces , il en naît
tout comme des défauts'; & ce n’eft pas merveille
qu’un peuple, devenu depuis fi recommandable, 6c
qui ne le cede à aucun autre dans les fciences ni dans
les arts, non plus qu’en éloquence & en poéfie , ait
trouvé le moyen de s’expliquer en fa langue, mais le
vice d’origine y demeure empreint.
Quant à la difficulté d’apprendre une langue qui a
des genres, c’eft encore à la balance des inconvéniens
6c des avantages à décider la queftion ». ( A A . )
GRANCEY, Granceium, ( Géogr. Hifl. ) bourg ,'
château 6c titre de comté, en Champagne, autrefois
en Bourgogne, entre Châtillon , Langres 6c Dijon ;
c’eft une ancienne baronnie qui a do.né le nom à d’il-
luftres feigneurs. Ponce de Grancey ètoit connétable
de Bourgogne à la fin du xn e fiecle ( 1193 )._
Eudes de Grancey 6c Mahaut de Noyers, fa femme,
fondèrent en 1361, une collégiale dans leur château :
cette maifon, très-puiffahte, poffédoit vingt-quatre
terres en Bourgogne, entre autres, Gemeaux, Meur-
fault: elle a donné, aux x iv 5 c xve fiecles, deux
évêques à Autun, diftingués par leur favoir 6c leur
piété. L’un d’eux, Ferry de Grancey, mort en 1434 ,
eft inhumé en la collégiale de Saulieu. .
On conferve dans les archives du château , l’original
du billet fuivant, écrit de la main de Hem i.I V ,
avant la bataille de Fontaine -Françoife, au marquis
de Fervaques, comte de Grancey, en juin 15.9.5 : Fer-
vaques, à cheval, Üennemi approche, j'ai befoin de ton
bras; je fuis Henri. Cette courte lettre pourroit être
mife en parallèle aveç celle qui nous telle de Brutus,
dit M. le préfident Bouhier dans un de fes manufcrits.
Cette belle terre paffa aux Medavi de Normandie,
dont le maréchal de Medavi a illuftré le nom.
Quand Galas, général des impériaux, fit une irruption
dans la Bourgogne en 1636, l’armée françoife
fut obligée en fe repliant, de paffer la riviere de Til-
let , au pont de Spoi, près de Lux ; le comte de Grancey
qui commandoit l’arriere-garde, pour amufer
les, ennemis, fit une aélion d’une valeur extraordinaire
; pouffé par plufieurs efcadrons de cavalerie, il
fit fa retraite au pont de Spoi 6c fe vit abandonné
de l’infanterie qui devoit le défendre : à la faveur
des haies qui le bordoient, ayant paffé ce pont il fe
trouva feul contre cés efcadrons: il tua d’un feul
coup de piftolet le cheval de celui qui le preffoit le
pliis près ; 6c ce cheval étant tombé mort fur le pont,
Grancey l’épée à la main y difputa le paffage, fou-
tenu d’un feul cavalier. Ce fut un fpeûacle fingulier
que de voir deux hommes arrêter mille chevaux z
cette réfiftance donna le tems à quelques officiers
d’infanterie de ramener des moufquetaires qui tinrent
en bride les ennemis jufqu’à ce qu’on eût fait filer le
bagage qu’on étoit réfolu d’abandonner. Il renouvella
ainfi la belle aélion du chevalier Bayard 6c celle
d’Hpratius Codés.
Le maréchal de Grancey fut bleffé plufieurs fois
6c n’a jamais été battu quand il a commandé en chef,
ni en France, ni en Allemagne, ni en Italie. t'oyez
Mercure, janv. 1681 , /rag. tia.
En 1690, dans la guerre que la France déclara au
duc de Savoye, le marquis de Grancey, brigadier
commandant l’aile droite de l’armée de Catinat ,
trouva, un marais bordé de gros bataillons, foutenu
de la cavalerie Piémontoife; il fe mit dans, la boue
jufqu’au ventre, 6c paffa appuyé fur un de fes gens
qui fut tué en lui donnant la main. Lorfqu’il fut au-
dela du marais, il cria aux foldats : Je vais bien voir f i
je fuis aimé; à ces mots chacun le fuivit & paffa malgré
l’incommodité de l’eau 6c du feu des ennemis qui
fe retirèrent en défordre : il n’y'eut pas un feul batail-
loaoifif 6c qui ne renverfât tout ce qui lui étoit op*
pofé.
Cette anecdote eft tirée de l’EJfai de morale relative
au militaire, / vol. in -12,
Voici un autre trait qui fait honneur à un feigneur
de ce nom, Grancey ; je le tire du I X e vol. de Y Hifl.
de France par Villaret, à l’an 1359, fous le régné au
roi Jean.
Pierre d’Andelei, capitaine Anglois , qui s’étoit
emparé de plufieurs fortereffes entre Troies ôc Châ-
lon , entreprit de fe rendre maître de cette derniere
ville , dans laquelle il trouva moyen de s’introduire
à la faveur de la nuit. Les habitans réveillés par le
bruit des armes fe levèrent avec précipitation, criant
aux larrons Anglois & Navarrois. S’étant raffemblés
ils foutinrent le premier choc, 6c donnèrent le tems
au feigneur de Grancey, chevalier de Bourgogne,
d’arriver avec fbixante hommes d’armes au fecours
de la place ; fa préfence ranima les habitans, qui achevèrent
de repouffer les ennemis. C ’eft Eudes de Grancey
, que Philippe le Hardi nomma gouverneur de
Bourgogne, en 1370. (G .)
GRANDE - CLEF, ( Mufiq. ) On appelle quelquefois
ainfi la cjef de Yutfa fur la quatrième ligne, apparemment
parce que c’eft la plus baffe. ( F. D. C. )
GRAND - HOMME, ( Philof Morale. ) Le titre de
grand-homme tout court ne convient proprement
qu’aux grands génies de deux efpeces de profeffions,
illuftres 6c importantes: la première eft celle des génies
fpéculatifs, appliqués à perfeélionner celles des
connoiffances humaines qui font lesplusimportantes
au bonheur des hommes, comme a fait Defcartes:
l ’autre profeffion illuftré 6c importante eft des génies
plus praticiens que fpéculatifs; elle regarde la grande
augmentation du bonheur, non des hommes en général,
mais d’une nation en particulier: telle eft la profeffion
6c l’emploi des rois, des miniftres, des généraux
d’armée, des premiers magiftrats, qui tous avec
de grands talens peuvent devenir de grands - hommes,
fi la plus grande utilité publique eft le motif de leur
entreprife; par-là Henri IV , fut non feulement un
grand ro i, mais un grand-homme. Au contraire Charles
V , pour n’avoir fait du bien qu’à des courtifans
avides, 6c n’avoir cherché que fon propre avantage
& non celui de fes fujets, eft parvenu à la vérité au
titre de roi illuftré, de grand empereur entre les empereurs.
On peut, avec juftice l’appeller Charles-le-
grand; mais de là au grand-homme il y a encore un
efpace prodigieux. Epaminondas rendit d’importans
fervices, non feulement à fa patrie, mais à toute la
Grece, eh détruifant.la tyrannie des Lacédémoniens :
il eft donc un grand-homme. Alexandre, qu’eft - il ?
lin guerrier, un roi d’une grande réputation, en un
mot un homme illuftré, 6c plus illuftré par fes fuc-
cès que par fes bienfaits envers fa patrie. Scipion eft
véritablement grand-homme. Céfar n’eut point d’An-
hibal à vaincre, 6c s’il eût perdu la vie à Pharfal’e , il
eût été comparé juftement à Catilina : ainfi au lieu du
titre de grand-homme il mérite plutôt celui de fcélè-
fat illuftré. Sÿlla fut un fcélérat du inême genre, mais
il mourut grand-homme: le dernier Caton a droit de
marcher à côté de Scipion. Ces réflexions font de M.
C abbé de Saint-Pierre. ( C. )
§ G R AN I QUE ( le ) , Géogr. anc. Les T urcs l’appellent
Sanfon, dit le D ici. ratf. des Sciences r Si c. c’eft
Soufouy 6c non Sanfon. (G.)
* § GRANSBAINS, ( Géogr. ) chaîne de montagnes
qui traverfe PEcoJfe. « Ce nom moderne ne comprend.
» pas, dit M. oe la Martiniere, toute la chaîne de
» montagnes qui s’étend entre les provinces d’Ar-
» gyle, de Lorn, de Murray, de Marre, &c. »
C eft une partie du mont Grampins dont Tacite fait
mention dans la vie d’Agricola. Lifez du mont Gram-
pius 6c non pas Grampins. Voyeç la Martiniere au
mot Grampius. Lettres fur P Encyclopédie»
g r a ppe DE RAIS IN, f. f. ( terme de Blafon. )
meuble de l’écu qui repréfente une grappe de raifin *
elle paroît avec un peu de fa tige 6c pendante, de
meme qu’on la voit à la vigne.
On dit tigée d’une grappe de raifin dont la tige eft
d un email différent.
Les grappes de raifins font l’attribut de Bacchus ,
elles lignifient l’automne.
De Brun, en Franche-Comté; d'or à trois grappes
de raifin de. pourpre, tigées de finople. ( G. D . L. T. )
GRATIEN, ( Hifloire des empereurs. ) fils de l’empereur
Valentinien, lui fuccéda à l’empire : il n’avoit
que huit ans lorfque fon pere lui conféra le titre de
Céfar. Dès qu’il eut pris les rênes de l’état, il fit
affeoir la philofophie fur le trône avec lui. Tous les
arts 6c ceux qui les cultivent furent protégés. Gra-
tien, riche des dons du génie, eut tous les talens qui
font les grands princes, 6c toutes les vertus qu’on
exige d un homme privé. Sa piété envers fes parens
fit l’éloge de fon coeur. Sans jaloufie contre fon frere,
ne d’un autre lit, il le nomma Augufte ; quoiqu’il
fût encore enfant, à l’exemple de Nerva qu’il choifit
pour fon modèle , il adopta Théodofe qui, comme
Trajan, étoit Efpagnol. Il fe défia modeftementde
fes forces 6c crut devoir choifir un collègue pour
partager avec lui le poids des affaires. 11 réprima les
eourfes des Germains dans les Gaules, il leur livra
plufieurs combats , 6c en fit paffer plus de trente
mille par le fil de l’épée : il envoya fon collègue
dans l’Orient pour s’oppofer aux invafions des Goths
6c des Huns qui regardoient la Thrace 6c la Dacie
comme leur domaine. Ses fuccès 6c fon mérjte ne
purent lui concilier les coeurs , il témoigna quelque
prédilection pour un corps d’Alains qu’il avoir pris
à fa folde. Cette préférence fit murmurer l’ancienne
milice dont il reffentit bientôt les effets. Son zele
pour le chriftianifme acheva d’aigrir les efprits; tandis
qu’il détruifoit les temples des idoles, une cruelle
famine défola Rome 6c l’Italie. Les peuples fuperfti-
tieux imputèrent leur malheur à fon infidélité envers
les dieux du capitole qu’il avoit abandonnés.
Sourd aux plaintes 6c aux inveCtives de la fuperfti-
tion, il fit détruire un autel de la Victoire que Confiance
avoit démoli, 6c que Julien avoit fait rétablir.
La deftruCtion des autels excita les clameurs des
prêtres dont il retrancha les penfions pour les appliquer
aux befoins de l’état. Ces miniftres mercénai-
res menacèrent l’empire des vengeances céleftes. Il
ne fut plus permis de léguer par teftament des terres
aux veftales. C’éfoit fapper le paganifme dans fes
fondemens. Gratien fut traité de profanateur 6c de
facriiege ; le feu de la fédition fe répandit dans toutes
les parties de l’empire. Maxime s’étoit déjà fait
reconnoîrre empereur dans la Bretagne par fon armée;
il profita de la difpofition des efpritspour exécuter
fes projets ambitieux , proteftant qu’il n’afpi-
roit à l’empire que pour venger les dieux 6c leurs
miniftres. Gratien entra dans les Gaules 6c le joignit
à Paris. Il fe préparoit à le combattre lorfqu’il fe vit
abandonné de fon armée. Il n’eut d’autre reffource
que la fuite, il fut découvert-6c arrêté à Lyon lorfqu’il
fe difpofoit à partir pour l’Italie. Maxime le
fit inaffacrer pour fe débarraffer d’un concurrent à
qui il étoit facile de fe relever de fa chûte. Ce prince
dont faint Ambroife a fort exalté le mérite, paroît
avoir eu plus de zele que de prudence. Ce prince
dont les païens n’ont point contefté les vertus , périt
à l'âge de vingt-quatre ans. Il en avoit régné huit. Sa
mort arriva l’an 383 de l’ere chrétienne. (T—iv.)
GRAVE , adj.-ÇGrammaire, Profodie.') On femé-
prendroitau fens de ce mot, fi l’on croyoit que dans
notre langue , les voyelles graves ont un fon plus bas
que les voyelles-claires. Le cara&ere de nos voyelles
graves n’eft pas l’abaiflement, tuais le volume 6c le