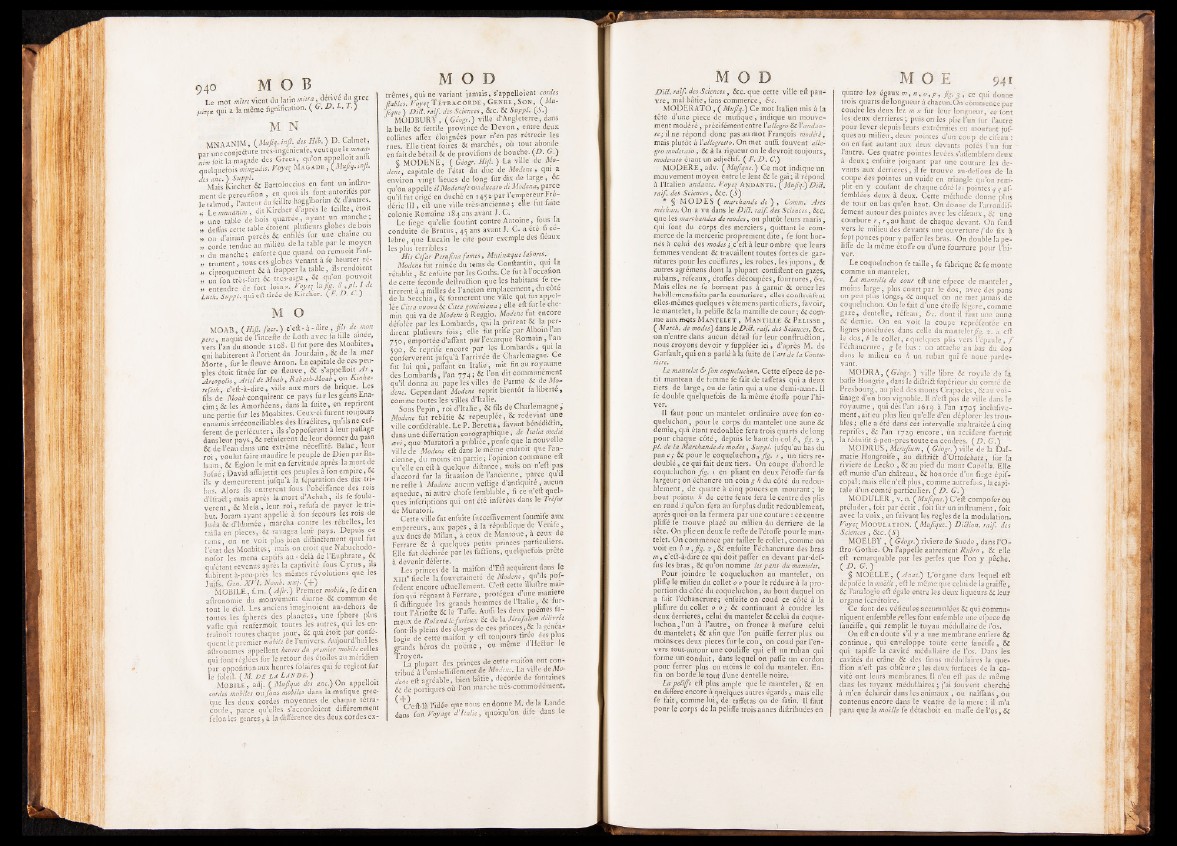
Le mot mitre vient du latint ot« « - ideriv-e du grec
fAiTpu qui a la même figniBcatmn. ( G. D . L. I .)
M N
MNAANIM, {Mufiq.infi. des Héb.) D.Calmet,
oar une conjeâure très-ingémeufo, veut que\umnaa-
I L f o i t la magade des Grecs, qu on appellent auffi
quelquefois mingadis. Voyet’ Ma g ad e , {Mufi.injl.
M Kkcher & Bartoloccius en font un infiniment,
de percurfion 1 en quor ris font autonfes par
le talmud , l’auteur du faille,haggibonm E g d autres,
« Le mnaituim , dit Ktrcher d aptes le faille,, etoit
I une table de bois, quatrée ayant un manche ;
» deffus cette table étorent plüfieurS globes de bois
>, ou d’airain percés, & enfilés fur une chaîne ou
1 corde tendue au milieu dé la table.par le moyen
» du manche; eriforte que quand on remuoit 1 tnl-
» M H tous ces globes venant-à fe heurter ré-
» ciproquement 6c à frapper la table, tlsrendoten
1 un fontrèrfort U- très-aigu, & quon pouvoir
» entendre, de fort low.,»;, jm m E f f lË B f f lS g m
Luth. Suppl, qui eft tiree de Kircher. ( F. D. C. )
M O
MO AB, (Hiji.facr.) c’e f t-à -d ire , fils demon
pere, naquit de i’incefte de Loth avec fa fille ainee, J
vers l’an du monde n o S . II fut pere des Moabites,
qui habitèrent à l’orient du Jourdain , & de la mer
Morte , fur le fleuve Arnon. Là capitale de ces peuples
étoit fituée fur.ee fleuve, & s'appelle« Ar ,
Artopolis, Ariel de Moab, Rabath-Moab, ou Kmha-
refah, c'eft-à-dire, ville, aux murs de brique. Les
fils de Moab conquirent ce pays for les géans Ena-
cim ; 8c les Amorhéens, dans la fuite, en reprirent
une partie fur les Moabites. Ceux-ci furent toujours
ennemis irréconciliables des Ifraélites, qu ilsne cel-
ferent de perfécutet.; ils s’oppoferent à leur paffage
dans leur pays, 8c refuferent de leur donner du pain
6c de l’eau dans une extrême néceflïté. Balac, leur
r o i , voulut foire maudire le peuple de Dieu par Ba-
laam 6c Eglon le mit en fiervitude après la mort de
Jofué'; David affujettit- ces peuples à fon empire, 8c
ils y demeurèrent, jufqu’à la féparation des dix tribus.
Alors ils entrèrent fous l’obéiffance des rois
d’Ifraëliymais après la mort d’Achab, ils fe foule -
verent, 8c Mefa , leur roi, refufa de payer le tribut.
Joram ayant appelle à fon fecours des rois de
Juda êc d’Idumée, marcha contre les rébelles, les
tailla en; pièces, 8c ravagea leur pays. Depuis ce
teins on ne voit plus bien diftinâement quel fut
l ’état des Mpâbites ; mais on croit que Nabuchodo-
nofor les mena captifs au - delà de 1 Euphrate, 8c
.qu’étant revenus après la captivité fous Cyrus , ils
fubirent à-peu-près les mêmes révolutions que les
juifs. m Ê m Ê B ËgjSjl m H I
"M O B IL E , l'.m. (AJlr.) Premier mobile, fe dit en
aftronomie du mouvement diurne 8c commun de
tout le ciel. Les anciens imaginoient au-dehors. de
toutes les fpheres des planètes, une fphere plus
vafte qui renfermoit toutes les autres, qui les en-
traînoit toutes chaque jour, 8ç qui etoît par confondent
le premier mobile de l’univers. Aujourd’hui les
ailronomes appellent heures du premier mobile celles
qui font réglées fur le retour des étoiles au méridien
par oppofuion aux heures folâtres qui fe règlent fur
le foleil. {M. d e la La n d e .)- , f
Mo b il e , adj. ( Mufique des anc) On appelant
cordes mobiles ou fin s mobiles dans la mufique grecque
les deux cordes moyennes de chaque tétra-
corde, parce qu’elles s’accordoient différemment
félon les genres, à la différence des deux cordes éxtrêmes,
qui ne variant jamais, s’appelloient cordes
fiables. ^oyeîTÉTRACOEDE, G en re, f io s , {Mufique
) DiS. raif. dis Sciences, 8cc. 8c Suppl: {S.)
MODBURY, ( Géogr. ) vilfo d’Angleterre, dans
la belle 6c fertile province de Devon , entre deux
chitines affer éloignées pour n’en pas rétrécir les
rués.: Elle tient foires 8c marchés; oit tout.âbonde
en fait de bétail 8c de provifions de bouche. (£>. G.)
§ MODENE, ( Géogr. Hifi\ ) La ville de Modene,
capitale de l’état du duc de Modene, qui_a
environ vingt lieues de long fur dix de large, oC
qu’on appelle il Modenefc ou dncato di Modena, parce
qu’il fut érigé en duché en 1451 par l’empereur Frédéric
III, eft une ville très-ancienne ; elle fut faite
colonie Romaine 184 ans avant J. C.
Le fiege qu’elle foutint contre Antoine, fous la
conduite de Brutus, 45 ans avant J. C. a été fi célébré
, que Lucain le cite pour exemple des fléaux
les plus terribles :
HisCefar Perufina famés, Mutinoeque labores.
Modem fut ruinée du t«ms de Conftantin, qui la
rétablit, 6c enfuite par les Goths. Ce fut à l’occafion
de cette fécondé deftru&ion que les habitans fe retirèrent
à 4 milles de l ’ancien emplacement, du cote
de la Seccbia, & formèrent une ville qui fut appel-
lée Citta nuova 6c Citta geminiana ; elle eft fur le chemin
qui va de Modene à Reggio. Modene fut encore
défolée par les Lombards, qui la prirent & la perdirent
plufieurs fois; elle fut prife par Alboin 1 an
750, emportée d’affaut par l’exarque Romain , l an
590, ôc reprife encore par les Lombards, qui la
conferverent jufqu’à l’arrivée de Charlemagne. Ce
fut lui qui, paffant en Italie, mit fin au royaume
des Lombards, l’an 774 ; & l*on dit communément
qu’il donna au pape les villes de Parme & de Modene.
Cependant Modene reprit bientôt fa liberté,
comme toutes les villes d’Italie.
Sous Pépin, roi d’Italie, & fils de Charlemagne ;
Modene fut rebâtie 6c repeuplée, & redevint une
ville confidérable. Le P. Beretta, favant bénédïâin,
dans une differtation corographique, de Italia medu
avi, que Muratori a publiée, penfe que la nouvelle
ville de Modene eft dans le même endroit que l’ancienne,
du moins'en partie; l’opinion commune eft
qu’elle en eft à quelque diftance, mais ori n eft pas
d’accord fur la fituation de l’ancienne, parce qu’il
ne refte à Modene aucun veftige d’antiquité , aucun
aqueduc, ni autre chofe femblable, fi ce n’eft quel“
ques inferiptions qui ont été inférées dans le Trefor
de Muratori. r 'c
Cette ville fut enfuite fucceffivement foumiie aux
empereurs, aux papes , à la république de Vemfe ,
aux ducs de Milan, à ceux de Mantoue, à ceux de
Ferrare & à quelques petits princes particuliers.
Elle fut déchirée par les faélions, quelquefois prete
à devenir déferte.
Les princes de la maifon d’Eft acquirentjlans le
xm e fiecle la fouveraineté de Modene, qu ils pof-
fedent encore aâuellement. C’eft eette illuttre maifon
qui régnant à Ferrare protégea d’une maniéré
fi diftinguée les grands hommes de l’Italie, & lur-
tout i’Ariofte & le Taffe. Auffi les deux poenjes fa-
meux d e Roland le furieux & de la Jirufalem délivrée
font-ils pleins des éloges' de ces princes, & la généalogie
de cette maifon y eft toujours tirée des plus
grands héros du poème , ou même d Heftor le
Troven.
La plupart des, princes de cette maifon ont contribué
à l’embelliffement de Modene.%3 ville AiMo-
dme eft agréable, bien bâtie, decoree de fontaines
& de portiques or. l’on marche très-commodemenr.
^"(yefi.l‘à“l’idée que nous en donne M. de la Lande
dans fon royage d’Italie, quoiqu’on dife dans le
Dicl. raif .des Sciences, & c. que cette ville eft pauvre,
mal bâtie, fans commerce, &c.
MODERATO, ( Mufq.) Ce mot Italien mis à la
tête d’une piece de mufique, indique un mouvement
modéré, précifément entre l'allegro & Vandan-
te; il ne répond donc pas au mot François modéré,
mais plutôt à l’allegretto. On met auffi fouvent allegro
moderato , & à la rigueur on le devroit toujours,
moderato étant un adjeâif. ( F. D . C.)
MODÉRÉ, adv. ( Mufique.) Ce mot indique un
mouvement moyen entre le lent & le gai; il répond
à l’Italien andante. Voyeç A n d a n t e . ( Mufq.) Dicl.
raif. des Sciences, &c. (^)
* § M O D E S ( marchande d e ) , Comm. Arts
méchan. On a vu dans le Dicl. raif. des Sciences, &c.
que les marchandes de modes, ou plutôt leurs maris,
qui font du corps des merciers, quittant le commerce
de la mercerie proprement dite, fe font bornés
à celui des modes f i eft à leur ombre que leurs
femmes vendent & travaillent toutes fortes de garnitures
pour les coëffures, les robes, les jupons, &
autres agrémens dont la plupart confiftent en gazes,
rubans, réfeaux, étoffes découpées, fourrures, &c.
Mais elles ne fe bornent pas à garnir & orner les
habillemensfaits parla couturière, elles conftruifent
elles-mêmes quelques vêtemensparticuliers, favoir,
le mantelçt, la peliffe & la mantille de cour ; & comme
aux mqts M a n t e l e t , M a n t i l l e & P e l i s s e ,
( March. dé modes) dans le Dicl. raif. des Sciences, & c.
on n’entre dans aucun détail fur leur conftruttion ,
nous croyons devoir y fuppléer ici, d’après M. de
Garfault, qui en a parlé à la fuite de Y art de la Coutu-
Le mantelet & fon coqueluchon. Cette efpece de petit
manteau de femme fe fait de taffetas qui a deux
tiers de large, ou de fatin qui a une demi-aune. Il
fe double quelquefois de la même étoffe pour l’hiver.
Il faut pour un mantelet ordinaire avec fon coqueluchon
, pour le corps du mantelet une aune &
demie, qui étant redoublée fera trois quarts de long
pour chaque côté, depuis le haut du col b, fig. 2 ,
pl. de la Marchande de modes , Suppl, jufqu’au bas du
pan c ; & pour le coqueluchon, fig. / , un tiers redoublé
, ce qui fait deux tiers. On coupe d’abord le
coqueluchon fig. 1 en pliant en deux l’étoffe fur fa
largeur; on échancre un coin g A du côté du redoublement,
de quatre à cinq pouces en mourant ; le
bout pointu h de cette fente fera le centre des plis
en rond i qu’on fera au furplus dudit redoublement,
après quoi on la fermera par unè couture : ce centre
pliffé le trouve placé au milieu du derrière de la
tête. On plie en deux le refte de l’étoffe pour le mantelet.
On commence par tailler le collet, comme on
voit en b n ,fig. 2 , & enfuite l’échancrure des bras
m, c’eft-à-dire ce qui doit paffer en devant par-def-
fus les bras, & qu’on nomme les pans du mantelet.
Pour joindre le coqueluchon au mantelet, on
pliffe le milieu du collet 0 o pour le réduire à la proportion
du côté du coqueluchon, au bout duquel on
a fait l’échancrure; enfuite on coud ce côté à la
pliffure du collet o 0 ; & continuant à coudre les
deux derrières, celui du mantelet & celui du coqueluchon,
l’un à l ’autre, on fronce à mefure celui
du mantelet ; & afin que l ’on puiffe ferrer plus ou
moins ces deux pièces fur le cou, on coud par l’envers
tout-autour une couliffe qui eft Un ruban qui
forme un conduit, dans lequel on paffe un cordon
pour ferrer plus ou moins le col du mantelet. Enfin
on borde le tout d’une dentelle noire.
Lapelife eft plus ample que le mantelet, & en
en différé encore à quelques autres égards, mais elle
fe fait, comme lui, de taffetas ou de fatin. Il faut
pour le corps de la peliffe trois aunes diftribuées en
quatre lez égaux m, n, 0,p , fig. 3 , Ce qui donne
trois quarts de longueur à chacun. On cômmence par
coudre les deux lez m n fur leur longueur, ce font
les_deux derrières; puis on les plie l’un fur l’autre
pour lever depuis leurs extrémités en mourant juf-
ques au milieu, deux pointes d’un coup de cifeau :
on en fait autant aux deux devants pofés- l’un fur
l’autre. Ces quatre pointes levées s’affemblent deux
à deux ; enfuite joignant par une couture les devants
aux derrières, il fe trouve au-deffous de la
coupe des pointes un vuide en triangle qu’on remplit
en y coufant de chaque côté les pointes q q af-
femblées deux à deux. Cette méthode donne plus
de tour en bas qu’en haut. On donne de Parrohdif:
fement autour des pointes avec les cifeaux, & une
courbure r , r, au haut de chaque devant. On fend
vers le milieu des devants une ouverture/’de fix à
fept pouces pour y paffer les bras. On double la peliffe
de la même étoffe ou d’une fourrure pour l’hi,-
ver.
Le coqueluchon fe taille, fe fabrique & fe monte
comme un mantelet.
La mantille de cour eft une efpece de mantelet,
moins large, plus court par le dos, avec des pans
un peii plus longs, & auquel on ne met jamais de
coqueluchon. On le fait d’une étoffe légère, comme
gaze, dentelle, réfeau, &c. dont il faut une aune
6c demie. On en voit la coupe repréfentée en
lignes pon&uées dans celle du mantelet ƒ 2. a eft
le dos, b le collet, e quelques plis vers l’é p a u le ,/
l’échancrure, g le bas : on attache au bas du dos
dans le milieu en h un ruban qui fe noue parde-
vant.
MODRA, ( Géogr. ) ville libre & royale de la
baffe-Hongrie, dans le diftriftfupérieur du comté de
Presbôurg, au pied des monts Crapacks , &au voi-
finage d’un bon vignoble. Il n’eft pas de ville dans le
royaume, qui dès l’an 1619 à l’an 1705 inclufive-
ment, ait eu plus lieu qu’elle d’en déplorer les troubles
; elle a été dans cet intervalle maltraitée à cinq
reprifes, & l’an 1729 encore, un accident fortuit
la réduifit à-peu-près toute en cendres. (D . G.)
MODRUS, Merufium, ( Géogr.) ville de la Dal-
matie Hongroife, au diftri& d’Ottofchatz, fur la
riviere de Lecko , & au pied du mont Cape lia. Elle
eft munie d’un château, & honorée d’un fiege épif-
copal; mais elle n’eft plus, comme autrefois, la capitale
d’un comté particulier. ( D. G .)
MODULER , v. n. (Mufique.) C’eft compoferou
préluder, foit par écrit, foit fur un infiniment, foit
avec la voix, en fuivant les réglés de la modulation.
Voye{ M o d u l a t i o n . (Mufique.) Diction, raif. des
Sciences , &c. /.S)
MOELBY , ( Géogr.) riviere de Suede, dans l’O-
ftro-Gothie. On l’appelle autrement Rubro , & elle
eft remarquable par les perles que l’on y pêche'.
{ D . G .)
§ MOELLE, (Anat.) L’organe dans lequel eft
dépofée la moelle, eft le même que celui de la graiffe,
& l’analogie eft égale entre les deux liqueurs 6c leur
organe fécrétoire.
Ce font des véficules accumulées & qui communiquent
enfemble,“elles font enfemble une efpece de
fauciffe, qui remplit le tuyau médullaire de l’os.
On eft en doute s’il y a une membrane entière &
continue, qui enveloppe tonte cette fauciffe, &
qui tapiffe la cavité médullaire de l’os. Dans les
cavités du crâne & des finus médullaires la que-
ftion n’eft pas obfcure ; les deux furfaces delà cavité
ont leurs membranes. Il n’en eft pas de même
dans les tuyaux médullaires ; j’ai fouvent cherché
à m’en éclaircir dans les animaux , ou naiffans ou
contenus encore dans le ventre de la mere : il m’a
paru que la moelle fe détachoit en maffe de l’os, 6c