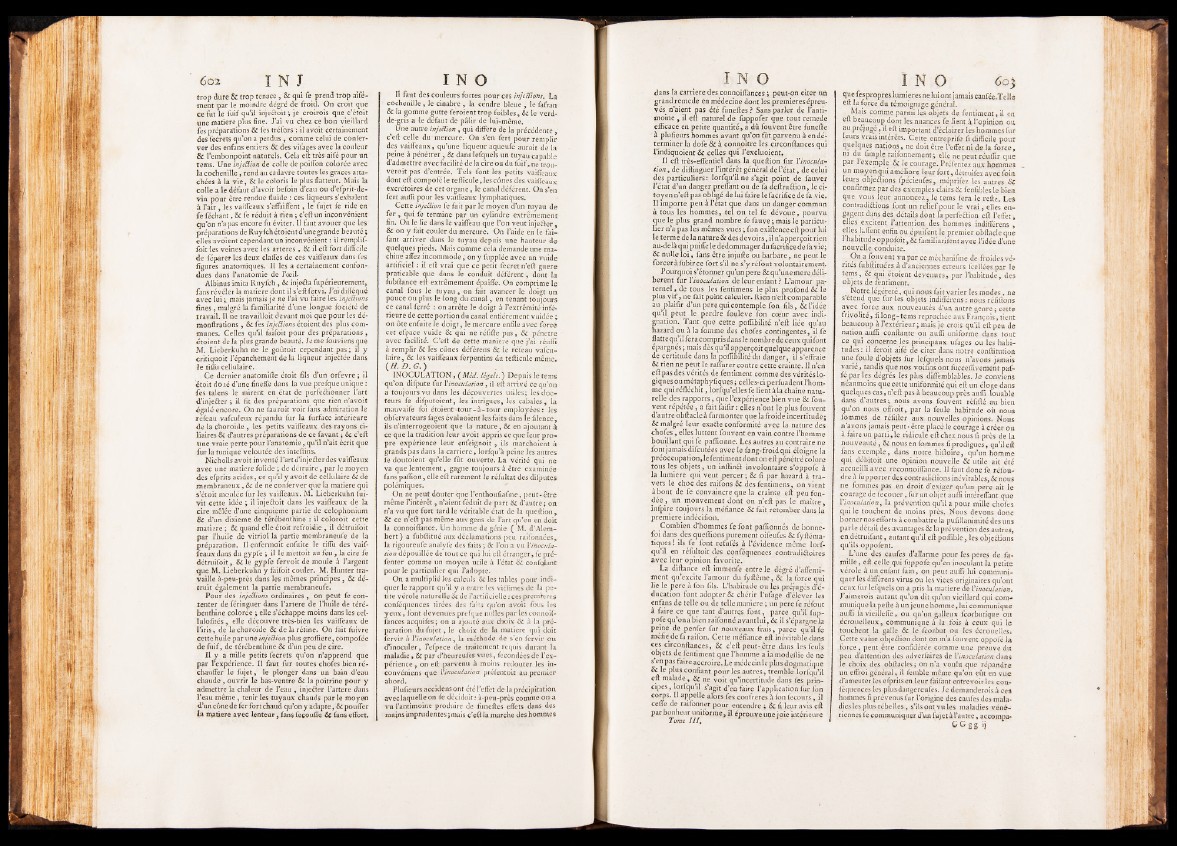
trop dure & trop tenace, 6c qui fe prend trop aifé-
ment pa r le moindre degré de froid. On croit que
c e fut le fu if qu’il inje&oit ; je croirois que c’étoit
une matière plus fine. J’ai vu chez ce bon vieillard
ibs préparations & fes tréfors : il avait certainement
des fecrets qu’on a perdus , comme celui de confer-
v e r des enfans entiers 6c des vifages avec la couleur
& l’embonpoint naturels. Cela eft très aifé pour un
tems. Une injection de colle de poiffon colorée avec h cochenille, rend au cadavre toutes les grâces attachées
à la v i e , 6c le coloris le plus flatteur. Mais la
colle a le défaut d ’avoir befoin d’eau ou d’efprit-de-
v în pour être rendue fluide : ces liqueurs s’exhalent
à l’a i r , les vaiffeaux s’affailfent, le fujet fe ride en
fe féchant, 6c fe réduit à rien ; c’eft un inconvénient
q u ’on n’a pas encore fu éviter. Il faut avouer que les
préparations de Ruyfch étoient d’une grande beauté ;
elles avôient cependant un inconvénient : il refriplif-
fb itie s veines avec les arteres , & il eft fort difficile
de féparer les deux claffes de ces vaiffeaux dans fes
figures anatomiques. Il les a certainement confondues
dans l’anatomie de l’oeil.
Albinus imita Ruyfch , 6c inje&a fupérieurement,
fans révéler la matière dont il s ’eft fervi. J’ai difféqué
av e c lui ; . mais jamais je ne l’ai vu faire les injections
fin e s , malgré la familiarité d’une longue fociété de
travail. Il ne travàilloit devant moi que pour les dé-
monftrations , 6c fes injections étoient des plus communes.
Celles qu’il faifoit pour des préparations,
étoient de la plus grande beauté. Je me fouviens que
M. Lieberkuhn ne le goûtoit cependant pas ; il y
critiquoit l’épanchement de la liqueur inje&ée dans
le tiflu cellulaire.
C e dernier anatomifte étoit fils d’un o rfevre ; il
é toit do.ié d’une fineffe dans la vue prefque unique :
fes talens le mirent en état de perfectionner l ’art
d ’injeCter » il fit des préparations que rien n’avoit
éga lé encore. On ne lauroit voir fans admiration le
réfeau vafculeux répandu fur la furface intérieure
de la choroïde , les petits vaiffeaux des rayons ciliaires
6c d’autres préparations de ce favant ; 6c c’ eft
line vraie perte pour l’anatomie, qu’il n’ait écrit que
fur la tunique veloutée des inteftins.
Nicholls a voit inventé l ’art d’in jeder des vaiffeaux
av e c une matière folide ; de détruire, par le moyen
des efprits acides, ce qu’il y avoit de cellulaire 6c de
membraneux, 6c de ne conferver que la matière qui
s’étoit moulée fur les vaiffeaux. M. Lieberkuhn fui-
v it cette idée ; il injeftoit dans les vaiffeaux de la
cire mêlée d’une cinquième partie de celophonium
& d’un dixième de térébenthine : il colo roit cette
matière ; & quand elle étoit refroidie , il détruifoit
pa r l’huile de v itrio l la partie membraneufe de la
préparation. Il enfermoit enfuite le tiflii des v aiffe
au x dans du gyp fe ; il le mettoit au fe u , la cire fe
d é t r u i f o i t& le gyp fe fervoit de moule à l’argent
que M. Lieberkuhn y faifoit couler. M. Hunter trav
aille à-peu-près dans les mêmes principes, 6c détruit
également la partie membraneufe.
Pour des injections ordinaires , on peut fe contenter
de féringuer dans l’artere de l ’huile de térébenthine
colorée ; elle s’échappe moins dans les cel-
lu lo fité s , elle découvre très-bien les vaiffeaux de
l ’ir is , de la choroïde & de la rétine. On fait fuivre
cette huile par une injection plus groffiere, compofée
de fu if , de térébenthine 6c d’un peu de cire.
Il y a mille petits fecrets qu’on n’apprend que
par l’expérience. Il faut fur toutes choies bien réchauffer
le fu je t , le plonger dans un bain d ’eau
chaude , ouvrir le bas-ventre & la poitrine pour y
admettre la chaleur de l’eau , inje&er l’artere dans
l ’eau m êm e , tenir les tu yau x chauds par le moyen
d’un cône de fer fort chaud qu’on y adapte, 6c pouffer
la matière a v e c lenteur, fans fecouffe & fans effort.
M faut des couleurs fortes pour ces injections. La
coch en ille , le cinabre , la cendre bleuè , le fafran
& la gomme j»utte féroient trop fo ib le s , 6c le verd-
de-gris a le défaut de pâlir de lui-même.
Une autre injection , qui différé de la précédente ,
c’eft celle du ' mercure. On s’en fert pour remplir
des vaiffeaux, qu’une liqueur aqueufe auroit de la
peine à pénétrer , 6c dans Iefquels un tuyau capable
d’admettre avec facilité de la cire ou du fu if, ne trou-
v ero it pas d’entrée. T e ls font les petits vaiffeaux
dont eft compofé le tefticule, les cônes des vaiffeaux
excrétoires de cet organe, le canal déférent. On s’en
fert aufli pour les vaiffeaux lymphatiques.
Cette injection fe fait par le moyen d’un tuyau de
fe r , qui fe termine par un cylindre extrêmement
fin. On le lie dans le vaiffeau que l’on veut in je&er ,
& on y fait couler du mercure. On l’aide en le fa i-
fant arriver dans le tuyau depuis une hauteur de
quelques pieds. Mais comme cela demande une machine
affez incommode ,• on y fupplée avec un vuide
artificiel : il eft vrai que ce petit fecret n’eft guere
praticable que dans le conduit déféren t, dont la
lubftance eft extrêmement épaiffe. On comprime le
canal fous le tu y a u , on fait avancer le doigt yn
pouce ou plus le long du c an a l, en tenant toujours
ce canal ferré : on arrête le doigt à l’extrémité inférieure
de cette portion du canal entièrement vuidée ;
on ôte enfuite le d oigt, le mercure enfile av e c force
cet efpace vuide 6c qui ne réfifte p a s , 6c pénétré
av e c facilité. C ’eft de cette maniéré que j’ai réuflï
à remplir 6c lés cônes déférens 6c le réfeau vafcu-
la ire , 6c les vaiffeaux ferpentins du tefticule même.
( H .D .G . )
IN O C U L A T IO N , ( Med. légale. ) Depuis le tems
qu’on difpute fur l’inoculation, il eft arrivé ce qu’on
a toujours vu dans les découvertes utiles; les docteurs
fe difputoient, les intrigues, les cab ales , la
mauvaife foi étoient «tou r-à -tou r employ ée s : les
obfervateurs fagèsévaluoient les faits dans le iîlence,
ils n’interrogeoient que la nature, 6c en ajoutant à
ce que la tradition leur avoit appris ce que leur propre
expérience leur enfeignoit , ils marchoient à
grands pas dans la carrière, lorfqu’à peine les autres
1e doutoient qu’elle fût ouverte. La vérité qui ne
va que lentement, gagne toujours à être examinée
fans paffion, elle eft rarement le réfultat des difputes
polémiques.
On ne peut douter que l ’enthoufiafme, peu t-ê tre
même l’in té rê t, n’aient féduit de part 6c d’autre ; on
n’a vu que fo rt tard le véritable état de la queftion,
& ce n’eft pas même aux gens de l’art qu’on en doit
la connoiffance. Un homme de génie ( M. d’Alem-
b e r t) a fubftitué aux déclamations peu raifonnées,
la rigoureufe analyfe des fa its; & l’on a vu Y inoculation
dépouillée de tout ce qui lui eft étranger, fe pré-
fenter comme un moyen utile à l’état & c o n fia n t
pour le particulier qui l’adopte.
On a multiplié les calctils 6c les tables pour indiquer
le rapport qu’il y a entre les viéïimes de la petite
vérole naturelle 6c de l’artificielle : ces premières
conféquences tirées des faits qu’on avoit fous les
y e u x , font devenues prefque nu lies par les connoif-
fances acquifes ; on a ajouté aux choix & à la préparation
du fu je t , le choix de la matière qui doit
lerv ir à Yinoculation, la méthode de s’en fervir ou
d’inoculer, l’efpece de traitement requis durant la
maladie, 6c par d’heureufes vue s , fécondées de l’expérience
, on eft parvenu à moins redouter les in-
convéniens que Yinoculation préfentoit au premier
abord.
Plufieurs accidensont été l’effet de la précipitation
aveclaquelleon fe deudoit: à-peu-près comme on a
v u l’antimoine produire de funeftes effets dans des
mains.imprudentes;mais c ’eft la marche des hommes
dans la carrière des connoiffances ; peut-on citer ùn
grand remede en médecine dont les premières épreu-
v é s n’aient pas été funeftes ? Sans parler de l’antimoine
, il eft naturel de fuppofer que tout remede
efficace en petite quantité, a dû fouvent être funefte
à plufieurs hommes avant qu’on fût parvenu à en déterminer
la dofe 6c à connaître les circonftances qui
l ’indiquoient 6c celles qui l’excluoient.
II eft très-effentiel dans la queftion fur Y inocula;-
tion, de diftinguer l ’intérêt général de l’é ta t, de celui
des particuliers : lorfqu’il ne s’agit point de fauver
l ’état d’un danger preffant ou de fa deftru&ion, le cito
yen n’eft pas obligé de lui faire le facrifice de fa vie.
11 importe peu à l’etat que dans un danger commun
à tous les hommes, te l ou tel fe d é v o u e , pourvu
qu e le plus grand nombre fe fauve ; mais le particulier
n’a pas les mêmes vues ; fon exiftenceeft pour lui
le terme de la nature & des devoirs , il n’apperçoit rien
au-delà qui puiffe le dédommager du facrifice de fa v ie;
& nulle lo i , fans être injufte ou barbare, ne peut le
fo rc e rà fu b irc e fo rt s’il ne s’y r é fo u t volontairement.
Pourquoi s’étonner qu’un pere & qu’une mere délibèrent
fur Yinoculation de leur enfant ? L’amour paternel
, de tous les fentimens le plus profond 6c le
plus v i f , ne fait point calculer. Rien n’eft comparable
au plaifir d’un pere qui contemple fon fi ls , & l’idée
qu’il peut le perdre fouleve fon coeur av e c indignation.
Tant que cette poffibilité n’eft liée qu’au
hazard ou à la fomme des chofes contingentes, il fe
flatte qu’il fera compris dans le nombre de ceux qui font
épargnes ; mais dès qu ’il apperçoit quelque apparence
de certitude dans la poffibilité du danger, il s’effraie
& rien ne peut le raffurer contre cette crainte. Il n’en
e ft pas des vérités de fentiment comme des vérités logiquesou
m étaphyfiques; celles-ci perfuadent l’homme
qui réfléchit, lorsqu’elles fe lient à la chaîne naturelle
des rapports, que l’expérience bien vue 6c fou-
vent répétée ) a fait faifir : elles n’ont le plus fouvent
d’autre obftacleà furmonter que la froide incertitude;
& malgré leur exa&e conformité av e c la nature des
c h o fe s , elles luttent fouvent en vain contre fhomme
bouillant qui fe paflionne. Les autres au contraire ne
font jamais difcutées avec le fang-froidqui éloigne la
préoccupation, le fentiment dont on eft pénétré colore
tous les o b je ts , un inftinft involontaire s’oppofe à
la lumière qui v eu t percer ; 6c fi par hazard à travers
le choc des raifons & des fentimens, on vient
à bout de fe convaincre que la crainte eft peu fondée
, un mouvement dont on n’eft pas le maître.
infpire toujours la méfiance 6c fait, retomber dans la
première indécifion.
Combien d’hommes fe font paflionnés de bonne-
fo i dans des queftions purement oifeufes 6c fy Hématiques
! ils fe font refufés à l’évidence même lorfqu
’il en réfultoit des conféquences contradidoires
a v e c leur opinion favorite.
L a diftance eft immenfe entre le dégré d’affenti-
merit qu’ excite l’amour du fy ftêm e , 6c la force qui
lie le pere à fon fils. L’habitude ou les préjugés d’é- .
ducation font adopter 6c chérir l’ufage d’élever les
enfans de telle ou de telle maniéré ; un pere fe réfout
à faire ce que tant d’autrejs fo n t, parce qu’il lup-
pofe qu’ona bien raifonné avant lu i, & il s’épargne la
peine de penfer fur nouveaux frais, parce qu’il fe
méfie de fa raifon. Cette méfiance eft inévitable dans
ces circonftances, 6c c’eft peu t-ê tre dans les feuls
objets de fentiment que l’homme a iamodeflie de ne
s en pas faire accroire. Le médecin le plus dogmatique
& le plus confiant pour les autres, tremble lorfqu’il
eft malade, 6c ne voit qu’incertitude dans fes princ
ip es , lorfqu’il s’agit d’en faire l’application fur fon
corps. Il appelle alors fes confrères à fon fecours, il
celle de raifonner pour entendre ; & fi leur avis eft
par bonheur uniforme, il éprouve une jo ie intérieure
Tome I I I ,
que fespropres lumières ne lui ont jamais caufée.Telle
eft la force du témoignage général.
Mais comme parmi les objets de fentiment, il en
eft beaucoup dont les nuances fe lient à l ’opinion ou
au préjugé, il eft important d’éclairer les hommes fur
leurs vrais intérêts. Cette eytreprife fi difficile pour
quelques nations, ne doit être l’effet ni de la fo r c e ,
ni du {impie raifonnement ; elle ne peut réuflïr que
par l’exemple 6c le courage. Préfentez aux hommes
un moyen qui améliore leur fo r t , détruifez avec foin
leurs obje&ions fpécieufes, méprifez les autres 6c
confirmez par des exemples clairs &c fenfibles le bien
que vous leur annoncez, le tems fera le refte. Les
contradictions font un relie f pour le v r a i , elles engagent
dans des détails dont la perfection eft l’effet,
elles excitent l’attention des hommes indifférens ,
elles biffent enfin ou épuifent le premier obftacle que
1 habitude oppofoit, 6c familiarifent avec l’idée d’une
nouvelle conduite.
On a fouvent vu par ceméchanifme de froides vé rités
fubilituées à d’anciennes erreurs fcellées par le
tems, 6c qui étoient devenues, par l’habitude, des
objets de fentiment.
( Notre légé re té , qui nous fait varier les mode s, ne
setend que fur les objets indifférens: nous réfiftons
av e c force aux nouveautés d’un autre genre ; cette
fr iv o lité , fi long-tems reprochée aux François, tient
beaucoup à l’extérieur; mais je crois qu’il eft peu de
nation aufli conftante ou aufli uniforme dans tout
ce qui concerne les principaux ufages ou les habitudes
: il feroit aifé de citer dans notre conftitutiort
une foule d’objets fur Iefquels nous n’avons jamais
v a r ie , tandis que nos voifins ont fucceflîvement paf-
lé par les dégrés les plus diffemblables. Je conviens
néanmoins que cette uniformité qui eft un éloge dans
quelques cas , n’ eft pas à beaucoup près aufli louable
dans d’autres; nous avons fouvent réfifté au bien
qu’on nous offroit, par la feule habitude oit nous
fommes de réfifter aux nouvelles opinions. Nous
n’avons jamais peu t-ê tre placé le courage à créer ou
à faire un pa rti, le ridicule eft chez nous fi près de la
n ouv e au té , 6c nous en fommes fi p rodigues, qu’il eft
fans e x em ple, dans notre hiftoire, qu’un homme
qui débitoit une opinion nouvelle 6c utile ait été
accueilli a v e c reconnoiffance. Il faut donc fe réfoudre
à fupporter des contradictions inévitables, & nous
ne fommes pas en droit d’exiger qu’un pere ait le
courage de fe c o u e r , fur un objet àuflï intéreffant que
Yinoculation, la prévention qu’il a pour mille chofes
qui le touchent de moins près. Nous devons donc
borner nos efforts à combattre la pufillanimité des uns
parle détail des avantages 6c la prévention des autres,
en détruifant, autant qu’il eft poflib le, les objections
qu’ils oppofent.
L ’une des caufes d’allarme pour les peres de fam
ille , eft celle qui fuppofe qu’en inoculant la petite
vérole à un enfant fain, on peut aufli lui communiquer
les différens virus ou les vices originaires qu’ont
ceux fur Iefquels on a pris la matière de Yinoculation.
J’aimerois autant qu’on dît qu’un vieillard qui communique
la pefte à un jeune homme,lui communique
aufli là vieilleffe, ou qu’un galleux feorburique ou
e crou elleu x, communique à la fois à ceux qui le
touchent la galle 6c le feorbut ou les écrouelles*
Cette vaine objection dont on m’a fouvent oppofé la
fo r c e , peut être confidérée comme une preuve du
peu d’attention des adverfaires de Yinoculation dans
le choix des obftacles; on n’a voulu que répandre
un effroi général, il femble même qu’on eût en vue
d’ameuter les efpritsen leur faifant entrevoir les conféquences
les plusdangereufes. Je demanderois à ce»
hommes fi prévenus fur l’origine des caufes des maladies
les plus réb elles , s’ils ont v u le s maladies v éné riennes
fe communiquer d’un fujet à l’autre, accompa