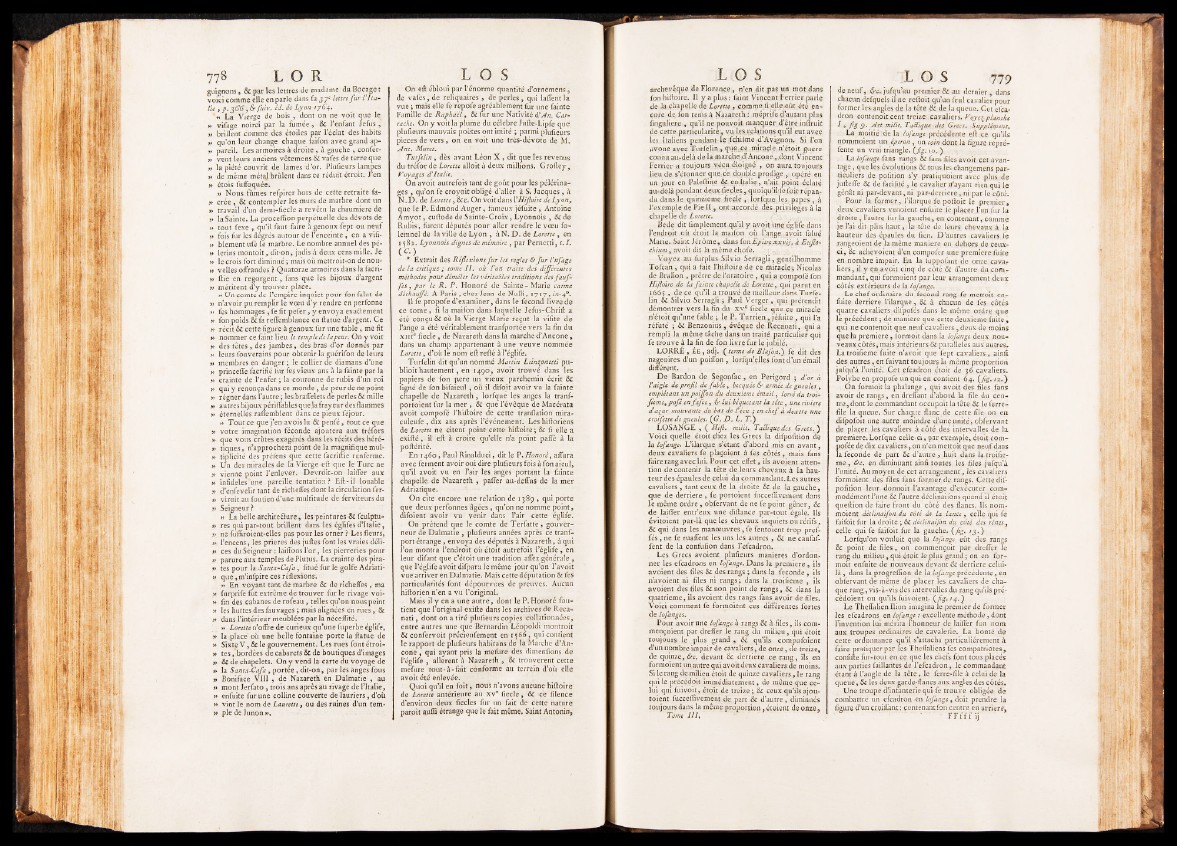
guignons, & par les lettres de madame du Bocage :
voici comme elle en parle dans fa 37e Lettre fur l Italie
, p , fttiv. éd. de Lyon 1764.
' « La Vierge de bois , dont on ne voit que le
» vifage noirci par la fumée, & l’enfant Jefus ,
» brillent .comme des étoiles par l’éclat des habits
» qu’on leur change chaque faifon avec grand ap-
» pareil. Les armoires à droite, à gauche , confer-
» vent leurs anciens vêtemens & vafes de terre que
» la piété couvrit de lames d ’or. Plufieurs lampes
» de même métaj brûlent dans ce réduit étroit. J’en
» étois fuffoquée.
» Nous fûmes refpirer hors de cette retraite fa-
» crée , & contempler les murs de marbre dont un
» travail d’un demi-fiecle a revêtu la chaumière de
» la Sainte. La proceflion perpétuelle des dévots de
» tout fexe , qu’il faut faire à genoux fept ou neuf
» fois fur les dégrés autour de l’enceinte , en a vifi*
» blement ufé le marbre. Le nombre annuel des pé-
» lerins montoit, dit-on, jadis à deux cens mille. Je
» le crois fort diminué ; mais où mettroit-on de nou-
» velles offrandes ? Quatorze armoires dans la facri-
» ftie en regorgent, fans que les bijoux d’argent
» méritent d’y trouver place.
» Un comte de l’empire inquiet pour fon falut de
» n’avoir pu remplir le voeu d’y rendre en perfonne
» fes hommages , fe fit pefer, y envoya exa&ement
» fon poids & fa reffemblance en ftatùe d’argent. Ce
» récit & cette figure à genoux fur une table, me fit
» nommer ce faint lieu le temple de lapeur. On y voit
» des têtes , des jambes , des bras d’or donnés par
» leurs fouverains pour obtenir la guérifon de leurs
» membres en danger ; le collier de diamans d’une
» princeffe facrifié lur fes vieux ans à la fainte par la
» crainte de l’enfer ; la couronne de rubis d’un roi
» qui y renonça dans ce monde, de peur de ne point
» régner dans l’autre ; les braffelets de perles & mille
» autres bijoux périffables que la frayeur des flammes
» éternelles raffemblent dans ce pieux féjour.
» Tout ce que j’en a vois lu & penfé, tfout ce que
» votre imagination féconde ajoutera aux tréfors
» que vous crûtes exagérés dans les récits des héré-
» tiques, n’approcher.a point de la magnifique mul-
» tiplicité des préfens que cette facriftie renferme.
>» Un des miracles de la Vierge eft que le Turc ne
» vienne point l’enlever. Devrôit-on laiffer aux
» infidèles une - pareille tentation? Eft-SL louable
» d’enfevelir tant de richeffes dont la circulation fer-
» viroit au foutien d’une multitude de ferviteurs du
» Seigneur?
» La belle archite&ure, les peintures & fculptu-
» res qui par-tout brillent dans les églifes d’Italie,
» ne fuffiroient-elles pas pour les orner ? Les fleurs,
». l’encens, les prières des juftes font les vraies déli-
» ces du Seigneur : laiffons l’o r , les pierreries pour
» parure aux temples de Plutus. La crainte des pira-
» tes pour la Santa-Cafd, fitué fur le golfe Adriati-
» que ,m’infpire ces réflexions.
» En voyant tant de marbre & de richeffes , ma
» furprife fut extrême de trouver fur le rivage voi-
» fin des cabanes de rofeau, telles qu’on nous peint
» les huttes des fauvages ; mais alignées en rues, &
» dans l’intérieur meublées par la néceflité.
» Lorette n’offre de curieux qu’une fuperbe églife,
» la placé oîi une belle fontaine porte la flatue de
» Sixte V , & le gouvernement. Les rues font étroi-
» tes, bordées de cabarets & de boutiques d’images
» & de chapelets. On y vend la carte du voyage de
» la Santa-Cafa , portée, dit-on, par les anges fous
» Boniface VIII , de Nazareth en Dalmatie , au
» mont Jerfato , trois ans après au rivage de l’Italie,
» enfuite fur iine colline couverte de lauriers, d’où
» vint lé nom de Laurette, ou des ruines d’un tem-
» pie de Junon »,
On eft ébloui par l’énorme quantité d’ornemens,
de vafes, de reliquaires , de perles , qui laffent la
vue ; mais elle fe repofe agréablement fur une fainte
Famille de Raphaël, & fur une Nativité d’An. Car-
rache. On y voit la plume du célébré Jufte-Lipfe que
plufieurs mauvais poètes ont imité ; parmi plufieurs
pièces de vers , on en voit une très-dévote de M.
Ant. Muret.
Turfelin, dès avant Léon X , dit que les revenus
du tréfor de Lorette alloit à deux millions. Grofley,
Voyages £ Italie.
On avoit autrefois tant de goût pour les pélérina-
ges , qu’on fe croyoit obligé d’aller à S. Jacques , à
N. D . de Lorette, &c. On voit dans VHifioire de Lyon,
que le P. Edmond Auger, fameux jéfuite , Antoine
Amyot, euftode de Sainte-Croix, Lyonnois , & de
Rubis , furent députés pour aller rendre le voeu fo-
Ietainel de la ville de Lyon , à N. D. de Lorette , en
1582.Lyonnois dignes de mémoire , par Pernetti, 1.1. (c-) .. H * Extrait des Réflexions fur les réglés & fur Vufage
de la critique ; tome I I . où Von traite des différentes
méthodes pour démêler les véritables traditions des fauf-
fe s , par le R. P. Honoré de Sainte-Marie carme
déchauffé. A Paris , chez-Jean de Nulli, 17 1 7 , «2-4°.
11 fe propofe d’examiner, dans le fécond livre de
ce tome, fi la maifon dans laquelle Jefus-Chrift a
été conçu & où la Vierge Marie reçut la vifite de
l’ange a été véritablement tranfportée vers la fin du
xm e fiecle, de Nazareth dans la marche d’Ancone,
dans un champ appartenant à une veuve nommée
Lorette, d’où le nom eft refté à l’églife.
Turfelin dit qu’un nommé Martin Leinyonetti pu-
blioit hautement, en 1490, avoir trouvé dans les
papiers de fon pere un vieux parchemin écrit ôc
ligné de fon bifaïeul, où il difoit avoir vu la fainte
chapelle de Nazareth, lorfque les anges la tranf-
portoient fur la mer , & que l’évêque de Macérata
avoit compofé l’hiftoire de cette tranflation mira-
culeufe , dix ans après l’événement. Les hiftoriens
de Lorette ne citent point cette hiftoire; & -fi elle a
exifté, il eft à croire qu’elle n’a point paffé à la
poftérité.
En 1460, Paul Rinalduci, dit le P .Honoré, affura
avec ferment avoir oui dire plufieurs fois à fon aïeul,
qu’il avoit vu en l’air les anges portant la fainte
chapelle de Nazareth , paffer au-deffus de la mer
Adriatique.
On cite encore une relation de 1389 , qui porte
que deux perfonnes âgées , qu’on ne nomme point,
difoient avoir vu venir dans l’air cette églife.
On prétend que le comte de Terfattè, gouverneur
de Dalmatie , plufieurs années après ce transport
étrange, envoya des députés à Nazareth, à qui
l’on montra l’endroit où étoit autrefois l’églife , en
leur difant que c’étoit une tradition affez générale ,
qüe l’églife avoit difpa'ru le même jour qu’on l’avoit
vue arriver en Dalmatie. Mais cette députation & fes
particularités font dépourvues de preuves. Aucun
hiftorien n’en a vu l’original.
Mais il y en a une autre, dont le P. Honoré fou-
tient que l’original exifte dans les archives de Reca-
nati, dont on a tiré plufieurs copies collationnées,
entre autres une que Bernardin Léopoldi montroit
& confervoit précieufement en 1566, qui contient
le rapport de plufieurs habitans de la Marche d’Ancone
, qui ayant pris la mefüre des dimenfions de
l’églife , allèrent à Nazareth , & trouvèrent cette
mefure tout-à-fait conforme au terrein d’où elle
avoit été enlevée.
Quoi qu’il en foit, nous n’avons aucune hiftoire
de Lorette antérieure au x v e fiecle, & -ce filence
d’environ deux fiecles fur un fait de cette nature
paroît aufli étrange que le fait même. Saint Antonin,
orcheyêque de Florence, n’en dit pas un mofrdans
fon hiftoire. Il y a plus : faint Vincent. Ferrier parle
dé jà chapelle de Lorette , comme,fi ellp..eut été encore
de fon tems à Nazareth : mép.rife d’autant plus
fingulie.re., qu’il ne pouvoir manquer d’être inftruit
çle cette particularité» yiyl,es,rglaj.ions qu’il eut avec
les Italiens pendant:le fclfifme .d’Avignon, Si, l’on
lïvoùe ayec Turfelin » qqqßCe miraçle,- n’étoit guere
connu aur.delû de la.m^P.fi^A'Anço,ne-,jdont Vincent
Ferner a toujours,yépu,éJoigpé , op a,ura toujours
lie.u de s’ étonner que; ce dç^ib;le)prp4ige,\opéré en
un jour en Paleftine en-Ltalie, n’ait point éclaté
au-delà pendant deipofiecles, quoiqu’ilffe foit répandu
dans le quinzième fieple , îorfque,les; papes
l’exemple de Pie II;, ont accordé dés .privilèges à la
chapelle de Lorette.
Bedç dit fimplement.qu’il y avoir upe églife dans
l’endroit où étoit la maifon où l’aqge ,avoit falué
Marie. Saint Jérôme, dans IonEpitre.xxvij. à Eufio-
chium, avoit dit la même chofe.
Voyez au furplus Silvio SerragU, gentilhomme
Tofcan , qui a fait l’hiftoire de ce miracle» Nicolas
de Bralion , prêtre de l’oratoire, qui a,çompofé fon
Hißoire de la fainte chapelle de Lorette f qui parut en
1665 , de ce qu’il a trouvé de meilleur-dans Turfelin
& Silvio Serragli ; Paul Verger , q.ui ;prétendit
démontrer vers la fin du xv,e fiecle que.çe miracle
n’étoit qu’une fable ; le P. Turrienjéfuite , qui l’a
réfuté ; & Benzonitis , .évêque de, Recànati, qui a
rempli la même tâche dans un traité particulier qui
fe trouve à la fin de fon livre fur le jubilé.
LORRÉ , ÉE, adj. ( terme de BlafopV) fe dit des
nageoires d’un poiffon , iorfqu’elles font d’un émail
différent.
De Bardon de Segonfac , en Périgord ; d'or à
Vaigle de profil de fable, becquée & armée de gueules ,
empiétant un poiffon du deuxieme émail, lorré du troi-
fieme, pofé en fajee, & lui béquetant la tête, une riviere
d'azur mouvante du bas de Vécu ; en chef à dextre une
croifette de gueules. ( G . D . L. T.)
LOSANGE , ( Hifi. milit. Tactique des Grecs.}
Voici quelle étoit chez les Grecs la difpofition de
la lo f ange. L’ilarque :s’étant d’abord mis en avant,
deux cavaliers fe plaçoient à fes côtés, mais fans
faire rang avec lui. Pour cet effet, ils avoient attention
de contenir la tête de leurs chevaux à la hauteur
des épaules de celui du commandant. Les autres
cavaliers , tant ceux de la droite & d.e la gauche,
que de derrière , fe portoient fucceflivement dans
le même ordre , obfervant de ne fe point gêner, &
de laiffer entr’eux une diftance par-tout égale. Ils
évitoient par-là que les chevaux inquiets ou rétifs,
6c qui dans les manoeuvres, fe fentoient trop pref-
fés , ne fe ruaffent les uns les autres , & ne caufaf-
fent de la confufion dans l’efeadron.
Les Grecs avoient plufieurs maniérés d’ordonner
les efeadrons en lofange. Dans la première , ils
avoient des files & des rangs ; dans la fécondé, ils
n’avoient ni files ni rangs; dans la troifieme , ils
avoient des files & non point de rangs, & dans la
quatrième, ils avoient des rangs fans avoir de files.
Voici comment fe formoient ces différentes fortes
de lofanges.
Pour avoir une lofange à rangs & à files, ils com-
mençoient par drefler le rang du milieu, qui étoit
toujours le plus grand , & qu’ils compofoient
d’un nombre impair de cavaliers, de onze, de treize,
de quinze, &c. devant & derrière ce rang, ils en
formoient un autre qui avoit deux cavaliers de moins.
Si le rang de milieu étoit de quinze cavaliers , le rang
qui le précçdoit immédiatement, de même que celui
qui fuiv.oit, étoit de treize ; & ceux qu’ils ajou-
toient fucceflivement de part & d’autre, diminués
toujours dans la même proportion, étoient de onze,
"Tôme III,
de neuf, &c..jufqu’au premier & au dernier, dans
chacun defquels il ne reftoit qu’un fe.ul cavalier pour
former les angles de la tête & de-la queue. Cet efea-
dron contenpit,cent treize,',ça;valiers. Voye^planche
1 9 fië 9 • ÂrP..milit. Tactique\des Grecs. Supplément.
La moitié : de la lofange précédente eft.ee qu’ils
nommoient un, éperon , un, coin dont la figure repréfente
un vrai triangle. (fig.\oJ '\
La lofange fans rangs & fans files avoit cet avan-
■ tage, que les évolutions & tous.les changemens particuliers
de, pofition s’y pratiqu'oient avec plus, de
jufteffe & de facilité , le cavalier tf ayant rien qui fe
gênât ni par-devant,ni par-derriere, ni par le côté.
.. Pour la former, l’ilarque fe poftoit le premier,
deux cavaliers yenoient enfiiite fe placer l’un fur la
droite » l’autre fur la gauche, en contenant, comme
je l’ai dit plfis haut, la; tête de leurs chevaux à la
hauteur des épaules du fien. D ’autres cavaliers fe
rangeoient de la même maniéré en dehors de ceux-
ci, ôc açheyoient d’en compofer. une première fuire
en nombre impair. En la iupp,ofant de onze cavay
liers, il y emayoit cinq de côté & d’autre du commandant,
qui formoient par leur arrangement deux
côtés extérieurs de la Iffange.
Le chef ordinaire du fécond rang, fe mettoit en-
fuite derrière l’ilarque, 8c à chacun de fes, côtés
quatre cavaliers dilpofés dans :le même- ordre que
le précédent ; de maniéré que- cette deuxieme fuite ,
qui . ne contenoit que neuf cavaliers , deux de moins
que,h première , tbrmoit dans la lofange deux nouveaux
côtés, mais intérieurs & parallèles aux autres»
La troifieme fuite n’avoit que fept cavaliers., ainfi
des. autres, enfuivant toujours la même proportion
jufqu’à l’unité.' Cet efeadron étoit de 36 cavaliers.
Polybe en propofe un qui en contient 64. (fig.-iz.)
On formoit la phalange , qui aypit des files fans
avoir de rangs, en dreffant d’abord la file du centre,
dont le commandant occupoit la tête & le ferre-
file la queue. Sur chaque flanc de cette file.on en
difpofoit une autre moindre d’uneiinité, obfervant
de placer les cavaliers à côté des intervalles de la
première. Lorfque celle-ci , par exemple, étoit com-
pofée de dix cavaliers, on n’en mettent que neuf dans
la fécondé de part & d’autre, , huit dans ia trpifie-
me , &c. en diminuant ainfi toutes les files juiqu’à
l’unité. Au moyen de cet arrangement, les cavaliers
formoient des files fans former de rangs. Cette difpofition
leur, donnait l’avantage d’exécuter .commodément
l’une & |’autre déclinaifons quand il étoit
queftion de faire front du côté des flancs. Ils nommoient
déclinaifon-du côté de la,lance, celle qui fe
faifoit fur la droite ; & déclinaifon du côté des rênes,
celle qui fe faifoit fur la ga,uche..( fig. 13.}
Lorfqu’on vouloit que la lofange eût des rangs
& point de files, on commençoit par dreffer le
rang du milieu, qui étoit le plus grand; on en formoit
enfuite de nouveaux devant & derrière celui-
là , dans la progreflion de la lofange précédente, en
obfervant de même de placer les cavaliers de chaque
rang, vis-à-vis des intervalles du rang qu’ils pré-
cédoient ou qu’ ils fuivoient. ( fig. 14.}
Le Theffalien- Ilion imagina le premier de former
les efeadrons en lofange : excellente méthode, dont
l’invention lui mérita l’honneur de laifler fon nom
aux troupes ordinaires de cavalerie. La bonté de
cette ordonnance qu’il s’attacha particuliérement à
faire pratiquer par les Theffaliens fes compatriotes,
confine fur-tout en ce que les chefs font tous placés
aux parties {aillantes de l’efcadron,.le commandant
étant à l’angle .de la tête, le ferre-file à celui de la
queue, & les deux garde-flancs aux angles des côtés.
Une troupe d’infanterie qui fe trouve obligée de
combattré un efeadron en lofange, doit prendre la
figure d’un croiflant: contenantfon centre en arriéré,
| F F 'f f f ij