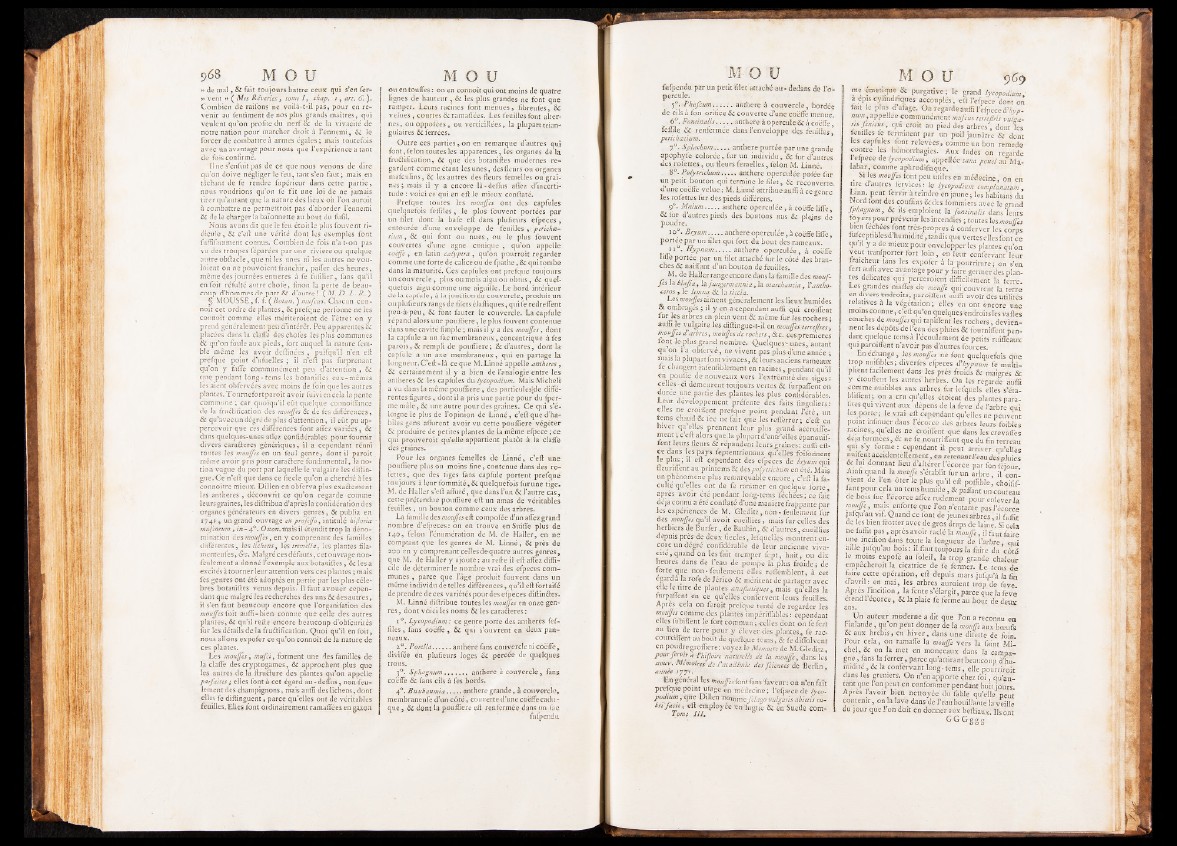
» de mal, & fait toujours battre ceux qui s’en fer-
» vent » f Mes Rêveries , (orne /, ckap. i , art. 6. ).
Combien de raifons ne voilà-t-il pas, pour en revenir
au fentiment de nos plus grands maîtres, qui
veulent qu’on profite du nerf & de la vivacité de
notre nation pour marcher droit à l’ennemi, 6c le
forcer de combattre à armes égales ; mais toutefois
avec un avantage pour nous que l’expérience a tanc
de fois confirmé.
Il ne s’enfuit pas de ce que nous venons de dire
qu’on doive négliger le feu, tant s’en faut; mais en
tâchant de fe rendre fupérieur dans cette partie,
nous voudrions qu’on fe fît une loi de ne jamais
tirer qu’autant que la nature des lieux oh l’on auroit
à combattre ne permettroit pas d’aborder l’ennemi
& de le charger la baïonnette au bout du fufil.
Nous avons dit que le feu étoit le plus fouvent ridicule,
6c c’eft une vérité dont les exemples font
fuffifamment connus. Combien de fois n’a t-on pas
vu des troupes féparées par une riviereou quelque
autre obftacle, que ni les unes ni les autres ne vou-
loient ou ne pou voient franchir, paffer des heures,
même des journées entières à fe fufilier, fans qu’il
en foit réfulté autre chofe, linon la perte de beaucoup
d’hommes de part & d’autre! (Af. D . L. R .)
§ MOUSSE, f. f. ( Botan.) mufcus. Chacun con-
noît cet ordre de plantes, & prefque perfonne ne les
connoît comme elles mériteroient de l’être: on y
prend généralement peu d’intérêt. Peu apparentes &
placées dans la clafle des chofes les plus communes
6c qu’on foule aux pieds, fort auquel la nature fem-
ble même les avoir defiinées , puifqu’il n’en eft
prefque point d’ufuelles ; il n’eft pas furprenant
qu’on y faffe communément peu d’attention , 6c
que pendant long-tems les botaniftes eux-mêmes
les aient obfervées avec moins de foin que les autres
plantes. Tournefortparoît avoir fuivi en cela la pente
commune ; car quoiqu’il eût quelque connoiflance
de la fructification des moujfes 6c de fes différences,
& qu’avec un dégré de plus d’attention , il eût pu ap-
percevoir que ces différences font affez variées, 6c
dans quelques-unes affez confidérables pour fournir
divers cara&eres génériques, il a cependant réuni
toutes-les moujfes en un feul genre, dont il paroît
même avoir pris pour caradtere fondamental, la notion
vague du port par laquelle le vulgaire les diftin-
gue. Ce n’eft que dans ce fiecle qu’on a cherch'é à les
connoître mieux. Dillen en obferva plus exactement
les anthères , découvrit ce qu’on regarde comme
leurs graines, les diftribua d’après la confidération des
organes générateurs en divers genres, & publia en
174 1 , un grand ouvrage ex profejfo, intitulé hifloria
majcorum, in - 40. Oxon. mais il étendit trop la dénomination
des rnoujfes, en y comprenant des familles
différentes, les lichens t les tremella, les plantes fila-
menteufes, &c. Malgré ces défauts, cet ouvrage non-
feulement a donné l’exemple aux botaniftes, & les a
excités à tourner leur attention vers ces plantes ; mais
fes genres ont été adoptés en partie par les plus célébrés
botaniftes venus depuis. Il faut avouer cependant
que malgré les recherches des uns 6c des autres,
il s’en faut beaucoup encore que l’organifation des
moujfes foit auffi-bien connue que celle des autres
plantes, 6c qu’il refte encore beaucoup d’obfcurités
îur les détails de la fru&ification. Quoi qu’il en foit,
nous allons expofer ce qu’on connoît de la nature de
ces plantes.
Les moujfes, mufci, forment une des familles de
la claffe des cryptogames, & approchent plus que
les autres de la ftruCture des plantes qu’on appelle
parfaites ; elles font à cet égard au - defliis, non-feulement
des champignons, mais auflï des lichens, dont
elles fe diftinguent, parce qu’elles ont de véritables
feuilles. Elie$ font ordinairement ramaffées en gazon
ou en touffes : on en connoît qui ont moins de quatre
lignes de hauteur , & les plus grandes ne font que
ramper. Leurs racines font menues, fibreufes, 6c
velues, courtes & ramaflees. Les feuilles font alternes,
ou oppofées, ou verticillées, la plupart triangulaires
6c ferrées.
Outre ces parties, on en remarque d’autres qui
font, félon toutes les apparences, les organes delà
fructification, & que des botaniftes modernes regardent
comme étant les unes, des fleurs ou organes
mafculins, 6c les autres des fleurs femelles ou graines;
mais il y a encore là-defl'us affez d’incertitude
: voici ce qui en eft le mieux conftaté.
Prefque toutes les moujfes ont des capfules
quelquefois fefliles, le plus fouvent portées par
un filet dont la bafe eft dans plufieurs efpeces ,
entourée d’une enveloppe de feuilles ,> perickoe-
tium, & qui font ou nues, ou* le plus fouvent
couvertes d’une agne conique ; qu’on appelle
coëffe , en latin calyptra , qu’on pourroit regarder
comme une forte de calice ou de fpathe, 6c qui tombe
dans la maturité. Ces capfules ont prefque toujours
un couvercle, plus ou mois aigu Ou obtus, & quelquefois
aigu comme une aiguille. Le bord intérieur
de la capfule, à la jo n c t io n du couvercle, produit un
ou plufieurs rangs de filets élaftiques, quife redreffent
peu-à-peu, 6c font fauter le couvercle. La capfule
répand alors une pouflïere, le plus foiivent contenue
dans une cavité fimple ; mais il y a des moujfes, dont
la capfule a un fac membraneux, concentrique à fes
parois, & rempli de pouflïere; 6c d’autres, dont la
capfule a un axe membraneux,' qui en partage la
longueur. C’eft-là ce que M..Linné appelle anthères ,
6c certainement il y a bien de l’analogie entre les
anthères & les capfules du lycopodium. Mais Micheli
a vu dans la même pouflïere , des particulesjde différentes
figures , dont il a pris une partie pour du fper-
me mâle, & une autre pour des graines. Ce qui s’éloigne
le plus de l’opinion de Linné, c’eft que d’habiles
gens affurent avoir vu cette pouflïere végéter
6c produire de petites plantes de la même efpece ; ce
qui prouveroit qu’elle appartient plutôt à la clafle
des graines’. ' '
Pour les organes femelles de Linné, c’eft une
pouflïere plus ou moins fine, contenue dans des ro-
feites, que des tiges fans capfule portent prefque
toujours à leur fommité, & quelquefois furune tige.
M. de Haller s’eft afliiré, que dans l’un & l’autre cas,
cette prétendue pouflïere eft un amas de véritables
feuilles , un bouton comme ceux des arbres.
La famille des moujfes eft compofée d’un affez grand
nombre d’efpeces: on en trouve en Suifle plus de
140, félon l’énumération de M. de Haller, en ne
comptant que les genres de M. Linné, & près de
200 en y comprenant celles de quatre autres genres,
que M. de Haller y ajoute : au refte il eft affez difficile
de déterminer le nombre vrai des efpeces Communes
, parce que l’âge produit fouvent dans un
même individu de telles différences, qu’il eft fort aifé
de prendre deces variétés pour des efpeces diftinétes.
M. Linné diftribue toutes les moujfes en onze genres
, dont voici les noms 6c les cara&eres :
ï °. Lycopodium: ce genre porte des anthères fef-
files, fans coëffe , 6c qui s’ouvrent en deux panneaux.
20. Porella......... anthere fans couvercle ni coëffe,
divifée en plufieurs loges & percée de quelques
trous.
30. Sphagnum............ anthere à couvercle, fans
coëffe 6c fans cils à fes bords.
40. Buxbaumia. . . . . anthere grande, à couvercle,
membraneufe d’un côté, couverte d’une coëffe caduque,
6c dont la pouflïere eft renfermée dans un fac
fufpendu
fufpendu par un petit filet attaché au - dedans de l’opercule.
_ 5°* Phàfcum..........anthere à couvercle, bordée
de cils à fon orifice & couverte d’une coëffe menue.
-6°. ■ Fo'minalis. . . . . . anthere à opercule & à coëffe,
feflïle 6c renferme© dans l’enveloppe des feuilles,
perichceùfim,
7°. SpLackum.... . . anthere portée par une grande
apophyfe Colorée, fur un individu, 6c fur d’autres
des rofettes, ou fleurs femelles, félon M. Linné.
8°-PoLytrichiim. . . . . anthere operculée pofée fur
un petit bouton qui termine le filet, & recouverte,
d’une coëffe velue : M. Linné attribue auflï à ce genre
les rofettes fur des pieds différens.
cf. Mnium. . . . . anthere operculée, à coëffe liffe,
& fur d’autres pieds des boutons nus 6c pleins de
poudre.
1 o®. Bryum... . . anthere operculée, à coëffe liffe,
portée par un filet qui fort du bout des rameaux.
p M j Rypnuni........anthere operculée , à coëffe
liffe portée par un filet attaché fur le côté des branches
6c naiffant d’un bouton de feuilles.
M. de Haller range encore dans la famille des mouf-
fes la blajia, la jungermannia, la marchanda, i'antho-
eeros , le lemna 6c la riccia.
Les moujfes aiment généralement les lieux humides
& ombragés ; il y en a cependant auffi qui croiffent
fur les arbres en plein vent 6c même fur les rochers ;
auffi le vulgaire les cliftingue-t-il en moujfes terrejlres^
moujfes d'arbres, moujfes de rockers, Sic. ces premières
font le|)lusgrand nombre. Quelques-unes, autant
qu on l’a obfervé, ne vivent pas plus d’une année ;
mais la plupart font vivaces, 6c leurs anciens rameaux
fe changent infenfiblement en racines, pendant qu’il
en pouffe de nouveaux vers l’extrémité des tiges :
celles-ci demeurent toujours vertes 6c furpaffent en
durée une partie des plantes les plus confidérables.
Leur développement préfente des faits finguliers:
elles ne croiffent prefque point pendant l’été, un
tems chaud Sc fec ne fait que les reflerrer ; c’eft en
hiver qu’elles prennent leur plus grand accroiffe- j
ment ; c’eft alors que la plupart d’entr’elles épanouif- :
fent leurs fleurs & répandent leurs graines : auffi eft- :
ce dans les pays feptentrionaux qu’elles foiforinent
le plus ; il eft cependant des efpeces de bryum qui
fieuriffent au printems & dèspolytrichiim en été. Mais
un phénomène plus remarquable encore :, c’eft la faculté
qu’elles ont de fe ranimer en quelque forte,
après avoir été pendant long-tems féc-hëes ; ce fait
déjà connu a été conftaté d’une maniéré frappante par
les expériences de M. Gleditz, non-feulement fur
des moujfes qu’il avôit cueilliesmais fur celles des
herbiers de Burfer , de Bauhin, & d’autres, cueillies
depuis près de deux fiecles, leïquelles montrent en-
core un degre c’onfiderable de leur ancienne vivacité,
quand on les'fait tremper fe.pt, huit, ou dix
heures .dans de l’eau de pompe la plus froide.; de
forte que non-feulement êlles reffemblent, à cet
égard à la rofe de Jérico 6c méritent de partager avec
elle le titre de plantes anajîatiques, mais qu’elles la
furpaffent en ce qu’elles conservent leurs feuilles.
Après cela on feroit prefque tenté de regarder les
moujfes comme des plantes impérïfl'ables : cependant
elles fnbiflent le fort commun ^celles dont on fèfert
au lieu de terre pour y élever des plantes, fe rac-
courciffe'nt au bout dc quëlque tems, & fe dïffolvent
en poudre groffiere: voyez le Mémoire de M. Gleditz',
poùrférvir à 4’hijloire •naturelle de la tnotge, dans les
nouv. Mémoires de l'académie des fciénces de Berlin
année iy j'i.
•En général les thôujfes font fans Savent: on n’en fait
prefque point ulage en médecine; l’efpvce de lycopodium
, qtre Dillen nornmej'elago vulgüris ciblais m-
brifaeie, eft employée tn Ingtie & en Sue de com-
Tome I II,
; me émeticjue & purgative; le grand lycopoiiutn •
• a épis cylindriques accouplés, ell l'efpecc dont oii
fart le plus d’uïage. On regarde auffi l’efpece à’hyp-
hmn, appellée communément mufcus urrcftris vulea-
■ ris femeus, qui croît au pied dès arbres, dont lè s
reuilles le terminent par un poil jannârre & dont
• les Captltles font rdevees , comme Un bon reblede
contre les hémorrhagies. Aux Indes on regarde
; 1 efpece de lycopodium, appellée tma poüd au Maj
labar, comme aphrodifiaque.
. S i t e (Bët/^ifoht peu Utiles en médecine,'on èn
; tire d autres fervices .- le lycopodium complanaiurn 9
H B H b en jaune; les habîtafls du
; iNordfont des couffins 6cdes fommiers avec le grand
i J'phagmrrn, & ils emploient la fonùnalis dans leurs
foyers pouf prévenir t e incendies ; toutes les mouffes
pien léchées'font très-propres à conferver les corps
îulceptibles d’humidité, tandis que vertes elles font ce
tfu il y a de mieux pour envelopper les plantes qu’on
yeut tranfporterfort loin , ■ leur Colifervant leur
fraîcheur fans les expofer à la pourriture ; on s’en
fort auffi avèc avantage pour y faire germef des plantes
délicates qui pcrceroieut difficilement la terry.
Les grandes inàffês.de mduffe c:ui,co;:vrtnî la terre
en divers endroits, paroiffent àuffi avoir des utilités
relatives à la végétation; elles en ont encore une
moins connue, c’eft qu’en quelques endroits les vaftes
couches de moujfes qui tapiffent les rochers, deviennent
les dépôts de l’eau des pluies 6c fourniffent pendant
quelque tems à l’écoulement de petits ruiffeaux
qui paroiffent n’avoir pas d’autres fources.
En échange, les mouffes ne font quelquefois que
trop nuilibles ; diverfes efpeces à'hypnum fe multiplient
facilement dans les prés froids 6c maigres &
y étouffent les autres5 herbes. On les regarde auflï
comme miifibles aux arbres fur lefquels elles s’éta-
bliffent ; on a cru qu’elles étoient des plantes parantes
qui vivent aux dépens de la feve de l’arbre qui
les porte; le vrai eft cependant qu’elles ne peuvent
point infinuer dans l’écorce des arbres leurs foibles
racines;, qu’elles ne Croiffent que dans les crevaffes
déjà formées , 6c ne fe ..nourrifient que du fin rerreau
qui s’y forme : cependant il peut arriver ou’clles
mufenl: accidentellement, en retenantl’eau des pluies
« ll'' 'donnant lieu d’altcrer l’ècorce par fon féjottr
Ainfi quand la mouffe s’établit fur un arbre, il convient.
de,l’en ôfor le-plus qu’il eft poffible, choiiîf-
lantpout cpla un tems humide, & paffant un couteau
de bois fur l’écorce affez rudement pourenieverla
nioufe , mais enfoae que l’on n’entame pas fécotee
jufqu’au vif. Quand ce font de jeunes arbres i-iî feffit
de les bien fifotter avec, degrés jjraps de laine. Si cela
ne fuffit pas, après avoir raclé.fa moufft, il faut faire
une incifiou (jr.ns toute la longueur de l'arbre, oui
aille jufqu’au bois: il faut toujours la faire du'coté
le moins éxpofë au foleil, la trop grande qhateujr
empêcheront la cicatrice de fe .fermer. Le tems de
faire cette opération, eft depuis mars .fufqu’à la fin
d avril : en mai, les arbres.sauraient trep cie lève.
Après l’incifion , là fenté.s’élargit, parce que Jafovê
étend l’étorcé, & la plaie fe fermé au bout de deux
ans.
Un auteur moderne a dit que l’ôn a reconnu en
Finlande, jjü’ bnpent donner de la inoujfc aux boeufs
& aux brebis, en hiver, dans une difelte de foin
Pour cela, on ramafl'e la nioufi vers la faiut Mi-'
Chel, & on la met en mÇn'çVàux d'aps ^ campagne
, fans la ferrer, parce qu’attirant beaucoup d ï i i l
midité, & la cdnfervant l'oiigé té'ms, elle pôurriroit
ilans les greniers. On ri’en apporte chez foi, qu’autant
que l’on peut en confommerpendant ht.it jours
Après l’avoir bien nettoyée’ du fable qu’elle peut
contenir, on ia lave daris’d e l’eau'bouillantefryeille
du jour qucj’cn doit en donner a;ix .beftiaux Ils Ont
G C Î G g g g