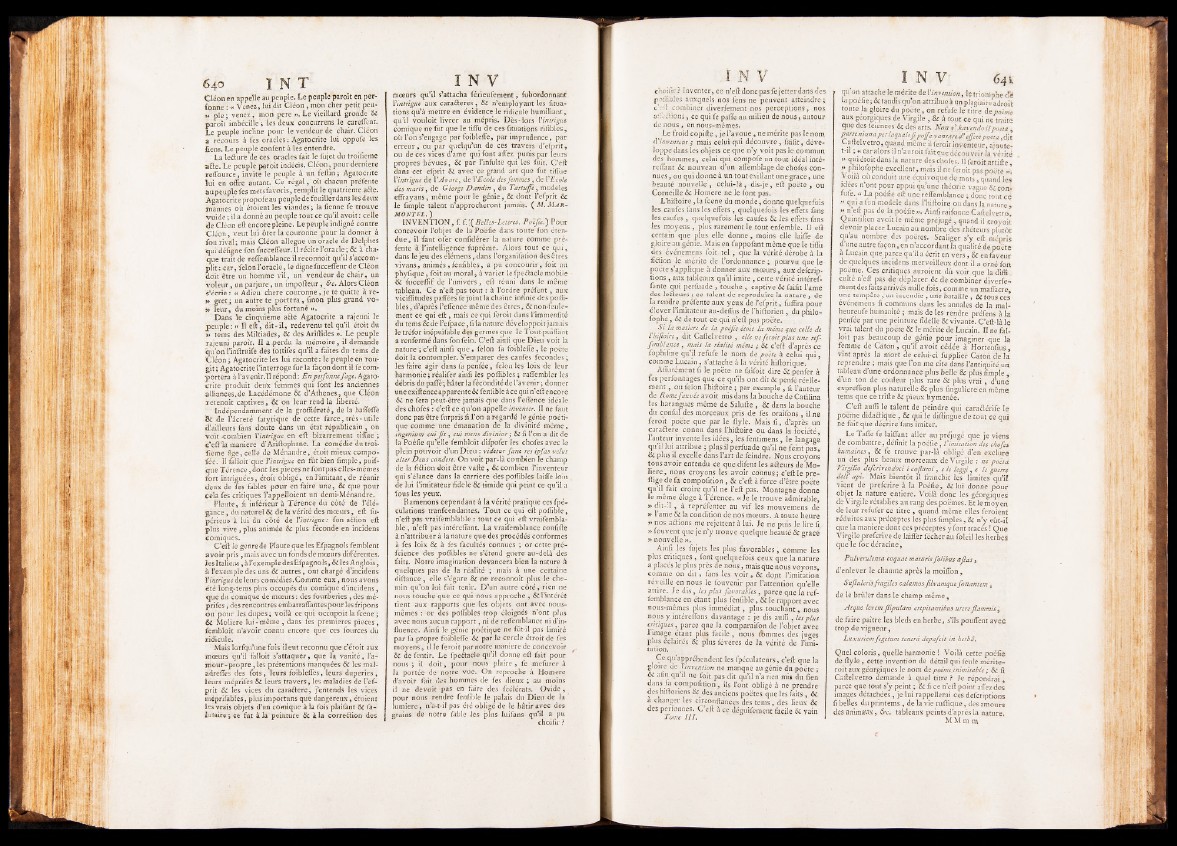
Cléonen appelle au.peuple. Le peuple paroît en per-
fônne : « Venez, lui dit Cléon , mon cher petit peu-
,> pie ; venez; mon pere ». Le vieillard groride 8c
paroît imbécille; les deux concurrens le careffent.
Le peuple incline pour le.vendeur de chair. Cléon
a récours à fes oracles: Agatocrite lui oppofe les
Tiens. Le peuplé confent à les entendre.
La le&urè de ces oracles fait le fujet du troifieme
afte.Le peuple paroît indécis. Cléon, pour derniere
reffource, invite le peuple à un feftin ; Agatocrite
lui en offre autant. Ce régal, où chacun préfente
au peuple fes metsfavoris, remplit le quatrième a£te.
Agatocrite propofe au peuple de fouiller dans les deux
mannes où étoient les viandes ; la fienne fe trouve
vuide ; il a donné au peuple tout ce qu’il avoit : celle
de Cléon eft encore pleine. Le peuple indigné contre
'Cléon, veut lui ôter la couronne pour la donner à
Ton rival ; mais Cléon allégué un oracle de Delphes
qui défigne fon fucceffeur. Il récite l’oracle ; & à chaque
trait de reffemblance il reconnoît qu’il s’accomplit
: car, félon l’oracle, le digne fucceffeur de Cléon
doit être un homme v il, un vendeur de chair, un
voleur, un parjure, un impofteur, &c. Alors Cléon
s’écrie: « Adieu chere couronne, je te quitte à re-
» gr.et; un autre te portera, finon plus grand vo-
» leur, du moins plus fortuné ».
Dans le cinquième atte Agatocrite a rajeuni le
peuple: « Il eft, dit- il, redevenu tel qu’il étoit du
» tems clés Miltiades, & des Ariftides ». Le peuple
rajeuni paroît. Il a perdu la mémoire, il demande
qu’on l’inftruife des (ottifes qu’il a faites du tems de
Cléon ; Agatocrite les lui raconte : le peuple en rougit
; Agatocrite l’interroge fur la façon dont il fe comportera
à l’avenir.il répond: Enperfonnefage. Agato-
crite produit deux femmes qui font les anciennes
alliances.de Lacédémone 8c d’Athenes, que Cléon
crétenoit captives, 8c on leur rend la liberté.
Indépendamment de la groffiéreté, de la baffeffe
& de l’âcreté fatyrique de cette farce, très - utile
bailleurs fans doute dans un état républicain , on
voit ^combien l’intrigue en eff bizarrement tiffue ;
c ’eft la maniéré d’Ariftophane. La comédie du troifieme
-âge, celle de Ménandre,,étoit mieux composée.
Il falloir que Y intrigue en fut bien fimple, puif-
qtie Térence, dont les pièces ne fontpas elles-mêmes
fort intriguées, étoit obligé, en l’imitant, de réunir
deux de Tes fables pour en faire une, & que pour
cela Tes critiques Tappelloient un demi-Ménandre.
Plaute, fi inférieur à Térence du côté de l’élégance,
du naturel & de la vérité des moeurs, eft fu-
périeup à lui du côté de Yintrigue: fon a&ion eft
plus vive ,plus animée & plus féconde en incidens
comiques.
C’eft le genrede Plaute que les Efpagnols femblent
avoir p ris, mais avec un fonds de moeurs différentes,
les Italiens, à l’exemple des Efpagno 1s, & les A nglois,
à l’exemple des uns 8c autres, ont chargé d’incidens
Y intrigue de leurs comédies. Comme eu x, nous avons
été long-tems plus occupés du comique d’incidens,
que du comique de moeurs : des fourberies , des mé-
prifes, des rencontres embarraffantes pour les fripons
ou pour les dupes; voilà ce qui occnpoit la fcene ;
6c Moliere lui-même, dans tes premières pièces, ,
fembloit n’avoir connu encore que ces fources du,
ridicule.
Mais lorfqu’une fois il eut reconnu que c’étoit aux
moeurs qu’il falloit s’attaquer, que la vanité, l’amour
propre, les prétentions manquées 8c les mal-
adreffes des fots, leurs foibleffes, leurs duperies,
leurs méprifes 8c leurs travers, les maladies de l’ef-
prit 8c les vices du caraftere, j’eritends les vices
méprifables, plus importuns que dangereux, étoient I
les vrais objets d’un comique à la fois plaifant 8c fa- I
iutaire ; ce fut à la peinture ÔC à la correction des ]
moeurs qu’il s’attacha férieufement, fubordonnant
Y intrigue aux cara&eres , 8c n’employant les fitua-
tions qu’à mettre en évidence le ridicule humiliant,
qu’il voulôit livrer au mépris. Dès-lors Y intrigue
comique ne fut que le tiffu de ces fituations rifibles,
où l’on s’engage par foibleffe, par imprudence, par
erreur, ou par quelqu’un de ces travers d’efprit,
ou de ces vices d’ame qui font affez punis par leurs
propres bévues, 8c par l’infulte qui les fuit. C’eft
dans cet efprit 8c avec ce grand art que fut tiffue
Y intrigue de Y Avare t de Y Ecole desfemmes, de Y Ecole
des maris, de Géorge Dandin , du Tartuffe, modèles
effrayans, même pour le génie, 8c dont l’efprit 8c
le fimple talent n’approcheront jamais. ( M. Ma r - MONT EL. )
INVENTION, f. f. '(Belles-Lettres. Poéfie.) Pour
concevoir l’objet de la Poëfie dans toute fon étendue
, il faut ôfér confidérer la nature comme préfente
A l'intelligence fuprême. Alors tout ce qui,
dans le jeu des élémens, dans l’organifation des êtres
vivans, animés, fenfibles, a pu concoùrir, foit au
phyfique, foit au moral, à varier lefpe&aciemobile
8c fucceflîf de l’univers, eft réuni dans le même
tableau. Ce n’eft pas tout : à l’ordre préfent , aux
viciflitudès paffées fe joint la chaîne infinie des poflî-
bles, d’après l’effence même des êtres, 8c non-feulement
ce qui e ft , mais ce qui feroit dans l’immenfité
du tems & de l’efpace,fila nature développoit jamais
le tréfor inépuifable des germes que le Tout-puiflànt
a renfermé dans fon fein. C’eft ainfi que Dieu voit la
nature ; c’eft ainfi que, félon fa foibleffe, le poète
doit la contempler. S’emparer des caufes fécondés ;
les faire agir dans fa penfée, félon les loix de leur
harmonie; réalifer ainfi les poflibles ; raffembler les
débris du paffé; hâter la fécondité de l’avenir ; donner
une exiftenceapparente 8c fenftbleàce qui n’eft encore
8c ne fera peut-être jamais que dans Teffence idéale
des chofes : c’eft ce qu’on appelle inventer. Il ne faut
donc pas être furpris fi l’on a regardé le génie poétique
comme une émanation de la divinité même,
ingenium cu ifit, cui mens divinhr ; 8c fi l’on a dit de
la Poéfie qu’elle fembloit difpofer les chofes avec le
plein pouvoir d’un Dieu : videtur fane res ipfas velut
aller Deus condere. On voit par-là combien le champ
de la fiétion doit être vafte, 8c combien l’inventeur
qui s’élance dans la carrière des poflibles laiffe loin
de lui l’imitateur fidele 8c timide qui peint ce qu’il a
fous les yeux.
Ramenons cependant à la vérité pratique ces fpé-
culations tranfcendantes. Tout ce qui eft poflible,
n’eft pas vraifemblable : tout ce qui eft vraifembla-
b le , n’eft pas intéreffant. La vraifemblance confifte
à n’attribuer à la nature que des procédés conformes
à fes loix 8c à fes facultés connues ; or cette pré-
fcience des poflibles ne s’étend guère au-delà des
faits. Notre imagination devancera bien la nature à
quelques pas de la réalité ; mais à une certaine
diftance, elle s’égare 8c ne reconnoît plus le chemin
qu’on lui fait tenir. D ’un autre côté, rien ne
nous touche que ce qui nous approche , & l’intérêt
tient aux rapports que les objets ont avec nous-
mêmes : or des poflibles! trop éloignés n’ont plus
avec nous aucun rapport, ni de reffemblance ni d’influence.
Ainfi le génie poétique ne fut-il pas limité
par fa propre foibleffe 8c par le cercle étroit de fes
moyens, il le feroit par notre manière de concevoir
8c de fentir. Le fpeftacle qu’il donne eft fait pour
nous ; il doit, pour nous plaire , fe mefurer à
la portée de nqtre vue.. On reproche à Homere
d’avoir fait des hommes de fes dieux ; au moins
il ne devdit pas en faire des fcélérats. Ovide,
pour nous rendre fenfible le palais du Dieu de la 1
lumière , n’a-t-il pas été obligé de le bâtir avec des
grains de notre fable Jes plus luifans qu’il a pu
choifir ?
choifir r Inventer , ce n’eft donc pas fejetter dans des
poflibles auxquels nos fens ne peuvent atteindre ;
c’eft combiner diversement nos perceptions, nos
a f f e cH o n s , ce qui fe.paffe au milieu de nous,, autour
de nous, en nous-mêmes.
Le froid copifte, je l’avoue, ne mérite pas le nom
à'inventeur.; mais celui qui découvre, faifit, développe
dans les objets ce que n’y voit pas le commun
des hommes , celui qui compofe un tout idéal intéreffant
8c nouveau d’un affemblage de chofes connues,
ou qui donne à un toutexiftant une grâce, une
beauté nouvelle, celui-là, dis-je, eft poète , ou
Corneille 8c Homere ne le font pas.
L’hiftoire, la fcene du monde, donne quelquefois
les caufes fans les effets , quelquefois les effets fans
les caufes , quelquefois les caufes 8c les effets fans
les moyens , plus rarement le„ tout enfemble. Il eft
certain que plus elle donne, moins elle laiffe de
gloire au génie. Mais en fuppofant même que le tiflu
des événemens foit tel , que la vérité dérobe à la
fldion le mérite de l’ordonnance ; pourvu que le
poète s’applique à donner aux moeurs, aux defcrip-
tions , aux tableaux qu’il imite , cette vérité intéref-
fante qui perfuade , touche , captive 8c faifit l’ame
des leéieurs ; ce talent de reproduire la nature , de
la rendre préfente aux yeux de l’efprit, fuffira pour
élever l’imitateur au-deffus de l’hiftorien, du philo-
fophe, 8c de tout ce qui n’eft pas poète.
Si la matière de la poéfie étoit la même que celle de
thifioire , dit Caftelvetro , elle ne feroit plus une reffemblance
, mais la réalité même ; 8c c ’eft d’après ce
fophifme qu’il refufe le nom de poète à celui qui,
comme Lucain , s’attache à la vérité hiftorique.
Affurément fi le poète ne faifoit dire 8c penfer à
les perfonnâges que ce qu’ils ont dit & penfé réellement
, Qu félon l’hiftoire ; par exemple , fi l’auteur
de Romefauvée avoit mis, dans la bouche de Catilina
les harangues même de Salufte , 8c dans la bouche
du conful des morceaux pris de fes oraifons , il ne
feroit poète que par le ftyle. Mais f i , d’après un
caraûere connu dans l’hiftoire ou dans la fociété,
l’auteur invente les idées, les fentimens, le langage
qu’il lui attribue ; plus il perfuade qu’il ne feint pas,
8c plus il excelle dans l’art de feindre. Nous croyons
tous avoir entendu ce que difent les a&eurs de Molière,
nous croyons les avoir connus; c’eft le pre*
ftige de fa compofition , & c’eft à force d’être poète
qu’il^fait moire qu’il ne l’eft pas. Montagne donne
le même éloge à Térence. «Je le trouve admirable,
» dit-il , à représenter au v if les mouvemens de
» l’ame & la condition de nos moeurs. A toute heure
» nos a étions me rejettent à lui. Je ne puis le lire f y
» fouvent que je n’y trouve quelque beauté & grâce
» nouvelle ».
Ainfi les fujets les plus favorables comme les
plus critiques , font quelquefois ceux que la nature
a placés le plus près de nous, mais que nous voyons,
comme on d it , fans les v o ir , 8c dont l’imitation
réveille en nous le fouvenir par l’attention qu’elle
attire. Je dis, les plus favorables , parce que la reffemblance
en étant plus fenfible, 8c le rapport avec
nous-mêmes plus immédiat, plus touchant, nous
nous y intéreffons davantage : je dis aufli, les plus
critiques, parce que la comparaifon de l’objet avec
l'image étant plus facile, nous Ifemmes des juges
plus éclairés & plus féveres de la vérité de l’imitation.
Ce qu’appréhendent les fpéculateurs, c’eft que la
gloire de \ invention ne manque au génie du poète ;
8c afin qu’il ne foit pas dit qu’il n’a rien mis du fien
dans fa compofition, ils l’ont obligé à ne prendre
des hiftoriens & des anciens poètes que les faits , &
à changer les circonftances des tems, des lieux &
des perfonnes. C eu à ce déguifement facile 8c vain
Tome III.
qu’on attache le mérite de l'invention, le triomphe de
la poéfie; & tandis qu’on attribue à un plagiaiteadroit
toute la gloire du poète , on refufe le titre dtpointe
aux géorgiques de Virgile , & à tout ce qui rie traité
que des fciences 8c des arts. Non v’ havendo ilpoeta ■
parte nmna per laquait f i poffa vantare d’ effere poèta, dit
Caltelvetro, quand même il feroit inventeur, ajbute-
> « car alors il n auroit fait que découvrir la vérité
» qui étoit dans la nature des chofes. Il feroit artifte
» philofophe excellent, mais il ne feroit pas poète »’
Voilà ou conduit une équivoque de mots, quand les
idées n’ont pour appui qu’une théorie vague &con-
fufe. « La poéfie eft uneréffemblance ; donc tout ce
» qui a fon modèle dans î’hiftoire ou dans la nature*
», n eft pas de la poéfie». Ainfiraifonne Caftelvetro*
Quintilien avoit le même préjugé, quand il croyoit
devoir placer Lucain au nombre des rhéteurs plutôt
qu’au nombre des poètes. Scaliger s’y eft mépris
d’une autre façon, en n’accordant la qualité de poète
à Lucain que parce qu’il a écrit en vers, & en faveur
de quelques incidens merveilleux dont ii a orné fon
poème. Ces critiques auroient du voir que la diffi ;
culté n’eft pas de déplacer & de combiner diverfe-
ment des faits arrivés mille fois, comme un maffaere,
une tempête, un incendie , une bataille , & tous ces
événemens fi communs dans les annales de- la maî-
heureufe humanité ; mais de les rendre préfens à la
penfée par une peinture fidellè 8c vivante. C ’eft-là lé
vrai talent du poète & le mérite de Lucain. II ne falloit
pas beâufcoiip de génie pour imaginer que la
de Caton , quil avoit cédée à Hortenfius,
vînt après la mort de celui-ci fupplier Caton de là
reprendre ; mais que l’on me cite dans l’antiquité iin
tableau d’une ordonnance plus belle & plusfimple ,
d’un ton de couleur plus rare 8c plus vrai , d’uné
expreflion plus naturelle 8c plus finguliere en même,
tems que ce trifte 8c pieux hymenée.
C’eft aufli le talent de peindre qui caraftérife le
poème didaélique , 8c qui le diftingue de tout ce qui
ne fait que décrire fans imiter.
Le Taffe fe laiffant aller au préjugé que je viens
de combattre, définit la poefie, l'imitation des chofes
humaines, 8c fe trouve par-là obligé d’en exclure
un des plus beaux morceaux de Virgile : ne poètà
Firgilio deferivendoeï i cofiumi , e U leggi, e le guerre
deil’ dpi. Mais bientôt il franchit les limites qu’il
vient de preferire à la Poéfie, & lui donne pour
objet la nature entière. Voilà donc les géorgiques
de Virgile rétablies au rang des poèmes. Et le moyen
de leur refufer ce titre , quand même elles feroient'
réduites aux préceptes les plus fimplés, & n’y eût-il
que la maniéré dont ces préceptes y font tracés ! Que
Virgile preferive de laiffer fécher au foleil les herbes
que le foc déracine ,
Pulverulenta coquat rnaturis fôlibus oeflas ,
d’enlever le chaume après la moiffon,
Sufiuleris fragiles calamosfilvamque fonantem ;
de le brûler dans le champ même,
Atque levém fiipulam crepitantibuS urere flammis\
de faire paître les bleds en herbe, s’ils pouffent avec
trop de vigueur,
Luxuriem fegetum tenerâ depafeit in herbdi
Quel coloris, quelle harmonie ! Voilà cette poéfie
de ftyle, cette invention de détail qui feule mérite-
roit aux géorgiques le nom de poème inimitable ; 8c fi
Caftelvetro demande à quel titre ? Je répondrai ,
parce que tout s’y peint ; & fi ce n’eft point a f f e z des
images détachées , je lui rappellerai ces deferiptions
lî bëlles du printems , de la vie ruftique, des amours
des animaux, &c. tableaux peints d’après la nature.
M M m m