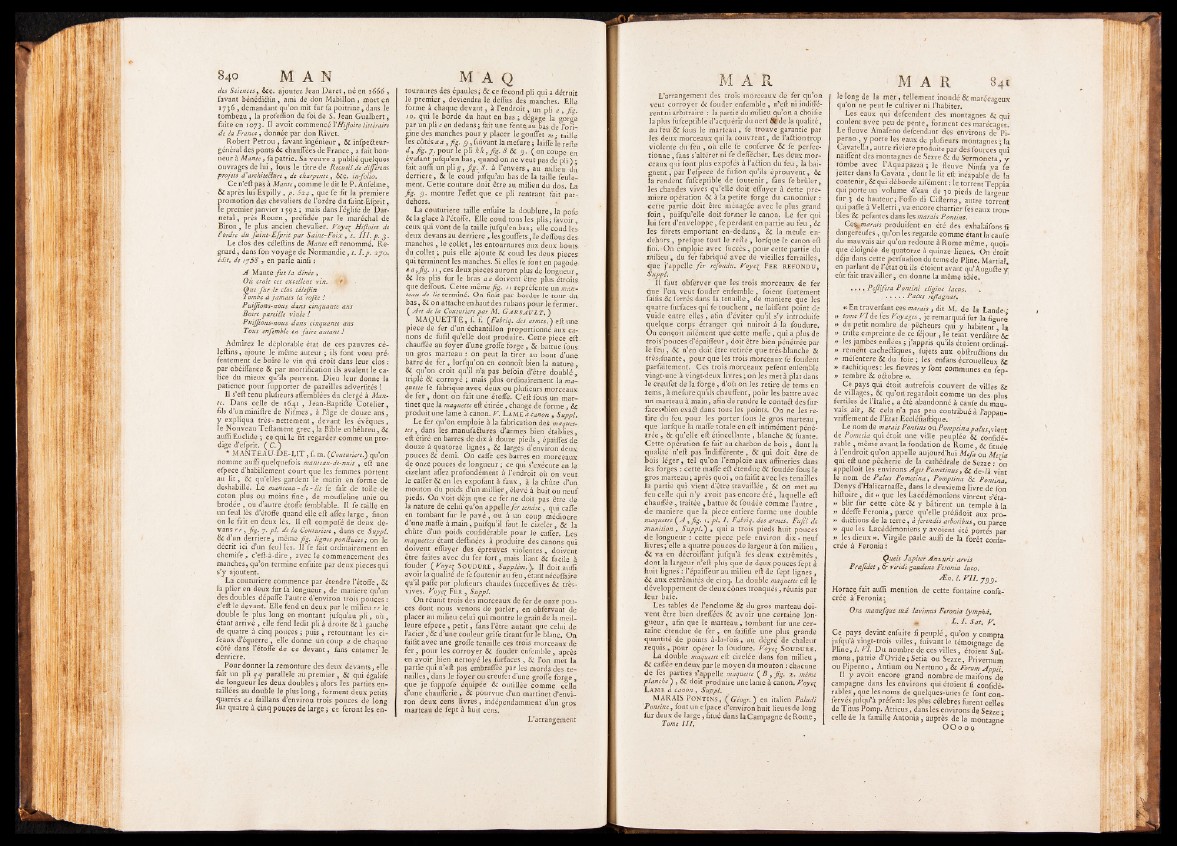
8 4 ° M A N
des Sciences y & c . ajoutez Jean Daret, né en 1666 ,
favant bénédiftin, ami dé don Mabillon, mort en
1736 , demandant qu’on mît fur fa poitrine, dans le
tombeau, la profeftion de foi de S. Jean Gualbert,
Faite en 1073. Ë avoit commencé VHifioire Littéraire
de la France, donnée par don Rivet.
Robert Petrou, favànt ingénieur, & infpedeur-
général des ponts & chauffées de France, a fait honneur
à Mante, fa patrie. Sa veuve a publié quelques
ouvrages de lu i, fous le titre de Recueil de différens
projets d'architecture , de charpente , &c. in-folio.
Ce n’eft pas à Mante, comme le dit le P. Anfelme,
& après lui Expilly, p. S24 , que fe fit la première
promotion des chevaliers de l’ordre du faint-Efprit,
le premier janvier 1592 ; mais dans l’églife de Dar-
netal, près Rouen, préfidée par le maréchal de
Biron, le plus ancien chevalier. Foye£ ïïijioirc de
Cordre du faint-Êfprit par Saint-Foix, t. III. p. 3.
Le clos des céleftins de Mante eft renommé. Regnard,
dans fon voyage de Normandie, t. I.p. 270*
édit, de 1768 -, en parle ainfi i
A Mante fut la dînée »
Ou croit cet excellent vin. ?. 0$
Que fur le clos célefiin
Tombe à jamais la rofée !
P ui(fions-nous dans cinquante ans
Boire pareille vinée !
Puiffions-nous dans cinquante ans
Tous enfemble en faire autant !
Admirez le déplorable état de ces pauvres céleftins
, ajoute le même auteur ; ils Font voeu pré-
fentement de boire le vin qui croît dans leur clos :
j>ar obéiffance & par mortification ils avalent le calice
du mieux qu’ils peuvent. Dieu leur donne la
patience pour fupporter de pareilles adverfités !
Il s’eft tenu plufieurs affemblées du clergé à Mante.
Dans celle de 16 41 , Jean-Baptifie Cotelier,
fils d’unminiftre de Niimes, à l’âge de douze ans,
y expliqua très-nettement, devant les évêques,
le Nouveau Teftament grec, la Bible en hébreu, &
aufti Euclide ; ce qui le fit regarder comme un prodige
d’efprit. ( C. )
* MANTEAU-DE-I^IT , f . m. (Couturière.) qu’on-
nomme aufti quelquefois manteau-de-nuit , eft une
efpece d’habillement court que les femmes portent
au lit , & qu’elles gardent le matin en forme de
deshabillé. Le manteau - de - lit fe fait de toile de
coton plus ou moins fine, de mouffeline unie ou
brodée , ou d’autre étoffe femblable. Il fe taille en
un feul lès d’étoffe quand elle, eft affez large, finon
On le fait en deux lès. II eft compofé de deux de-
vans rr , fig. y. pl. de la Couturière , dans ce Suppl.
& d’un derrière, même fig. lignes ponctuées ; on le
décrit ici d’un feul lès. Il fe fait ordinairement en
chemife , c’eft-à-dire , avec le commencement des
manches, qu’on termine enfirite par deux pièces qui
s’y ajoutent.
La couturière commence par étendre l’étoffe, &
la plier en deux fur fa longueur, de maniéré qu’un
des doubles dépaffe l’autre d’environ trois pouces :
c’eft le devant. Elle fend en deux par le milieu rr le
double le plus long en montant jufqu’au pli, o îi,
étant arrivé , elle fend ledit pli à droite & à gauche
de quatre à cinq pouces ; puis , retournant les ci-
feaux d’équerre , elle donne un coup a de chaque
côté dans l’étoffe de ce devant, fans entamer le
derrière.
Pour donner la remonture des deux devants, elle
fait un pli qq parallèle au premier , & qui égalife
dé longueur les deux doubles % alors les parties entaillées
au double le plus long, forment deux petits
quarrés a a faillans d’environ trois pouces de long
fur quatre à cinq pouces de large ; ce feront les en-
M A Q
tournures des épaulés; & ce fécond pli qui a détruit
le preipier , deviendra le deffus des manches. Elle
forme à chaque devant, à l’endroit, un pli a , fig.
10. qui le borde du haut en bas ; dégage la »orge
par un pli c en dedans ; fait une fente. au bas d e l’ori-
gine des manches pour y placer le gouffet m; taille
les côtés a a , fig. c), fuivant la mefure ; laiffe le refte.
dt > fië' 7; Pour le pli h h , fig. 8 & 9 . (on coupe en
évafant jufqu’en bas, quand on ne veut pas de pli) ;
fait aufti un pli#, fig. 8. à l’envers , au milieu du
derrière, & le coud jufqu’au bas de la taille feulement.
Cette couture doit être au milieu du dos. La
fig. 5). montre l’effet que ce pli rentrant fait par-
dehors.
La couturière taille enfuite la doublure, la pofe
& la glace à l’étoffe. Elle coud tous les plis ; favoir,
ceux qui vont de la taille jufqu’en bas ; elle coud les
deux devans au derrière, les gouffets, le deffous des
manches , le collet, les entournures aux deux bouts
du collet ; puis elle ajoute & coud les deux pièces
qui terminent les manches. Si elles fe font en pagode.
* a , fig. 1 1 , ces deux pièces auront plus de longueur,
& les plis fur le bras a a doivent être plus étroits,
que deffous. Cette même fig. 11 repréfente un mdn-
teau -d e -lit terminé. On finit par border le tpur du
bas, & on attache en haut des rubans pour le fermer.
( A r t de la Couturière p ar M . G a RSA ITL T. )
MAQUETTE, f. f. (Fabriq, des armes.') eft une
piece de fer d’un échantillon proportionné aux canons
de fufil qu’elle doit produire. Cette piece e ft .
chauffée au foyer d’une groffe forge, & battue fous
un gros marteau : on peut la tirer au bout d’une
barré de fe r , lorfqu’on en connoît bien la nature,
& qu’on croit qu’il n’a pas befoin d’être doublé ,
triplé & corroyé ; mais plus ordinairement la maquette
fe fabrique avec deux ou plufieurs morceaux
de f e r , dont on fait une étoffe. C’eft fous un martinet
que la maquette eft étirée, change de forme , &
produit une lame à canon. V. L a m e à canon , Suppl.
Le fer qu’on emploie à la fabrication dei maquettes
, dans les .manufa&ures d’armes bien établies,
eft étiré en barrés de dix à douze pieds , épaiffesde
douze à quatorze lignes, & larges d’environ deux
pouces & demi. On caffe c es barres en morceaux
de onze pouces de longueur ; ce qui s’exécute en le
cizelant affez profondément à l’endroit oii on veut
le caffer & en lés expofant à faux, à la chute d’un
mouton du poids d’un millier, élevé à huit ou neuf
pieds. On voit déjà que ce fer ne doit pas être de
la nature de celui qu’on appelle fer tendre , qui caffe
en tombant fur le p a vé , ou à un coup médiocre
d’une maffe à main, puifqu’il faut le cizeler, & la
chute d’un poids confidérable pour le caffer. Les
maquettes étant deftinées à produire des canons qui
doivent effuyer des épreuves violentes , doivent
être faites avec du fer fort, mais liant & facile à
fouder (Foye^ SOUDURE, Supplém.). II doit aufti
avoir la qualité de fe foutenir au feu, étant néceffaire
qu’il paffe par plufieurs chaudes fuccefîives & très-
vives. Foye[ F e r , Suppl. .
On réunit trois des morceaux de fer de onze pouces
dont nous v.enons de parler, en obfervant de
placer au milieu celui qui montre le grain de la meilleure
efpece, petit, fans l’être autant que celui de
l’acier d’une couleur grife tirant fur le blanc. On
faifit avec une groffe tenaille ces trois morceaux de
fe r , pour les corroyer & fouder enfemble, après
en avoir bien nettoyé les furfaces , & l’on met la
partie qui n’eft pas embraflee par les mords des tenailles
, dans le foyer ou creufet d’une groffe forge ,
que je fuppofe équipée & outillée comme celle
d’une chaufferie , & pourvue d’un martinet d’environ
deux cens livres, indépendamment d’un gros
marteau de fept à huit cens.
L ’arrangement
M A' R
L’arrangement des trois morceaux de fer qu’on
veut corroyer &c fouder enfemble , n’eft ni indifférent
ni arbitraire : la partie du milieu qu’on a choifie
la plus fufceptible d’acquérir du nèrf dt de la qualité,
au feu & fous le marteau, fe trouve garantie par
les deux morceaux qui la couvrent, de l’a&iontrop
violente du feu , oii elle fe conferve & fe perfectionne
, fans s’altérer ni fe deffécher. Les de‘ux morceaux
qui font plus expofés à l’a&ion du feu, la baignent
, par l’efpece de fufion qu’ils éprouvent, &
la rendent fufceptible de foutenir, fans febrCiler,
les chaudes vives qu’elle' doit effuyer à dette première
opération & à la petite forge du canonnier:
cefte partie doit être ménagée avec le plus grand
foin , pfciifqu’elle doit former le canon. Le Fer qui
lui fert d’enveloppe, fe perdant en.partiesu feu , &
lès forets emportant en-dedans, & la meule en-
dehors , prefque tout lë refte , lorfque le canon eft
fini.-On emploie avec fuccès , pour cette partie du
milieu , du fer fabriqué avec de vieilles ferrailles,
que j’appelle fer refondu. Foye[ F e r REFONDU,
s HPPl- -
Il faut obfervër que les'trois morceaux de fer
que l’on veut fouder enfemble, foient fortement
faifis & ferrés dans la tenaille, de maniéré que les
quatre furfaces qui fe touchent, ne laiffent point de
yiiide entre elles, afin d’éviter qu’il s’y introduife
quelque corps étranger qui nuiroit à la foudure.
On conçoit aifément que cette maffe, qui a plus de
trois’pouces d’épaiffeur, doit être bien pénétrée par
le feu , & n’en doit être retirée que très-blanche &
trèsTfuante, pour que les trois morceaux fe' foudent
parfaitement. Ces trois morceaux pefent enfemble
vingt-une à vingt-deux livres ; on les met à plat dans
le creufet de la forge, d’oîi ori les retire de tems en
îems, à mefure qu’ils chauffent, pour les battre avec
un marteau à main, afin de rendre le conta# des fur-
faces*bien exa# dans tous les points. On ne les retire
du feu pour les porter fous le gros marteau,
que lorfque la maffe totale en eft intimément pénétrée
, & qu’elle eft étincellante , blanche & fuante.
Cette operation fe fait au charbon de bois, dont la
qualité n’eft pas Indifférente, & qui doit être de
bois léger, tel qu’on l’emploie aux afïïneries dans
les forges : cette maffe eft étendue & foudée fous le
gros marteau ; après quoi, on faifit avec les tenailles
la partie qui vient d’être travaillée, & on met au
feu celle qui n’y avoit pas encore é té, laquelle eft
chauffée, traitée , battue & foudée comme l’autre ,
de maniéré que la piece entière forme une double
maquette ( A , fig. 1. pl. I. Fabriq. des armes. Fufil de
munition y Suppl.) , qui a trois pieds huit pouces
de longueur : cette piece pefe environ dix - neuf
livres; elle a quatre pouces de largeur à fon milieu,
& va en décroiffant jufqu’à fes deux extrémités,
dont la largeur n’eft plus que de deux pouces fept à
huit lignes : l’épaiffeur au milieu eft de fept lignes,
& aux extrémités de cinq. La double maquette eft le
développement de deux cônes tronqués, réunis par
leur bafe.
Les tables de l’enclume & du gros marteau doivent
être bien drefféés & avoir une certaine longueur
, afin que le marteau, tombant fur une certaine
étendue de fer , en faififlè une plus grande
quantité de points à-la-fois, au dégré de chaleur
requis, pour opérer la foudure. Foye[ S o u d u r e .
La double maquette eft cizelée dans fon milieu >
& caffee en deux parle moyen du mouton : chacune
de fes parties s’appelle maquette { B , fig. 2. même
planche ) , & doit produire une lame à canon. Foye{
L a m e a canon , Suppl.
MARAIS Po n t i n s ,.( Géogr. ) ‘ en italien Paludi
Pontine, font un efpace d’environ huit lieues de long
fur deux de large, fitué dans la Campagne de Rome,
Tome I I I ,
M A R 841
I le long de la mer, tellement inondé & marécageux
qu’on ne peut le cultiver ni l’habiter.
Les eaux qui defeendent des montagnes & qui
coulent avec peu de pente , forment ces marécages.
Le fleuve A'mafeno defeendant des environs de Pi-
perno, y porte les eaux de plufieurs montagnes ; la
Cavatella, autre riviere produite par des fources qui
naiffent des montagnes de Sezze & de Sermon eta, y
tombe avec l’Aquapazza ; le fleuve Ninfa va fe
jetter dans la Cavata , dont le lit eft incapable de la
contenir, & qui déborde aifément : le torrent Teppia
qui porte .un volqme d’eau de 30 pieds de largeur
fur 3 de hauteur; Foffo di Cifterna, autre torrent
qui paffe à Velletri, va encore charrier fes eaux troubles
& pefantes dans les marais Pontins.
CeSfpnarais produifent en été des exhalaifons fi
dangereufes , qu’on les regarde comme étant la caufe
du mauvais air qu’on redoute à Rome même, quoique
éloignée de quatorze à quinze lieues. On étoit
déjà dans cette perfuafion du tems de Pline. Martial,
en parlant deTétât oit ils étoient avant qu’Augufte y
eût fait travailler, en donne la même idée. 1
. . . . Pefiifera Pontini eligine lacus. -,
- ..........Palus refiagnat.
« En traverfant ces marais , dit M. de la Lande '
» tome F I de fes Viyages, je remarquai fur la figure
» du petit npnibre de pêcheurs qui y habitent la
» trifte empreinte de ce féjour , le teint verdâtre &c
» les j^ b e s enflées ; j’appris qu’ils étoient ordinai-
» rement cache&iques, fujets aux obftruéfions du
» mefentere & du foie ; les enfans é.crouelleux &
» rachitiques : les fievres y font communes en fep-
» tembre & o&obre ».
Ce pays qui étoit autrefois couvert de villes &
de villages, & qu’ort regardoit comme un des^plus
fertiles de l’Italie, a été abandonné à caufe du mauvais
air, & cela n’a pas peu contribué à l’appau-
vriffement de l’Etat Eccléfiaftique. “
Le nom de marais Pontins ou, Pomptinanpalus, vient
de Pometia cp\i étoit une ville peuplée & éonfidé-
rable , même avant la fondation de Rome & fituée
à l’endroit qu’on appelle aujourd’hui Mefa ou Méfia
qui eft une pêcherie de la cathédrale de Sezze : on
appelloit les environs AgerPometinus> & de-là vint
le nom de Palus Pometina, Pomptina & Pontina.
Denys d’Halicarnaffe, dans le deuxieme livre de fon
hiftoire, dit « que les Lacédémoniens vinrent s’éta-
» blir fur cette côte & y bâtirent un temple à la
» déeffe Feronia, parce qu’elle préfidoit aux pro-
» durions de la terre, à ferendis arboribus, ou parce
» que les Lacédémoniens y avoient été portés par
» les dieux ». Virgile parle aufti de la forêt confa-
crée à Feronia :
Quels Jupiter Anxuris arvis
Prcefidet, 6* viridi gaudens Feronia luco.
Æ n . l .F l I . 799 :
Horac.e fait aufti mention de cette fontaine confa-
crée à Feronia:
Ora manufque tuâ lavimus Feronia lymphâ.
« L. I. Sat. F.
Ce pays devint enfuite û peuplé, qu’on y compta
jufqu’à vingt-trois villes, fuivant le témoignage de
Pline, l. VI. Du nombre de c es villes, étoient Sul-
mona, patrie d’Ovide ; Setia ou Sezze, Privernum
ou Piperno , Antium ou Nertuno , & Forum Appii.
Il y avoit encore grand nombre de maifons de
campagne dans les environs qui étoient fi confidé-
rables , que les noms de quelques-unes fè font con-
fervés jufqu’à préfent: les plus célébrés furent celles
de Titus Pomp. Attiçus, dans les environs de Sezze *
celle de la famille Antonia, auprès de la montagne
O O 0 0 0
i i m
wmmKÊmtSÊmaÊKammmmÊÊÊmÊ^mMmÊÊSÊÊÊm*g!mS£mÊ!»^