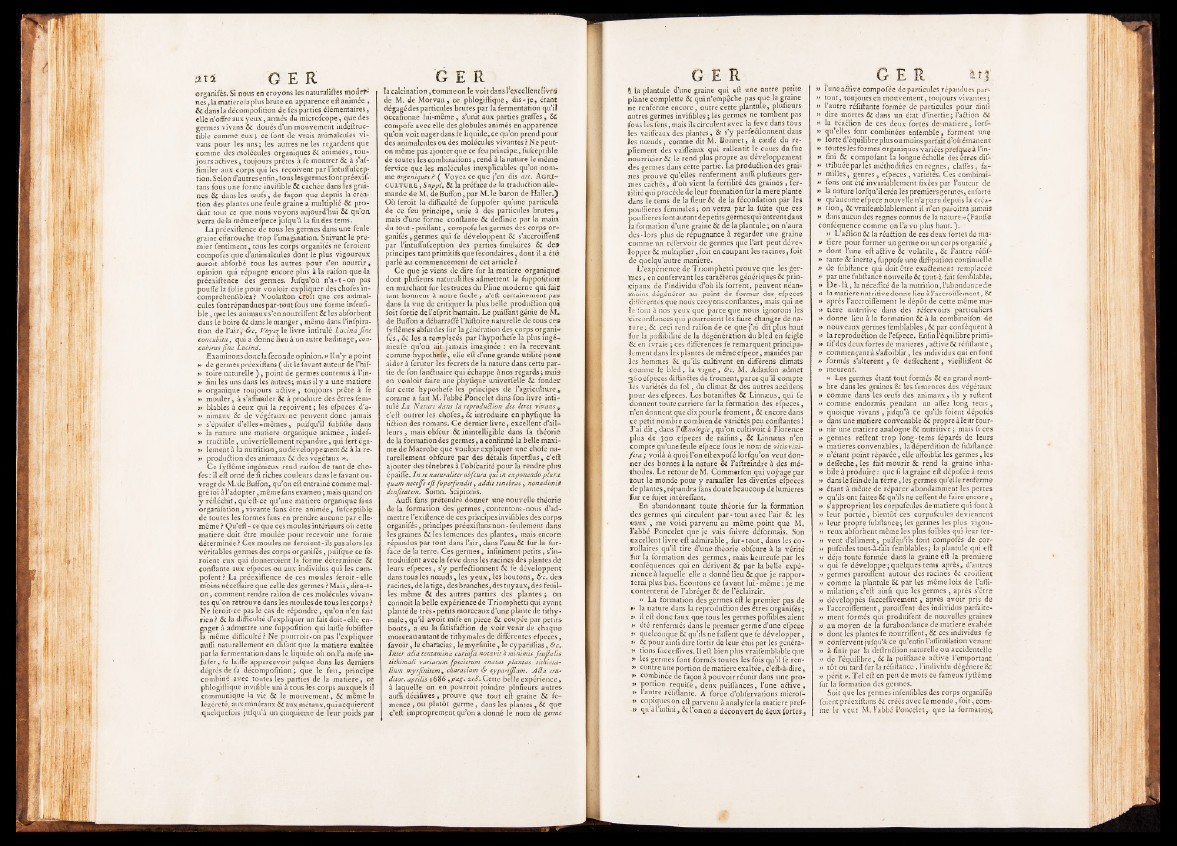
organifés. Si nous en croyons les naturaliftes triodef-
nés, la matière la plus brute en apparence eft animée ,
& dans la décompofition de fes parties élémentaires,
elle n’offre aux y eux, armés du microücope, que des
germes vivans ôc doués d’un mouvement indeftruc-
tible comme eux ; ce font de vrais animalcules vi-
vans pour les uns ; les autres ne les regardent que
comme des molécules organiques Ôc animées, tou*»
jours actives, toujours prîtes à fe montrer 8c à s’af-
fimiler aux corps qui les reçoivent par l’intuffufcep-
tion. Selon d’autres enfin, tous les germes font préexif-
tans fous une forme invifible ôc cachée dans les graines
& dans les oeufs, de façon que depuis la création
des plantes une feule graine a multiplié 8c produit
tout ce que nous voyons aujourd’hui 8c qu’on
verra delà même efpece jufqu’à la fin des tems.
La préexiftence de tous les germes dans une feule
graine effarouche trop l’imagination. Suivant le premier
fentimenr, tous les corps organifés ne feroient
compofés que d’animalcules dont le plus vigoureux
auroit abforbé tous lés autres pour s’en nourrir,
opinio'n qui répugne encore plus à la raifon que -la
préexiftence des germes. Jufqu’oii n’a -1 -on pas
pouffé la folie pour vouloir expliquer des chofes in-
compréhenfibles? Voolafton cfoit que ces animalcules
font répandues partout fous une forme infenfi-
b le , que les animaux s’en noutriffent ôc les abforbent
dans le boire 8c dans le manger, même dans l’inlpira-
tion de l’air( &cf Voye^ le livre intitulé Lucina fine
concubitu, qui a donné lieu à un autre badinage, con-
cubitusfine Lucind.
Examinons donc la féconde opinion. » Il n’y a point
» de germes préexiftans ( dit le favant auteur de l’hif-
» toire naturelle ) , point de germes contenus à l’in-
» fini les uns dans les autres; mais il y a une matière
» organique toujours aétive, toujours prête à fe
» mouler, à s’afluailer & à produire des êtres fem-
» hlables à ceux qui la reçoivent ; les efpeces d’a-
» nimaux Ôc de végétaux» ne peuvent donc jamais
» s’épuifer d’ellesr-mêmes , puifqu’il fubfifte dans
» la nature une matière organique animée, indef-
» trudlible, univerfellement répandue, qui fert éga-
» le ment à la nutrition, au développement & à la re-
» production des animaux 8c des végétaux ».
Ce fyftême ingénieux rend raifon de tant de chofes
: il eft orné de fi riches couleurs dan9 le favant ouvrage
de M. de Buffon, qu’on eft entraîné comme malgré
loi à l’adopter, même fans examen ; mais quand on
y réfléchit, qu’eft» ce qu’une matière organique fans
organifation, vivante fans être animée, fufceptibfé
de toutes les formes fans en prendre aucune par elle-
même ? Qu’eft - ce que ces moules intérieurs oh cette
matière doit être moulée pour recevoir une forme
déterminée? Ces moules ne feroient-ils pas alors les
véritables germes des corps organifés, puifque ce feroient
eux qui donneroient la forme déterminée 8c
confiante aux efpeces ou aux individus qui les com-
pofent? La préexiftence de ces moules feroit-elle
moins néceffaire que celle des germes ? Mais, dira-t-
on, comment rendre raifon de ces molécules vivantes
qu’on retrouve dans les moules de tous les corps ?
Ne feroit-ce pas le cas de répondre, qu’on n’en fait
rien ? & la difficulté d’expliquer un fait doit-elle en- tager à admettre une fuppofition qui laiffe fubfifter
i même difficulté ? Ne pourroit-on pas l’expliquer
auffi naturellement en difant que la matière exaltée
parla fermentation dans le liquide où on.l’a mife in-
fufer, fe laiffe appercevoir jufque dans les derniers
•dégrés de fa décompofition ; que le feu , principe
combiné avec toutes les parties de la matière, ce
phlogiftique invifible uni à tous les corps auxquels il
communique la vie 8c le mouvement, 8c même la
légéreté, aux minéraux 8c aux métaux, qui acquièrent
quelquefois jufqu’à un cinquième de leur poids par
ta calcination, comme on le voit dans l’excellent lîvfei
de M. de Morvau, ce phlogiftique, d is -je , étant
dégagé des particules brutes par la fermentation qu’il
occafionne lui-même, s’unit aux parties graffes, ôc
compofe avec elle des globules animés en apparence
qu’on voit nager dans le liquide, ce qu’on prend pour
des animalcules ou des molécules vivantes ? Ne peut-
on même pas ajouter que ce feu principe, fufceptible
de toutes les combinaifons, rend à la nature le même
fervice que les molécules inexplicables qu’on nomme
organiques? ( Voyez ce que j’en dis art. AgrJ-
culturr t Suppl. 8c la préface de la traduûion allemande
de M. de Buffon, par M. le baron de Haller.)
Où feroit la difficulté de fuppofer quune particule
de ce feu principe, unie à des particules brutes*
mais d’une forme confiante 8c deffinée par la main
du tout - puiffant, compofe les germes des corps organifés
, germes qui fe développent 6c s’accroiffenï
par l’intuffufcepdon des parties fimilaires 6c de»
principes tant primitifs que fecondaires, dont il a cto
parlé au commencement de cet article ?
Ce que je viens de dire fur la matière organique
dont plufieurs naturaliftes admettent la fuppofitioiT
en marchant fur les traces du Pline moderne qui fait
tant honneur à notre fiecle, n’eft certainement pas
dan9 la vue de critiquer la plus belle production qui
foit fortie de l’efprit humain. Le puiffant génie de M.
de Buffon a débarraffé t’hiftoire naturelle de tous cesr
fyftêmes abfurdes fur la génération des corps organi>
fes , 6c les a remplacés par l’hypothele la plus ingé-<
nieufe qu’on ait jamais imaginée : en la recevant
confine hypothefè, elle eft d’une grande utilité pou»
aider à feruter les fecrets de la nature dans cette partie
de fon fan&uaire qui échappe à nos regards ; mais
en vouloir faire une phyfique universelle 6c fonder
fur cette hypothefe les principes de l’agriculture,
comme a fait M. l’abbé Poncelet dans fon livre intitulé
La Nature dans la reproduction des êtres vivans
c’eft outrer les chofes, 6c introduire en phyfique la
fiction des romans. Ce dernier livre, excellent d’ailleurs
, mais obfcur 6c inintelligible dans fa théorie
de la formation des germes, a confirmé la belle maxime
de Macrobe que vouloir expliquer une chofe naturellement
obfcure par des détails fuperflus, c’eft
ajouter des ténèbres à l’obfcurité pour la rendre plus
épaiffe. In re naturaliter obfcura qui in exponendo plura.
quant necejje efi fuperfundit, addit tenebras , nonadimif
denfitatem. Somn. Seipionis.
Auffi fans prétendre donner une nouvelle théorie
de la formation des germes, contentons-nous d’admettre
l’exiftence de ces principes invifibles des corps
organifés, principes préexiftans non - feulement dans
les graines 6c les femences des plantes, mais encore
répandus par tout dans l’air, dans l’eau 6c fur la fur-
face de la terre. Ces germes, infiniment petits, s’in-
troduifent avec la feve dans les racines des plantes de
leurs efpeces, s’y perfectionnent 8c fe développent
dans tous les noeuds, les y eu x, les boutons, &c. des
racines, de la tige, des branches, des tuyaux, des feuilles
même 6c des autres parties des plantes ; on
connoît la belle expérience de Triomphetti qui ayant
planté de très-petits morceaux d’une plante de tithy-
male, qu’il aVoit mife en piece 6c coupée par petits
bouts, a eu la fatisfaftion de voir venir de chaque
morceau autant de tithymales de différentes efpeces,
favoir, le characias, le myrfinite, le cypariffias,
Inter alia tentamina curiofa notavit è rninimis frufiulis
tithirnali variarttm fpecierum enatas plantas tithinui-
lium myr(initem , characiam G* eypan (fiant. A cia eru-
ditor. aprilis 1686,pag. 118. Cette belle expérience,
à laquelle on en pourroit joindre plufieurs autres
auffi décifives, prouve que tout eft graine 6c fe-
mence , ou plutôt germe, dans les plantes, 6c que
, c’eft improprement qu’on a donné le nom de germe
6 ta pîantule d’une graine qui eft urie autre petite
plante complette 8c qui n’empêche pas que la graine
ne renferme encore, outre cette pîantule, plufieurs
autres germeis invifibles ; lés germes ne tombent pas
fous lesfens,màis ils circulent avec la feve dans tous
les vaiffeaux des plantes, & s’y perfectionnent dans
les noeuds, comme dit M. Bonnet , à caufe du repliement
des vaiffeaux qui rallentit le cours du fuc
nourricier 8c le rend plus propre au développement
des germes dans cette partie. La prôduCtioii des graines
prouve qu’elles renferment auffi plufieurs germes
cachés, d’où vient la fertilité des graines, fertilité
qui procède de leur formation fur la mere plante
dans le tems de la fleur 6c de la fécondation par les
pouffieres ieminales ; on verra par la fuite que Ces
pouffieres font autant depetits germes qui entrent dans
la formation d’une graine 6c de la pîantule ; on n’aura
dès - lors plus de répugnance à regarder une graine
comme un réfervoir de germes que l’art peut développer
6c multiplier, foit en coupant les racines, foit
de quelqu’autre maniéré.
L’expérience de Triomphetti prouve qtie lés ger-
taes, en confervant les caraCteres génériques 6c principaux
de Pindividu d’où ils fortent, peuvent néanmoins
dégénérer au point de former des efpeces
différentes que nous croyons confiantes, mais qui rie
le font à nos yeux que parce que nous ignorons les
tirconftances qui pourroierit les faire changer de nature
; ôc ceci rend raifon de ce que j’ai dit plus haut
fui*,la poffibilité de la dégénération du bled en feigle
&£ en ivraie ; ces différences fe remarquent principalement
dans les plantes de même efpece, maniées par
les hommes 8c qu’ils cultivent en différens climats
comme le bled, la vigne, &c. M. Adanfon admet
3<$o efpèces diftinétes de froment, parce qu’il compte
les variétés du f o l , du climat 6c des autres accidens
pour des efpeces. Les botaniftes 6c Linnæus, qui fe
donnent toute carrière fur la formation des efpeces,
n ’en donnent que dix pour le froment, 6c encore dans
çe petit nombre combien de variétés peu confiantes !
J’ai dit, dans l’ OEnologie, qu’on cultiyoit à Florence
plus de 300 efpeces de raifins, 6c Linnæus n’en
compte qu’une feule efpece fous le nom de vitis vinifiera
; voilà à quoi l’on eft expofé lorfqu’on veut donner
des bornes à la nature 6c l’aftreindre à des méthodes.
Le retour de M. Commerfon qui voyage par
tout le monde pour y ranaafler les diverfes efpeces
de plantes, répandra lans doute beaucoup de lumières
fur ce fujet intéreffant.
En abandonnant toute théorie fur la formation
des germes qui circulent par-tout avec l’air 6c les
eaux , me voici parvenu au même point que M.
l ’abbé Poncelet que je vais fuivre déformais. Son
excellent livre eft admirable, fur-tout, dans les corollaires
qu’ il tire d’une théorie obfcure à la vérité
fur la formation des germes, mais heureufe par les
conféquences qui en dérivent 8c par la belle expérience
à laquelle elle a donné lieu 6c.que je rapporterai
plus bas. Ecoutons ce favant lui-même : je me
contenterai de l’abréger 6c de l’éclaircir.
« La formation des germes eft le premier pas de
h la nature dans la reproduction des êtres organifés;
» il eft donc faux que tous les germes poffibles aient
» été renfermés dans le premier germe d’une efpece
» quelconque 6c qu’ils ne faffent que fe développer,
» 6c pour ainfi dire fortir de leur étui par les généra-
» rions fucceffives. Il eft bien plus vraisemblable que
» les germes font formés toutes les fois qu’il fe ren-
» contre une portion de matière exaltée, c’eft-à-dire,
» combinée de façon à pouvoir réunir dans une pro-
» ‘portion requife, deux puiffances, l’une aCtive ,
» 1 autre réfiftante. A force d’obfervations microf-
» copiques on eft parvenu à ànalyfer la matière pref-
» qu à l’infini, 6c l’on en a découvert de deux fortes*
» Pline aCtive compofée de particules répandues par*
» tout, toujours en mouvement, toujours vivantes;
» l’autre réfiftante formée de particules pour àinft
» dire mortes ôc dans un état d’inertie ; l’aCtiôn 6c
>> la féaCtkm de ces deux fortes de»matiere* lorf-
» qu’elles font combinées enfémble ; forment une
» lorte d’équilibre plus oumoins parfait d’où émanent
» toutes les formes organiques variées prefque à l’in-
» fini 6c compofant la longue échelle des etres dif-
» tribuée parles méthodiftes en régnés j claffes, fa-
» milles, genres, efpeces, variétés. Ces combinai-
» fons ont été invariablement fixées par l’auteur dé
» là nature lorfqu’il créa les premiers germes, enfortô
» qu’aucune efpece nouvelle n’a paru depuis la créa-
» tion, ôc vraifemblablement il n*en pâroîtra jamais
» dans aucun des régnés connus de la nature >> (Fauffe
conféquence comme ori l’a vu plus haut. )i
» L’aétiôn 6c la réaction de ces deux fortes de fîia3
» rierë pour former un germe ou un corps organifé ;
» dont l’une eft aétive 6c volatile, 6c l’autre réfif*
» tante ôc inerte, fuppofe une diftipàtion eontinuellé
» de fubftance qui doit être exaétement remplacéé
» par urie fubftance nouvelle 6c tout-à-fait femblable*
» De - là , la néceffité de la nutrition,l’abondance de
» la riiatiere nutritive donne lieu à Paccroiffement, 8c
» après Paccroiffement le dépôt de cette même ma-
» tiere riutritive dans des réfervoirs particuliers
» donne lieu à la formation 6c à la combinaifon dé
» nouveaux germes femblables, ôc par conféquent à
» la reprodu&ion de l’elpece. Enfin l’équilibre primi-
» tif des deux fortes de marieres, aétive 6c réfiftante,
» commençant à s’affoiblir, les individus qui en font
» formés s’altèrent j fe deffechent, vieilliffent ÔC
» meurent.
» Les gerriles étant tout formés 8c en grand nom-
» bre dans les graines 6c les femences des végétaux
» comme dans les oeufs des animaux, ils y relient
n comme endormis pendant un affez long tems,
» quoique vivans , jufqu’à ce qu’ils foient dépofés
» dans une matière convenable Ôc propre à leur four-
» nir une matière analogue 6c nutritive ; mais fi ces
» germes retient trop long-tems féparés de leurs
» matières convenables, la déperdition de fubftance
» n’étant point réparée, elle affoiblit les germes, les
» deffeche, les fait mourir 8c rend la graine inha-
» bile à produire : que fi la graine eft dépofée à tems
» dans le fein de la terre, les germes qu’elle renferme
» étant à même de réparer abondamment les pertes-
» qu’ils ont faites 6c qu’ils ne ceffent de faire encore,
» s’approprient les corpufcules de matière qui font à
» leur portée, bientôt ces corpufcules deviennent
» leur propre fubftance ; les germes les plus vigou-
» reux abforbent même les plus foibles qui leur fer-
» vent d’aliment, puifqu’ils font compofés de cor-
» pufcules tout-à-fait femblables; la pîantule qui eft
» déjà toute formée dans la graine eft la premieré
» qui fe développe ; quelques tems après, d’autres
» germes paroinent autour des racines 6c croiffent
» comme la pîantule 6c par les même loix de l’afli-
» milation; c’eft ainfi que les germes , après s’êtré
» développés fucceffivement, après avoir pris de
» l’accroiffement, paroiffent des individus parfaite-
» ment formés qui produifent de nouvelles graines
». âu moyen de la furabondance de matière exaltée
» dont les plantes fe nourriffent, 6c ces individus fé
» confervent jufqu’à ce qu’enfîn l’affimilation venant
» à finir par la deftrudtiori naturelle ou accidentelle
» de l’équilibre, ôc la puiffance a£tive l’emportant
» tôt ou tard fur la réfiftance, l’individu dégénéré 8c
» périt ». Tel eft en peu de mots ce fameux fyftêmé
fur la formation des germes.
Soit que les germes inferifibles des corps organifés
foient préexiftans 6c créés avec le monde, foit, com*
me le vçut M. l’abbé Poncelet* que la fo rm a tif.