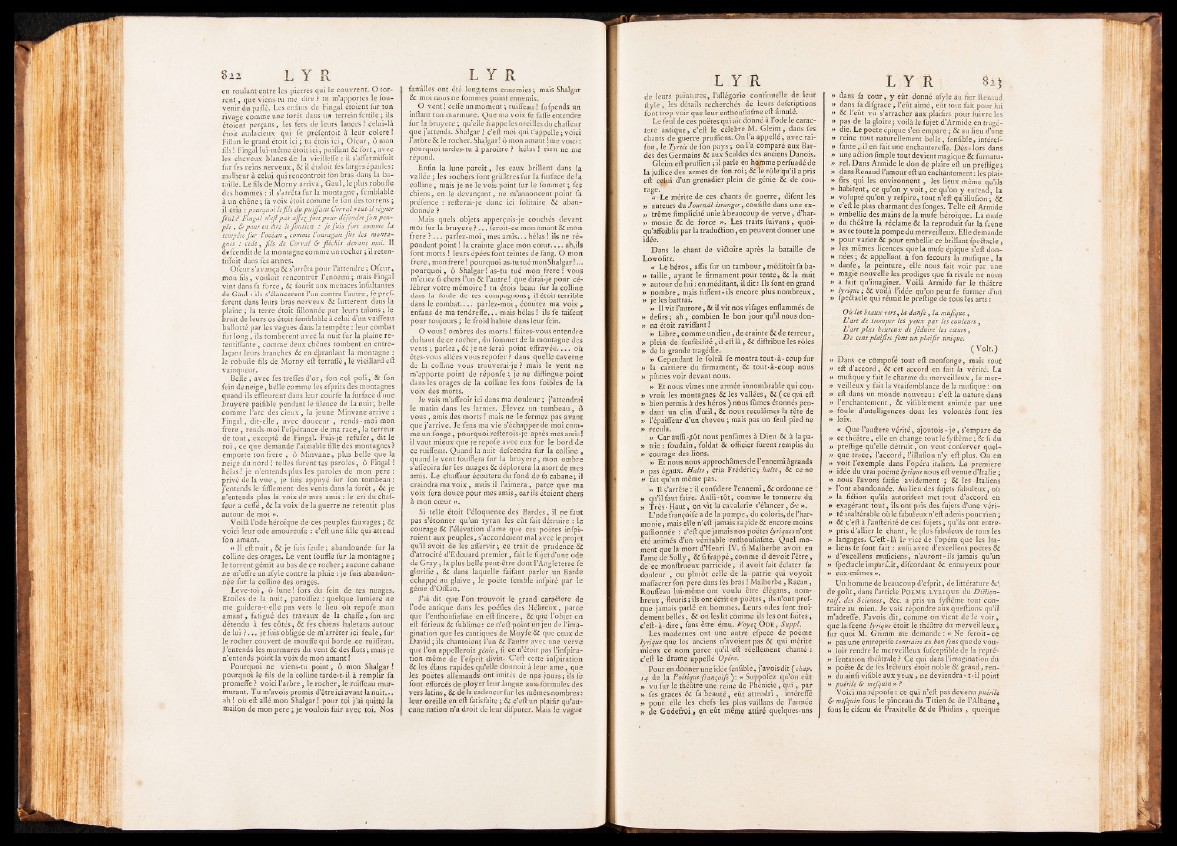
822 L Y R
en roulant entre les pierres qui le couvrent. O torrent
, que viens-tu me dire ? tu m’apportes le Souvenir
du palîe. Les en fans de Fingal étoient fur ton
rivacre comme une forêt dans un terrein fertile ; ils
étoient perçans, les fers de leurs lances ! celui-là
étoit audacieux qui fe préfentoit à leur colerê !
Fillan le grand étoit ici ; tu étois ic i, Ofcur, ô mon
fils ! Fingal lui-même étoit ici, puiffant ôc fort, avec
les cheveux blancs de la vieilleflé : il s’affermiffoit
fur fes reins nerveux, ôc il étaloit fes larges épaules :
malheur à celui qui rencontroit fon bras-dans la bataille.
Le fils de Morny arriva, Gaul, le plus robufte
des hommes : il s’arrêta fur la montagne, Semblable
à un chêne ; fa voix étoit comme le fon des torrens ;
il cria : pourquoi le fils du puiffant Corval veut-il regner
feul ? Fingal riefi pal affe{ fort pour défendre fon peuple
y & pour en àre le foutien : je fuis fort comme la
tempête fur C océan , comme Üouragan fur les montagnes
: ccde, fils de Corval & fléchis devant moi. Il
defcendit de la montagne comme un rocher ; il reten-
tiffoit dans fes armes.
Ofcur s’avança ôc s’arrêta pour l’attendre ; Ofcur,
mon fils, votiloit rencontrer l’ennemi ; mais Fingal
vint dans fa force, ôc Sourit aux menaces infultantes
de Gaul : ils s’élancèrent l’un contre l’autre, fe pref-
ferent dans leurs bras nerveux Ôc luttèrent dans la
plaine ; la terre étoit fillonnée par leurs talons ; le
bruit de leurs os étoit Semblable à celui d’un vaiffeau
ballotté par les vagues dans la tempête : leur combat
fut long, ils tombèrent avec la nuit fur la plaine re-
tentiffante , comme deux chênes tombent en entrelaçant
leurs branches ôc en-ébranlant la montagne :
le robufte fils de Morny eft terraffé, le vieillard eft
vainqueur.
Belle , avec fes treffes d’o r , fon col poli, & fon
fein de neige, belle comme les efprits des montagnes
quand ils effleurent dans leur courfe lafurface d’une
bruyere paifible pendant le filence de la nuit; belle
comme l’arc des cieux, la jeune Minvane arrive :
Fingal, dit-elle, avec douceur , rends - moi mon
frere , rends-moi l’efpérance de ma race, la terreur
de tout, excepté de Fingal. Puis-je refufer, dit le
r o i , ce que demande l’aimable fille des montagnes ?
emporte ton frere , ô Minvane, plus belle que la
neige du nord ! telles furent tes paroles, ô Fingal 1
hélas! je n’entends plus les paroles de mon pere :
privé de la v u e , je fuis appuyé fur fon tombeau :
j’entends le fifflement des vents dans la forêt, ôc je
n’entends plus la voix de mes amis : le cri du chaf-
feur a ceffé, & la voix de la guerre ne retentit plus
autour de moi ».
Voilà l’ode héroïque de ces peuples fauvages ; ôc
voici leur ode amoureufe : c’eft une fille qui attend
fon amant.
« Il eft nuit, & je fuis feule; abandonnée fur la
colline des orages. Le vent fouffle fur la montagne ;
le torrent gémit au bas de ce rocher ; aucune cabane
ne m’offre un afyle contre la pluie : je fuis abandonnée
fur la colline des orages.
Leve-toi, ô lune ! fors du fein de tes nuages.
Etoiles de la nuit, paroiffez : quelque lumière ne
me guidera-t-elle pas vers le lieu oh repofe mon
amant, fatigué des travaux de la chaffe, fon arc
détendu à fes côtés, ôc fes chiens haletans autour
de lui ? . . . je fuis obligée de m’arrêter ici feule, fur
le rocher couvert de moufle qui borde^ce ruiffeau.
J’entends les murmures du vent ôc des flots ; mais je
n’entends point la voix de mon amant !
Pourquoi ne viens-tu point, ô. mon Shalgar !
pourquoi le fils de la colline tarde-t-il à remplir fa
promeffe ? voici l’arbre, le rocher, le ruiffeau murmurant.
Tu m’a vois promis d’être ici avant la nuit...
ah ! oii eft allé mon Shalgar ! pour toi j ’ai quitté la
maifon de mon pere ; je voulois fuir avec toi. Nos
L Y R
familles ont été long-tems ennemies ; mais Shalgar
ôc moi nous ne fommes point ennemis.
O vent! ceffe un moment ; ruiffeau ! fufpends un
inftant ton murmure. Que ma voix fe faffe entendre
fur la bruyere ; qu’elle frappe les oreilles du chaffeur
que j’attends. Shalgar ! ç’eft moi qui t’appelle ; voici
l’arbre ôc le rocher. Shalgar ! ô mon amant ! me voici :
pourquoi tardes-tu à paroître ? hélas ! rien ne me
répond.
Enfin la lune paroît, les eaux brillent dans la
vallée ; les rochers font grifâtres fur la furface de la
colline, mais je ne le vois point fur le fommer ; fes
chiens, en le devançant, ne m’annoncent point fa
préfençe : refterai-je donc ici folitaire ôc abandonnée
?
Mais quels objets apperçois-je couchés devant
moi fur la bruyere ? . . . feroit-ce mon-amant ôc mon
frere ? . . . parlez-moi, mes amis... hélas ! ils ne ré-*
pondent point,! la crainte glace mon coeur.. . . ah,ils
font morts ! leurs épées font teintes de fang. O mon
frere, mon frere! pourquoi as-tu tué mon Shalgar!...
pourquoi, ô Shalgar ! as-tu tué mon frere ! vous
m’étiez fi chers l’un ôc l’autre ! que dirai-je pour célébrer
votre mémoire ! tu étois beau fur la colline
dans la foule de tes compagnons; il étoit terrible
dans le combat.. . . parlez-moi, écoutez ma voix ,
enfans de ma tendreffe... mais hélas ! ils fe taifent
pour toujours ; le froid habite dans leur fein.
O vous ! ombres des morts ! faites-vous entendre
du haut de ce rocher, du.fommet de la montagne des
vents ; parlez, Ôc je ne ferai point effrayée.. . . oh
êtes-vous allées vous repofer ? dans quelle caverne
de la colline vous trouverai-je ? mais le vent ne
m’apporte point de réponfe ; je ne diftingue point
dans les orages de la colline les fons foibles de la
voix des morts. .
Je vais m’affeoir ici dans ffla douleur ; j’attendrai
le matin dans les larmes. Élevez un tombeau, ô
vous, amis des morts ! mais ne le fermez pas avant
que j’arrive. Je fens ma vie s’échapper de moi comme
un fonge, pourquoi refterois-je après mes amis!
il vaut mieux que je repofe avec eux fur le bord de
ce ruiffeau. Quand la nuit defcendra fur la colline ,
quand le vent foufflera fur la bruyere, mon ombre
s’affeoira fur les nuages ôc déplorera la mort de mes
amis. Le chaffeur écoutera du fond de fa cabane; i!
craindra ma v o ix , mais il l’aimera, parce que ma
voix fera douce pour mes amis, car ils étoient chers
à mon coeur ».
Si telle étoit l’éloquence des Bardes, il ne faut
pas s’étonner qu’un tyran les eût fait détruire : le
courage & l’élévation d’ame que ces poètes infpi-
roient aux peuples, s’acçordoient mal avec le projet
qu’il avoit de les affervir; ce trait de prudence &
d’atrocité d’Edouard premier, fait le fujetd’une ode
de Gray, la plus belle peut-être dont l ’Angleterre fe
glorifie , ÔC dans laquelle faifant parler un Barde
échappé au glaive, le poète femble infpiré par le
génie d’Olîian.
J’ai dit que l’on trouvoit le grand caraétere de
l’ode antique dans les poéfies des Hébreux, parce
que l’enthoüfiafme eneftfincere, & qu e l’objet en
eft férieux ôc fublime : ce n’eft point un jeu de l’imagination
que les cantiques de Moyfe ÔC que ceux de
David ; ils chantoient l’un ôc l’autre avec une verve
que l’on appelleroit génie, fi ce n’étoit pas Éinfpira-
tion même de l’efprit divin. C’eft cette infpiration
Ôc les élans rapides qu’elle donnoit à leiir ame, que
les poètes allemands ont imités de nos jpurs ; ils fe
font efforcés de ployer leur langue aux»formules des
vers latins, ôc de la cadencerfur les mêmes nombres:
leur oreille en eft fatisfaite ; ôc c’eft un plaifir qu’aucune
nation n’a droit de leur difputer. Mais le vague
L Y R
de leurs peintures, l’allégorie continuelle de leu?
fty le, les détails recherchés de leurs defcriptions
font trop voir que leur enthdufiafme eft fimulé.
Le feul de ces poètes qui ait donné à l’ode le caractère
antique > c’eft le célébré M. Gleim , ■ dans-fes
chants de guerre prufliens. On l’a appelle, avec rai-
fon, le Tyrtée de fon pays ; on l’a comparé aux Bardes
des Germains Ôc aux Scaldes des anciens Danois.
Gleim eft pruffien ; il parle en homme perfuadé de
la juftice des armes de fon roi; & l e rôle qu’il a pris
eft cakii d’un grenadier plein de génie ôc de courage.
^
« Le mérite de ces chants de guerre, difent les
t> auteurs du Journdl étranger,,confifte dans une ex-
» trême fimplicité unie à beaucoup de verve, d’har-
» monie Ôc de force ». Les traits fuivans, quoi-
qu’affoiblis par la traduction, en peuvent donner une
idée.
Dans le chant de victoire après la bataille de
Lowofitz.
« Le héros, affis fur un tambour, méditoit fa ba-
» taille, ayant le firmament pour tente, Ôc la nuit
» autour de lui : en méditant, il dit : Ils font en grand
» nombre, mais fuffent-ils encore plus nombreux, ;
» je les battrai.
» Il vit l’aurore, & il vit nos vifages enflammés de I
» defirs ; ah, combien le bon jour qu’il nous don-
» na étoit raviffant !
» Libre, comme un dieu, de crainte & de terreur,
» plein de fenfibilité, il eft là , Ôc diftribue les rôles
» de la grande tragédie.
» Cependant le foleil fe montra tout-à-coup fur
» la carrière du firmament, ôc tout-à-coup nous
» pûmes voir devant nous.
» Et nous vîmes une armée innombrable qui cou-
» vroit leS montagnes ôc les vallées, ôc (ce qui eft
» bien permis à des héros ) nous fûmes étonnés pen-
» dant un clin d’oeil, ôc nous reculâmes la tête de
» l’épaiffeur d’un cheveu ; mais pas un feul pied ne
» recula.
» Car aufli -jtôt nous penfâmés à Dieu ôc à la pa-
» trie : foudain, foldat & officier furent remplis du
» courage des lions.
» Et nous nous approchâmes de l’ennemi àgrands
» pas égaux. Halte y cria Frédéric; halte, & ce ne
» fut qu’un même pas.
» Il s’arrête : il confidere l’ennemi, & ordonne ce '
» qu’il faut faire; Aufli-tôt, comme le tonnerre du
» Très - Haut j on vit la cavalerie s’élancer, &c ».
L’ode frariçôife a de la pompe, du coloris, de l’harmonie)
mais elle n’eft jamais rapide ôc encore moins
paffionnée : c’eft que jamais nos poètes lyriques n’ont
été animés d’un véritable enthoufiafme. Quel moment
que la mort d’Henri IV. fi Malherbe avoit eu
l’ame de Sully, ôc fi frappé, comme il devoit l’être,
de ce monftrüeux parricide, il avoit fait éclater fa
douleur , ou plutôt celle de la patrie qui voyoit
maffacrer fon pere dans fes bras ! Malherbe, Racan,
Rouffeau lui-même ont voulu être élégans, nombreux
fleuris ; ils ont écrit en poètes, ils n’ont pref-
que jamais parlé en hommes. Leurs odes font froidement
belles, ôc oh leslit comme ils les ont faites,
c ’eft-à-dire, fans être ému. Voye{ Od ë, Suppl.
Les modernes ont une autre efpece de poème
.lyrique que les anciens n’avoient pas ôc qui mérite
mieux ce nom parce qu’il eft réellement chanté i
c’eft le drame appellé Opéra.
Pour en donner une idée fenfible, j’avois dit ( chap.
"i J de la Poétique françoife ) : « Suppofez qu’on eût
» vu fur le théâtre une reine de Phénicie, qui, par
» fes grâces ôc fa beauté, eût attendri, intéreffé
» pour elle les chefs les plus vaillans de l’armée
»> de Godefroi, en eût même attiré quelques-uns
L Y R
» dans fa cour, y eût donné afyle au fier Renaud
» dans fa difgrace, l’eût aimé, eût tout fait pour lui
» ôc l’eût vu s’arracher aux plaifirs pour fuivre les
>> pas de la gloire; voilà le fujet d’Armide en tragé-
» die. Le poète épique s’en empare ; ôc au lieu d’une
» reine tout naturellement belle, fenfible, intéref*
» fante ,.il en fait une enchantereffe. Dès - lors dans
» une aâion fimple tout devient magique & furnatu-
» rel. Dans Armide le don de plaire eft un preftige;
» dans Renaud l’amour eft un enchantement : les plai^
» firs qui les environnent , les lieux même qu’ils
» habitent, ce qu’on y, v o it, ce qu’on y entend, la
» volupté qu’on y refpire, tout n’eft qu’illufion ; ÔC
» c’eft le plus charmant des fonges. Telle eft Armide
» embellie des mains de la mule héroïque. La mufe
» du théâtre la réclame & la reproduit fur la fcene
» avec toute la pompe du merveilleux. Elle demande
» pour varier ôc pour embellir ce brillant fpe&acle,
» les mêmes licences que la mufe épique s’eft don-
» nées ; ôc appellant à fon fecours la mufique ; la
» danfe, la peinture, elle nous fait voir par une
» magie nouvelle les prodiges que fa rivale ne nous
» a fait qu’imaginer. Voilà Armide fur le théâtre
» lyrique ; ôc voilà l’idée qu’on peut fe former d’un
» fpe&acle qui réunit le preftige de tous les arts :
Où les beaux vers y la danfe, la mufique , •
Hart de tromper les yeux par les couleurs y
- Vart plus heureux de féduire' les coeurs,
De cent plaifirs font un plaifir unique.
(V o lt,)
» Dans ce compofé tout eft mebfonge, mais tout
» eft d’accord,. & cet accord en fait la vérité. La
» mufique y fait le charme du merveilleux, le mer-
» veilleux y fait la vraifemblance de la mufique : on
» eft dans un monde nouveau: c’eft la nature,dans
» l’enchantement, ôc vifiblement animée par une
» foule d’intelligences dont les volontés font fes
» loix.
« Que l’auftere vérité, ajôütôis-je, s’empare dé
» ce théâtre, elle en change tout le fyftême ; ôc fi du
» preftige qu’elle détruit, on veut conferver quel-
» que trace, l’accord, Pillufion n’y eft plus. On en
» voit l’exemple dans l’opéra italien. La première
» idée du vrai poème lyrique nous eft venue d’Italie ;
» nous l’avons faifie avidement ; ôc les Italiens
» l’ont abandonnée. Au lieu des fujets fabuleux, où
» la fiâion qu’ils -autorifent met tout d’accord en
» exagérant tout, ils ont pris des fujets d’une véri-
» té inaltérable où le fabuleux n’eft admis pour rien ;
» ôc c ’eft à l’auftérité de ces fujets j qu’ils ont entre-
» pris d’allier le chant, le plus fabuleux de tous les
» langages; C’eft - là le vice de l’opéra que les Ita—
» liens fe font fait : aufli avec d’excellens poètes &
» d’excellens muficiens, n’auront-ils jamais qu’un
» fpe&acle impartit, difcôrdant ôc ennuyeux pour
» eux-mêmes ».
Un homme de beaucoup d’efprit, de littérature ôc\
dégoût, dans l’article PoeMe lyrique du Diclion-
raif. des Sciences y ôcc. a pris un fyftême tout contraire
aü mien. Je vais répondre aux queftions qu’il
m’adreffe. J’avois dit, çommé on vient de1 le voir,
quela fcene lyrique étoit le théâtre du'merveilleux;
fur quoi M. Grimm me demande: « Ne feroit-ce
» pas une éntreprife contraire au bon fens que de vou-
» loir rendre le merveilleux fufceptible de la repré-
» fentaiion théâtrale ? Ce qui dans l’imagination dit
» poète ôc de fes lecteurs étoit noble & grand, ren- '
» du ainfi vifible aux yeux , ne deviendra * t-il poinè
» puérile & mefquin » ?
Voici nia réponfe: ce qui n’eft pas devenu puérilé
6* mefquin fous le pinceau du Titien ôc de l’Albane,
fous le cifeau de Praxiîelle Ôc de Phidias , quoique
i
n
M