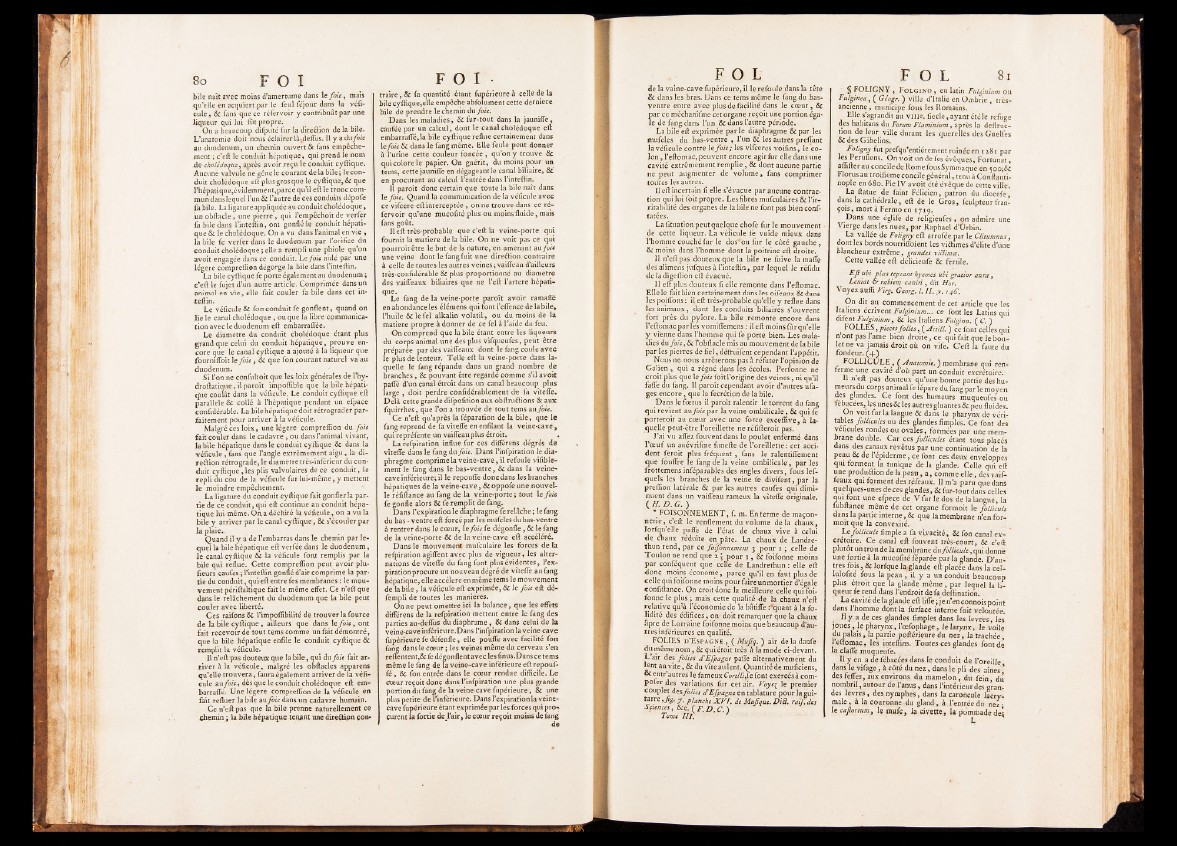
bile naît avec moins d’amertume dans 1 efo ie , mats
qu’elle en acquiert par le feul féjour dans la vefi-
cule, 8c fans que ce réfervoir y contribuât par une
liqueur qui lui fût propre, ■
On a beaucoup difputé fur la direction de la bile.
L’anatomie doit nous éclairer la^leffus. Il y a du foie
au duodénum, un chemin ouvert & fans empêchement
; c’eft le conduit hépatique, qui prend le nom
de cholédoque, après avoir reçu le conduit cyftique.
Aucune valvule ne gênele courant delà bile; le conduit
cholédoque eft plus gros que le cyftique, & que
l ’hépatique,évidemment,parce qu’il eft le tronc commun
dans lequel l’un 8c l’autre de ces conduits dépofe
fa bile. La ligature appliquée au conduit cholédoque,
un obftacle, une pierre, qui l’empêchoit de verfer
fa bile dans l’inteftin, ont gonflé le conduit hépatique
8c le cholédoque. On a vu dans l’animal en vie ,
la bile fe verfer dans le duodénum par l’orifice du
conduit cholédoque ; elle a rempli une phiole qu’on
avoit engagée dans ce conduit. Le foie aidé par une
légère compreffion dégorge la bile dans l’inteftin.
La bile cyftique fe porte également au duodénum ;
c’eft le fujet d’un autre article. Comprimée dans un
animal en v ie , elle fait couler fa bile dans cet in-
teftin.
Le véficule & fon conduit fe gonflent, quand on
lie le canal cholédoque , ou que la libre communication
avec le duodénum eft embarraffée.
Le diamètre du conduit cholédoque étant plus
grand que celui du conduit hépatique, prouve encore
que le canal cyftique a ajouté à la liqueur que
fourniffoit le fo ie , 8c que fon courant naturel va au
duodénum.
Si l’on ne confultoit que les loix générales de l’hy-
droftatique, il paroît impoffible que la bile hépatique
coulât dans la véficule. Le conduit cyftique eft
parallèle 8c collé à l’hépatique pendant un efpace
confidérable. La bile hépatique doit rétrograder parfaitement
pour arriver à la véficule.
Malgré ces loix, une légère compreffion du foie
fait couler dans le cadavre, ou dans l’animal vivant,
la bile hépatique dans le conduit cyftique & dans la
véficule , fans que l’angle extrêmement aigu, la di-
reélion rétrograde, le diamètre très-inférieur du conduit
cyftique, les plis valvulaires de ce conduit, le
repli du cou de la véficule fur lui-même, y mettent
le moindre empêchement.
La ligature du conduit cyftique fait gonfler la partie
de ce conduit, qui eft continue au conduit hépatique
lui-même. O a a déchiré la véficule, on a vu la
bile y arriver par le canal cyftique, 8c s’écouler par
la plaie.
Quand il y a de l’embarras dans le chemin par lequel
la bile hépatique eft verfée dans le duodénum,
le canal cyftique 8c la véficule font remplis par la
bile qui reflue. Cette compreffion peut avoir plu-
fieurs eaufes ; l’inteftin gonflé d’air comprime la partie
du conduit, qui eft entre fes membfanes : le mouvement
périftaltique fait le même effet. Ce n’eftque
dans le relâchement du duodénum que la bile peut
couler avec liberté.
Ces raifons 8c l’impoffibilité de trouver la fource
de la bile cyftique, ailleurs que dans le foie, ont
fait recevoir de tout tems comme un fait démontré,
que la bile hépatique enfile le conduit cyftique 8c
remplit la véficule.
Il n’eftpas douteux que la bile, qui du foie fait arriver
à la véficule, malgré les obftacles apparens
qu’elle trouvera, faura également arriver de la véficule
au foie, dès que le conduit cholédoque eft em-
barraffé. Une légère compreffion de la véficule en
fait refluer la bile au foie dans un cadavre humain.
Ce n’eft pas que la bile prenne naturellement ce
chemin ; la bile hépatique tenant une dire&ipn contraire,
8c fa quantité étant fupérieure à celle de la
bile cyftique,elle empêche abfolument cette demiere
bile de prendre le chemin du foie.
Dans les maladies, 8c fur-tout dans la jauniffe,
caufée par un calcul, dont le canal cholédoque eft
embarraffé,la bile cyftique reflue certainement dans
le foie 8c dans le fang même. Elle feule peut donner
à l’urine cette couleur foncée , qu’on y trouve 8c
qui colore le papier. On guérit, au moins pour un
tems, cette jauniffe en dégageant le canal biliaire, 8c
en procurant au calcul l’entrée dans l’inteftin.
II paroît donc certain que toute la bile naît dans
le foie. Quand la communication de la véficule avec
ce vifeere eft interceptée, on ne trouve dans ce réfervoir
qu’une mucofité plus ou moins fluide, mais
fàns goût.
Il eft très-probable que c’eft la veine-porte qui
fournit la matière de la bile. On ne voit pas ce qui
pourrait être le but de la nature, en amenant au foie
une veine dont le fang fuit une direétion contraire
à celle de toutes les autres yeines ; vaiffeau d’ailleurs
très-confidérable 8c plus proportionné au diamètre
des vaiffeaux biliaires que ne l’eft l’artere hépafi-
que.
Le fang de la veine-porte paroît avoir ramaffé
en abondance les élémens qui font l’effence de la bile,
l’huile 8c lefe l alkalin volatil, ou du moins de la
matière propre à donner de ce fel à l ’aide du feu.
On comprend que la bile étant entre les liqueurs
du corps animal une des plus vifqueufes, peut être
préparée par des vaiffeaux dont le fang coule avec
le plus de lenteur. Telle eft la veine-porte dans laquelle
le fang répandu dans un grand nombre de
branches, 8c pouvant être regarde comme s’il avoit
paffé d’un canal étroit dans un canal beaucoup plus
large , doit perdre confidérablement de fa vîteffe.
Delà cette grande difpofition aux obftruâions & aux
fquirrhes, que l’on a trouvée de tout tems au foie.
Ce n’eft qu’après la féparation de la bile, que le
fang reprend de fa vîteffe en enfilant la veine-cave ,
qui repréfente un vaiffeau plus étroit.
La refpiration influe fur ces différens dégrés de
vîteffe dans le fang du foie. Dans l’infpiration le diaphragme
comprime la veine-cave, il refoule vifible-
ment le fang dans le bas-ventre, 8c dans la veine-
cave inférieure; il le repouffe donc dans les branches
hépatiques de la veine-cave, 8c oppofe une nouvelle
réfiftance au fang de la veine-porte; tout le foie
fe gonfle alors 8c fe remplit de fang.
Dans l’expiration le diaphragme fe relâche ; le fang
du bas - ventre eft forcé par les mufcles du bas-ventre
à rentrer dans le coeur, le foie fe dégonfle, 8c le fang
de la veine-porte 8c de la veine-cave eft accéléré.
Dans le mouvement mufculaire les forces de la
refpiration agiffent avec plus de vigueur, les alternations
de vîteffe du fang font plus évidentes, l’expiration
procure un nouveau dégré de vîteffe au fang
hépatique, elle accéléré en même tems le mouvement
de labile, la véficule eft exprimée, 8c le foie eft dé-
fempli de toutes les maniérés.
On ne peut omettre ici la balance, que les effets
différens de la refpiration mettent entre le fang des
parties au-deffus au diaphrame, 8c dans celui de la
veine-cave inférieure.Dans l’infpiration la veine-cave
fupérieure fe défenfle, elle pouffe avec facilité fon
fang dans le coeur ; les veines même du cerveau s’en
reflentent,8c fe dégonflent avec les finus.Dans ce tems
même le fang de la veine-cave inférieure eft repouffé
, 8c fon entrée dans le coeur rendue difficile. Le
Oceur reçoit donc dans l’infpiration une plus grande
portion du fang de la veine-cave fupérieure ; 8c une
plus petite de l’inférieure. Dans l’expiration la veine-
cave fupérieure étant exprimée par les forces qui pro*»
curent la fortie de Y air, le coeur reçoit moins de fang
de la vaine-cave fupérieure, il le refoule dans la tête
8c dans les bras. Dans ce tems même le fang du bas-
ventre entre avec plus de facilité dans le coeur, 8c
par ce méchanifme cet organe reçoit une portion égale
de fang dans l’un 8c dans l’autre période.
La bile eft exprimée par le diaphragme 8c par les
mufcles' du bas-ventre , l’un 8c les autres preffant
la véficule contre \tfoie; les vifeeres voifins , le colon
, Peftomac, peuvent encore agir fur elle ,dans une
cavité extrêmement remplie, 8c dont aucune partie
ne peut augmenter de volume, fans comprimer
totffes les autres.
Il eft incertain fi elle s’évaçue par aucune contraction
qui lui l'oit propre. Les fibres mufculaires 8c l’irritabilité
des organes de la bile ne font pas bien conf-
tatées-.
La fituation peut quelque chofe furie mouvement
de cette liqueur. La véficule fe vuide mieux dans
l’homme couché fur le dos*ou fur le côté gauche,
8c moins dans l’homme dont là poitrine eft droite.
11 n’eft pas douteux qüe la bile ne fuive la malle
des alimens jufques à l’inteftin, par lequel le réfidu
de la digeftion eft évacué.
11 eft plus douteux fi elle remonte dans I’eftomac.
Elle le faitbien certainement dans les oifeaux 8c dans
les poiffons : il eft très-probable qu’elle y reflue dans
les animaux, dont les conduits biliaires s’ouvrent
fort près du pylore. La, bile .remonte encore dans
l’eftomacparles vomiffemens : il eft moins fûr qu’elle
y vienne dans l’homme qui fe porte bien. Les maladies
du foie, 8c l’obftacle mis au mouvement de la bile
par les pierres de fiel, défruifent cependant l’appétit.
Nous ne nous arrêterons pas à réfuter l’opinion de
Galien , qui a régné dans les écoles. Perfonne ne
croit plus que le foie foit l’origine des veines, ni qu’il
faffe du fang. Il paroît cependant avoir d’autres ufa-
ges encore, que la fecrétion de la bile.
Dans le foetus il paroît ralentir le torrent du fang
qui revient au foie par la veine ombilicale, 8c qui fe
porteroit au coeur avec une force exceffive, à laquelle
peut-être l’oreillette ne réfifteroit pas.
J’ai vu àffez fouvent dans le poulet enfermé dans
l’oe uf un anévrifme funefte de l’oreillette: cet accident
ferait plus fréquent, fans le ralentiffement
que fouffre le fang de la veine ombilicale, par les
frottemens inféparables des angles divers, fous lef-
quels les branches de la veine fe divifent, par la
preffion latérale 8c parles autres caufes qui diminuent
dans un vaiffeau rameux la vîteffe originale.
( H. D . G. )
*. FOISONNEMENT, f. m. En terme de maçonnerie,
c’eft le renflement du volume delà chaux,
ï0rfqu’elle paffe de l’état de chaux vive à celui
de (maux réduite en pâte. La chaux de Landre-
thun rend, par ce foifonnement 3 pour 1 ; celle de
Toulon ne rend que pour 1 , 8c foifonne moins
par conféquent que celle de Landrethun : elle eft !
donc moins économe, parce qu’il en faut plus de i
celle qui foifonne moins pour faire un mortier d’égale !
confiftance. On croit donc la meilleure celle qui foi- i
fonne le plus ; mais cette qualité de la chaux n’eft
relative qu’*à l’économie de la bâtiffe roquant à la fo-
lidité des édifices, on doit remarquer que la chaux
âpre de Lorraine foifonne moins que beaucoup d’autres
inférieures en qualité.
FOLIES d’Espagn e , ( Mufiq. ) air deladanfe
du même nom, Sc quiétoit très à la mode ci-devant.
L air des folles ÆEfpagne paffe alternativement du
lent auvite, 8cdu vîte ail lent. Quantité de muficiens,
8c entr’autres le fameux Cqrellife font exercés à com-
pofer des variations fur cet air. Voye^ le premier
couplet d es folies (TEfpagne en tablature pour Iagui-
tarre, y. planchc X F l. de Mujique. Di cl. raif. des
Sciences, 8cc. ( F .D .C . )
Tome III.
§ FOLIGNY, Folgino , en latin Fulginium ou
Fu/gineat ( Géogr. ) ville d’Italie en Ombrie , très-
ancienne , municipe fous les Romains.
Elle s’agrandit au vme. fiecle, ayant été le refuge
des habitans du Forum FLaminium, après la deftruc-
tion de leur ville durant les querelles des Guelfes
8c des Gibelins.
Foligny fut prefqu’entiérement ruinée eft 1281 par
les Perufiens. On voit un de fes évêques, Fortunat,
affifter au concile de Rome fousSymmaque en 5oo;8c
Florus au troifieme concile général, tenu à Conflanti-
nople en 680. Pie IV avoit été évêque de cette ville.
La ftatue de faint Félicien, patron du diocefe
dans la cathédrale, eft de le Gros, fculpteur français,
mort à Fermoen 1719,
Dans une églife de religieufes, on admire une
Vierge dans les nues, par Raphaël d’Ûrbin.
La vallée de Foligny eft arrofée par le Clitumnus ;
dont les bords nourriffoient les vi&imes d’élite d’une
blancheur extrême, grandes vielimee.
Cette vallée eft délicieufe 8c fertile.
EJl ubi plus tepeant hyemes ubi gratior aura,
Leniat & rabiem caniri, dit Hor.
Voyez auffi Virg. Georg. I. 11. y . 14G.
On dit au commencement de cet article que les
Italiens écrivent Fulginium... ce font les Latins qui
difent Fulginium, 8c les Italiens Folgino. ( C. )
? FOLLES, pièces folles ,(A r till. ) ce font celles qui
n’ont pas l’ame bien droite, ce qui fait que le bou-
let ne va jamais droit oii on vife. C’eft la faute du
fondeur.(-j-)
FOLLICULE, ( Anatomie. ) membrane qui ren-
fenne une cavité d’oii part un conduit excrétoire.
Il n eft pas douteux qu’une bonne partie des humeurs
du corps animal fe fépare du fang par le moyen
des glandes. Ce font des humeurs muqueufes ou
iebacées,I)ps unes 8c les autres gluantes 8c peu fluides.
On voit fur la langue 8c dans le pharynx de véritables
follicules ou des glandes fimples. Ce font des
veficules rondes ou ovales, formées par une membrane
double. Car ces follicules étant tous placés
dans des canaux revêtus par une continuation de la
peau 8c de 1 epiderme, ce font ces deux enveloppes
qui forment la tunique de la glande. Celle qui eft
une produâion de la peau, a , comme elle, des vaiffeaux
qui forment des réfeaux. Il m’a paru que dans
quelques-unes de ces glandes, 8c fur-tout dans celles
qui font une efpece de V fur le dos de la langué, la
fubftance même de cet organe formoit le follicule
dans la partie interne, 8c que la membrane n’en formoit
que la convexité.
Lq follicule fimple a fa vivacité, 8c fon canal excrétoire.
Ce canal eft fouvent très-court, 8c c’eft
plutôt un trou de la membrane du follicule, qui donné
une fprtie à la mucofité féparée par la glande. D ’autres
fois, 8c lorfque la?iglande eft placée dans la cel-
lulofité fous la peau , il y a un conduit beaucoup
plus étroit que la glande même, par lequel la liqueur
fe rend dans l’endroit de fa deftination.
La cavité de la glande eft liffe ; je n’en connois point
dans l’homme dont la furface interne foit veloutée.
. Il y a de ces glandes fimples dans les levrês, les
joues,.le pharynx, l’oefophage , le larynx, le voile
du palais, la partie poftérieure du nez, la trachée
l’effomac , les inteftins. Toutes ces glandes font de
la claffe muqueufe. .
Il y en a de lébacées dans le conduit de l’oreille
dans le vifage, à côté, du nez, dans le pli des aînés *
des feffes, aux environs du mameîon, du fein, du
nombril, autour de l’anus , dans l’intérieur des grandes
levres, des nymphes, dans la caroncule lacrymale,
à la couronne du gland;, à l’entrée du nez-
le cajloreum, le mufe, la civette, la pommade des