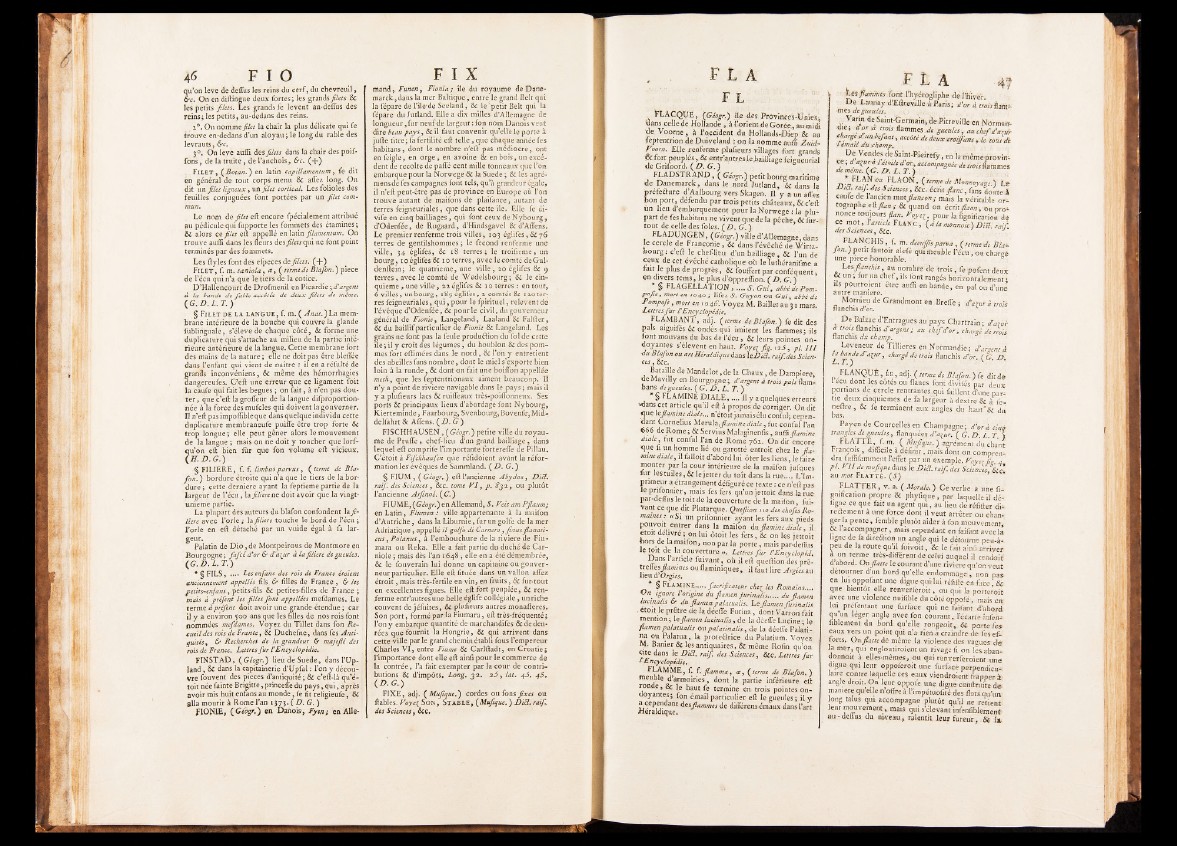
qu’on leve de deflïis les reins du cerf, du chevreuil,
& c. On en diftingue deux fortes; les grands jî/ew 6c
les petits filets. Les grands fe lèvent au-deffus des
reins; les petits, au-dedans des reins.
x ° . On nomme filet la chair la plus délicate qui fe
trouve en-dedans d’un aloyau ; le long du rable des
levraut^, &c.
3°. On leve aulïi des filets dans la chair des poif-
fons, de là truite, dé l’àrichois, &c. (+ )
Filet, {B o ta n .) en latin capillamtntum, fe dit
en général de tout corps menu 6c affez long. On
dit un filet ligneux, un filet cortical. Les folioles des
feuilles conjuguées, font portées par un filet com-
Le nom de filet eft encore fpécialement attribué
au pédicule qui fupporte les fommets des étamines ;
& alors ce filet eft appellé en latin filamentum. On
trouve auffi dans lès fleurs des filets qui ne font point
terminés par des fommets.
Les ftyles font des eipeces de filets. (+ )
Filet , f. m. taniola, ce, ( terme de Blajbn. ) piece
de l’écu qui n’â que le tiers de la cotice.
D ’Hallencourt de Drofmenil en Picardie ; d'argent
à la bande de fable accotée de deux filets de même.
( G .D . L . T . )
§ Filet de la langue, f. m. ( jJnat.)La membrane
intérieure de la bouche qui couvre la glande
fubliriguale, s’élève de chaque côté, & fqrme une
duplicature qui s’attache au milieu de la pairie inférieure
antérieure de la langue. Cette membrane fort
des mains de la nature ; elle né doit pas être bleffée
dans l’enfant qui vient de naître : il en a réfulté de
grands inconvéniens, & même des hémorrhagies
dangereufes. C’eft une erreur que ce ligament foit
la caufe qui fait les begues ; on fait, à n’en pas douter,
que c’eft la groffeur de la langue difproportion-
hée à la force des mufcles qui doivent la gouverner.
Il n’eft pas impoflible que dans quelque individu cette
duplicature membraneufe puiffe être trop forte &
trop longue ; elle peut gêner alors le mouvement
de la langue ; mais on ne doit y toucher que lorf-
u’on eft bien fur que fon volume eft vicieux.
H. D G. )
§ FILIERE , f. f. limbus parvus, ( terme de Bla-
fo n . ) bordure étroite qui n’a que le tiers de la bordure
; cette derniere ayant la feptieme partie de la
largeur de l’écu, la filiereae doit avoir que,la vingt-
unieme partie.
La plupart des auteurs du blàfon confondent la filière
avec l’orle ; la filière touche le bord de l’écu ;
l ’orle en eft détaché par un vuîde égal à fa lar-
geur.
Palatin de D io , de Montpeiroùs de Montmore èn
Bourgogne; fafcê d'or & d’azur à la filiere de gueules.
{ G .D .L . T . )
* § F IL S , .... Les enfahs des rois de France étoient
anciennement appelles fils. & filles de France , & les
petits-enfans, petits-fils 6c petites-filles de France ;
mais d préfent les filles font appellées mefdames. Le
terme d préfent doit avoir une grande étendue ; car
il y a environ 500 ans que les filles de nos rois font
nommées mefdames. Voyez du Tillet dans fon Recueil
des rois de France, & Duchefne, dans fes Antiquités,
& Recherches de la grandeur & tripjejté des
rois de France. Lettres fu r V Encyclopédie.
FINSTAD, ( Gêogr.) lieu de Suede, dansl’Up-
land, 6c dans la capitainerie d’Upfal : l’on y découvre
fouvent des pièces d’antiquité ; & c’eft-là qu’é-
toit née fainte Brigitte, princeffe du pays, qui, après
avoir mis huit.enfans au monde, fe fit religieufe, 6c
glla mourir à Rome l’an 1373.( D. G. )
FIONIE* ( Gêogr. ) en Danois', Fytn; en Ailemand,
Funen, Fionia ; île du royaume de Danem
a r k , dans la mer Baltique, entre, le grand Belt qui
la fépare de l’île'de Séeland, 6c le '''petit Belt qui la
fépare du Jutland. Elle a dix milles d’Allemagne de
longu eur, fur neuf de largeur : fon nom Danois veut
dire beau p a y s , & il faut convenir qu’ellé le porte à
jufte titre; fa fertilité eft te lle , que chaque année fes
habitans, dont le nombre n’eft pas médiocre , ont
en fe igle , en o r g e , en avoine & en b o is , un excédent
de récolté de paffé cent mille tonneaux que l’on
embarque pour la N o rv è ge 6c la Suede ; & les agré-
mensde fes campagnes font tels, qu’à grandeur égale,
il n’eft peut-être pas de pro vince en Europe oii l’on
trouv e autant de maifons de plaifance, autant de
terres feigneuriales, que dans cette île. Elle fe di-
v ife en cinq b a illiage s, qui font ceux de N y b o u r g ,
d’Od enfée , de Rugaard, d’Hindsgavel & d’Alfens.
L e premier renferme trois v ille s , 103 é glifes , 6c 76
terres de gentilshommes ; le fécond renferme une
v i l le , 34 é glifes , & 18 te rre s ; le troifieme, un
b o u rg , 1 0 églifes 6c 10 terres, av e c le comté deGul-
denftein; le quatrième, une v i l l e , 20 églifes 6c 9
te r r e s , avec le comté de V ed e lsb o u rg ; 6c le cinquième
, une v i l l e , 22 églifes & 10 terres : en tout,
6 v ille s , un b o u rg , 189 églifes, 2 comtés 6c 120 terres
feigneuriales, q u i, pour le fpirituel, rele ventde
l’évêque d’O d en fée , 6c pour le c iv il, du gouverneur
général de Fionie, Langeland, Laaland 6c F alfte r,
6c du b a illif particulier de Fionie 6c Langeland. Les
grains ne font pas la feule production du fol de cette
île ; il y croît des légumes ; du houblon 6c des pommes
fo rt eftimées dans le n o rd , 6c l’on y entretient
des abeilles fans nombre, dont le miel s’ exporte bien
loin à la ron de , & dont on fait une boiflon appellée
meth, que les feptentrionaux aiment beaucoup. Il
n’y a point de riviere navigable dans le pays ; mais il
y a plufieurs lacs 6c ruifleaux très-poiflonneux. Ses
ports & principaux lieux d’abordage font N yb ou rg ,
Kierteminde, Faarbourg, Svenbourg, Bovenfe, M idr
delfahrt & Aflens. ( D . G )
FISC HH AU S EN , ( Gêogr. ) petite v ille du ro y au me
de P ru ffe , chef-lieu d’un grand b a illiage , dans
lequel eft comprife l’importante fortereffe de Pillau.
C ’-étoit à Fifchhaiifen que réfidoient avant la réformation
les’ évêques de Sammland. ( D . G . )
§ FIUM , ( Gêogr. ) eft l’ancienne Abydos., D i cl.
ratf. des Sciences , & c . tome V I , p . 832 , ou plutôt
l ’ancienne Arjinoê. ( C. )
FIUME, {Gêogr.) en Allemand, S . Veit am Pfiaum;
en La tin , Flumen : ville appartenante à la maifon
d’A u tr ich e , dans la Liburnie, fur un golfe de la mer
Adria tique, appellé i l golfo di Carnero, Jinusfianati-
eus, Polanus, à l’embouchure de la riviere de Fiu-
mara ou R eka. Elle a fait partie du duché de C ar-
niole ; mais dès l’an 1 6 4 8 , elle en a été démembrée,
& le fouverain lui donne un capitaine ou g ou v e r neur
particulier. Elle eft fituée dans un vallon affez
é t ro it , mais très-fertile en v in , en fru its , & fur-tout
en excellentes figues. Elle eft fort peuplée, 6c renferme
entr’autreS une belle églife collég iale , un riche
couvent de jéfuites, 6c plufieurs autres monafteres.
Son p o r t, formé par la Fiumara, eft très-fréquenté;
l’on y embarque quantité de marchandifes 6c de denrées
que fournit la Hongrie, & qui arrivent dans
cette v ille parle grand chemin établi fous l’empereur
Charles V I , entre Fiume 6c Carlftadt, en C ro a tie ;
l’importance dont elle eft ainfi pour le commerce de
la contrée,, l’a fait exempter par la cou r de contributions
6c d’impôts. Long. 3 2 . a i , lat. 46. 4 $ .
C D . G . )
F IX E , adj. ( Mufique. ) cordes ou fons fixes ou
fiables. Voye{ Son, Stable, ( Mufique. ) Dicl, raif
des Sciences p ôte.
F L
, t t .A C Q C T . , (.Gêogr.') île dès Provinces-Ünies,
«ans celle de Hollande , h r o n é o t é e C o r é e , au midi
sle, Voprne , à i ’Oicqideot dn Hdllaods-Diep & an
fèptentrion de Duiyeland .on la nomme auffi g u t f ,
V lir a . E lle renferme plufieurs villages Fort, grands
& fort peuplés-, S f entrlautresleia illiaBe .feieoeurial
de Grifoord. ( D . G . )
F L A D S T R A N D , ( Gêogr.) petit bourg mari fini é
d e Danem arçk, dans le nord Jutland , 6c dans ia
préfecture d’A albourg vers Skagen. Il y a un affez
bon p o r t, défendu par trois petits châteaux, 6c c’eft
un lieu d’embarquement pour la N o rv è g e : la §jj$f
part de fes habitans ne viye.nt que de la pêche, 6c fur-f
tout de celle des foies. ( D . G. )
F L A D U N G E N , {Gêogr.) ville d’Allemagne, dans
le cercle de Françonie, 6c dans l’évêché de "Wirtz-
b ou rg : c’eft le chef-lièu d’un bailliage , 6c l ’un de
c eu x de cet évêché catholique oii le luthéranifme a
tait je plus de pro g rès , & fouffert par cûnféquent -,
en divers tems, le plus d’oppreffiom (D .G . )
* § F L A G E L L A T IO N , .... S . Gui, abbédePom-
P ° fie> moTL en 1040 ; lifez S . Guyon Ou Gui ,, abbé de
J ’ ompofe 9 mort en 1046. V o y e z M. Baillet au 31 mars;
1Lettres fu r ÜEncyclopédie.
F L AM B A N T , adj. {terme de Blajbn. ) fe dit des
pals aiguifés 6c ondés qui imitent les flammes; ils
lon t mouvans du bas de l’é cu , 6c leurs pointes o n doyantes
s’élèvent en haut. Voye^ fig. / 2 i , pi. I I I
Au Blafon ou art Héraldique dans le D ici. raif. des Scie)2-
cm , & c . . . • .
Bataille de Mandelot, de la C h a u x , de Dampiere;
de M a villy en Bourgogne ; d'argent à trois pals flarm,
bans de gueules. {G . D . L . T . )
* § FL AMINE D IA L E , .... Il y a quelques erreur^
*dans cet article qu’il eft à propos de corriger. On dit
que \efiqmine diale... n’étoit jamais élu conful; cependant
Cornélius Merula,j?/2//wizç diale, fut conful l’an
666 de R ome ; 6c Servius Malaginenfis, auffi famine
diale y fut conful l’an de .Rome 762. On dit encore
qu e fi un homme lié ou garotté entroit chez le fia*
mine diale, il falloit d’abord lui ô ter les liens , le mire
monter par la cour intérieure de la maifon jufques
lu r les tu iles , & le jetter du to ît dans la rue.... L ’im-
primeur a étrangement défiguré ce texte : ce n’eft pas
le p n fon n ie r, mais fes fers qu’on jettoit dans la rue
par-deflus le toit de la couverture de la ma ifon, fui-
Vant ce que dit Plutarque. Quefiion n o des chofes Romaines
: « S i un pnfonnier ayant les fers aux pieds
pou voit entrer dans la maifon du famine diale, il
e toit defivré ; on lui ôtoit les fe r s , 6c on les jettoit
hors de la m aifon, non par la p o r te , mais par-deflus
ie toit de la couverture ». Lettres fu r ÜEncyclopédk
Dans l article fu iv an t, oii il eft queftion des prê-
treffes flammes ou flaminiques, il faut lire Armées au
lieu a Orgies.
* S Fi -AMINÈ......facrificauur cht^ Us Romains.,..
V n Ignore l'oripne dri flarnen fm n a lh ......du flamin
lucinalis & du flamen palatualis. L e fiamen furinalis
,etoit le prêtre de la déeffe Furina, dont Varron fait
mention; flamen lucinalis.t de la déeffe Lucine ; le
flamen palatualis ou palatinalis, de la déeffe Palati-
na ou Palatua, la protectrice du Palatium. V o y e z
M. Banier 6c les antiquaires, & même Rofin qu’on
cite dans le Dicl, raif. des Sciences, & c . Lettres fu r
L Encyclopédie.
F LAM M E , f. f. fiamma.y es y { terme de Blajbn. )
meuble d’armoiries, dont la partie inférieure eft
ïo n c le , 6c le haut fe termine en trois pojntes ondoyante
s; fon émail particulier eft le gueules; il y
a cependant desjlammes de différens émaux dans l’art
Héraldique.
F I A
.es flammes . font i’hvy éteg6i iprj s^e dé *l îHKWiveérf..
D e Launay d Eftrevjlle à Paris ; d’or d trois àaïft«
-mes de gueules.
Vmn deSarat-feerinain., deEitrèviUe en Nômraff. Mfflmæm ^ 0,^w
% email du xhamp. o u iU e b é h m ^ m ^ h . i i i f J i
M Vendes de Samt-Pieirefy, en 'tenidmeprovin-
t e , d.alur,uiettnUdm,accompagnée daimisüalilffles
•de mepie.fG. D . L. T . )
r. ^ ^ F A N ou F LAOM , ( terme de Monnoyave. ) L é
D M . raif.desSciences & c . écrie fla n c , fans d oM e i
cw le de I ancien motflancon; mais la véritable or»
» g ra p h e efl.fl.ans & quand on é c r j t& o is v e n pro‘
nonce tonjours flan. Royei, pour la Figiii&atüon de
c e m o t , ia r tic k Fü n ç :, {.dla rnormokil D iR i ra i\
desSeteftces, & c . .... v , j
FLANCHIS, f. m. deCeiffispàrùa , (eermedt Riaa
Jon.) petit (antoir àlefé c[Ui meuble l ’écu, em ehargé
une piece honorable. - . . • . : r: :. , . . :
Lesflanchis au nombre de trois, fe pofent deux
« un ; fiir un chef, ils font rangés horizontalement î
ils pourraient etre auffi en bande, èn pal ou tl’tiné
autre maniéré. , '
Mornieu de Gréndmont en Breffe ; d'aruràmis
nancrus dé or. / v f i
, F>e Balzac d’Entragues au pays Chartrain • F azur
a trois flanchis d'argent; au chef# or, chargé de trois
flànchiis du champ. • . &
Leveneur de Tiïlieres en Normandie; d’argent à
■ la bande d’azur y chargé de trois flanchis d’or. { G. D .
L. T .)
, FF-ANQUÊ , ÉE, adj;, :( terme ie Êlafon. ) fe dit dé
1 ecu dont les côtés ou flânes font divifés par' deux
portions ,de p f e le rentrantes,gui faillent d’une pari
tie deux Cinquièmes de fa largeur' à dextre & £ fe .
neflre , & fe terminent aux angles du haut‘ & du
bibas,.
Payen de Çburcellés eii Champagne; d’orù tinà
'trangles de gueules, flanquée^.d’azur, ( G. D. L. T. \
FLATTÉ, f.-m. ( Miflÿie.) agrément
François , difficile â delinir, mais dont.on co:i:prr;idra
fuffifamment.l’effet par un'exemple. Foyer fia. a
p l,.VH de mufiqueAatis le Dicl. raif. des Sciences & cî
au mot Flatté. ( S)
FLATTER, v. a. ( Morale. ) Ce verbe à une fi»
gmneation propre & phyfique, par' laquelle iï èU
figne ce que fait un, agent qui, au lieu de réfifter di»
reaement à une force dont il veut arrêtée0« ehan»
gerla pente, femble plutôt aiderifon mouveinenr '
& l’accompagner, Biais cependant en feifiint aveclæ
ligne de fa direaipn un angle qui le détourne peii-à»
peu de. la route qu’il fuivoit, & le fait ainfi, arriver
à un terme très-différent de celui auquel il tendoié
d’abord. On flatte le courant d’une riviere qu’on veut
détourner d un bord qu’elle endommage;, non pas
en lui oppofant une digue qui lui réfilléen face &
que bientôt elle renwrferoit, ou qui la porteroit
avec une violence nuifible du çôtéo.ppQ«v mais eu;
lui^ préfentant une, fii.rfaee qui ne feifant d’abord
qu un léger angle avec fon courant,: l’écarfe infen*
fiblement du bord qu’elle rongeoit,. & porte fes
eaux Vers un point qui té a rien, à craindre de fes e fforts.
On flatte àè même la violence des vagues dé
la mer, qui engloutiroient un rivage fi on les-aban«.
donrioit à elles-mêmes, Ou qui renverferoient inné
digue- qui leur oppoferoit une furfacè perpendicu-^:
Iaire contre laquelle ées eaux viendroient frapper à'
angle droit. On leur oppofe une digue confiante dô
mamere qtt elle n’offre à l’impétuofité des floTs'-qu’urt'
long talus qui accompagne plutôt qu’il ne retient
leur mouvement, mais; qui s’élevant infenfifalemenÉ-
a,u- aelius du niveau,, ralentit leur fureur, 6c 1*.