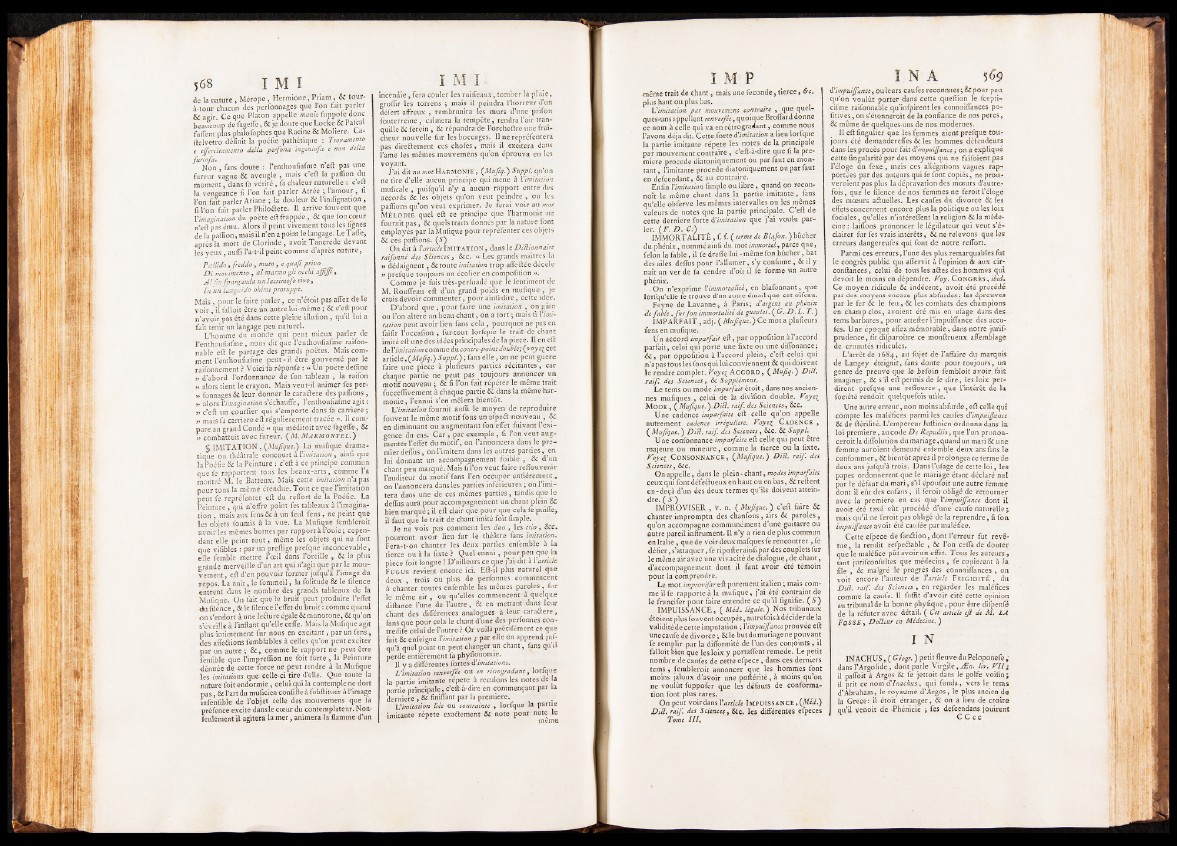
5 68 I M I
de la natufe, Mérope, Hermiône, Priam, & toùr-
à-tour chacun des personnages-que l’on fait parler
6 agir. Ce que Platon appelle marne fuppofe donc
beaucoup de fageffe, & je doute que Locke ScPâfcal
fuflent plus philofophes que Racine & Moliere. Ca-
ftelvetro définit la poéfie pathétique : Troyamento
e ejfércitamento delta perfona tngenwfa e non délia
fanafa. I . _
Non , fans doute : l’enthoufiafme n est pas une
fureur vague & aveugle , mais c’eft là paffion du
moment, dans fa vérité , fa chaleur naturelle" : c’eft
la vengeance ii l ’on fait parler Atree ; l’amour, fi
l’on fait parler Ariane ; la douleur & l’indignation ,
fi l’on fait parler Philoftete. 11 arrive fouvent que
Y imagination du poète eft frappée, & que fon coeur
n’eft pas ému. Alors il peint vivement tous les lignes
de la paffion, mais il n’en a point le langage. Le Taffe,
après la mort de Clorinde, avoit Tancrede devant
les y eux, auffi i'a-t-il peint comme d’après nature,
Pallido, freddo, tnuto , e quajt priva. ,
D i movimento , almarmo gli occhi afiijjt,
A l fin fparganda un lacrimofo n v o ,
In un languido ohime proruppe.
Mais, pour le faire parler, ce n’étoit pas affez de le
v o ir , il falloit être un autre lui-même ; 6c c’eft pour
n’avoir pas été dans cette pleine illufion, qu’il lui a
fait tenir un langage peu naturel.
L’homme du monde qui peut mieux parler de
l’enthoufiafme , nous dit que l’enthoufiafme raifon-
nable eft le partage des grands poëtes. Mais comment
l’enthoufiafme peut - il être gouverné par le
raifonnement ? Voici l'a réponfe : « Un poëte defline
» d’abord l’ordonnance de fon tableau , la raifon
» alors tient le crayon. Mais veut-il animer fes per-
» fonnages & leur donner le cara&ere des pallions,
» alors Y imagination s’échauffe, l’enthoufiafme agit :
» c’eft un eourfier qui s’emporte dans fa carrière ;
» mais fa carrière eft régulièrement tracée ». Il compare
au grand Condé « qui méditoit avec fageffe, 6c
» combattoit avec fureur. (Af. Ma rm on te l.)
§ IMITATION , 0Mufiquc.) La mufique dramatique
ou théâtrale concourt à limitation, ainfi que
la Poéfie 6c la Peinture : c’eft à ce principe commun
que fe rapportent tous les beaux-arts, comme l’a
montré M. le Batteux. Mais cette imitation n’a pas
pour tous la même étendue. Tout ce que l’imitation
peut fe repréfenter eft du reffort de la Poéfie. La
Peinture , qui n’offre point fes tableaux à l’imagination
, mais aux fens 6c à un feul fens , ne peint que
les objets fournis à la vue. La Mufique fembleroit
avoir les mêmes bornes par rapport à l’ouie ; cependant
elle peint tout, même les objets qui ne font
que vifibles : par un preftige prefque inconcevable,
elle femble mettre l’oeil dans l’oreille , 6c la plus
grande merveille d’un art qui n’agit que par le mouvement
, eft d’en pouvoir former jufqu’à l’image du
repos. La nuit, le fommeil, la folitude & le filence
entrent dans le nombre des grands tableaux de la
Mufique. On fait que le bruit peut produire l’effet
du filence, & le filence l’effet du bruit : comme quand
on s’endort à une le&ure égale & monotone, 6c qu’on
s’éveille à l’inftant qu’elle ceffe. Mais la Mufique agit
plus intimement fur nous en excitant, par un fens,
des affettions femblables à celles qu’on peut exciter
par un autre ; & , comme le rapport ne peut être
fenfible que l’impreflion ne foit forte , la Peinture
dénuée de cette force ne peut rendre à la Mufique
les imitations que celle-ci tire d’elle. Que toute la
nature foit endormie, celui qui la contemple ne dort
pas, & l’art du muficien confifte à fubftituer à l’image
infenfible de l’objet celle des mouvemens que fa
préfence excite dans le coeur du contemplateur. Non-
feulement il agitera la mer, animera la flamme d’un
incendie, fera couler les ruiffeaux, tomber la pluie,
groflir les torrens ; mais il peindra l’horreur d’ufi
défert affreux , rembrunira les murs d’une prifon
fouterreine, calmera la tempête, rendra l’air tranquille
6c ferein, 6c répandra de l’orcheftre une fraîcheur
nouvelle fur les boccages. Il ne repréfentera
pas direttement ces chofes, mais il excitera dans
l’ame les mêmes mouvemens qu’on éprouva en les
voyant.
J’ai dit au mot Harmonie , (Mufiq.) Suppl, qu’on
ne tire d’elle aucun principe qui mene à Y imitation
muficale , puifqu’il n’y a aucun rapport entre des
accords & les objets qu’on veut peindre , ou les
pallions qu’on veut exprimer. Je ferai voir au mot
Mélodie quel eft ce principe que l’harmonie ne
fournit pas, & quels traits donnés par la nature font
employés par la Mufique pour repréfenter ces objets
6 c ces pallions.' ( S )
On dit à Y article Imitatio n , dans le Dictionnaire
raifonné des Sciences , &c. « Les grands maîtres la
» dédaignent, & toute imitation trop affe&ée décele
» prefque toujours un écolier en compofition ».
Comme je fuis très-perfuadé que lë fentiment de
M. Rouffeau eft d’un grand poids en mufique , je
crois devoir commenter, pour ainfi dire, cette idée.
D ’abord que , pour faire une imitation , on gâte
ou l’on altéré un beau chant, on a tort ; mais fi Y imitation
peut avoir lieu fans cela, pourquoi ne pas en
faifir l’occafion , fur-tout lorfque le trait de chant
imité eft une des idées principales de la piece. Il en eft
de Y imitation comme du contre-point double; (y oye^czx.
article, (Mufiq.) Suppl.) ; fans elle, on ne peut guere
faire une piece à plufieurs parties récitantes, car
chaque partie ne peut pas toujours annoncer un.
motif nouveau ; & fi l’on fait répéter le même trait
fucceflivement à chaque partie 6c dans la même harmonie,
l’ennui s’en mêlera bientôt.
imitation fournit auffi le moyen de reproduire
fouvent le même motif fous un afpeâ: nouveau , 6c
en diminuant ou augmentant fon effet fuivant l’exigence
du cas. Car , par exemple , fi l’on veut augmenter
l’effet du motif, on l’annoncera dans le premier
deffus , on l’imitera dans les autres parties, en
liii donnant un accompagnement foible , & d’un
chant peu marqué. Mais fi l’on veut faire reffouvenir
l’auditeur du motif fans l’en occuper entièrement,
on l’annoncera dans les parties inférieures ; on l’imitera
dans une de ces mêmes parties, tandis que le
deffus aura pour accompagnement un chant plein 6c
bien marqué ; il eft clair que pour que cela fe puifle,
il faut que le trait de chant imité foit fimple.
Je ne vois pas comment les duo , les t r io , 6 c c .
pourront avoir lieu fur le théâtre fans imitation.
Fera-t-on chanter les deux parties enfemble à la
tierce ou à la fixte ? Quel ennui , pour peu que la
piece foit longue ! D’ailleurs ce que j’ai dit à Y article
F u g u e revient encore ici*. Eft-il plus naturel que
deux trois ou plus de perfonnes commencent
à chanter toutes enfemble les mêmes paroles , fur
le même air , ou qu’elles commencent à quelque
diftance l’une de l’autre, & en mettant dans leur
chant des différences analogues à leur caraftere,
fans que pour cela le chant d’une des perfonnes contredite
celui de l’autre ? Or voilà précifément ce que
fait & enfeigne Yimitaùon ; par elle on apprend juf-
qu’à quel point on peut changer un chant, fans qu’il
perde entièrement fa phyfionomie.
Il y a différentes fortes d ’imitations.
L'im itation renverfée ou en rétrogradant, lorfque
la partie imitante répété à reculons les notes de la
partie principale, c’eft-à-dire en commençant par la
derniere , 6c finiffant par la première.
\Jimitation liée ou contrainte , lorfque la partie
imitante répété exactement 6c note pour note le
I memei
même trait de chant, mais une fécondé, tierce, &c.
plus haut ou plus bas.
limitation par mouvement contraire , que quelques
uns appellent renverfée, quoique Broffard donne
ce nom à celle qui va en rétrogradant, comme nous
l’avons déjà dit. Cette forte limitation a lieu lorfque
la partie imitante répété les notes de la principale
par mouvement contraire, c’eft-à-dire que fi la première
procédé diatoniquement ou par faut en montant,
l’imitante procédé diatoniquement ou par faut
en defeendant, & au contraire.
Enfin Yimitation fimple ou libre, quand on recon-
noît le même chant dans la partie imitante, ^fans
qu’elle obferve les mêmes intervalles ou les mêmes
valeurs de notes que la partie principale. C’eft de
cette derniere forte d'imitation que j ’ai voulu parler.
(F . D . C:)
IMMORTALITÉ, f. f. ( terme de Blafon. ) bûcher
du phénix, nommé ainfi du mot immortel, parce que,
félon la fable, il fe dreffe lui - même fon bûcher, bat
des ailes deffus pour l’allumer, s’y confume, & il y
naît un ver de fa cendre d’oii il fe forme un autre
phénix.
■ On n’exprime Yimmortalité^ en blafonnant, que
ïorfqu’elle fe trouve d’un autre émail que cet oifeau.
Feyne de Lavanne, à Paris ; d'argent au phénix
de fable, furfon immortalité de gueules. ( G ,-D. L. T.)
IMPARFAIT, adj. ( Mufique.) Ce mot a plufieurs
fens en mufique.
Un accord imparfait eft, par oppofition a l’accord
parfait, celui qui porte une fixte ou une diffonance;
& , par oppofition à l’accord plein, c’eft celui qui
n’a pas tous les fons qui lui conviennent 6c qui doivent
le rendre complet. Voyeç A c c o r d , {Mufiq. ) Dicl.
ra if des Sciences, 6c Supplément.
Le tems ou mode imparfait etoit, dans nos anciennes
mufiques , celui de la divifion double. Voyei
MODE , ( Mufique. fD ici. raif. des Sciences, & C .
Une cadence imparfaite eft celle qu’on appelle
autrement cadence irrégulière. Voye{ C a d e n c e ,
( Mufique. ) Dicl. raif. des Sciences, &c. 6c SuppL
Une confonnance imparfaite eft celle qui peut etre
majeure ou mineure, comme la tierce ou la fixte.
Voyei CO N SO N N AN C E , {Mufique.) Dicl. raif. des
Sciences, &c.
On appelle, dans le plein - chant, modes imparfaits
ceux qui font défe&ueux en haut ou en bas, & reftent
en-deçà d’un des deux termes qu’ils doivent atteindre.
{ S )
IMPROVISER , v. n. {Mufique.) c’eft faire &
chanter impromptu des chanfons, airs & paroles ,
qu’on accompagne communément d’une guitarre ou
autre pareil inftrument. Il n’y a rien de plus commun
en Italie , que de voir deux mafquesfe rencontrer ,fe
défier, s’attaquer, fe ripofterainfi par des couplets fur
le même air avec une vivacité de dialoguq, de chant,
d’accompagnement dont il faut avoir été témoin
pour la comprendre.
Le mot improvifar eft puremen^italien ; mais comme
il fe rapporte à la mufique, j’ai été contraint de
le francifer pour faire entendre ce qu’il lignifie. { S )
IMPUISSANCE, ( Méd~ légale.) Nos tribunaux
étoient plus fouvent occupés, autrefois à décider de la
validité de cette imputation ; Yimpuiffance prouvée eft
unecaufe de divorce ; & le but du mariage ne pouvant
fe remplir par la difformité de l’un des conjoints;, il
falloit bien que les loix y portaffent remede. Le petit
nombre de caufes de cette efpece, dans ces derniers
tems , fembleroit annoncer que les hommes font
moins jaloux d’avoir une poftérité, à moins qû’on
ne voulût fuppofer que les défauts de conformation
font plus rares.
On peut vo ir dans Y article IMPUISSANCE, {Méd.)
Dicl. raif. des Sciences, &c. les différentes efpeces
Tome I I I%
Yimpuiffance ^ ou leurs caufes reconnues; & pour peu
qu’on voulût porter dans cette queftion le feepti-
cifme raifonnable qu’infpirent les connoiffances po-
fitives, on s’étonneroit de la confiance de nos peres,
& même de quelques-uns de nos modernes.
Il eft fingulier que les femmes aient prefque toujours
été demandereffes & les hommes défendeurs
dans les procès pour fait Yimpuiffance ; on a expliqué
cetre fingularité par des moyens qui ne faifoient pas
l’éloge du fexe, mais ces allégations vagues rapportées
par des auteurs qui fe font copiés, ne prou- .
veroient pas plus la dépravation des moeurs d’autrefois
, que le filence de nos femmes ne feroit l’éloge
des moeurs a&uelles. Les caufes du divorce & fes
effets concernent encore plus la politique ou les loix
fociales, qu’elles n’intéreffent la religion & la médecine
: laiffons prononcer le légiflateur qui veut s’éclairer
fur fes vrais intérêts, & ne relevons que les
erreurs dangereufes qui font de notre reffort.
Parmi ces erreurs, l’une des plus remarquables fut
le congrès public qui affervit à l’opinion & aux cir-
conftances, celui de tous les aâes des hommes qui
devoit le moins en dépendre. Vçy. C o n g r è s , ibid.
Ce moyen ridicule & indécent, avoit été précédé
par des moyens encore plus abfurdes : les épreuves
par le fer & le feu, 6c les combats des champions
en champ clos, avoient été mis en ufage dans des
tems barbares, pour attefter l’impuiffance des accu-
fés. Une époque affez mémorable, dans notre jurif-
prudence, fit difparoître ce monftrueux affemblage
de cruautés ridicules.
L’arrêt de 1684, au fujet de l’affaire du marquis
de Langey éteignit, fans doute pour toujours, un
genre de preuve que le-befoin fembloit avoir, fait
imaginer, & s’il eft permis de le dire, les loix perdirent
prefque une reffource , que l’intérêt de la
fociété rendoit quelquefois utile.
Une autre erreur, non moins abfurde, eft celle qui
compte les maléfices parmi les. caufes Yimpuiffance
6c de ftérilité. L’empereur Juftinien ordonna dans la
loi première, au code De Repudiis, que l’on pronon-
ceroit la diffolution du mariage, quand un mari & une
femme auroient demeuré enfemble deux ans fans le
confommer, & bientôt après ii prolongea ce terme de
deux ans jufqu’à trois. Dans l’ufage de cette lo i, les
papes ordonnèrent que le mariage étant déclaré nul
par le défaut du mari, s’il époufoir une autre femme
dont il eût des enfans, il feroit obligé de retourner
avec la première en cas que Yimpuiffance dont il
avoit été taxé eût procède d’une caufe naturelle ;
mais qu’il ne feroit pas obligé de la reprendre, fi fon.
impuiffance avoit été caufée par maléfice.
Cette efpece de fanélion, dont l’erreur fut revêtue,
la rendit refpedable , 6c l’on ceffa de douter
que le maléfice pût avoir un effet. Tous les auteurs,
tant jurifconfultes que médecins, fe copièrent à la
file , & malgré le progrès des connoiffances , on
voit encore l’auteur de Yarticle F r ig id i t é , du
Dicl. raif. des Sciences , en regarder les maléfices
comme la caufe. Il fuffit d’avoir cité cette opinion
au tribunal de la bonne phyfique, pour être diipenfé
de la réfuter avec détail. ( Cet article efi de M. LA
F o s s e , Docteur en Médecine. )
I N
INACHUS, ( Géogr. ) petit fleuve du Peloponefe ;
dans l’Argôlide , dont parle Virgile, Æn. liv. VU ;
il paffoit à Argos & fe jettoit dans le golfe voifin ;
il prit ce nom Ylnachus, qui fonda, vers le tems
d’Abrahâm, le royaume d’Argos, le plus ancien de
la Grece : il étoit étranger, & on a lieu de croire
qu’il yenoit * de -Phénicie ; fes defenen ndans jouirent __