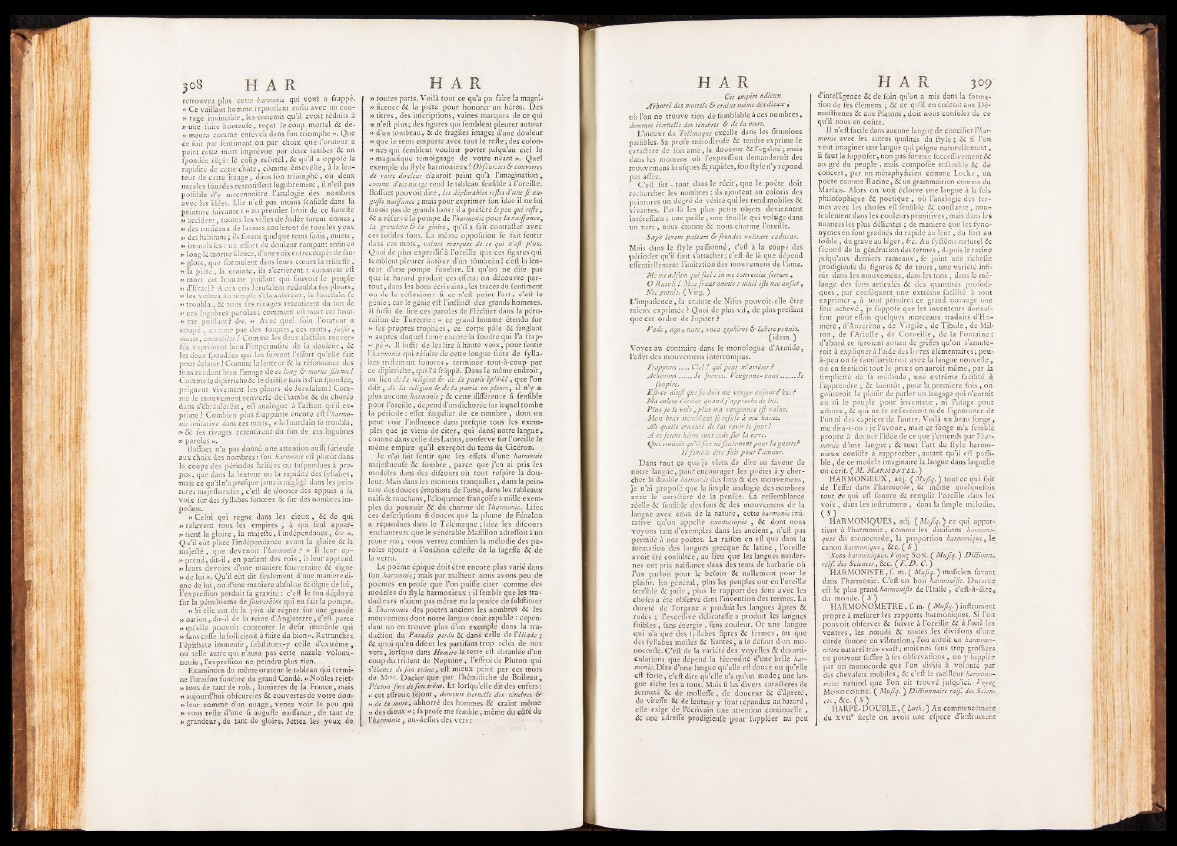
retrouvez plus cette harmonie qui vous a frappe.
« Ce vaillant homme repouffant enfin avec un cou-
» rage invincible , les ennemis qu’il avoit réduits à
» une fuite honteufe, reçut le coup mortel & de-
» meura comme enféveli dans fon triomphe ». Que
ce foit par fentiment ou par choix que l’orateur a
peint cette mort imprévue par deux iambes & un
fpondée reçût lë coup mortel, & .qu’il a oppofe la
rapidité de cette chute, comme ënsëvëlïe, à la lenteur
de cette image, dans fôn triomphe , ou deux
nazales fôurdes retentiffent lugubrement, il n’eft pas
polîible d’y meconnoître l’analogie des nombres
avec les idées. Elle n’eft pas moins fenfible dans la
peinture fuivante : « au premier bruit de ce funefte
» accident, toutes les villes de Judée furent émues ,
» des ruiffeaux de larmes coulèrent de tous les yeux
» des habirans ; ils furent quelque tems faifis, muets,
» immobiles : un effort de douleur rompant enfin ce
» long & morne filence, d’une voix entrecoupée de fan-
» glots, que formoient dans leurs coeurs la trifteflé ,
» la piété , la crainte, ils s’écrièrent : .comment ëft
» mort cet homme puiffant qui fauvoit le peuple
»> d’ffrael? A ces cris Jérufalem redoubla fes pleurs,
» les voûtes du temple s’ébranlèrent, le Jourdain fe
» troubla , & tous fes rivages retentirent du fon de
» ces lugubres paroles : comment eft mort cet hom-
» me puiffant? &c. » Avec quel foin l’orateur a
coupé , comme par des foupirs , ces mots , faifis,
muets, immobiles ! Comme les deux da&iles renver-
fés expriment bien l’impétuofité de la douleur, &
les deux fpondées qui les fuivent l’effort qu’elle fait
pour éclater ! Comme la lenteur & la réfonnance des
ions rendent bien l’image de ce long & morne filence!.
Comme le dipirriche &: le daélile fuivis d’un fpondée,
peignent vivement les pleurs de Jérufalem! Comme
le mouvement renverfé de l’iambe & du chorée.
dans s’ébranlèrent, eft analogue à l’a&ion qu’il exprime
! Combien plus frappante encore eft l’harmonie
imitative dans ces mo.ts, « le Jourdain fe troubla,
w & fes rivages retentirent du fon de ces lugubres
» paroles ».
Boffuet n’a pas donné une attention auffi ferieufe
aux choix des nombres : fon harmonie eft plutôt dans
la coupe des périodes brifées ou fufpendues à propos,
que dans la lenteur ou la rapidité des fyllabes,
mais ce qu’il n’a prefque jamais négligé dans les peintures
majeftueufes , c’eft de olonner des appuis à la
voix fur des fyllabes fonores & fur des nombres im-
pofans.
« Celui qui régné dans les deux , & de qui
» relevent tous les empires , à qui feul appar-
» tient la gloire , la majefté, l’indépendance, &c ».
Qu’il eût placé l’indépendance avant la gloire & la
majefté , que devenoit Vharmonie ? « Il leur ap-
» prend, dit-il, en parlant des rois , il leur apprend
» leurs devoirs d’une maniéré fouveraine & digne
» de lui». Qu’il eût dit feulement d'une maniéré digne
de lu i, ou d’une maniéré abfolue & digne de lui,
l ’expreflion perdoit fa gravité : c’eft: le fon déployé
fur la pénultième de fouveraine qui en fait la pompe.
« Si elle eut de la joie de régner fur une grande
» nation, dit-il de la reine d’Angleterre, ç’eft parce
» qu’elle pouvoir contenter le delir ïmmênfe qui
» fans ceffe lafollicitoit à faire du bien». Retranchez
l ’épithete immenfe , fubftituez-y celle d’extrême ,
ou telle autre qui n’aura pas cette nazale volumi-
neufe , l’expreffion ne. peindra plus rien.
Examinons du même orateur le tableau qui termine
l’oraifon funebre du grand Condé. « Nobles rejet-
» tons de tant de rois, lumières de la France, mais
» aujourd’hui obfcurcies & couvertes de votre doubleur
comme d’un nuage, venez voir le peu qui
» vous refte d’une û augufte naiffance , de tant de
»grandeur, de tant de gloire. Jettez;ies yeux de
» toutes parts. Voilà tout ce qu’a pu faire la magni-
» ficence & la piété pour honorer un héros. Des
» titres, des inferiptions, vaines marques de ce qui
» n’eft plus; des figures qui femblent pleurer autour
» d’un tombeau, & de fragiles images d’une douleur
» que le tems emporte avec tout le refte ;.des colôn-
» nés qui femblent vouloir porter jufqu’au ciel le
» magnifique témoignage de votre néant ». Quel
exemple duftyle harmonieux! Obfcurcies&couvertes
de votre douleur n’auroit peint qu’à l’imagination ,
comme d'un nuage rend le tableau fenfible à l’oreille.
Boffuet pouvoit dire, les déplorables refies d'une f i au-
gufie naiffance ; mais pour exprimer fon idée il ne lui
fattoit pas de grands Tons : il a préféré le peu qui refie,
& a réfervé la pompe de l’harmonie pour la naifjance9
la grandeur & la gloire, qu’il a fait contrafter avec
ces foibles fons. La même oppofition fe fait fentir
dans ces mots , vaines marques de ce qui nefi plus.
Quoi de plus expreflif à l’oreille que ces figures qui
femblent pleurer autour d’un tombeau ! c’eft la lenteur
d’une pompe funebre. Et qu’on ne dife pas
que le hazard produit ces effets: on découvre partout,
dans les bons écrivains, les traces du fentiment
ou de la réflexion: fi ce n’eft point l’art, c’eft'le
génie ; car le génie eft l’inftinéJ des grands hommes.
Il fufnt de lire ces paroles de Fléchier dans la péro-
raifon de Turenne: « ce grand homme étendu fur
» fes propres trophées, ce corps pâle & fanglant
» auprès duquel fume encore la foudre qui l’a frap-
» pé ». Il fuffit de les lire à haute v o ix , pour fentir
l'harmonie qui réfulte de cette longue fuite de fyllabes
triftement fonores, terminée tout-à-coup par
ce dipirriche, qui l’a frappe. Dans le même endroit,
au lieu de la religion & de la patrie éplorée , que l’on
dife , de la religion & de la patrie en pleurs, il n’y a
plus aucune harmonie ; & cette différence fi fenfible
pour l’oreille, dépend d’un dichorée fur lequel tombe
la période : effet fingulier de ce nombre , dont on
peut voir l ’influence dans prefque tous les exemples
que je viens de citer, qui dans] notre langue,
comme dans celle des Latins, conferve fur l’oreille le
même empire qu’il exerçoit du tems de Cicéron.
Je n’ai fait fentir que les effets d’une harmonie
majeftueufe & fombre , parce que j’en ai pris les
modèles dans des difeours où tout refpire la douleur.
Mais dans les momens tranquilles , dans la peinture
des douces,émotions de l’ame,dans les tableaux
naïfs & touchans, l’éloquence françoife a mille exemples
du pouvoir & du charme de l’harmonie. Lifez
ces deferiptions fi douces que la plume de Fénelon
a répandues dans le Télémaque ; lifez les difeours
enchanteurs que le vénérable Mafîillon adreffoitàun
jeune roi ; vous verrez combien la mélodie des paroles
ajoute à l ’onûion célefte de la fageffe & de
la vertu.
Le poème épique doit être encore plus varié dans
fon harmonie; mais par malheur nous avons peu de
poèmes en profe que l’on puiffe citer comme des
modèles du ftyle harmonieux : il femble que les traducteurs
n’aient pas même eu la penfée de fubftituer
à l’harmonie. des poètes anciens les nombres & les
mouvemens dont notre langue étoit capable : cependant
on en trouve plus d’un exemple dans la traduction
du Paradis perdu & dans celle de XIliade ;
& quoi qu’en difent les partifans trop zélés de nos
vers, lorfque dans Homere la terre eft ébranlée d’un
coup du trident de Neptune , l’effroi de Pluton qui
$’élance de fon trône, eft mieux peint par ces mots
de Mme. Dacier que par l’hémiftiche de Boileau,
Pluton fort de fon trône. Et lorfqu’elle dit des enfers :
« cet affreux, féjour, demeure éternelle des ténèbres 6*
» de la morij abhorré des hommes & craint même
» des dieux » ; fa profe me femble , même du côté de
l'éj&rmonie > aurdeffus des vers :: \ I ; H I
Cet empire odieux
Abhorré des mortels & craint même des dieux ,
où l’on ne trouve rien de femblableà ces nombres,
demeure éternelle des ténèbres & de la mort.
L’auteur du Télémaque excelle dans les fituations
paifibles. Sa profe méiodieufe & tendre exprime le
caraCtere de fon aîné, la douceur & l’égalité ; mais
dans les momens où l’expreflion demanderoit des
mouvemens brufques & rapides, fon ftyle n’y répond
pas affez. , .
C ’eft fur-tout dans le récit, que le poète doit
rechercher les nombres : ils ajoutent au coloris des
peintures un dégré de vérité qui les rend mobiles &
vivantes. Par-là les plus petits objets deviennent
intéreffans ; une paille, une feuille qui voltige dans
un vers , nous étonne & nous charme l’oreille.
Scepë levem paleam 6* frondes volitare caducas.
Mais dans le ftyle paflïonné, c’eft à la coupe des
périodes qu’il faut s’attacher; c’eft de là que dépend
effentiellement l’imitation des mouvemens de l’ame.
Me me adfum quifeci : in me convertite ferrum ,
O Rutuli ! Mea fraus omnis : nihil ifie nec aufus,
Necpotu.it. ( Virg. )
L’impatience , la crainte de Nifus pouvoit-elle être
mieux exprimée ? Quoi de plus v if, de plus preffant
que cet ordre de Jupiter?
Vade, âge , nate9 vota çephiros & labere pennis.
(.idem.)
Voyez au contraire dans le monologue d’Armide,
l ’effet des-mouvemens interrompus.
Frappons... .. Ciel ! qui peut m'arrêter?
Athivons ... ...Je frémis. Vengeons-nous........
Çoupiré.
EJl-u <ün£que je dois me venger aujourd'hui?
Ma colere s’t’.teint quandj'approche de lui.
Plus je le vcns y plus ma vengeance efi vaine.
Mon bras t.remblant fè refufe à mà haine.
Ah quelle ci’uauté de lui ravir le jour !
A ce jeune hxêros tout çede fur la terre. |
Qui croiroit qu'il fu t néfeulement pour.la guerre.
I l femble être fait pour l'amour.
Dans tout ce que je viens de dire en faveur de
notre langue,, pour encourager les poètes à y chercher
la double harmonie des fons & des mouvemens,
je n’ai propofé que la fimple analogie des nombres
avec le' caraâère de la penfée. La reffemblance
réelle & fenfible des fons & des mouvemens de la
langue avec ceux de la nature, cette harmonie imitative
qu’on appelle onomatopée , ÔC dont nous
voyons tarit d’exemples dans les anciens, n’eft pas
permife à nos poètes. La raifon en eft que dans la
formation des langues grecque & latine, l’oreille
avoit été confultée, au lieu que les langues modernes
ont pris naiffance dans des tems de barbarie où
l’on parloit pour le befoin & nullement pour le
plaifir. En général, plus les peuples ont eu l’oreille
fenfible & jufte , plus lè rapport des fons avec les
chofés a été obfervé dans l’invention des termes. La
dureté de l’organe a‘ produit les langues âpres &
rudes ; l’exceffive délicateffe a produit lès langues
foibles , fans énergie , fans copieur. Or une langue
qui n’a que des fyllabes âpres & fermes, ou que
des fyllabes molles & liantes, a le défaut d’un monocorde.
C ’eft de la variété des voyelles & dés articulations
que dépend la fécondité d’une belle harmonie.
Dire d\vne langue qu’elle eft douce ou qu’elle
eft forte , c’eft dire qu’elle n’a qu’un mode; une langue
riche les a tous. Mais fi les divers caratteres de
fermeté'Si de moll'effe, de douceur Si d’âpreté,
de vîteffe Si de lenteur y font répandus , au hazard ,
elle-exige de l’écrivain une attention continuelle ,
Si une adreffe prodigieufe pour fuppléer au peu
d’intelligence Si de foin qu’on a mis dans la formation
de fes élémens ; Si ce qu’il en coûtoit aux Dé*
mofthenes Si aux Platons, doit nous confoler de ce
qu’il nous en coûte.
Il n’eft facile dans aucune langue de concilier l'harmonie
avec les autres qualités du ftyle ; Si fi l’on
veut imaginer une langue qui peigne naturellement,
il faut la fuppofer, non pas formée fuCceflïvement Si
au gré du peuple , mais compofée enfemble Si de
concert, par un métaphyficien comme Locke, un
poète comme Racine, Si un grammairien comme du
Mariais. Alors on voit éclorre une langue à la fois
philofophique Si poétique , où l’analogie des termes
avec les chofes eft fènfible Si confiante, non-
feulement dans les couleurs primitives, mais dans les
nuances les plus délicates ; de maniéré que les fyno-
nymes en font gradués du rapide au len t, du fort au
foible, du grave au léger, &c. Au fyftême naturel Si
fécond de la génération des termes, depuis la racine
jufqu’aux derniers rameaux, fe joint une richeffe
prodigieufe de figures Si de tours, Une variété infinie
dans les mouvemens, dans les tons , dans le mélange
des fons articulés Si des quantités prolodi-
ques, par conféquent une extrême facilité à tout
exprimer , à tout peindre: ce grand ouvrage une
fois achevé , je fuppofe que les inventeurs donnaf-
fent pour eflàis quelques morceaux traduits d’Ho-
mere , d’Anacréon, dé Virgile , de Tibule , de Milton,
de l’Ariofte , de Corneille, de la Fontaine :
d’abord ce feroient autant de griffes qu’on s’amufe-
roit à expliquer à l’aide des livres élémentaires; peu-
à-peu on fe familiariferoit avec la langue nouvelle,
on en fentiroit tout lé prix : on auroit même, par la
fimplicité de fa méthode, une extrême facilité à
l’apprendre ; Si bientôt, pour la première fois , on
goûteroit le plaifir de parler un langage qui n’auroit
eu ni le peuple pour inventeur , ni l’ùfage pour
arbitre, Si qui ne fe reffentiroit ni de l’ignorance de
l’un ni des caprices de l’autre. Voilà un beau fonge,
me dira-t-on : je l’avoue, mais ce fonge m’a femblé
propre à donner l’idée de ce que j’entends par l'harmonie
d’une langue; & toutT’art du ftyle harmonieux
confifte à rapprocher, autant qu’il eft poffi-
ble, de ce modèle imaginaire la langue dans laquelle
on écrit. (Af. Ma rm o n t e l .)
HARMONIEUX, adj. ( Mufiq. ) tout ce qui fait
de l’effet dans rharmonie, & même quelquefois
tout <?e qui eft fonore Sç remplit l’oreille dans les
voix , dans les inftrumens , dans la fimple mélodie*
m RH
ARMONIQUES, adj. (Mufiq.') ce qui appartient
à l’harmonie, comme les divifions harmoniques
du monocorde, la proportion harmonique, le
canon harmonique, Sic. ( S )
Sons harmoniques. P'oye^ S ON. ( Mufiq. ) Diclionn.
raif. des Sciences ,_&c.' ('F. D . C. )
HARMONISTE, f. m. ( Mufiq. ) muficien favant
dans l’harmonie. C’eft un bon harmonifie. Durante
eft le plus grand harmonifie de l’Italie , c’eft-à-dire,
du monde. ( S )
HARMONOMETRE, f. m. ( Mufiq.') infiniment
propre à mefurer les rapports harmoniques. Si l’on
pouvoit obferver & fuivre à l’oreille & à l’oeil les
ventres, les noeuds & toutes les"clîvifions d’une
I corde fonore en vibration , l’on auroit un harmono-
métré naturel très-exaél; mais nos fens trop grofliers
ne pouvaut fuffire. à fes obfervatipns , on y fupplée
par un monocorde que l’on divife à volonté par
• des chevalets mobiles, & c’eft le meilleur harmono-
mitre naturel que l’on ait trouvé jufqu’ici. Vçye^
MONOCORDE. ( Mufiq. ) Dictionnaire raif. des Scien-
: &C. ( S )
H A R P E - D O U B L E , ( Luth. ) Au commencement
du xvii® fieçle on avoit une efpece d’inftrümenr