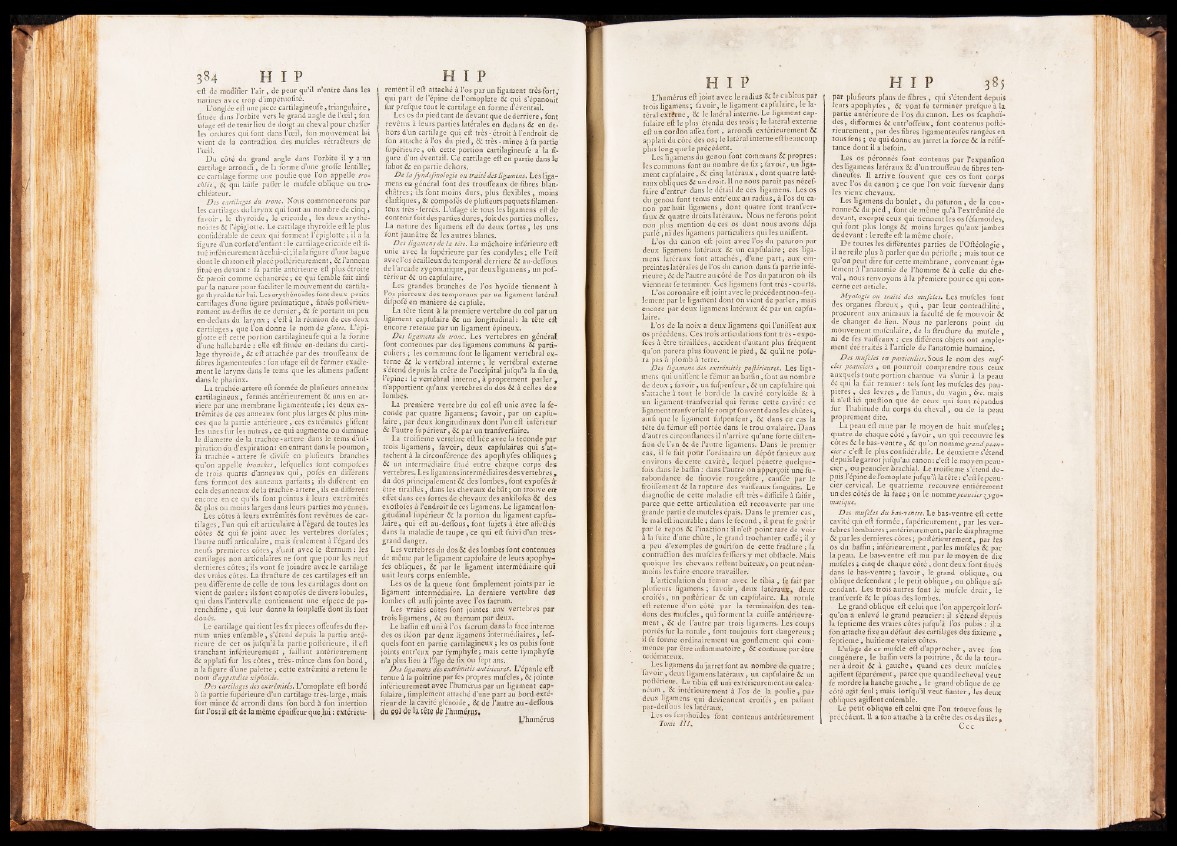
eft de modifier l’a ir , de peur qu’il n’entre dans les
narines avec trop d’impétuofite.
Donglée eft une piece cartilagineufe, triangulaire,
fituée dans l’orbite vers le grand angle de l’oeil; fon
ufage eft de tenir lieu de doigt au cheval pour chaffer
les ordures qui font dans l’oeil, fon mouvement lui
vient de la contraûion des mufcles rétraâeurs de
l’oeil.
Du côté du grand angle dans l’orbite il y a un
cartilage arrondi, de la forme d’une groffe lentille;
ce cartilage forme une poulie que l’on appelle tro-
chlk\ 6c qui lailfe paffer le mufcle oblique ou tro-
chléateur.
Des cartilages du tronc. Nous commencerons par
les cartilages du larynx qui font au nombre de cinq ,
favoir, le thyroïde, le cricoïde, les deux arythé-
noïdes & l’épiglotte. Le cartilage thyroïde eft le plus
confidérable de ceux qui forment l’épiglotte ; il a la
figure d’un corfet d’enfant: le cartilage cricoïde eft fi-
îué inférieurement à celui-ci; il a la figure d’une bague
dont le chaton eft placé poftérieurement, & l’anneau
fitué en devant : fa partie antérieure eft plus étroite
& paroît comme échancrée ; ce qui femble fait ainfi
par la nature pour faciliter le mouvement du cartilage
thyroïde fur lui. Les arythénoïdes font deux petits
cartilages d’une figure prifmatique, fitués poftérieurement
au-deffus de ce dernier, & fe portant un peu
en-dedans du larynx ; c’eft à la réunion de ces deux
cartilages, que l’on donne le nom de glotte. L’épiglotte
eft cette portion cartilagineufe qui a la forme
d’une hallebarde : elle eft fituée en-dedans du cartilage
thyroïde, & eft attachée par des trouffeaux de
fibres ligamenteufes : fon ufage eft de fermer exactement
le larynx dans le tems que les alimens paffent
dans le pharinx.
La trachée-artere eft formée de plufieurs anneaux
cartilagineux, fermés antérieurement 6c unis en arriéré
par une membrane ligamenteufe ; les deux extrémités
de ces anneaux font plus larges 6c plus minces
que la partie antérieure , ces extrémités gliffent
les unes fur les autres, ce qui augmente-ou diminue
le diamètre de la trachée - artere dans le tems d’inf-
piration du d’expiration : en entrant dans le poumon,
la trachée - artere fe divife en plufieurs branches
qu’on appelle bronches, lefquelles font compofées
de trois quarts d’anneaux qui, pofés en différens
fens forment des anneaux parfaits ; ils different en
cela des anneaux de la trachée-artere, ils en different
encore en ce qu’ils font pointus à leurs extrémités
6c plus ou moins larges dans leurs parties moyennes.
Les côtes à leurs extrémités font revêtues de cartilages,
l’un qui eft articulaire à l’égard de toutes les
côtes & qui fe joint avec les vertebres dorfales;
l’autre aufli articulaire, mais feulement à l’égard des
neufs premières côtes, s’unit avec le fternum : les
cartilages non articulaires ne font que pour les neuf
dernieres côtes; ils vont fe joindre avec le cartilage
des vraies côtes. La ftruclure de ces cartilages eft un
peu différente de celle de tous les cartilages dont on
vient de parler : ils font compofés de divers lobules,
qui dans l’intervalle contiennent une efpece de pa-
renchifme, q.ui leur donne la foupleffe dont ils font
doués.
Le cartilage qui tient les fix pièces offeufes du fternum
unies enfemble, s’étend depuis la partie antérieure
de cet os jufqu’à la partie poftérieure, il eft
tranchant inférieurement , faillant antérieurement
6c applati fur les côtes, très-mince dans fon bord,
a la figure d’une palette ; cette extrémité a retenu le
nom d’appendice xiphoïdc.
Des cartilages des extrémités. L’omoplate eft bordé
à fa partie fupérieure d’un cartilage très-large, mais
fort mince & arrondi dans fon bord à fon inlertion
fiir l’os: il eft de la même épaiffeur que lpi : extérieur
renient il eft attaché à l’os par un ligament très-fort,’
qui part de l’épine de l’omoplate 6c qui s’épanouit
fur prefque tout le cartilage en forme d’éventail.
Les os du pied tant de devant que de derrière, font
revêtus à leurs parties latérales en dedans & en dehors
d’un cartilage qui eft très - étroit à l’endroit de
fon attache à l’os du pied, 6c très - mince à fa partie
fupérieure, oit cette portion cartilagineufe a la figure
d’un éventail. Ce cartilage eft en partie dans le
iàbot 6c en partie dehors.
De la fyndefmologie ou traité des ligamens. Les liga—
mens en général font des trouffeaux de fibres blanchâtres;
ils font moins durs, plus flexibles i moins
élaftiques , & compofés de plufieurs paquets filamenteux
très-ferrés. L’ufage de tous les ligamens eft de
contenir foit des parties dures, foit des parties molles.
La nature des ligamens ëft de deux fortes, les uns
font jaunâtre 6c les autres blancs.
Des ligamens de la tête. La mâchoire inférieure eft
unie avec la fupérieure par fes condyles ; elle l’eft
avec l’os écailleux du temporal derrière 6c au-deffous
de l ’arcade zygomatique, par deux ligamens, un pof-
térieur 6c un capfulaire.
Les grandes branches de l’os hyoïde tiennent à
l’os pierreux des temporaux par un ligament latéral
difpofé en maniéré de capfule.
La tête tient à la première vertebre du col par un
ligament capfulaire 6c un longitudinal: la tête eft
encore retenue par urt ligament épineux.
Des ligamens du tronc. Les vertebres en général
, font conténues par des ligamens communs 6c particuliers
; les communs font le ligament vertébral externe
6c le vertébral interne ; le vertébral externe
s’étend depuis la crête de l’occipital jufqu’à la fin de
l’épine: le vertébral interne, à proprement parler,
n’appartient qu’aux vertebres du dos 6c à celles des
lombes.
La première vertebre du col eft unie avec la fécondé
par quatre ligamens; favoir, par un capfulaire
, par deux longitudinaux dont l’un eft inférieur
6c l’autre fupérieur, 6c par un tranfverfaire.
La troifieme vertebre eft liée avec la féconde par
trois ligamens, favoir, deux capfulaires qui s’attachent
à la circonférence des apophyfes obliques ;
6c un intermédiaire fitué entre chaque corps des
vertebres. Les ligamens intermédiaires des vertebres ,
du dos principalement 6c des lombes,font expofés k
être tiraillés, dans les chevaux de bât ; on trouve enr
effet dans ces fortes de chevaux des ankilofes & des
exoftofes à l’endroitdeces ligamens. Le ligament longitudinal
fupérieur 6c la portion du ligament capfulaire,
qui eft au-deffous, font fujets à être affeâés
dans la maladie de taupe , ce qui eft fuivi d’ün très-
grand danger.
Les vertebres du dos & des lombes font contenues
de même par le ligament capfulaire de leurs apophyfes
obliques, 6c par le ligament intermédiaire qui
unit leurs corps enfemble.
Les os de la queue font Amplement joints par ïô
ligament intermédiaire. La derniere vertebre des
lombes eft aufli jointe avec l’os facrum.
Les vraies côtes font jointes aux vertebres par
trois ligamens, 6c au fternum par deux.
Le baflïn eft uni à l’os facrum dans la face interne
des os iléon par deux ligamens intermédiaires, lef-
quels font en partie cartilagineux ; les os pubis font
joints entr’eux par fymphyle; mais cette fymphyfe
n’a plus lieu à l’âge de fix ou fept ans.,
Des ligamens des extrémités antérieures. L’épaule eft
tenue à la poitrine par fes propres mufcles, & jointe
inférieurement avec l’humérus par un ligament capfulaire
, Amplement attaché d’une part au bord extérieur
de la cavité glénoïde, 6c de l ’autre au-deffous
du col de la tête de {’humérus,
^’humérus
L’humérus eft joint avec le radius 6c le cubitus par
trois ligamens; favoir, le ligament capfulaire, le latéral
exttrne, 6c le latéral interne. Le ligament capfulaire
eft le plus étendu des trois ; le latéral externe
eft un cordon aflèz for t, arrondi extérieurement-&
applati du côté des os; le latéral interne eft beaucoup
plus long que.le précédeht.
Les ligamens du genou font communs & propres:
les communs font au nombre de fix ; favoir, un ligament
capfulaire, 6c cinq latéraux , dont quatre latéraux
obliques 6c un droit. Il ne nous paroît pas nécef-
faire d’entrer dans le détail de cés ligamens. LeS os
du genou font tenus entr’eux au radius, à l’os du canon
par huit ligamens, dont quatre font tranfver-
faux & quatre droits latéraux. Nous ne ferons point
non plus mention de ces os dont nous avons déjà
parlé, ni des ligamens particuliers qui les unifient.
L’os du canon eft joint avec Pos du paturon par
deux ligamens latéraux & un càpïulaire ; ces liga-.
mens latéraux font attachés, d’une part, aux empreintes
latérales de l’os du canon dans fa partie inférieure
; 6c de l’autre au côté de l’os du paturon où ils
viennent fe terminer. Ces ligamens font très-courts.
L’os coronaire eft joint avec le précédent non-feulement
par le ligament dont on vient de parler, mais
encore par deux ligamens latéraux 6c par un capfulaire.
L’os de la noix a deux ligamens qui l’unifient aux
os précédens. Ces irois articulations font très - expo-
fées à être tiraillées, accident d’autant plus fréquent
qu’on parera plus fouvent le pied, 6c qu’il ne pofe-
ra pas à p l o m b à terre.
Des ligamens des extrémités pojtérieures. Les liga-'
métis qui unifient le-fémur au baifin, font au nombre
de deux ; favoir r un fufpenfeur, 6c un capfulaire qui
s’attache à tout le bord de la cavité cotyloïde 6c à
un ligament trànfverfal qui ferme cette cavité: ce
ligament tranfverfal fe rompt fouvent dans les chûtes,
ainfi que le ligament fufpenfeur, 6c dans ce cas la
tête du fémur eft portée dans le trou ovalaire. Dans
d’autres circonftances il n’arrive qu’une forte diften-
fiôn de l’un 6c de l’autre ligamens. Dans le premier
cas, il fe fait potir l’ordinaire un dépôt fanieux aux
environs de cette cavité , lequel pénétré quelquefois
dans lé badin : dans l’autre on apperçoit une fu-
rabondanee de finovie rougeâtre , caufée par le
froidement 6c la rupture des vaiffeaux fanguins. Le
diagnoftic de cette maladie eft très - difficile à faifir,
parce que cette articulation eft recouverte par une '
grande partie de mufcles épais. Dans le premier cas,
le mal eft incurable ; dans le fécond , il peut fe guérir
par le repos 6c l’inaétion: il n’eft point rare de voir
à la fuite d’une chute, le grand trochanter caffé ; il y
a peu d’exemples de guérifon de cette fràéhirë ; la
contraction des mufcles feflïers y met obftacle. Mais
quoique les chevaux reftent boiteux, on peut néanmoins
les faire encore travailler.
L’articulation du fémur avec le tibia , fe fait par
plufieurs ligamens; favoir, deux latéraux, deux
croifés, un pQftérieur 6c un capfulaire. La rotule
eft retenue d’un côté par la tèrminaifon des tendons
des mufcles, qui forment la cuiffe antérieurement
, 6c de l’autre par trois ligamens. Les coups
portés fur la rotule , font toujours fort dangereux;
il fe forme ordinairement un gonflement qui commence
par être inflammatoire, 6c continue par être
oedémateux.
Les ligamens du jarret font au nombre de quatre ;
fa voir, deux ligamens latéraux, un capfulaire 6c un
poftérieur. Le tibia eft uni extérieurement au calcanéum
, 6c intérieurement à l’os de la poulie, par
deux ligamens qui deviennent croifés, en paffant
par-delfous les latéraux.
Les os feaphoïdes font contenus antérieurement
Tonie U K
par plufieurs plans de fibres , qui s’étendent depuis
leurs apophyfes , & vont fe terminer prefque à la
partie antérieure de l’os du canon. Les os feaphoïdes,
difformes 6c entr’offéux, font contenus poftérieurement
, par des fibres ligamenteufes rangées en
tous fens ; ce qui donne au jarret la force 6c la réfif-
tance dont il a befoin.
Les ôs peronnes font contenus par l’expanfiort
des ligamens latéraux 6c d’un trouffeau de fibres ten-
dineufes. II arrive, fouvent que ces os font corps
avec l’os du canon ; ce que l’on voit furvenir dans
les vieux chevaux.
Les ligamens du boulet, du paturon , de la cou-
ronne-& du pied , font de. même qu’à l’extrémité de
devant, excepté ceux qui tiennent les os féfamoïdes,
qui font plus longs 6c moins larges qu’aux jambes
de devant : lerefte eft la même chofe.
De toutes les différentes parties de l’O ftéologie,
il ne refte plus à parler que du périofte ; mais tout ce
qu’on peut dire fur cette membrane, convenant éga*
lement à l’anatomie de l’homme & à celle du cheval
, nous renvoyons à la première pour ce qui concerne
cet article.
Myologie ou traité des mufcles. Les mufcles font
des organes fibreux ■> q u i, par leur contraftilité ,
procurent aux animaux la faculté de fe mouvoir 6c
de changer de lieu. Nous ne parlerons .point du
mouvement mufculaire, de la ftru&ure du mufcle,
ni de fes vaiffeaux : ces différens objets ont ample-'
ment été traités à l’article de l’anatomie humaine.
Des mufcles en particulier. Sous. le nom des mufcles
peauciefs , on pourroit comprendre tous ceux
auxquels toute portion charnue va s’unir à la peau
Sç qui la fait remuer: tels font les mufcles des paupières
, des levres , de l’anus, du .vagin , &c. mais
il n’eft ici queftion que de ceux qui font répandus
fur l’habitude du corps du cheval, ou de la peau
proprement dite.
La peau eft mue par le moyen de huit mufcles;
quatre.de chaque côté , favoir, un qui recouvre les
côtes &:<le bas-vëntre, 6c qu’on nomme grand peau-
cier: c’eft le plus confidérable. Le deuxieme s’étend
depuis le garrot jufqu’au canon: c’eft le-moyen peau-
cier, ou peau'cier brachial. Le troifieme.s’érend depuis
l’épine de l’omoplate jufqu’à la tête : ‘c’eft le peau-
cier cervical. Le quatrième recouvre entièrement
un des côtés de la face ; on le nommepeaucier zygomatique.
Des mufcles du bas-ventre. Le bas-ventre eft cette
cavité qui eft formée., fupérieurement, par les vertebres
lombaires antérieurement, parle diaphragme
& par les dernieres côtes; poftérieurement, par les
os du baflïn; inférieurement,parles mufcles 6c par
la peau. Le bas-ventre eft mu par le moyen de dix
mufcles ; cinq de chaque côté, dont deux font fitués
dans le bas-ventre ; favoir, le grand oblique, ou
oblique defeendant ; le petit oblique , ou oblique af-
cendant. Les trois autres font le mufcle droit, le
tranfverfe 6c le pfoas des lombes.
Le grand oblique eft celui que l’on apperçoit lorf-
qu’on a enlevé le grand peaucier : il s’étend depuis
la feptieme des vraies côtes jufqu’à l’os pubis : iba
fon attache fixe au défaut des cartilages des fixieme ,
feptieme , huitième vraies-côtes.
L’ufage de ce mufcle eft d’approcher , avec fon
congénère, le baflin vers la poitrine, & de la tourner
à droit 6c à gauche, quand ces deux mufcles
agiffent féparément, parce que quand le cheval veut
fe mordre la hanche gauche, le grand oblique de Ce
côté agit feul ; mais lorfqu’il veut fianter, les deux
obliques agiffent enfemble.
Le petit oblique eft celui que l ’on trouve fous le
précédent. 11 a fon attache à la crête des os des îles,
C c c