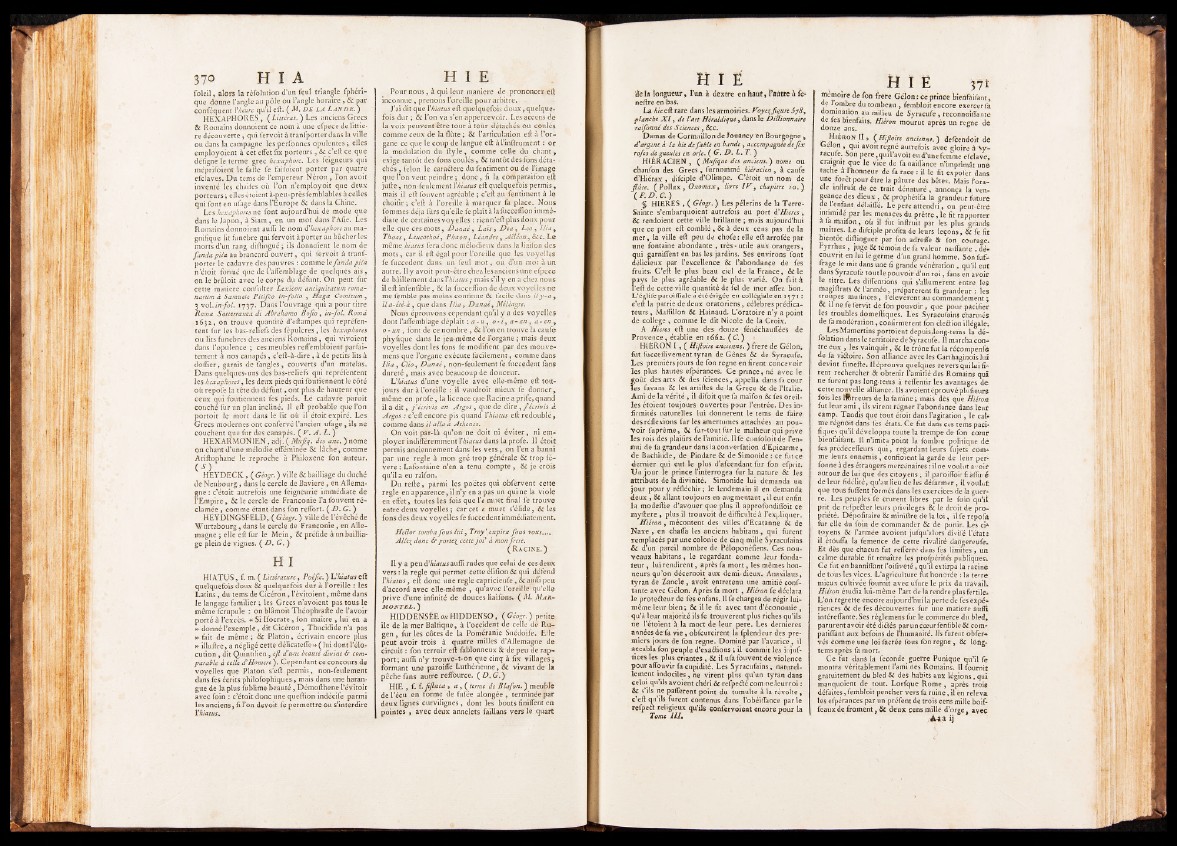
3 7 ° H I A
foleil, alors la réfolution d’un feul triangle fpheri-
que donne l’angle au pôle ou l’angle horaire, & par
conféquent l'heure qu’il eft. ( M. d e la La n d e . )
HEXAPHORES, ( Littéfat. ) Les anciens Grecs
& Romains donnoient ce nom à une efpece de littie-
re découverte, qui fervoit à tranfporter dans la ville
ou dans la campagne les perfonnes opulentes ; elles
employoient à cet effet fix porteurs, & c’eft ce que
déligne le terme grec hexaphore. Les feigneurs qui
méprifoient le faite fe failoient porter par quatre
efclaves. Du tems de l’empereur Néron , l’on avoit
inventé les chaifes où l’on n’employoit que deux
porteurs ; elles étoient à-peu-près femblables à celles
qui font en ufage dans l’Europe & dans la Chine.
Les hexaphores ne font aujourd’hui de mode que
dans le Japon, àSiam, en un mot dans l’Afie. Les
Romains donnoient aufli le nom d'hexaphore au magnifique
lit funebre qui fervoit à porter au bûcher les
morts d’un rang diftingué ; ils donnoient le nom de
fandapila au brancard ouvert, qui fervoit à tranfporter
le cadavre des pauvres : comme le fanda pila
n’étoit formé que de l’affemblage de quelques ais,
on le brûloit avec le corps du défunt. On peut fur
cette matière confulter Lexicon antiquitatum roma-
narum à Samuele Pitifco in-folio , Hagce Comitum,
3 vol. in-fol. 1737. Dans l ’ouvrage qui a pour titre
Roma Sotttrranea di Abrahamo Bojîo, in-fol. Romd
163z , on trouve quantité d’eftampes qui repréfen-
tent fur les bas-reliefs des fepulcres, les hexaphores
ou lits funèbres des anciens1 Romains , qui vivoient
dans l’opulence ; ces meubles reffembloient parfaitement
à nos canapés, e’eft-à-dire , à de petits lits à
doiîier, garnis de fangles, couverts d*un matelas.
Dans quelques-uns des bas-reliefs qui repréfentent
les hexaphores, les deux pieds qui foutiennent le côté
oîi repofe la tête du défunt, ont plus de hauteur que
ceux qui foutiennent fes pieds. Lë cadavre paroît
couché fur un plan incliné. Il eft probable que l’on
portoit le mort dans le lit oit il étoit expiré. Les
Grecs modernes ont confervé l’ancien ufage, ils ne
couchent que fur des canapés. ( V. A. L. )
HEXARMONIEN, adj. ( Mufiq. des anc. ) nome
ou chant d’une mélodie efféminée & lâche, comme
Ariftophané le reproche à Philoxene fon auteur.
{ S ) ..................................
HEYDECK , ( Géogr. ) ville & bailliage du duché
de Neubourg, dans le cercle de Bavière , en Allemagne
: c’étoit autrefois une feigneurie immédiate de
l’Empire & le cercle de Franconie l’a fouvent réclamée
, comme étant dans fon reflbrt. ( D . G. )
HEYDINGSFELD, ( Géogr. ) ville de l’évêché de
Wurtzbourg, dans le cercle de Franconie, en Allemagne
; elle eft fur le Mein, &c préfide à un bailliage
plein de vignes. (Z). G. j
H I
HIATUS, f. m. ( Littérature, Paéfie. ) Uhiatus eft
quelquefois doux & quelquefois dur à l’oreille : les
Latins, du tems de Cicéron y l’évitoient, même dans
le langage familier ; les Grecs n’avoient pas. tous le
même fcrupule : on blâmoit Théophrafte de l’avoir
porté à l’excès. « Si Ifocrate, fon maître , lui en a
» donné l’exemple, dit Cicéron , Thueidide n’a pas
» fait de même ; & Platdn, écrivain encore plus
» illuftre, a négligé cette délicateffe» (luidont l’élocution
, dit Quintilien, eft d'une beauté divine & comparable
à celle d'Homere"). Cependant ce concours de
voyelles que Platon s’eft permis, non-feulement
dans fes écrits philofophiques, mais dans une harangue
de la plus iublime beauté, Démofthene l’évitoit
avec foin : c’étoit donc une queftion indécife parmi
les anciens, fi l’on devoit fe permettre ou s’interdire
V hiatus.
H I E
Pour nous, à qui leur maniéré de prononcer eft
inconnue , prenons l’oreille pour arbitre.
J’ai dit que l'hiatus eft quelquefois doux, quelquefois
dur ; & l’on va s’en apperce voir. Les accens de
la voix peuvent être tour à toür détachés ou coidés
comme ceux de la flûte ; & l’articulation eft à l’organe
ce que le coup de langue eft à l’inftrument : or
la modulation du f ty le , comme celle du chant 9
exige tantôt des fons coulés , & tantôt des fons détachés
, félon le caraétere du fentiment ou de l’image
que l’on veut peindre ; donc, fi la eomparaifon eft
jufte, non-feulement l’hiatus eft quelquefois permis ,
mais il eft fouvent agréable ; c’eft au fentiment à le
choifir ; c’eft à l’oreille à marquer fa place. Nous
fommes déjà fûrs qu’elle fe plaîtàlafucceflion immédiate
de certaines voyelles : rien n’eft plus doux pour
elle que ces mots, Danaé, Lais, Dea, Léo , Ilia9
Thoas, Leucothoé, Phaon, Lèandre , Acléon, &c. Le
même hiatus fera donc mélodieux dans la liaifon des
mots, car il eft égal pour l’oreille que les voyelles
fe fuccedent dans un feul mot, ou d’un mot à un
autre. Il y avoit peut-être chez les anciens une efpece
de bâillement dans l’/iidw ; mais s’il y en a chez nous
il eft infenfible , & la fucceflion de deux voyelles ne
me femble pas moins continue & facile dans ily -a 9
il a-été-à, que dans Ilia, Danaé, Méléagre.
Nous éprouvons cependant qu’il y a des voyelles
dont l’aflemblage déplaît : a- u , o- i , a-an , a - en 9
o-un , font de ce nombre , & l’on en trouve la caufe
phyfique dans le jeu‘même de l’organe ; mais deux
voyelles dont les fons fe modifient par des mouve-
mens que l’organe exécute facilement, comme dans
Ilia , Clio9 Danaé, non-feulement fe fuccedent fans
dureté, mais avec beaucoup de douceur.
Uhiatus d’une voyelle avec elle-même eft toujours
dur à l’oreille : il vaudroit mieux fe donner,
même en profe, la licence que Racine a prife, quand
il a dit, j'écrivis en Argos , que de dire , j écrivis à.
Argos : c’eft encore pis quand l’hiatus eft redoublé ,
comme dans il alla à Athènes.
On voit par-là qu’on ne doit ni éviter, ni employer
indiffèremmentl’/»’<z*w5 dans la profe. Il étoit
permis anciennement dans les vers, on l’en a banni
par une réglé à mon gré trop générale & trop fé-
vere : Lafontaine n’en a tenu compte , & je crois
qu’il a eu raifon.
Du refte, parmi les poètes qui obfervent cette
réglé en apparence, il n’y en a pas un qui ne la viole
en effet, toutes les fois que Ve muet final fe trouve
entre deux voyelles ; car cet e muet s’élide, & les
fons des deux voyelles fe fuccedent immédiatement.
Hector tomba fous lu i, Troy'expira fous vous.....
Aile£ donc & porte£ cette joi à mon frère.
( R a c in e . )
II y a peu d'hiatus z\\K\ rudes que celui de ces deux
vers : la réglé qui permet cette élifion & qui défend
l'hiatus, eft donc une réglé capricieufe, & aufli peu
d’accord avec elle-même , qu’avec l’oreille^qu’elle
prive d’une infinité de douces liaifons. (-M . Mar-
M O N T E L . )
HIDDENSÉE ouHIDDENSO, ( Géogr.) petite
île de la mer Baltique, à l’occident ae celle dé Ru-
gen , fur les côtes de la Poméranie Suédoife. Elle
peut avoir trois à quatre milles d’Allemagne de
circuit : fon terroir eft fablonneux & de peu de rapport;
aufli n’y trouve-t-on que cinq à fix villages j
formant une paroiffe Luthérienne, & vivant de la
pêche fans autre reftource. ( D. G .j
HIE , f. f. fifiuca y a. , ( terme de Blafon. ) meublé
de l ’écu en forme de fufée alongée , terminée par
deux lignes curvilignes, dont les bouts finiffent en
pointes , avec deux annelets faillans vers le quart
H ï Ë
de la longueur, l ’un à dextre en haut, Ëaiitre à fe-
neftre en bas.
La hie eft rare dans les armoiries. Hoye{.figurc 5j 89
planche X I , de l'art, Héraldique, dans le Dictionnaire
raifonné des Sciences, & c.
Damas de Cormaillon de Jouancy en Bourgogne >
d'argent à la hie de fable en bande, accompagnée de f ix
rofes de gueules en orle. ( G. D . L. T. )
H1ÉRACIEN , ( Mufiquè des anciens.) nome ou
chanfon des Grecs , furnommé hieracien, à caufe
d’Hiérax , difciple d’Olitnpe. C ’étoit un nom de
flûte. (P o llu x , Ono/nax, livre IH } chapitre jo, )
( F. D. €. )
§ HIERES , ( Géogr. ) Les pèlerins de la Terre-
Sainte s’embarquoient autrefois au port d'Hieres ;
& rendoient cette ville brillante ; mais aujourd’hui
que ce port eft comblé, & à deux cens pas de la
mer, la ville eft peu de chofe : elle eft arrofée par
une fontaine abondante , très-utile aux orangers,
qui garniffent en bas les jardins. Ses environs font
délicieux par l’excellence & l’abondance de fes
fruits. C ’eft le plus beau ciel de la France, & le
pays le plus agréable & le plus varié* On fait à
l'eft de cette ville quantité dé fel de Mer affez bon.
L’églife paroifliale a été érigée en collégiale en 1571:
c’eft la patrie de deux oratoriens, célébrés prédicateurs
, MafîUIon & Hainaud. L’oratoire n’y a point
de college * comme le dit Nicole de la Croix.
A Hieres eft une des douze fénéchauffées de
Provence j établie en 1661. (6 ’. ) •
H1ÉRON I , ( Hifioire ancienne. ) frere de Gélon,
fut fuceeflivement tyran de Gênes & de Syraeufe.
Les premiers jours de fon régné en firent Concevoir
les plus hautes efpérances. Ce prince 9 né avec le
goût des arts & des fciences, appella dans fa cour
les favans & les artifteS de la Grece & de l’Italie.
Ami de la vérité , il difoit que fa maifon & fes oreilles
étoient toujours ouvertes pour l’entrée. Des infirmités
naturelles lui donnèrent le tems de faire
des réflexions fur les amertumes attachées au pouvoir
fuprême, & fur-tout fur le malheur qui prive
les rois des plaifirs de l’amitié. Il fe confoloit de l’ennui
de fa grandeur dans la converfation d’Epiearme,
de Bachilide, de Pindare & de Simonide : ce futcé
dernier qui eut le plus d’afeendant fur fon efprit.
Un jour lé prince l’interrogea fur la nature & les
attributs de la divinité. Simonide lui demanda un
jour pbur y réfléchir ; le lendemain il en demanda
deux , & allant toujours en augmentant, il eut enfin
la modeftie d’avouer que plus il approfondiffoit ce
myftere , plus il trouvoit de difficulté,à l’expliquer.
Hiéton, mécontent des villes d’Ecatanne & de
Naxe , en chaffa les anciens habitans, qui furent
remplacés par une colonie de cinq mille Syraculàins
& d’un pareil nombre de Péloponéfiens. Ces nouveaux
habitans, le regardant Gomme leur fondateur
, lui rendirent, après fa mort, les mêmes honneurs
qu’on décernoit aux demi-dieux. Anaxilaus,
tyran de Zancle, avoit entretenu une amitié çonf-
tante avec Gélon» Après fa mort , Hiéron fe déclara
le protecteur de fes enfans. U fe chargea de régir lui-
même leur bien ; & il le fit avec tant d’économie ,
qu’à leur majorité ilsfe trouvèrent plus riches qu’ils
ne l’étoient à la mort de leur pere. Les dernieres
années de fa v ie , obfcurcirent la fplendeur des prémiers
jours de fon régné. Dominé par l’avarice, il
accabla fon peuple d’exaéfions ; Ü commit les injuf-
ticés les plus criantes, & il ufa fouvent de violence
pour affouvir fa cupidité. Les Syracufains, naturellement
indociles, ne virent plus qu’un tyran dans
celui qu’ils avoient chéri & refpe&é comme.ieurroi :
& s’ils ne pafferent point du tumulte à la révolte,
c’eft qu’ils furent contenus dans î’obéiffance par le
refpeét religieux qu’ils confervoient encore pour la
Tome H L
H ï Ë Ht
■ | ‘ w/uiuMu , iciiiuiuii ciiLurc exercer la
domination au milieu de Syracüfe ', reconnoiffanté
de fes bienfaits. Hiéron mourut après un régné dé
douze ans.
Hiéron lï , ( Hifioire ancienne. ) deféendoit dé
Gelon , qui avoit régné autrefois avec gloire à Syraeufe.
Son pere,quil’avoit eu d’une femme efclave,
traJgniM ue le vice de fà naiffance n’imprimât unè
tache àThonnéur de fa race : il le fit expolër dans
une forêt pour être la pâture des bêtes. Mais l’oracle
inftruit dé ce trait dénaturé, annonça la vengeance
des dieux , & prophétifa là grandeur future
de l’enfant délaifle. Le pere attendri, ou peut êtré
intimidé par les menaces du prêtre, le fit rapporter
a fa maifon, où il fut inftruit par les plus grands
maîtres. Le difciple profita de leurs leçons, & fe fit
bientôt diftinguer par fon adreffe & fon, courage.
Pyrrhus , juge & témoin de fa valeur naiflante , découvrit
en lui le germe d'un grand homme. Son fuf-
irage lë mit dans une fi grande vénération , qu’il eut
dans Syraculè tout le pouvoir d’un ro i, fans en avoir
le titre; Les diffemions qui s’aflumerent entre |ej
MagiftratS & l’armée, préparèrent fa grandeur : les
troupes mutinées, l’éleverent au commandement ;
& il ne fe fervit de fon pouvoir, que pour pàcifier
les troubles domeftiques. Les Syracufains charmés
de fa modération, confirmèrent fon éleâion illégales
Les Mamertins portoient depuis.iong-tems la dé-
folation dans le territoire de Syraeufe. 11 Marcha contre
eux t les vainquit, & le trône fut la récompenfô
de fa vi&oire» Son alliance avec lés Carthaginois lui
devint funefte. Réprouva quelques revers qui lui firent
recherche!* & obtenir Ëàmitîé des Romains qui
ne furent pas long-tems à reffentir les avantages de
cette nouvelle alliance. Ils avoient éprouvé plufieurs
fois les Erreurs de la famine ; mais dès que Hiéron
fut leur ami, ils virent régner l’abondance dans leur
camp. Tandis que tout étoit dans l’agitation , le cal*
me régnôit dans fes états.,Ce fut dans ces tems paci*
fiques qu’il développa toute la trempe de fon coeur
bienfaifant. Il n’imita point la fombre politique dé
fes prédéceffeurs qui, regardant leurs fujetS corn*
me leurs ennemis , confident la garde de leur per-
fonne à des étrangers mercenaires : il ne voulut avoir
autour de lui que des citoyens ; il paroiffoir fi affûté
de leur fidélité, qu’au lieu de les délàrmer, il voulut
que tous Fuffeht formés dans les exercices de la guer*
re. Les peuples fë crurent libres par le foin qu*iî
prit de refpefler leurs privilèges & le droit de propriété.
Dépofitaire & miniftre de la lo i, il fe repofA
fur elle du foin de commander & de punir. Les ci*
toyens & l’armée avoient jufqu’alors divifé l’état :
il étôuffa la femence de cette rivalité dajngereufei
Et dès que chacun fut refferté dans fes limites , un
calme durable fit renaître les profpérités publiques;
Ge fut en banniffant l’oifivêté, qù’il extirpa la racinë
de tous les vices. L’agriculture fut honorée : la terré
mieux cultivée fournit avec ufure le prix du travail;
Hiéron étudia lui-même l’art de là rendre plus fertile;
L’on regrette encore aujourd’hui la perte de fesëxpé*
riences & ae fes découvertes fur une matière aufli
intéreffante;Ses réglemerts fur le commerce du bled,
parurentavoir étédiâés par Un coeur fenfible& com-
patiffànt aux befoins de l’humanité. Ils furent O.bfer*
vés comme une loi facréë fous fon régné , & long-
tems après fa mort;
Ce fut dans la feConde guetre Punique qu’il fe
montra véritablement l’ami des Romains. Il fournit
gratuitement du bled & des habits aux légions, qui
manquoient de tout. Lorfque Rome, après trois
défaites, fembloit pencher vers fa ruine, il ën releva
les efpérances par un préfeiit de trois cens mille boif-
feaux de froment, & deux cens mille d’orge, avec
A-aa ij