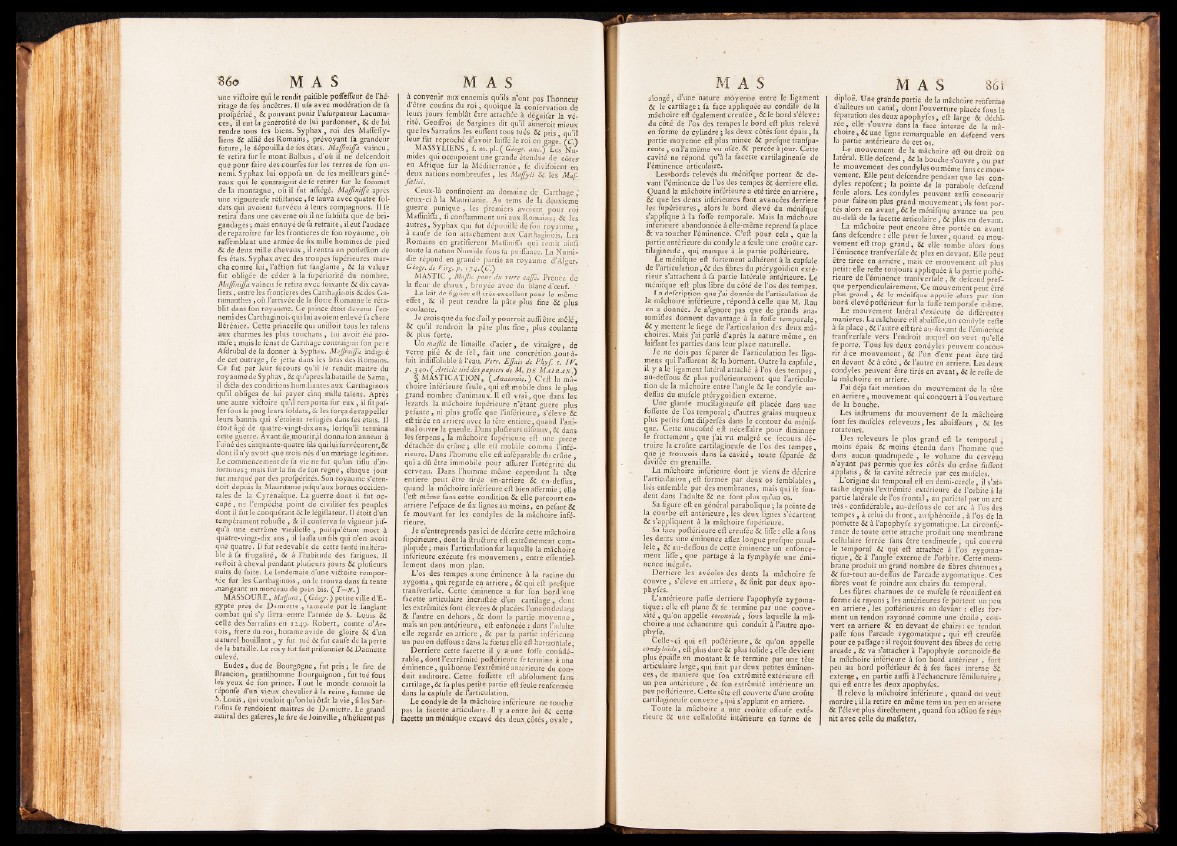
•une vi&oife qui le rendit pailible poffeffeur de l’héritage
de fes ancêtres. Il ufa avec modération de fa
profpérité, & pouvant punir l’ufurpateur Lacuma-
•ces, il eut la générofité de lui pardonner, 6c de lui
rendre tous fes biens. Syphax, roi des Maffeffy-
liens & allié des Romains, prévoyant fa grandeur
future, le dépouilla de fes états. MaJJînifla vaincu.,'
fe retira fur le mont Balbus, d’où il ne defcendoit
que pour faire des courfes fur les terres de fon ennemi.
Syphax lui oppofa un de fes meilleurs généraux
qui le contraignit de fe retirer fur le fommet
de la montagne, où il fut affiégé. MaJJîniJJa après
une vigoureufe réfirtance, fe fauva avec quatre fol-
dats qui avoient fur vécu à leurs compagnons. Il fe
retira dans une caverne où il ne fubfifta que de bri-
gandagës ; mais ennuyé de fa retraite, il eut l’audace
dereparoître fur les frontières de fon royaume, où
raffemblant une armée de fix mille hommes de pied
■ 6c de deux mille chevaux, il rentra en poffeffion de
fes états. Syphax avec des troupes fupérieures marcha
contre lu i,l’aâ:ion fut fanglante, 6c la valeur
fut obligée de céder à la fupériorité du nombre.
Mafftniflaysàwcw fe retira avec foixante 6c dix cavaliers
, entre les frontières des Carthaginois & des Ga-
ramanthes ,où l’arrivée de la flotte Romaine lé rétablit
dans fon royaume. Ce prince étoit devenu l’ennemi
des Carthaginois qui lui avoient enlevé fa chere
Bérénice. Cette princeffe qui uniffoit tous les talens
aux charmés les plus touchans, lui avoit été pro-
mife ; mais le fénat de Carthage contraignit fon pere
Afdrubal de la donner à Syphax. MaJJiniJfa indigné
de cet outrage, fe jetta dans les bras des Romains.
Ce fut par leur feeours qu’il fe rendit maître- du
royaume de Syphax, 6c qu’après la bataille de Sama,
il difta des conditions humiliantes aux Carthaginois
qu’il obligea de lui payer cinq mille talens. Après
une autre vi&oire qu’il remporta fur eu x, il fit paf-
fer fous le joug leurs foldats, & les força de rappeller
leurs bannis qui s’étoient réfugiés dans fes états. Il
étoit âgé de quatre-vingt-dix ans, lorfqu’il termina
cette guerre. Avant de^ourirjil donna fon anneau à
l’aîné des cinquante-quatre fils quiluifurvécurent,&
dont il n’y avoit que trois nés d’un mariage légitime.
Le commencement de fa vie ne fut qu’un tiflu d’in-
fbrtunes ; mais fur la fin de fon régné, chaque jour
fut marqué par dés profpérités. Son royaume s’éten-
doit depuis la Mauritanie jufqu’aux bornes occidentales
de la Cyrénaïque. La guerre dont il fut occupé,
ns l’empêcha point de civilifer fes peuples
dont il fut le conquérant 6c le légiflateur. Il étoit d’un
tempérament robufte , & il conferva fa vigueur juf-
qu’à une extrême vieilleffe, puilqu’étant mort à
quatre-vingt-dix ans , il laifla un fils qui n’en avoit
que quatre. Il fut redevable de cette lanté inaltérable
à fa frugalité, & à l’habitude des fatigues. Il
reftoit à cheval pendant plufieurs jours 6c plufieurs
nuits de fuite. Le lendemain d’une viûoire remportée
fur les Carthaginois , on le trouva dans fa tente
mangeant un morceau de pain bis. ( T— jv.)
MASSOURE, Maflora, ( Géogr. ) petite ville d’Egypte
près de Damiette , tameufe par le fanglant
combat qui s’y livra entre l’armée de S. Louis &
celle des Sarrafins en 1249. Robert, comte d’Artois,
frere du roi ; homme avide de gloire 6c d’un
naturel bouillant, y fut tué 6c fut caufe de la perte
de la bataille. Le roi y fut fait prifonnier 6c Damiette
enlevé.
Eudes , duc de Bourgogne, fut pris ; le lire de
Brandon, gentilhomme Bourguignon , fut tué fous
lés yeux de fon prince. Tout le monde connoît la
réponfe d’un vieux chevalier à la reine, femme de
S. Louis, qui vouloit qu’on lui ôtât la v ie, fi les Sar-
ftifins fe rendoient maîtres de Damiette. Le grand
amiral des galeres,le fire de Joinville, n’héfitentpas
I ^convenir aux1ennemis qu’ils n’ont pas l’honneur
| 1 d’être coufins du ro i, quoique la confervation dé
leurs jours femblât être attachée à dèguifer la vérité.
Geoffroi de Sargines dit qu’il aiméroit mieux
que les Sarrafins les euffent tous tués 6c pris, qu’il
. leur fût reproché d’avoir Iaiffé le roi en gage (C }
MASSYLIENS, f. m. pl. ( Géogr. anc.f Les Numides
qui occupoiént une grande étendue de côteÿ
en Afrique fur la Méditerranée, fe diyifoient en
deux nations nombreufes, les MaJJyli 6c les Maf-
Jklici.
Ceux-là confinoient au domaine de. Carthage »
ceux-ci à la Mauritanie., Au tems de la deuxieme
guerre punique , les; premiers avoient pour roi
Maffiniffa, fi conftamment uni aux Romains; & les
autres, Syphax qui fut dépouillé de fon royaume.,
à caufe de fon attachement aux Carthaginois. Les
Romains en gratifièrent Maffinifla qui remit ainfi
toute la nation Numide fous fa puiffance. La Nu raidie
répond en grande partie au royaume d’Alger.
Géogr. de P'irg. p. ,74. (C.)
MASTIC , Majlic pour du verre enflé. Prenez de
la fleur de chaux , broyée avec du blanc d’oeuf. '
Le lait de figuier eft très-excellent pouf le même
effet, 6c il peut rendre la pâte plus fine 6c plus
coulante.
Je crois que du fuc d’ail y pourroit auffi être mêlé
&c qu’il rendroit la pâte plus fine, plus coulante
& plus forte.
Un majlic de limaille d’acier, de vinaigre, de
vÇrre pilé 6c de fe l, fait une concrétion ^out-à-
fait indiffoluble à l’eau. Perr. Ejjais de Phyf. t. ƒ A'".
P• 340. {Article tiré dçs papiers de M. DE Ma i R AN.')
§ MASTICATION, ( Anatomie.) C’eft la mâchoire
inférieure feule, qui eft mobile dans le plus
grand nombre d’animaux. Il eft vrai, que dans les
lézards la mâchoire fupérieure n’étant guère plus
pefante, ni plus greffe que l’inférieure, s’élève &
eft tirée en arriéré avec la tête entière, quand l’animal
ouvre la gueule. Dans plufieurs oifeaux,& dans
lesférpens, la mâchoire fupérieure eft une piece
détachée du crâne ; elle eft mobile comme l’inférieure..
Dans l’homme elle ,eft inféparable.du crâne ,
qui a dû être immobile pour aflùrer l’intégrité du
cerveau. Dans l’homme même cependant la tête
entière peut être tirée en-arriere 6c en-deflus,
quand la mâchoire inférieure eft bien affermie ; elle
l’eft même fans cette condition & elle parcourt en-
arriere l’efpace de fix lignes au moins, en pefant &
fe mouvant fur les condyles de la mâchoire inférieure.
Je n’entreprends pas ici de décrire cette mâchoire
fupérieure, dont la ftru&ure eft extrêmement compliquée;
mais l’articulation fur laquelle la mâchoire
inférieure exécute fes mouvemens, entre effentiel»
lement dans mon plan.
L’os des tempes a une éminence à la racine du
zÿgoma , qui regarde en arriéré, & qui eft prefque
tranfverfale. Cette éminence a fur fon bord une
facette articulaire incruftée d’ùn cartilage, dont
les extrémités font élevées & placées l’une en dedans
& l’autre en dehors, &c dont la partie moyenne ,
mais un peu antérieure, eft enfoncée : dans l’adulte
elle regarde en arriéré , &c par fa partie inférieure
un peu en deffous : dans le foetus elle eft horizontale,
Derrière cette facette il y a une foffe confidé-
rable, dont l’extrémité poftérieure fe termine à une
éminence, qui borne l’extrémité antérieure du con*
duit auditoire. Cette foffette eft abfolumenf fans
cartilage,& fa plus petite partie eft feule renfermée
dans la capfule de l’articulation.
Le condyle de la mâchoire inférieure ne touché
pas la facette articulaire. Il y a entre lui 6c cette
facette unménifque excavé des deux.côtés, oyale,
M A S MAS 8 6 ï
alongé, d’une nature moyenhè entre le ligament
6c le cartilage ; fa face appliquée au condile de la
mâchoire eft également creufée, & le bord s’élève :
du côté de l’os des tempes le bord eft plus relevé
en forme de cylindre ; les deux côtés font épais, la
partie moyenne eft plus mince & prefque tranfpa-
rente, on l’a même vu .ufée. 6c percée à jour. Cette
cavité , ne répond qu’à la facette eartilagineufe de
l’éminence articulaire.
Les*bords-relevés du ménifque portent & devant
l’éminertce de l’os des tempes 6c derrière elle.
Quand la mâchoire inférieure a été tirée en arriéré,
6c que les dents inférieures font avancées derrière
les fupérieures, alors le bord élevé du ménifque
s’applique à la foffe temporale. Mais la mâchoire
inférieure abandonnée à elle-même reprend fa place
& va toucher l’éminence. C ’eft pour cela , que la
partie antérieure du condyle a feule une croûte car-
tilagineufe, qui manque à .la partie poftérieure.
Le ménifque eft fortement adhérent à la capfule
de l’articulation, & des fibres du ptérygoïdien extérieur
s’attachent à fa partie latérale' antérieure. Le
ménifque eft plus libre du côté de l’os des tempes.
La defeription que j’ai donnée de l’articulation de
la mâchoire inférieure, répond à celle que M. Rau
én a donnée. Je n’ignore pas que de grànds ana-
tomiftes donnent davantage à la foffe temporale,
6c y mettent le fiege de l’articulation des deux mâchoires.
Mais j’ai parlé d’après la nature même, en
laiffant les parties dans leur place naturelle.
Je ne dois pas féparer de l’articulation les liga-
mens qui l’affurent 6c la bornent. Outre la capfule,
il y a le ligament latéral attaché à l’os des tempes,
au-deffous & plus poftérieurement que l’articulation
de la mâchoire entre l’angle 6c le condyle au-
. deffus du mufcle ptérygoïdien externe.
Une glande mucilagineufe eft placée dans une
foffette de l’os temporal.; d’autres grains muqueux
plus petits font difperfés dans le contour du ménifque.
Cette mucofîté eft néceffaire pour diminuer
le frottement, que j’ai vu malgré ce feeours détruire
la croûte eartilagineufe de l’os des tempes,
que je trouvois dans la cavité, toute féparée 6c
diviféè en grenaille.
La mâchoire inférieure dont je viens de décrire
l’articulation, eft formée par deux os femblables,
liés enfemble par des membranes, mais qui fe fou-
dent dans l’adulte 6c ne font plus qu’un os.
Sa figure eft en général parabolique ; la pointe de
la courbe eft antérieure, les deux lignes s’écartent
6c s’appliquent à la mâchoire fupérieure.
Sa face poftérieure eft creufée & liffe : elle a fous
les dents une éminence affez longue prefque parallè
le , 6c au-deffous de cette éminence un enfoncement
liffe, que partage à la fÿmphyfe une éminence
inégale.
Derrierè les avéoles des dents la mâchoire fe
couvre , s’élève en arriéré, & finit par deux apo-
phyfes.
L’antérieure paffe derrière l’apophyfe zygomatique:
elle eft plane 6c fe termine par une convexité
, qu’on appelle coronoïde * fous laquelle la mâchoire
a une échancrure qui conduit à l’autre apo-
phyfe. ' _
Celle-ci qui eft poftérieure, & qu’on appelle
condyloïde, eft plus dure 6c plus folide ; elle devient
plus épaiffe en montant & fe termine par une tête
articulaire large, qui finit par deux petites éminences
, de maniéré que fon extrémité extérieure eft
un peu antérieure , 6c fon extrémité intérieure un
peu pofterieure. Cette tête eft couverte d’une croûte
eartilagineufe convexe , qui s’applanit en arriéré.
Toute )a mâchoire a une croûte offeufe extérieure
6c une cellulofité intérieure en forme de
diploé. Une grande partie de la mâchoirè renferme
d’ailleurs un canal, dont l’ouverture placée fous la
féparation des deux apophyfes, eft large & déchi-
r®e ? e^e s ouvré dans la face interne de la mâchoire
,& une ligne remarquable en defeend vers
la partie antérieure de Cet os.
Le mouvement de la mâchoire eft ou droit bu
latéral. Elle defeend, & la bouche s’ouvre j ou par
le mouvement des condyles ou même fans ce mouvement.
Elle peut defeendre pendant que les côn-
dyles repofent; la pointe de la parabole defeend
feule alors. Les condyles peuvent auffi concourir
pour faire un plus grand mouvement; ils font portes
alors en avant, 6c le ménifque avance un peu
au-delà de la facette articulaire, 6c plus en devant,
La mâchoire peut encore être portée en avant
fans defeendre : elle peùt/fe luxer, quand ce mouvement
eft trop grand, 6c elle tombe alors fous
l’éminence tranfverfale & plus en devant. Elle peut
être tirée en arriéré , mais ce mouvement eft plus .
petit: elle refte toujours appliquée à la partie poftérieure
de l’éminence tranfverfale, & defeend prefque
perpendiculairement.' Ce mouvement peut êtrë
plus grand , & le ménifque appuie alors par fon
bord élevé poftérieur fur la foffe temporale même;
Le mouvement latéral s’exécute de différentes
maniérés. La mâchoire eft abaiffée,ün condyle refte
à fa place, 6c l’autre eft tiré au*devant de l’éminencé
tranfverfale vers l’endroit auquel on veut qu^ellé
fe porte. Tous les deux condyles peuvent conéôua
rir à ce mouvement, 6c l*ùn d’eux peut être tiré
en devant 6c à côté , 6c l’autre en arriéré. Les deux:
condyles. peuvent être tirés en avant, 6c lé refte dé
la mâchoire en arriéré.
J’ai déjà fait mention du mouvement de la tété
en arriéré, mouvement qui concourt à l’oüverturè
de la bouche.
Les inftrumens du mouvement de la mâchoiré
font fes mufcles releveufs, les abaiffeurs , 6c les
rotateurs*
Des releveurs le plus grand eft le temporal l
moins épais 6c moins étendu dans l’homme que
dans aucun quadrupède , le volume du cerveau
n’ayant pas permis què les côtés du crâne fuffent
applatis, 6c fa cavité rétrécie par ces mufcles;
L’origine du temporal eft en demi-cercle, il s’afc
tache depuis l’extrémité extérieure de l’orbite à lâ
partie latérale de l’os frontal, au pariétal par un arc
très-confidérable, au-deffous de cet arc à l’os des
tempes , à celui du front, au fphénoïde, à l’os de là
pomette 6c à l’apophyfe zygomatique. La circonférence
de toute cette attache produit une membranë
cellulaire ferrée fans être tendineufe, qui çouvrè
le temporal 6c qui eft attachée à Toà zygomatique
, 6c à l’angle externe de l’ofbite. Cette mem*
brane produit un grand nombre de fibres charnues ;
& fur-tout au-deffus de l’arcade zygomatique; Ces
fibres vont fe joindre aux chairs‘du temporal*
Les fibres charnues de ce mufcle fe réunifient ètt
forme de rayons ; les antérieures fe portent un peu
en arriéré, les poftérieures en devant : elles fors
ment un tendon rayonné comme une étoilé, cou*
vert en arriéré 6c en devant de chairs: ce tendori
paffe fous l’arcade zygomatique, qui eft crèuféé
pour ce paffage : il reçoit fouvent des fibres de cettë
arcade , & va s’attacher à l’apophyfe coronoïde de
la mâchoire inférieure à fon bord antérieur , fort
peu au bord poftérieur 6c à fes faces interne Sè
externe, en partie auffi à l’échancrure fémilunaire*
qui eft entre les deux apophyfes*
Il releve la mâchoire inférieure , quand Oit veut
mordre ; il la retire en même tems un peu en arriefë
& l’éleve plus direélement, quand fon a&ion fe feU»
nit avec celle du maffetei'«