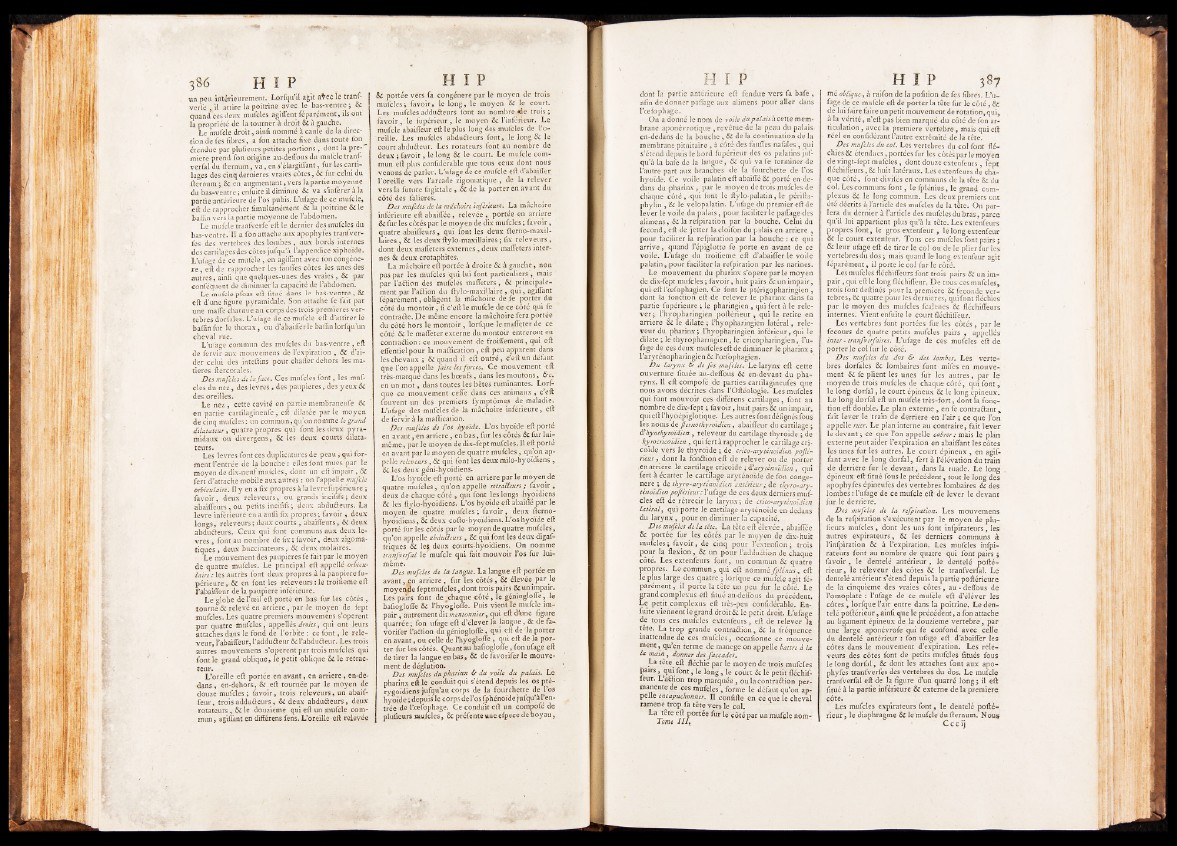
un peu intérieurement. Lorfqu’il agit a^ec le tranf-
verfe , il attire la poitrine avec le bas-ventre ; §c
quand ces deux inufcles agiffent féparpment, ils ont
la propriété de la tourner à droit & à gauche.
Le mufele droit, ainfi nommé à caufe de la direction
de fes fibres, a fon attache fixe dans toute fon^
étendue par plufieurs petites portions , dont la première
prend fon origine au-deffous du mufele tranf-
verfal du fternum, v a , en s’élargiflant, fur les cartilages
des cinqdernieres vraies cotes, & fur celui du
fternum ; 8c en, augmentant, vers la partie moyenne
du bas-ventre ; enfuite il diminue 8c va s inferer à la
partie antérieure de Pos pubis. L ufage de ce mufele, 1
eft de rapprocher fimultanément 8c la poitrine 8c le
baffin vers la partie moyenne de l'abdomen.
Le mufele tranfverfe eft le dernier des mufcles du
bas-ventre. Il a fon attache aux apophyfes tranfver-
fes des vertebres des lombes , aux bords internes
des cartilages des côtes jufqu’à l’appendice xiphoïde.
L’ufage de ce mufele , en agiffant avec fon congéne- .
r e , eft de rapprocher les fauffes côtes les unes des
autres, ainfi que quelques-unes des vraies , 8c par
conféquent de diminuer la capacité de l’abdomen.
Le mufele pfoâs eft fitué dans le bas-ventre, 8c
eft d’une figure pyramidale. Son attache fe fait par
une maffe charnue au corps dès tr.Ois premières vertebres
dorfales. L’ufage de ce mufele eft d’attirer lë
baffin fur le thorax, ou d’abaiffer le baffin lorfqu’un
cheval rue.
L’ufage' commun des mufcles du bas-ventre , eft
de fervir aux mouvemens de l’expiration , & d’aider
celui des inteftins pour chaffer dehors les matières
ftercorales.
Des mufcles de la face. Ces mufcles font, les mufcles
du nez, des levres, des paupières, des yeux 8c
des oreilles.
Le nez , cette cavité en partie membraneufe &
en partie cartilagineufe, eft dilatée par le moyen
de cinq mufcles; un commun, qu’on nomme le grand
dilatateur, quatre propres qui font les deux pyramidaux
o u divergens, 8c les deux courts dilatateurs.
Les levres font ces duplicatures de peau, qui forment
l’entrée de la bouche : elles font mues par le
moyen de dix-neuf mufcles, dont un eft impair, 8c
fert d’attache mobile aux autres : on l’appelle mufele
orbiculaire. Il y en a fix propres à la levre fupérieure ;
favoir deux releveurs, ou grands incififs ; deux
abaiffeurs , ou petits incififs; deux abdufteurs. La
levre inférieure en a auffi fix propres ; favoir *.deux
longs, releveurs ; deux courts , abaiffeurs, 8c deux
abdu&eurs. Ceux qui font communs aux deux levres
, font au nombre de fix ; favoir, deux zigoma-
tiques , deux buccinateurs^i & deux molaires.
Le mouvement des paupières fe fait par le moyen
de quatre mufcles. Le principal eft appellé orbiculaire:
les autrès font deux propres à la paupière fupérieure,
8c en font les releveurs: le troifieme eft
l’abaiffeur de la paupière inférieure.
Le globe de l’oeil eft porté en bas fur les côtés ,
tourné 8c relevé en arriéré, par le moyen de fept
mufcles. Les quatre premiers mouvemens s’opèrent
par quatre mufcles, appellés droits, qui ont leurs
attaches dans le fond de l’orbite : ce font, le rele-
veur, l’abaiffeur, l’addu&eur & l ’abduâ:eur. Les trois
autres mouvemens s’opèrent par trois mufcles qui
font le grand oblique, le petit oblique 8c le retracteur.
L’oreille eft portée en avant, en arriéré, en-dedans
, en-dehors, 8c eft tournée par le moyen de
douze mufcles ; favoir, trois releveurs, un abaif-
feur, trois adduâeurs, & deux abdu&eurs, deux
rotateurs, 8c le douzième qui eft un mufele commun,
agiffant en différens fens. L’oreille eft relevée
8l portée vers fa congénère par le moyen de trois
mufcles; favoir, le long, le moyen 8c le court.
Les mufcles adducteurs font au nombre «le trois ;
favoir, le fupérieur, le moyen 8c l’inférieur. Le
mufele abaiffeur eft le plus long des mufcles de l’oreille.
Les mufcles abdu&eurs font, le long & le
court abduéteur. Les rotateurs font au nombre de
deux ; favoir , le long 8c le court. Le mufele commun
eft plus confidérable que tous ceux dont nous
venons de parler. L’ufage de ce mufele eft d’abaiffer
l’oreille vers l’arcade zigomatique-, de la relever
vers la future fagittale , -8c de la porter en avant du
côté des .falieres. -
Des mufcles de la mâchoire inférieure. La mâchoire
inférieure eft abaiffée, relevée , portée en arriéré
8c fur les côtés par le moyen de dix mufcles ; favoir,
quatre abaiffeurs, qui font les deux fterno-maxil-
laires, 8c les deux ftylo-maxillaires ; fix releveurs ,
dont deux maffeters externes, deux maffeters internes
& deux crotaphitès.
La mâchoire eft portée à droite 8c à gauche, non
pas par les mufcles qui lui font particuliers , mais
■ par l’aftion des mufcles maffeters, 8c principalement
par l’aélion du ftylo-maxillaire, qui, agiffant
féparément, obligent la mâchoire de fe porter du
côté du montoir, fi c’eft le mufele de ce côté qui fe
contrarie. De même encore la mâchoire fera portée
du côté hors le montoir , lorfque le maffçter de ce
côté & le maffeter externe du montoir entreront en
contra&ion : ce mouvement de froiffement, qui eft
effentiel pour la maftication , eft peu apparent dans
les chevaux ; & quand il eft outré, c’eft un défaut
que l’on appelle faire les forces. Ce mouvement eft
très-marqué dans les boeufs, dans les moutons, & ç .
en un mot, dans toutes les bêtes ruminantès. Lori-
que ce mouvement ceffe dans ces animaux, c’eft
fouvent un des premiers fymptômes de maladie.
L’ufage des mufcles de la mâchoire inférieure, eft
de fervir à la maftication.
Des mufcles de Vos -hyoïde. L’os hyoïde eft porté
en avant, en arriéré, en bas, fur les côtés" 8c fur lui-
même , par le moyen de dix-fept mufcles. 11 eft porte
en avant par le moyen de quatre mufcles, qu’on appelle
releveurs , 8c qui font les deux milo-hyoïdiens ,
& les deux géni-hyoïdiens.
L’os hyoïde eft porté en arriéré parle moyen de
quatre mufcles, qu’on appelle retracleurs ; favoir,
deux de chaque côté , qui font les longs hyoïdiens
& les ftylo-hyoïdiens. L’os hyoïde eft ahaiffé par le
moyen de quatre, mufcles ; favoir, deux fterno-
hyoïdiens, & deux cofto-hyoïdiens. L’os hyoïde eft
porté fur les côtés par le moyen de quatre mufcles,
qu’on appelle abducteurs , 8c qui font les deux digaf-
triques 8c les. deux courts-hyoïdiens. On nommé
tranfverfal le mufele qui fait mouvoir l’os fur lui-
même.
Des mufcles de la langue. La langue eft portée en
avant, en arriéré , fur les côtés, 8c élevée par le
moyenne fept mufcles, dont trois pairs 8c un impair.
Les pairs font de ^chaque cô té , le géniogloffe, le
bafiogloffe & l’hyogloffe. Puis vient le mufele impair
,'autrement dit rnentonnier, qui eft d«une figure
quarrée;. fon ufage eft d’élever la langue, & de fa-
vorifer l’a&ion du géniogloffe » qui eft d e’la porter
en avant, ou celle de l’hyogloffe , qui eft de la porter
fur les côtés. Quant au bafiogloffe, fon ufage eft
de tirer la langue en bas, & de favorifer le mouvement
de déglution. , g
Des mufcles du pharinx & du voile du palais. Le
pharinx eft le conduit qui s’étend depuis les os pté-
rygoïdiens jufqu’au corps de la fourchette de l’os
hyoïde ; depuis le corps de l’os fphénoïde jufqu’à l’entrée
de l’oefophage. Ce conduit eft un compofé de
plufieurs ïRufcles, 8c préfente une efpece de'boyau,
dont la partie antérieure eft fendue vers fa bafe ,
afin de donner paffage aux alimens pour aller dans
l’oefophage.
On a donné le nom de voile du palais à cette membrane
aponévrotique , revêtue de la peau du palais -
en-dedàns de la bouche, & de la continuation de la
membrane,pituitaire , à côté des fauffes nafales , qui
s’étend depuis le bord fupérieur des os palatins jufqu’à
la bale de la langue, 8c qui va fe terminer de
l’autre part aux branches de la fourchette de l’os
hyoïde. Ce voile palatin eft abaiffé 8c porté en-de-
daris du pharinx, par le moyen de trois mufcles de
chaque côté, qui font le ftylo-palatin, le périfta-
phylin , 8c le velopalatin. L’ufage du premier eft de
lever le voile du palais, pour faciliter le paffage des
alimens, ,8c la respiration par la bouche. Celui du
fécond, eft de jetter la cloifon du palais en arriéré ,
pour faciliter la refpiration par la bouche : ce qui
arrive, quand l’épiglotte fe porte en avant de ce
voile. L’ufage du troifieme eft d’abaiffer le voile
palatin, pour faciliter la refpiration par les narines.
Le mouvement du pharinx s’opère parle moyen
de dix-fept mufcles ; favoir, huit pairs 8c un impair,
qui eft l’oefophagien. Ce font le ptérigopharingien ,
dont la fonction eft de relever le pharinx dans fa
partie fupérieure ; le pharingien , qui fert à le relev
e r ; l’hyopharingien poftérieur , qui le retire en
arriéré 8c lé dilate ; l’hyopharingien latéral, rele-
veur du pharinx; l’hyopharingien inférieur, qui le
dilate ; le thyropharingien, le cricopharingien, l’u-
fage de ces deux mufcleseft de diminuer le pharinx ;
l ’aryténopharingien 8c l’oefophagien.
Du larynx & de fes niufcles. Le larynx eft cette
ouverture fituée au-deffous & en-devant du pharynx.
11 eft compofé de parties cartilagineufes que
nous avons décrites dans l’Oftéologie. Les mufcles
qui font mouvoir ces différens cartilages, font au
nombre de dix-fept ; favoir, huit pairs 8c un impair^
quieftl’hyoépiglotique. Les autres fontdéfignésfous
les noms de Jternothyroïdien, -abaiffeur du cartilage ;
8? hyo thyroïdien , releveur du cartilage thyroïde ; de
hyrocricoïdien, qui fert à rapprocher le cartilage crj-
coïde vers le thyroïde ; de crico-aryténoïdien pofié-
rieur, dont la fonétion eft de relever ou de porter
.en arriéré le cartilage cricoïde ; d'aryténoïdien, qui
fert à écarter le cartilage aryténoïde de fon conge^-
nere ; de thyro-aryténoïdien antérieur; de thyro-aryténoïdien
poftérieur: l ’ufage de ces deux derniers mufcles
eft de rétrécir le larynx; de crico-aryténoïdien
latéral, qui porte le cartilage aryténoïde en-dedans
du larynx , pour en diminuer la capacité.
Des mufcles de là tête. La tête eft élevée, abaiffée
& portée fur les côtes par le moyen de dix-huit
mufcles ; favoir, de cinq pour rextenfion ; trois
pour la flexion, & un pour l’addu&ion de chaque
côté. Les,extenfeurs font, un commun 8c quatre
propres. Le commun, qui eft nommé fplénus, eft
le plus large des quatre ; lorfque ce mufele agit féparément
, il porte la tête un peu fur le côté. Le
grand cômplexus eft fitué au-deffous du précédent.
Le petit_complexus eft très-peu confidérable. En-
fuite viennent le grand droit &: le petit droit. L’ufage
de tous ces mufcles extenfeurs, eft de relever la
tête. La trop grande contraction, & la fréquence
inattendue de ces mufcles ,. occafionne ce m°uve-
ment, qu’en terme de manege on appelle battre à la
la màin, donner des faccades.
La tête eft fléchie par le moyen de trois mufcles
pairs, qui font, le long, le court & lë petit flechif-
leur. L ââion trop marquée, ou la contraction permanente
de ces mufcles, forme le défaut qu’on appelle
encapuchonnée. Il confifte en ce que le cheval
ramene trop fa tête vers le col.
La têre eft portée fur le côté par un mufele nom-
Tçme III,
mé oblique, à raifon de la pofition de fes fibres. L’ufage
de ce mufele eft de porter la tête fur le côté, 8c
de lui faire faire un petit mouvement de rotation, qui,
à la vérité, n’eft pas bien marqué du côté de fon articulation
, avec la première vertebre, mais qui eft
réel en confidérant l’autre extrémité de la tête.
Des mufcles du col. Les vertebres du col font fléchies
& étendues, portées fur les côtés par le moyen
devingt-fept mufcles , dont douze extenfeurs , fept
fléchiffeurs, & huit latéraux. Les extenfeurs de chaque
côté, font divifés en communs de la tête 8c du
col. Les communs fon t, le fplénius, le grand com-
plexus & le long commun. Les deux premiers ont
été décrits à l’article des mufcles de la tête. On parlera
du dernier à l’article des mufcles du bras, parce
qu’il lui appartient plus qu’à la tête. Les. extenfeurs
propres font, le gros extenfeur , le long extenfeur
& le court extenfeur. Tous ces mufcles font pairs ;
& leur'ufage eft de tirer le col ou de le plier fur les
yertebres du dos ; mais quand le long extenfeur agit
féparément, il porte le col fur le côté.
Les mufcles fléchiffeurs font trois pairs & un impair
, qui eft le long fléchiffeur. De tous ces mufcles,
trois font deftinés pour la première 8c fécondé vertebres,
8c quatre pour les dernieres, quifont fléchies
par le moyen des mufcles feajenes & fléchiffeurs
internes. Vient enfuite le court fléchiffeur.
Les vertebres font, portées fur les côtés, par le
fecoilirs de quatre petits mufcles pairs , appellés
inter-tranfverfaires. L’ufage de ces mufcles eft de
porter le col fur le côté.
Des mufcles du dos & des lombes. Les vertebres
dorfales 8c lombaires font mifes en mouvement
& fe plient les unes fur les autres, par le
moyen de trois mufcles de chaque côté, qui font,
le long dorfal, le court épineux 8c le long épineux.
Le long dorfal eft un mufele très-fort, dont la fonction
eft double. Le plan externe , en fe contractant %
fait lever le train de derrière -en l ’air ; ce que l’on
appelle ruer. Le plan interne au contraire, fait lever
le devant ; cè que l’on appellé cabrer : mais le plan
externe peut aider l’expiration en abaiffant les côtes
les unes fur les autres. Le court épineux , en agiffant
avec le long dorfal, fert à l’élévation du train
de derrière fur le devant, dans la ruade. Le long
épineux eft fitué fous le précédent, tout le long des
apophyfes épineufes des vertebres lombaires 8c des
lombes : l’ufage de ce mufele eft de lever le devant
fur le derrière.
Des mufcles de la refpiration. Les mouvemens
de la refpiration s’exécutent par le moyen de plu-
fieurs mufcles, dont les uns font infpirateurs, les
autres expirateurs, & les derniers communs à
l’infpiration 8c à l’expiration. Les mufcles infpirateurs
font au nombre de quatre qui font pairs ;
fa voir, le dentelé antérieur , le dentelé poftérieur,
le releveur des côtes & le tranfverfal. Le
dentelé antérieur s’étend depuis la partie poftérieure
de la cinquième des vraies côtes, au - deffous de
l’omoplate : l’ufage de ce mufele eft d’éléver les
côtes, lorfque l’air entre dans la poitrine. Le dentelé
poftérieur, ainfi que le précédent, a fon attache
au ligament épineux de la douzième vertebre, par
une large aponévrofe qui fe confond avec celle
du dentelé antérieur : fon ufage eft d’abaiffer les
côtes dans le mouvement d’expiration. Les releveurs
des côtes font de petits mufcles fitués fous
le long dorfal, & dont les attaehes font aux apophyfes
tranfverfes des vertebres du dos. Le mufele
tranfverfal eft de la figure d’un quarré long ; il eft
fitué à la partie inférieure & externe de la première
côte.
Les mufcles expirateurs font, le dentelé poftérieur
, le diaphragme 8c le mufcle du fternum. Nous
C c c i j